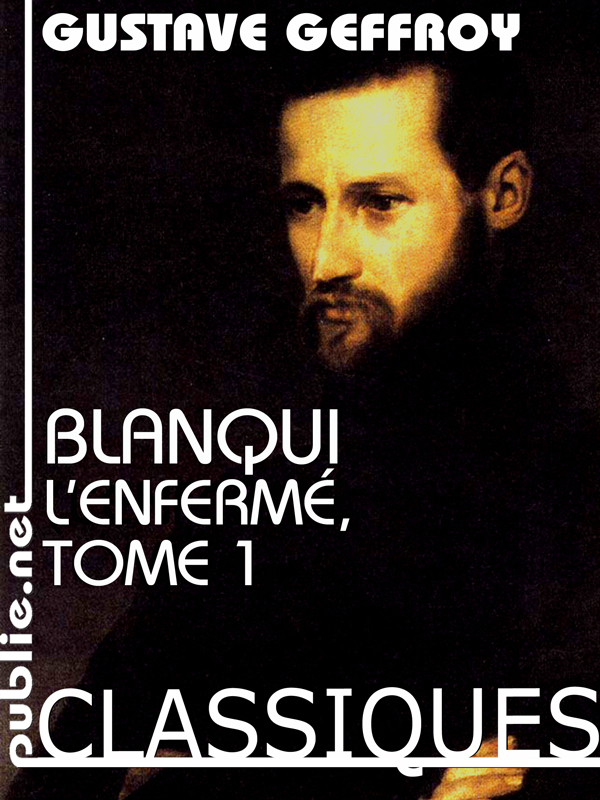
reprise sur publie.net d’un livre essentiel pour Walter Benjamin : L’Enfermé, biographie de Blanqui par Gustave Geffroy
Mais il est de ce siècle de géants, en pleine conscience de ce que leur a offert leur siècle. On ne raccourcit pas sa phrase sous prétexte qu’on n’est pas en littérature.
Blanqui est une immense figure. Mais une figure toujours à l’index : le grand projet d’oeuvres complètes initié par Maurice Dommanget est toujours à l’arrêt.
Blanqui : né d’une révolution, acteur de 2 autres, en 1830 et 1848, et toute sa vie enfermé, déporté.
Ce qu’entreprend Geffroy, c’est de rendre hommage à Blanqui en le resituant dans cette traversée du siècle. Les ombres de Hugo, Balzac et Baudelaire ne sont pas loin. Mais Geffroy, quand il entreprend la rédaction de L’Enfermé, a encore accès aux témoins directs de l’émeute de 48 ou de l’évasion de Belle-Île.
C’est ce qui fait de ce livre un monument incontournable. Walter Benjamin ne s’y est pas trompé. Jamais réédité depuis 1931, en voici ce soir la première version numérique.
Et ci-dessous un extrait (la première moitié) du chapitre sur l’enfermement de Blanqui, avec Barbès et d’autres, au Mont Saint-Michel.
Et encore des routes qui s’ouvrent pour publie.net, continuer avec Blanqui (Insurrection pour une prise d’armes, L’éternité par les astres), mais continuer aussi avec Gustave Geffroy (son Méryon et son Monet).
Mais il y a longtemps, bien longtemps, que je souhaitais – pour moi – une version numérisée de L’Enfermé. Deuxième tome dès lundi si tout va bien.
I
Le 6 février 1840, le char à bancs escorté de gendarmerie part de la prison d’Avranches, emporte vers le Mont-Saint-Michel la troupe dernière des insurgés de mai : Auguste Blanqui, Charles Herbulet, Godard, Quignot, Hendrick, Dubour-dieu. Le cortège parcourt, au bruit des roues, des fers des chevaux, des sabres heurtant les étriers, les pentes des routes qui suivent la Sée, descendent vers le Gué de l’Epine. Près Courtils. à la pointe de Rochtorin pointant droit sur le Mont qui grandit, se vaporise, se dissout dans la brume d’hiver, la voiture entre dans la tangue. Tout est blanc, mou, ouaté, silencieux. On n’entend plus le bruit des roues qui tournent dans le sol friable, le bruit du pas des chevaux qui enfoncent leurs sabots dans la poussière humide et glaiseuse. Seul le cliquetis clair des sabres tinte dans l’air avec un son de frêles clochettes.
La brume est moins épaisse, les voiles se décroisent lentement, le haut monument, les longs promontoires des côtes se précisent, vaguement bleutés et dorés, l’horizon est plus profond, le paysage s’agrandit, mais reste mystérieux et inquiétant. Qu’est-ce que cette grève tremblante, cette grève mouillée, sans fin, cette grève qui semble un piège, le trompe-l’œil d’un sous-sol de boue sans cesse ébranlé et détrempé par la mer ? Qu’est-ce que cette prison isolée, perdue entre cette tangue blanche et ce ciel blanc dans cette atmosphère de rêve polaire ? On la voit mieux, maintenant, elle s’avance, elle vient au-devant des prisonniers, elle leur montre un dur visage de pierre, couleur de fer et de rouille, un visage ridé, cicatrisé, aveugle, amer, qui ne sourit plus, qui ne pleure plus, un visage de vieillesse insensible.
II
Une ceinture de remparts fortement bouclée retient les maisons d’une rue, des jardinets étages, tout le minuscule village sur plan incliné, prêt à tomber, tout pauvre, tout humble, cramponné au roc rébarbatif, écrasé sous l’ombre froide de l’abbaye. C’est l’église et la forteresse, le château et le monastère, tout le féodal et le religieux anciens jaillissant du roc en fortes assises, en épaisses murailles, en sveltes et mystiques fleurissements. À mesure que l’on approche, peut-être la hautaine figure de pierre va-t-elle manifester aux yeux qui savent voir une douleur contenue, un effort d’élancement et de prière. L’idéale maçonnerie voudrait fuser, s’envoler toujours plus haut, quitter la grève boueuse, le roc aride, se perdre dans l’incertain des nuées. Mais Blanqui ne peut admettre du monument que son premier aspect, sa façade de cachot, sa construction redoutable. Sorti de voiture, emmené par l’escalier de l’unique rue montante, tout petit, tout grêle, au long des massifs remparts, c’est à peine s’il a pu voir, en se haussant, la grève monotone, coupée par un filet d’eau qui serpente et qui est bientôt bu par la tangue, la grève crevée en deux endroits par ces deux rocs farouches, abrupts, ici le Mont-Saint-Michel, et là-bas, au nord, Tombelaine, Tombelaine inhabité, une ruine cachant à peine un fragment du roc envahi par la mousse et la christe-marine. Tout cela, rapide, apparu comme une vision dans une lueur d’éclair, le prisonnier vite arrivé à la tour Claudine, à la porte du Châtelet, ouverte comme une mâchoire, à forte denture de herse. Il n’a pu que mesurer la hauteur de l’abbaye en raccourci, que sonder la force des murs, et son individu marchant vers la prison, peu soucieux d’architecture, n’a retrouvé dans le rapide coup d’œil de colère froide et de ferme dédain dont il a enveloppé cette bastille, que son ancienne haine du gothique et du romantisme.
III
Il est seul, maintenant, dans l’étroite chambre des bâtiments du Grand-Exil, après les cérémonies administratives de l’écrou et de la guicheterie. Il a gravi des escaliers larges, froids, a passé sous des voûtes, s’est retrouvé en plein air, sur des plates-formes où grimacent des gargouilles. Le directeur l’a reçu, lui a montré un visage poli, des yeux doucereux, un ventre satisfait, lui a fait entendre une voix amène. On a griffonné des lignes dans les casiers d’un registre, on a tournoyé dans un escalier, ouvert une porte. C’est là, dans cette pièce irrégulière de dix mètres carrés, entre cette cheminée condamnée, remplacée par un poêle sur une plaque de fonte, et cette étroite fenêtre grillagée qui prend un aspect de meurtrière par l’épaisseur du mur, c’est là qu’il faut s’asseoir pour la détention perpétuelle. Le verrou glisse dans l’anneau, fait entendre son bruit définitif.
IV
Un jour, un autre jour, tous les jours, une semaine, des semaines, – des années ! L’existence qui s’écoule, l’activité de l’homme immobilisée, fixée en une minute qui est toujours la même, qui ignore la distraction, le changement, la perplexité de l’avenir, le frisson de l’inattendu. La destinée de l’isolé a été réglée d’avance par les magistrats en robes rouges, fourrés d’hermine ; ils ont décidé quel espace il occuperait, à quelles heures diurnes il prendrait ses repas, à quelles heures nocturnes les rondes des guichetiers couperaient son sommeil, quelle profondeur de l’horizon pourrait fouiller son regard. Un calendrier invisible et inflexible a réglé pour lui le cours du temps, l’inoccupation des heures, l’ennui des jours. Le pendule muet, que le prisonnier est seul à entendre, bat pour lui inexorablement le Toujours et le Jamais d’une éternité monotone.
L’homme se sent bien enfermé dans le colossal et dur monument qu’il a entrevu à l’arrivée, au-dessus de la rue tortueuse et des remparts en zigzag. Au milieu de ces terrains dangereux, de cette baie boueuse, tremblante, presque inaccessible, dont le sol est prêt à se fendre, à s’effondrer sous les pas, la prison elle-même est en prison, la forteresse est sous la garde de la dure geôlière qu’est ici la nature.
Gravissant les escaliers, traversant les vestibules et les cours, longeant les galeries extérieures, Blanqui, de son regard épieur, a vite compris le mystère de la construction, l’effort de l’homme pour utiliser la matière, et la forme de la pyramide rocheuse. Depuis la base jusqu’au sommet, c’est le roc. La pierre taillée a été partout ajoutée à la pierre brute. Dans chaque creux, sur chaque saillie, on a scellé un moellon, élevé une muraille. On a étayé le granit par des contreforts robustes, on l’a ajouré en dentelle, fleuri de sculptures, aiguisé en flèche. C’est sur le rocher que reposent les piliers romans, les colonnes gothiques. Parfois, à cent mètres au-dessus de la mer, au milieu d’une salle, le rocher pointe entre deux dalles, comme si son arête tranchante avait crevé le granit sous lequel on voulait le murer. Il y a une bataille entre la dure montagne et les pierres que l’on a dressées sur elle. En montant, en descendant les escaliers rongés, en parcourant les salles sonores, les cryptes obscures, les couloirs au fond desquels s’ouvrent des trous pleins d’ombre qui sont des cachots, les promenoirs aux larges dalles, en passant sous les voûtes romanes, sous les arcs ogivaux, sous les fines arcades brisées du cloître, le prisonnier, l’esprit troublé par les élancements et les fuites vertigineuses des lignes, a des sensations hallucinantes de vertige, d’inclinaison, de mouvement.
C’est que le temps a ridé et crevassé les pierres, que le vent de la mer a été l’auxiliaire du roc contre la construction humaine, et s’est acharné sur le monument, jetant à bas un pan de mur, démantelant une tour, cassant une flèche, brisant un vitrail. Et sont venus ensuite les hommes, des bénédictins qui ont fait pis que détruire, qui ont réparé, qui ont ajouté, qui ont donné des béquilles à ce corps splendide, qui l’ont creusé de plaies, l’ont bossue de verrues, ont bâti la façade de l’église en style jésuite. Aujourd’hui, c’est l’administration de la prison, pour loger les condamnés, qui fait couper en deux les immenses galeries, briser les nervures pour établir des plafonds, élargir les étroites fenêtres pour donner aux prisonniers un air encore insuffisant et un filet de lumière toujours ironique.
VI
La cellule de Blanqui est au sud-sud-est. Il voit de sa fenêtre le cimetière du Mont, et la tour de la Liberté, tour basse dentelée de créneaux. À sa droite, la rivière du Couesnon, qui est la ligne de partage de la Normandie et de la Bretagne. Il a devant lui les collines d’Ardevon et de Huines il peut apercevoir la pointe de Rochtorin, le commencement du pays d’Avranches. Mais toute cette terre est bien vague et bien lointaine, dans l’humidité, dans la brume presque continuelle de l’air. Il est en face des grèves silencieuses, de l’étendue triste. L’agitation de l’existence ne lui apparaît plus que comme le grouillement confus d’un rêve.
C’est ici le triomphe de la mélancolie des paysages. Toutes les lignes sont simples et semblent indéfinies, tous les horizons fuient et s’effacent. Partout le gris. L’immense plaine de tangue en rassemble toutes les nuances. C’est jaunâtre, crémeux, cendré. Les rivières qui sont bues par la baie, le Couesnon, la Sélune, la Sée, la Guintre, courent en minces lacets argentés. À peine un bateau, une rangée de balises, la silhouette d’un coquetier, une carriole dont le cheval bourre péniblement la tangue, servent-ils de points de repère pour mesurer l’espace.
VII
La vie est concentrée derrière les remparts du Mont, dans l’unique rue, la Grand’rue, large comme un couloir, que les maisons semblent gravir, se hissant, se soutenant, se cognant, dressant leurs toits pointus, coiffés de travers. Les cent habitants descendent et montent cette échelle de pavés, tout entiers à la pêche, à la petite culture de leurs jardinets accrochés au rocher, au transport des denrées, de l’eau qu’il faut parfois aller chercher à six kilomètres.
Le prisonnier n’a sous les yeux que le spectacle de cette existence toujours semblable. Auprès de la contemplation si longuement fixée à la lucarne, les mains empoignant à plein les barreaux, auprès des marches de fauve toujours recommencées de long en large par la cellule, dans les coins, vers les murs, vers la porte, les pieds heurtant cette porte, les mains tâtant ces murs, le regard levé, s’inquiétant des hauteurs, auprès de ce perpétuel piétinement de solitude, la vue de ce dehors si muet et si peu remuant apparaît pourtant une humanité en mouvement et en liberté. Comme il est actif, ce vieux qui bêche et qui pioche dans la terre et dans la pierre, qui pique des salades et qui empote des fleurs ! Comme il est libre, ce pêcheur qui s’en va, nu-jambes, vers Genêts, suivant la ligne de la marée descendante !
VIII
Et même ce guichetier, qui sort, par moments, ses heures de service finies, qui descend si vite l’escalier des remparts, s’arrête à l’auberge, et boit sur le seuil en jetant encore un regard de surveillance sur la prison dont il est le chien de garde, ce guichetier, tout enfermé qu’il est, de jour et de nuit, avec ceux qu’il verrouille dans leurs cellules et qu’il surveille par les grillages des judas, il est libre aussi. Il peut sortir, marcher sur la ferre, entrer nu-pieds dans l’eau, respirer l’air du dehors qui a un goût si différent de l’air filtré aux barreaux de fer. Plus que tout autre, en y réfléchissant, il représente la liberté perdue. Ce qui ouvre les portes et ce qui donne l’espace, la clef bruyante, qui parle dans les serrures un langage si bref et si impérieux, cette clef, il l’a dans sa poche, et quand il sort, et que des yeux de reclus suivent son pas rude et insouciant, c’est l’image de leur servitude que les prisonniers voient apparaître au dehors, allègre et désœuvrée, musardant aux ruelles et bayant à l’air.
IX
Que cette muraille est dure ! Que cette matière de granit est pesante ! Deux pauvres poings de chair, malgré la force nerveuse qui les anime, le fluide de volonté qui passe en eux, ne peuvent rien contre ce gros grain serré de la pierre, contre cette épaisseur de roc humide transformée en cloison. Des journées passées à contempler cette paroi contre laquelle il faut vivre, s’appuyant le front, s’usant les ongles, ces journées finissent en rêverie sur l’inconnaissable mystère des choses. Le mur est façonné en infinies parcelles, en aspérités irrégulières, en cristaux durs ayant chacun sa forme, sa couleur, sa durée, sa vie. Il en est de pointus, de sphériques, d’elliptiques, il en est en cubes, en pyramides, en cônes, en dodécaèdres. Certains sont gris de fer, gris d’argent, teintés de vieil or, parcourus de vives veinules presque imperceptibles et qui sont des sillons cuivrés ou de plomb en fusion. Mais le plus grand nombre est bleu et rose, du bleu fin et transparent du ciel et de l’eau, du rose doux et mourant des tièdes crépuscules. Il y a des yeux aussi, qui ont dans leurs prunelles des gouttes de ce bleu de saphir apaisé, et il y a des lèvres où se fane ce rose. À regarder longtemps cette muraille, jusqu’à perdre la notion de l’entour, à ne fixer qu’une étroite surface dont les nuances bientôt se brouillent, toute cette couleur de ciel et d’eau, de soleil disparu, de regard lointain et de bouche pâle, toute cette couleur devient éparse, et mêle ses nuances comme en un champ de fleurs. Sur un fond qui est un fond de terre grise et dorée, s’avivent légèrement des roses alanguies, des roses où se dissout une parcelle de soufre, de chair, de sang, des bleuets vus comme à travers un voile de pluie, et des étendues, des étendues de bruyères lilas et violettes, humbles et tristes, qui s’égrènent et se fanent dans la lenteur du soir qui tombe.
X
Ces douceurs, ces finesses, ces minuscules cellules séparées, forment ce solide agrégat, cet obstacle qui ne pourrait céder qu’à la violence d’un effort, qu’à l’acharnée morsure d’un outil. L’attraction a réuni ces fragments et les tient formidablement soudés, cette poussière séculaire a été un rocher résistant à la mer, et dans ce rocher on a taillé les pierres rectangulaires et massives d’une prison. Puis l’ironie s’est ajoutée à l’inexorable. La cage granitique est ornée de main d’artiste. Les lignes sont combinées pour donner un aspect de grâce élancée à la densité de ce bloc, des détails ont été cherchés au bout d’un ciseau de statuaire pour affiner cette brutalité. C’est un jaillissement de fleur, un ajouré de dentelle. Le prisonnier gît dans le treillis délicieux de cette architecture, comme un squelette jauni de martyr dans la frêle et fine ciselure d’un reliquaire.
XI
Si les murs rébarbatifs s’épanouisssent en floraisons ironiques, les visages des hommes recèlent, sous l’hypocrisie de leur politesse administrative, de froides âmes peu pitoyables. Le directeur Theurrier, de la grosse bourgeoisie orléaniste, allié des Montalivet, gras, discret, mielleux, s’exprimant avec modération, prenant un air d’intérêt aux réclamations de son troupeau de captifs, est en réalité un pasteur méfiant, taquin, exigeant, récréant le séjour ennuyeux qu’il a accepté par des sournoiseries d’homme correct en quête de distractions, par de subites cruautés de tortionnaire. L’aumônier Lecourt le seconde, un prêtre sans préoccupations d’esprit, forcé, pour passer les heures, de recourir à des travaux journaliers de maçonnerie, de serrurerie. L’inspecteur Gaujoux traduit en violences les susurrements du directeur. Le médecin rédige ses ordonnances par ordre. Les deux gardiens-chefs grognent, injurient, bousculent, frappent. Tous ces porteurs de clefs, ces ouvreurs de portes, ces apporteurs de mangeailles, circulent, inspectent, rudoient, comme s’ils étaient les gardiens d’une ménagerie politique, d’un muséum révolutionnaire, chargés de la surveillance et de la subsistance de bêtes dangereuses, solidement encagées, et que l’on fait changer de place à coups de fourche.
XII
Le 17 juillet 1839, environ sept mois avant Blanqui, Armand Barbès, Martin-Bernard, Delsade, Austen, avaient été amenés au Mont et enfermés dans les cachots à doubles grilles de la tour Perrine. À la fin de cette même année 1839, autre convoi de prisonniers : Martin Noël, Roudil, Guilmain, Bézenac.
Les premiers temps furent calmes, un silence de monastère plana sur ces passions mises sous scellés. Puis, peu à peu, un tressaillement, une rumeur, le désir irraisonné de persécutions des gardiens désœuvrés, excités par leur autorité, la révolte instinctive de l’homme isolé, sans occupation de la pensée, sans occupation du corps. Les premiers jours, cet homme s’étonne d’être ainsi enfermé. Il est frappé par la nouveauté de cette situation. La porte qui le sépare du monde des vivants l’intéresse. L’idée de claustration travaille en son cerveau stupéfié. S’il a le sens exact des choses, s’il sait qu’il est inutile de vouloir lorsque le ressort de la volonté a été arrêté comme par un doigt invisible, il supportera sa captivité et se satisfera des choses immédiates. Ces impassibles sont rares. Presque immédiatement, l’ordinaire prisonnier qui a perdu ses habitudes de libre respiration et de libre marche s’irrite contre l’étroite pièce sans air, contre les murs qui l’empêchent de passer. Il s’ennuie, et il est impuissant contre son ennui. Il tombe en une atonie qui confine à la colère. Il reste une journée sans rien dire, et tout à coup un son de voix, un bruit, une pensée subite, éveillent en lui la fureur. Le labeur manuel ne suffit pas toujours à occuper ces somnolences, à endormir ces violences.
Du jour où la découverte a été faite qu’il était possible de respirer et de bouger davantage, la nostalgie de l’atmosphère et de l’espace est entrée en cette âme mise en cellule. La fièvre rougit et brûle les pommettes, un perpétuel étouffement contracte la gorge, réveille en sursaut le dormeur, dans des cris et des suffocations, des chaleurs alourdissent ses pieds et ses mains, des aiguillons les traversent en tous sens. Il fait effort pour ne pas subir ce fourmillement despotique. Il marche d’un mur à l’autre, bouscule la table et la chaise, se frictionne, se jette aux barreaux. Quand il s’arrête, la sensation s’est aggravée, un poids de chaînes et de boulets semble fixé à ses poignets et à ses chevilles.
XIII
La révolte, la maladie, la folie sont les poteaux d’arrivée auxquels l’homme se trouve conduit par ces misérables chemins. Il y eut, au seuil des cachots, des insurrections de prisonniers contre leurs guichetiers, des clameurs roulèrent en échos dans les couloirs, la prison se prolongea en infirmerie, des cerveaux sombrèrent dans le délire.
Martin Noël, qui a voulu emprunter vingt francs à Barbès, et qui ne veut pas accepter le directeur comme prêteur, est réveillé, toute une nuit, de demi-heure en demi-heure, par une ronde de guichetiers, par le coup de lumière de la lanterne approchée de son visage. Il s’irrite, il est pris aux cheveux, traîné, frappé, cette nuit-là, et au matin la même scène recommence. Mais ce n’est plus par les cheveux qu’on le traîne, c’est par les pieds. Sa tête sonne sur les marches, à la descente des galeries de Montgomery, à travers la crypte, par l’escalier qui mène aux oubliettes.
Le crâne fracassé, les reins saignants d’un coup de sabre, meurtri de coups de soulier, il est jeté dans le noir et la glace de ces réduits. L’eau froide tombe des murs en ruisselets. Il faut rester couché, assis, accroupi : la voûte est à un mètre et demi du sol granitique. Il n’y a de prise d’air et de lumière que sur le couloir, et c’est ainsi, tout au long, une série de tombes ouvertes dans une tranchée de cimetière obscur.
Les rats ne sont plus les maîtres, ils ont été chassés par les poux. C’est à cette vermine acharnée, à cette pullulation silencieuse et dévorante que le prisonnier est livré sans défense. Le cachot ne suffit pas. Les pieds de Martin Noël ont été enchaînés à l’anneau de fer scellé dans le mur. Les chaînons et les boulons qui les maintiennent broient ses chairs, entrent en elles, mettent à nu les muscles, les nerfs, les os. Il faut rester couché sur le ventre, manger le pain noir et boire l’eau croupie que le geôlier dépose devant la face inerte, à portée des lèvres gémissantes. Il ne sut jamais, ce triste enchaîné, combien de jours il fut laissé là. Il fallut une heure pour le déferrer, pour retrouver et retirer de ses pieds les anneaux cachés dans l’enflure et la pourriture.
Le monument de grâce fière, de hautaine élégance, prend une autre allure, garde une autre signification, quand on est ainsi descendu dans ses entrailles. Il devient double et effrayant : les salles sont belles comme des hymnes, les dessous tortueux et de méchanceté hypocrite, enfouie aux ténèbres. Le Mont est simple et compliqué comme l’homme, plein d’élan et le fond cruel.
XIV
Cette affreuse aventure de Martin Noël se passait avant l’arrivée de Blanqui. Mais elle ne resta pas à l’état d’exception. Après la fournée d’insurgés versés au Mont en 1840, les règlements se firent plus sévères encore. Défense de parler par les fenêtres, défense de parler aux geôliers, défense de chanter, la mise aux fers annoncée comme remède aux mauvaises humeurs, comme calmant des colères. La résignation ordonnée, le silence imposé. Les maladies de nerfs, d’estomac, de cerveau ravagent ces ennuyés dont on verrouille les lèvres. Staube se coupe la gorge d’un coup de rasoir. Austen devient fou.
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne et dernière modification le 22 septembre 2011
merci aux 772 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page

