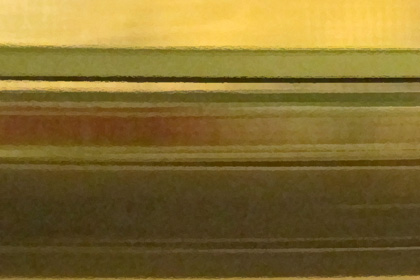
"Inside Houses" ("Maisons intérieures d’écriture") pour la 1ère fois en traduction française, feuilleton, n° 17
Ville dure pour ses vieux, on le sait. On ne le remarque peut-être pas assez, pourquoi ? Parce que la ville est chère, donc les vieux ont tendance à s’éloigner des zones qu’on est amené à fréquenter dans ses propres activités, d’une part. Parce que nos activités sont au rythme de la ville, rapides, alors on distingue moins ceux qui vont un autre rythme. Il faut qu’on les aperçoive pliés sur une table, attendant sur un banc dans les squares, ou pour ces drôles d’habillement qu’ils superposent, pour qu’on se souvienne que la ville nous abrite jusqu’au bout des âges. Peut-être que la ville n’est pas faite que pour être dehors, comme souvent nous sommes dehors : la ville est un confinement. On peut bien descendre à n’importe quelle heure de la nuit pour se ravitailler, mais descendez dans votre Morton le matin vers dix heures et vous serez surpris de combien ils sont. D’autant qu’il leur faut du temps, même pour choisir aussi peu, prendre les légumes à l’unité et le lait à la demi-bouteille, et une fois passée la caisse avec le sac à roulettes, s’asseoir un moment dans ce sas avec machine à café où personne jamais ne boit du café et là on s’en rend compte, de ce que la ville est aussi pour eux, les vieux. Puis ils remontent, ils n’aiment pas le vend froid et coupant de nos rues, le vacarme des autobus, le ronflement général qu’est la ville. Comment aurais-je même supposé qu’il vivait là ? Les noms qu’on lit en haut des couvertures de livres ne sont pas censés avoir existence ou lieu dans votre propre ville, on découvre les deux ensuite, par des articles ou un reportage. Et là, le reportage, c’est moi qui le faisais : une toute petite maison étroite de trois étages comme il y en a encore une floppée dans la 21ème, avec un escalier de fer extérieur pour chaque étage et trois fenêtres en façade – j’étais passé avant voir les mandolines vintage à la boutique qui jouxte le Chelsea Hotel sur la 23ème, quand j’ai à faire dans le quartier je ne peux pas m’empêcher. Et je me disais, grimpant ces trois étages par l’escalier de fer extérieur, que ça ne devait pas être marrant pour la vieille personne qu’il était – et qu’il était encore plus maintenant (mais descend-il encore au Morton, ou quelqu’un de connaissance s’arrange pour l’approvisionner). Je sonne, et reçu directement dans sa pièce à vivre. Une pièce quasi nue, le coin cuisine et une petite table, une couche dans l’angle et la porte qui donnait sur les autres pièces : un occupant par étage, ça faisait bien les trois fenêtres pour chacun et lui vivait seul, puisque ça faisait partie de ses théories concernant l’écriture. Nous avions échangé par courrier, il savait que j’avais connaissance préalable sérieuse de son travail, on a pu assez vite aller assez loin. Pendant trois décennies ou plus, ce type avait arpenté tout Manhattan, Brooklyn et Hoboken (il y était né, pour cela le rôle important d’Hoboken dans son oeuvre). Il n’y avait pas un papier à traîner, un jouet ou un meuble jeté, une affiche posée ou un graffiti exposé, qu’il ne l’ait repris dans ces chroniques où toute la ville soudain paraissait une immense construction de mots, et tout le reste disparaissant à l’arrière, mais la laissant comme nue et vive, habitée oui, mais de nos émotions et souvenirs, de nos rêves. Je l’ai interrogé sur sa bibliothèque, il m’a montré la porte, au fond de la pièce. Je l’ai interrogé sur les surréalistes français et son amitié avec l’éditeur Ferlinghetti, chez qui il était longtemps resté, et quels documents il en gardait, il m’a montré la porte. Je l’ai interrogé sur les visites que lui rendait paraît-il Bob Dylan, longtemps son presque voisin, et la célèbre allusion à lui faite dans une de ses plus énigmatiques chansons, il s’est lentement levé de ce fauteuil avec repose-tête et m’a ouvert la porte. Les livres effectivement couvraient les murs. Il m’a désigné ceux qui concernaient le surréalisme, et la toile avec son propre portrait que lui avait offerte Bob Dylan son voisin – mais comment y entrer, dans la pièce, et celle qui suivait (la porte était démontée) semblait encore en pire situation : les journaux quotidiens, les journaux publicitaires, les affiches et les flyers, le moindre papier ramassé, tout s’entassait à hauteur d’homme, voire plus haut que nous deux qui en étions venus au bord. Et tous ces objets dont il avait parlé, les bribes de meubles ramassées, les jouets cassés, les livres tombés des poubelles, ils s’intercalaient dans la masse, la déportaient ou la brisaient. Il me dit que chaque journal – et ces empilements de cartons avec les articles découpés – était relié à un point précis de ce qu’il avait publié, et que ce lien il était toujours en état de l’énoncer. Il me dit que toutes ses années d’activité, il avait ainsi eu l’idée d’une telle collection qu’elle lui servirait ensuite des années : au lieu d’aller dans la ville, il n’aurait qu’à puiser dans ce qu’il avait jour après jour monté, par l’escalier de fer tout raide à l’extérieur, dans son troisième étage aux trois fenêtres sur rue, dans la maison étroite. Il me dit qu’effectivement un jour était venu où il ne lui avait plus été possible d’y pénétrer. Mais il n’y faisait pas de recherche, il s’était contenté de poser, jour après jour, papier sur papier, objet ramassé sur objet ramassé. Il me dit qu’il restait dans sa pièce, à côté, mais qu’il y pensait souvent. Qu’il revoyait ses marches, ses collectes, ses trouvailles. Qu’il savait même avec précision, s’il devait retrouver un article, un cendrier ou un miroir brisé, à quel lieu précis il lui faudrait aller le chercher, même à tant d’années de distance. Et que cela lui était bon d’y penser. Qu’il y rêvait beaucoup, à ce livre qui serait fait de tout ce que la ville gribouille, raconte, ou jette. Que cela l’occupait même suffisamment, dans ses jours et dans ses nuits, d’imaginer ce livre qui serait fait de tout ce qu’il avait accumulé (vingt-huit ans environ, précisa-t-il) dans ses collectes quotidiennes. Qu’il en refaisait la carte, la table, la matière. Je lui ai dit qu’un tel livre me faisait rêver aussi, il a refermé la porte, s’est à nouveau assis dans son fauteuil à repose-tête, et moi sur le tabouret à la table de la cuisine, devant mes notes. Je l’ai quitté, j’ai descendu l’escalier de fer. Je repasse régulièrement : les trois fenêtres ne sont jamais ouvertes, mais n’ont jamais été closes d’un rideau ou d’un volet. Il est toujours là, le vieil homme, dans la ville dure à ses vieux.
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne et dernière modification le 24 décembre 2011
merci aux 253 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page

