contribution à l’exercice d’après « Penser/classer » de Georges Perec
– atelier proposé en août 2016, voir l’exposé de la consigne et sa vidéo.
– ne jamais hésiter à demander suppression d’un texte d’atelier en archive, ils vous appartiennent !
Ma table de travail n’est pas une table de travail c’est la table de notre cuisine, c’est la table sur laquelle mes deux fils, mon compagnon et moi, mangeons tous les jours, c’est la table qui est vidée et nettoyée après chaque repas. Et c’est justement pour cela qu’elle est ma table de travail quand je suis seule et que je travaille.
Ma vraie table de travail est toujours encombrée des choses en attente, elle est dans un coin du salon où la lumière manque et où on entend trop les voitures qui passent sur le boulevard.
Ma table de travail dans la cuisine est donc pour le travail en devenir, en train d’être fait. Elle offre la place dont j’ai besoin pour poser mes livres, mes feuilles, mes tasses à café, mon grand verre d’un demi litre que l’on trouve dans toute maison autrichienne.
Alors je suis là dans ma cuisine à ma table, à table, pour travailler, seule. Et je décide de ne pas travailler mais d’écrire ce texte, est-ce un travail ? oui, puisque je suis là, seule, devant cette table.
Les sets de table sont encore là et n’ont pas été rangés après le dernier repas familial. Des miettes aussi et un flocon d’avoine datant d’un petit-déjeuner.
Un bouquet de fleurs égaye la table, mais la seule pivoine perd ses pétales. Hier, je me suis dit, elle n’est pas gênée la pivoine, comme ça à peine éclose, de perdre ses pétales. Elle est un peu lâche la pivoine, elle aurait pu attendre. Elle n’est là que depuis le 30 mai, pour les 41 ans de mon compagnon. Mais les autres fleurs, elles, tiennent le coup. Elles ont l’air un peu bête dans leur bocal. Oui, je n’ai pas pris notre beau vase – trop grand – et je lui ai préféré un bocal dans lequel il y avait des petits pois – bio bien-sûr. Le bocal est sur un carreau servant de dessous de verre, acheté à Prague il y a douze ans. Dessus, un chat dessiné regarde un paysage par une fenêtre, « Carpe Diem ». On ne voit jamais plus ces deux mots – ah encore des pétales qui tombent…- car il y a toujours quelque chose dessus.
et puis le chaos est là , toujours et encore : des photocopies du dernier ouvrage de Tristan Garcia , 7, pour mes étudiants. Et puis quelques pages du quotidien Der Standard sont encore éparpillées sur la table, mon fils l’a laissé ouvert à la rubrique auto. Mon grand verre est posé sur le journal, mais toujours assez loin de moi pour éviter toute inondation. Un bloc de feuille à lignes avec dedans une veille feuille retrouvée hier avec une possible question de recherche pour mon mémoire de Master 2 de FLE, avec une liste d’étudiants pour des entretiens pour le dossier du cours sur l’interculturel, en dessous, le numéro de téléphone de l’orthodontiste de mon fils aîné, et puis les horaires de consultation de l’ophtalmo pour que je prenne rendez-vous pour mon cadet. Je ne l’ai pas fait. Il y est allé avec son papa, mon compagnon, une feuille verte où j’ai pris des notes pour mon cours de master sur la recherche en acquisition des langues. Sous mon coude, une autre feuille verte : avec une liste. J’aime les listes, j’aime coucher sur papier ce que j’ai à faire, établir un planning impossible à tenir. Il y a toujours là où je travaille une liste de choses à faire que je n’arriverai de toute façon pas à faire. Je crois que j’en ai besoin.
Je baisse l’écran de mon ordinateur portable pour voir ce qu’il y a derrière : une vielle pomme qu’il faut manger pour ne pas la jeter, je rebaisse l’écran…
der Standard là-bas aussi, la carafe d’eau vide car je ne bois que dans mon grand verre, le catalogue Lego que mon fils cadet apprend par cœur, peut-être que lui aussi , il aime les listes. Une autre liste de choses à faire ce weekend et mon téléphone portable, un très vieux modèle déjà et qui me fait souvent passer pour une décroissante ou une vielle femme avant l’heure, pas du tout dans l’air du temps, j’ai 35 ans.
Mais aucune table n’est suffisante. Il faut des chaises à côté, pour des livres : aujourd’hui, c’est un numéro du français dans le monde, recherches et applications sur l’acquisition des langues, un autre ouvrage sur le sujet et Pensée et Langage de Vygotski, acheté dans la librairie en face de la Sorbonne à Paris, rue des écoles, 36 euros, je ne l’ai pas acheté tout de suite car je n’étais pas sûre de vouloir dépenser 36 euros, et puis j’y suis revenue et je l’ai pris. Mais, je ne sais pas pourquoi, depuis, il me fait un peu peur. La table ne suffit pas, li faut le banc à côté pour poser le cadeau pour la petite voisine et d’autres livres, le bouquine de Louise Dabène sur la sociolinguistique et un livre magique d’Hervé Walbecq qui appartient à mon fils mais que je vais utiliser avec mes étudiants en cours de phonétique.
Ah, et j’ai oublié ma petite tasse, en fait c’est celle de mon compagnon, avec l’âne de winnie l’ourson dont je viens d’oublier le nom, et un couteau sur la tasse, encore plein de beurre. J’ai eu un peu faim tout à l’heure.
Et enfin, quelques restes des carrés de chocolat noir tachent mes feuilles, mais sans chocolat noir 85 %, pas de travail, alors je vis avec les petites taches marron.
Ah, et sans ordi, pas de travail. Je l’aime bien mon ordi. Mon premier ordi à moi que mon amoureux m’a offert pour mon anniversaire en septembre pour que je puisse travailler correctement – et qu’il puisse jouer à Civilization aussi longtemps qu’il le veut. L’ordi, avec, à sa droite, une clé USB cadeau d’anniversaire de ma fac ici, très précieuse car, en fait, tout mon travail du moment est là-dedans, et, à sa gauche, un enregistreur Olympus pour mes entretiens à analyser pour le master.
La table est belle, en bois, faite par un menuisier hongrois, c’était moins cher, c’est mon compagnon qui l’a dessinée. Et, il ne le sait pas, mais, elle est parfaitement conçue. Je peux toujours caler ma jambe croisée contre un de ses gros pieds bien massifs et solides.
Le rectangle bancal de ma table, la planche des coudes presque cintrée, plus basse que la planche des poignets.
À gauche, la fenêtre sur la ville, balcon et grenadier qui séparent le son de la rue du silence du bureau ; la branche glanée que des enfants inconnus ont ramassée et que leur mère a jetée ; des bois flottés tordus ; des pots où poussent herbes folles et géraniums sauvages, coquelicots encore en feuilles.
À droite, le bric-à-brac de cartons, le fauteuil cassé à réparer, le piano fermé depuis, la porte vers le couloir la cuisine ; la bibliothèque emplie de manuels d’informatique, des dossiers, manuscrits et livres 00h00 conservés, boîtes et trésors sur une planche.
Partout autour des tableaux ; du père, du grand-père, des amis, des brocantes. Devant surtout. Un placard, un lit pour l’ami ou l’amie de passage, une carte.
Derrière, la vraie bibliothèque, que j’ai faite, aidée des filles. En bas, les catalogues d’expos, livres de peinture ; l’imprimante, les tiroirs à courrier, à papier. À hauteur de main, les boîtes à fourbis, les pléiades et les 8 volumes d’AB, les catalogues, livres qu’on ouvre chaque jour, le grand pot à crayons où le typomètre ancien a sa place. Des photos des enfants petites avec leurs voisins amis, à donner à ceux des amis voisins qui. Leur fils dessus qui. Là, il sourit, il joue. On entend sa voix qui joue. Son sourire, il est dedans, dans son jeu.
L’étagère du dessus soutient deux photos : Gracq, découpé dans le Mag Litt, au visage entouré d’un rideau qui augmenté par le dessin au crayon, forme coiffe de paysanne bourrue : « j’ai plaisir à débusquer ces nuances paysagistes », dit la légende imprimée. D. marche aux confins de la Pyramide et des plans d’eau en triangle, son imper flotte, il a les mains dans les poches et les fenêtres du Louvre à l’arrière-plan comme celle du palais d’Hadrien. Un tableau d’un rocher translucide qui semble voler au-dessus d’un nuage bleu, son ombre est noire, il est cerné par un fond rouge – le tout peint à la diable, en trois minutes, mais toujours changeant. La carte postale d’une plume dans une météorite reçue au moment où une météorite arrivait sur la Terre. Les photos cachent mal : la Typoésie, le Bon Usage, La Chose imprimée, le dictionnaire de l’édition, des carnets empilés, des livres sur AB encore, biographies, catalogues, dictionnaire et revues. Dans des boites, des chemises rangées par couleurs.
Au-dessus, les vieux dicos, puis encore au-dessus les livres essentiels qu’on relit.
A ma gauche, un petit meuble de bois blanc, peint à la va-vite d’un vert sans intérêt, écaillé, qui pourtant me touche : un double et fort fil de fer pour le suspendre, un abattant d’écritoire dont la partie basse s’avance au milieu pour le saisir, trois tiroirs à compartiments remplis de fils, de liseuses, de prises (américaine, anglaise, italienne, française), de peaux de chamois (naturelle et synthétique), d’ampoules (à vis, à baïonnette, à incandescence, halogène, LED), de piles. Il maintient comme il peut un carton à dessins sans fond ni lien, fond usé déchiré mais empli de gravures, de dessins et de sacs en papier imprimés récoltés au marché. Dérisoires et essentiels. Sur un tabouret là par hasard, superposition de paperasses bancaires et du dossier AB en cours.
J’ai fait le tour du bureau, je suis à nouveau à gauche de ma table de travail.
Sous le casque audio/micro, à portée de main, les notes prises pendant les leçons d’XX, une boîte d’allumettes, courrier du jour non ouvert, un téléphone. Cigarettes (2 par jour max), cendrier près de lampe à l’abat-jour remplacé par un sac de papier froissé noué d’un élastique à asperges, son socle couvert d’encriers vides en verre soufflé bleus, verts ou à peine, de deux encriers d’écolier en faïence blanche, renversés, d’un lapin en pierre donné par mon frère pour rappel du lapin, car il lui ressemble, que je ne savais pas ancien précieux et que j’avais cassé comme on casse sa tirelire, car c’en était une. Le petit lapin de pierre à savon a la même forme et les mêmes taches que la tirelire de porcelaine bleue du 18e siècle. Mais il ne se casse pas. Il n’est pas creux, n’a pas de fente sur le dos, on ne peut rien mettre dedans ; juste le regarder, lui parler. Il est attentif comme un chat. D’autres taches, à ses côtés, sur des écorces de platanes, découpés par le hasard et peintes à l’encre par la main d’un peintre ; des trombones circulaires ; des vis à boucles pour les tableaux. Pot à crayon, bol à fatras - gomme, taille-crayon, stabylos, papiers pelures qui couvrent la gomme des enveloppes, pour D. Une rondelle du cyprès qu’il a fallu abattre cet hiver : ses noix, ses feuilles tombaient dans la gouttière rouillée qu’elles mangeaient. Le mur, humide sur sept mètres, a décidé de la mort du cyprès. B. l’emportera pour en faire quelques étagères pour sa maison dans le ciel. Le cyprès coupé embaumait le jardin. Les rondelles posées sur un radiateur parfumaient la maison. On en a donné aux filles, petits bouts du midi dans le nord de l’Europe.
Le carnet où sont notées les taches en cours est ouvert, raturé au fil du temps, feuilles arrachées dès que. L’ordi ronronne, comme un poële. Comme le rond de feu que le poële à fuel projetait au plafond de la chambre où nous nous endormions enfants, l’ordi raccroche non pas aux parents qui viennent alimenter le poële, mais comme lui à ceux d’en bas, non pas ceux qui rient et qui dînent dans la lumière chaude de la cuisine, mais à ceux du monde, ceux qui bruissent, ceux qui avancent, ceux qu’on aime et qui sont là, tout près, à portée de micro et de vidéo, et aussi ceux avec qui l’on travaille, par mail, par skype, par ticket, par drive - qu’ils soient à San Francisco, à Amsterdam, à Baltimore, à Oxford, à Melun, à Penne, à Bordeaux, à Paris, ou même ici dans la maison. Parfois on ne sait pas où ils sont ces collègues, ces conseillers, ces amis. Parfois, on ne les a jamais vus.
À la droite de l’ordi, les post-it qui classent les priorités des travaux en cours, classés dans le désordre ; les lunettes, des pièces de monnaie anglaises et européennes, des mouchoirs en papier ; un écran qui fait suite à l’ordi et où la souris, depuis hier, aime à se poser de temps à autre. Celle que je tiens dans la main droite est posée sur un buvard vert, seul tapis léger à transporter, aisé à remplacer. Une carte SNCF, des tickets Ouibus et les clés. Un carnet, un stylo à pompe, un encrier rempli d’encre noire.
Lien marqué entre le monde ancien de la table - les encriers, l’encre, le stylo plume, le buvard - et le monde actuel du bureau - la souris comme stylo qui court sur le buvard. L’apprentissage de l’écriture, la plume sergent-major qu’on nous faisait tremper dans l’encrier d’école pour écrire nos lignes, le monde qui s’ouvrait dans les rédacs qu’on devait donner à la maîtresse, sans ratures, ni fautes, ni taches. Fierté de lire, d’écrire - enfin ! Soif de tout lire, et d’abord, les affiches dans la rue, les noms sur les boites de médicaments, plus difficiles. Les livres en série de bibliothèques, rose, verte, mais pas les BD dont on ne distinguait pas, dans les bulles, les mots écrits en capitales. Puis Roland, Ulysse, Tom Sawyer, Oliver Twist, Meaulnes, Les Hauts de Hurlevent - et c’est une autre histoire.
Le bureau de l’ordinateur. Toujours encombré de fenêtres ouvertes glissées dans un coin mais jamais fermées. La messagerie sur l’écran de droite, avec les trois répertoires principaux d’AB, le site version front, les index des projets en cours ; sous les yeux, les messages auxquels répondre, les images et les fichiers qui s’affichent l’un après l’autre, à l’envi ; les fenêtres des réseaux sociaux, le site version back, les fichiers - documents, tableaux, pdf, diapos, vidéos - et les flux - journaux, sites, blogs, chaînes vidéo, radio. Quand par hasard, le bureau ne disparaît pas sous un flot de fenêtres, on y voit des raccourcis vers des logiciels (bases de données, structuration, open office), deux ou trois navigateurs, le courrier, la musique, skype, projets, abonnements, catalogues, billets de train ou de bus vers des destinations d’où l’on est depuis longtemps revenue, des démos, des livres récemment chargés. Perspectives promises.
Quand on ouvre l’une de ces fenêtres, l’arborescence vertigineuse du travail en cours, fragmenté en de multiples compartiments qu’on a tenté d’intituler et qui - bien souvent - se sont avérés inclassables. Bonheur d’écrire quelques lettres ou chiffres dans un champ avant de cliquer sur Enter. L’ordre alphabétique des cahiers d’écriture n’a plus de sens, les dictionnaires Littré, Robert, Webster et Larousse rangés dans mon dos sont hors de portée tant le web offre de réponses - ou de nouvelles questions. Non pas sous forme de définitions forcément, mais en images, en forums, en perspectives. Et si on tapait quelques lettres et qu’on voyait s’afficher une image, qui parle, qui réponde, qui bouge - qui vive ?
Un trait de lumière qui traverse le rideau, bravant la brume du petit matin et se pose quelque secondes sur le coin du bureau, avant de se rendormir.
Le silence de la maison encore baignée de ce dernier sommeil où les rêves galopent sur des collines d’opaline.
Un carnet cuivré de moleskine burinée, ficelé d’un élastique tellement étiré sur la tranche qu’il ondule nerveusement comme une danseuse andalouse.
Un stylo fatigué, fardé de pois de couleur mauve assortis à son encre.
Un pavé de verre protégeant le plateau de bois de hêtre, travaillé de volutes surannées, recouvert d’une fine pellicule de cuir, rêve d’un bœuf se prenant pour un daim.
Un pot d’argile où poussent quelques crayons, faute d’avoir trouvé graines à son pied.
Une boîte en fer blanc décorée en relief d’un paysage de l’île de Ré où les roses trémières jaillissant des pavés inégaux, s’accrochent aux façades, et où les caramels au beurre salé souvenirs d’étés envolés, ont laissé la place à une nichée de bonbons à la réglisse.
Une rose de mai courbée vers le sol, penchant sa corolle défraîchie vers le pétale qui lui a échappé, comme pour arrêter le temps avant qu’il ne l’emporte vers sa flétrissure.
Un casque bleu outremer branché sur le téléphone, en attente de ce morceau de musique qui portera l’inspiration, comme un zeppelin libéré de ses amarres s’élèverait en silence dans la lumière de l’aube.
Un écran noir et son minuscule clavier, qui dort dans le silence du petit matin, dans l’attente des promesses de l’écriture qui viendra.
Le reflet de mon visage dans cet écran, pâle, presque inconnu, qui me jette un regard de connivence et sourit avant de disparaître derrière les icônes du bureau de l’ordinateur qui s’éclaire.
Mes doigts qui se posent sur le clavier, caressent les touches un instant avant de prendre leur élan pour ce pas de deux avec les mots.
Mon souffle qui se tend comme un arc et se perd dans l’inutile.
Les phrases qui s’étirent sur l’écran au rythme de la musique.
Le texte qui prend forme, inventaire de l’instant, pense-bête temporel, photographie instantanée de ce qui ne reviendra jamais.

– sa table de travail est petite, faite de matière métallique, avec des alvéoles octogonales à travers lesquelles les mots tombent parfois sur le plancher en bambou ;
– l’ordi semble la seule fenêtre en face, l’autre se trouve sur la droite, il faut tourner la tête pour l’apercevoir et pouvoir aller ensuite sur le balcon donnant sur un grand jardin en contrebas ;
– trois gravures de sa fille, collées au mur en attendant un improbable encadrement, l’emmènent vers l’époque des travaux manuels et des cours de dessin au lycée ;
– sur la gauche, on aperçoit l’amorce d’étagères avec des livres (André Breton tout près, dans le désordre mais pas dans la Pléiade), une carte postale de l’Ensemble Intercontemporain ;
– le rayon SF est perché tout en haut, mais il existe pour toute cette bibliothèque un « deuxième rayon » – comme lorsque l’on parlait des ouvrages interdits aux âmes innocentes – et cela décourage parfois les recherches ;
– en fait, il ne s’agit pas d’une « table de travail » mais de rêve, d’imagination, de création (beau mot pour exercices), d’espace ouvert grâce à l’écran du MacBook ;
– on pourrait dire que cela ressemble à un pont de décollage de porte-avions (l’atterrissage est cependant une manœuvre délicate et élastique) ;
– quand il tape sur le clavier, il repense souvent à la machine à écrire de son père (une Japy qu’il a conservée précieusement), avec sa petite sonnette quand le charriot arrive à bout de course avant le retour à la ligne et l’écrit s’arrête alors au bout du rouleau avant de donner un petit coup de levier ;
– la souris, qui n’est pas d’origine, émet une petite lumière bleue avec un « m » qui lui fait toujours penser, paradoxalement, à « la marque jaune » de la BD ;
– tout ce qu’il écrit sur sa machine est relié automatiquement à un service spécialisé de la DGSI et son bureau est filmé en permanence (comme le prouve la photo ci-jointe) par une mini-caméra du ministère de l’Intérieur installée obligatoirement, comme les détecteurs de fumée, dans toutes les maisons et appartements de France : mais le savoir est une liberté grande.

Lumière, fond
( -> il y a une ampoule au bout d’un flexible qui fait ambiance si elle est orientée vers le mur, soit "le fond", ou...
(il y a aussi une fenêtre qui envoie la lumière du soleil mais là c’est beaucoup trop violent : obligé de fermer les volets, introduction crainte de drame)
- ordi
- sous ordi pub "festival 7 collines" avec jolie nenette + vagues de l’océan poétique
- pot de feutres, stylo, crayons, jamais utilisés
- boîte de crayons watersoluble souvent utilisée, le pinceau quelque part.
- des papiers des papiers des papiers
- à coté une chaise sur laquelle s’assoient le thé et le café (mais non la ricorée) (mais non le chicorée café) (ricorée est une marque, merde)
- un verre sponsorisé par saint-étienne métropole
- des mouchoirs usagés et froissés serviettes papier pour se moucher ou essuyer (nettoyer l’écran, par exemple), ou faire oeuvre de lutte contre la poussière
- une boîte perdue de trombones ignorés
ordi, fond
( -> cette table est si petite que un ordi à peine plus grand que un ipad suffit à la boucher)
- une clef blootooth / usb
- lunettes RSA à 3€
- pub villes#1 collectif X, un truc d’ici
- des tas de bouts de papier : il y a quelque part des ciseaux et / ou cutter qui découpent les papiers "souches" en multiples papiers "enfants" pour former de nouveaux papiers individuels et autonomes servant à mémoriser tel ou tel ou tel ou tel ou til ou tyl ou trac ou truc à se souvenir nécessairement.
Un papier individuel devient un papier souche par mutation aléatoire.
- une nappe plastique style années de guerre tachée (c’est thé café chicorée)
- à coté une chaise où poser la chicorée café car c’est interdit sur la table de l’ordi : il n’est permis de ne poser sur la table de l’ordi que la petite cuillère pour remuer le thé, la chicorée café, et c’est elle qui tache la nappe plastique
- souris, fils, écouteurs, transfo
- tas de papiers sous ou derrière l’ordi
Finalement, seuls l’ordi et la lampe bougent.
Sous l’avant-bras gauche (sous le coude ?) bulletin de paie de Novembre 2015 et sa photocopie pour satisfaire aux exigences administratives de consitution d’un dossier CGOS - lequel permettra moyennant finances l’obtention de chèques-livres autorisant eux-mêmes une réduction de 50 % sur l’achat de bouquins, dont ceux recommandés précédemment par l’initiateur de l’atelier (l’infra-ordinaire et penser-classer) lesquels seront un jour probablement placés in situ, sur l’étagère blanche mélaminée au-dessus du bureau, aux côtés, reste à voir après quel vagabondement, (mieux que vabagondage, c’est encore plus hasardeux et tout terrain le vagabondement, collé dans la glaise humide ou tout au contraire volatile mais insistant, façon chaume qui pique et mordille la plante des pieds, bien sûr s’ils sont nus, ou alors à travers l’espèce d’espace laissé par les lanières des sandales en cuir, sur le côté, après souvent ça fait un point rouge qui saigne, c’est l’été, le chien aboie sous le ciel étendu de loin très haut sans nuage, chaud, alors c’est encore plus long et étiré le vagabondement, tandis que sous la pluie au contraire c’est serré comme une nuit tout seul au pied des morts. ) aux côtés donc de W – le goût des mots – Fragments du dedans - Le lecteur de cadavre - Ecrire -Tous les mots sont adultes - Notes de chevet - Stèles - Le banquet - Belle du seigneur - Les bienveillantes - La pierre de la folie - le lecteur inconstant (et pas inconsistant bien que ça ouvre une porte) – Voyage au bout de la nuit - l’herbe des nuits - métaphysique des tubes - Mrs Dalloway - Cabaret mystique - et puis les autres tous les autres fins épais alanguis couchés debouts chevauchés Gogol entrou’verts en attente en repos en répit sans répit en dépôt - l’écrivain et l’autre - entremêlés entr’aperçus oubliés retrouvés parcourus cornés soulignés surlignés déchirés intacts. Blanc noir vert rouge vif marron jaune lumineux jaquettes brillantes ternes usées plissées ridées - le Cid - souples - vengeance - ? – rigides les 120 journées de Sodome, imposantes Les Fables, timides et fugaces ou têtues obstinées toujours là ah les Choses , bleue foncée - être là être avec, être sans mais alors être quoi mais oui quoi ? – le spleen de Paris – Le mort qu’il faut – Fragments du dedans – et de partout.
Dessus prospectus posé là : « Bois chauffage rhone. fr » tarifs. Bientôt corbeille à papier, plastique, payée une misère, à droite du bureau, posée sur le parquet en chêne, payée une misère. Le « e » suffit à indiquer qu’il s’agit de la corbeille et pas du parquet. Malin le « e ». Exit le « e » c’est du parquet pas cher… Ca sera plus du chêne ou alors….
Un peu à gauche le disque dur de sauvegarde – pas branché ( ! ) – tue mémoire et salut sérendipité. (A la mode). Le Zazar fait des liens ; heureux ou malheureux ou fantasveilleux.
A côté la double corbeille à courrier : dessous brouillons et déjà traité, dessus à traiter et brouillon ainsi que déjà traité, comme dessous, en vrai.
A droite de la bannette une pochette de photos en double ou triple exemplaires c’est bretagne – bretagne – bretagne - grands mâts – côte – océan pour écrire – envoyer des bouts de lumière et de noir, océan pour respirer pour pleurer rire noyer elle est à l’envers la pochette, elle pèse lourd et bizarrement sur son bleu clair un poisson noir éructe des bulles snapfish en jaune et blanc.
A côté et appuyé contre le mur, derrière l’ordi portable, un porte CD double lui-aussi, deux étages superposés, 20 CD par étage, sans ordre, et façon grille-pain il incarcère des software et autres logiciels mais, classieux, Bernard Pivot dépasse pour un entretien avec Levi-Strauss (archives INA).
Derrière en sandwich entre le porte CD et le mur, un mandala colorié avecc minutie puis encadré (cadre plastique noir Reslic d’IKEA) ; derrière le tableau, en lettres appliquées et enfantines avec des majuscules aléatoires ( ?) : « Pour un Monsieur bien tristounet et bien Mélancolique. De la Part de V.C. »
Une fois extirpé de sa cache on découvre le motif sur fond blanc : le paon posé sur une branche dans une explosion d’oranges – rouges - bleus – verts - pleins tons et dégradés, feuilles fleurs plumes où se multiplient des yeux-poissons hypnotiseurs et iridescents. Et puis courbes, courbes, courbes et réseaux, fractales de feuillage et d’enluminures en toiles d’araignées.
A droite le scanner-imprimante-photocopieur noir quadrangulaire, trapu, degré zéro de la fantaisie, avec petit écran tactile de commande sur le devant, à gauche, fonctionnel à pictogrammes universels, enfin presque parce que pas pour les papous.
A côté la lampe de bureau, deux régimes d’éclairage, moyen ou surpuissant mais du mauvais côté, à droite donc de l’ordi et du clavier. Entre le portable et l’imprimante. Histoire de place, fils, cables. Inconfort résiduel.
Sur l’étagère aux livres – enfin – celle qui est là, à gauche et dans l’espace laissé entre les bouquins et le bord de l’étagère :
– un paquet de photos de Toscane envoyées par erreur mais en vrai remerciement ; la première, un dragon – gargouille tordue en S et en métal, langue et queue fourchues, ventre couvert d’une crête d’écaille, pattes décharnées et griffues enserrant un rouleau ( ?), un récipient cylindrique ( ?) au fond déchiqueté, sur arrière-plan de ciel blanc plein de rien, giclée succinte et indécise de bleu en bas à droite,
– sous le paquet, tickets de RER, compostés,
– à droite, boîte à stylos avec cartouches d’encre bleue et jaune pour l’imprimante,
– boussole (deux), dont une dans un boîtier vert, l’autre sur socle transparent, bien plus pratique, cadeaux pour les deux,
– un mousqueton,
– une petite pochette avec de petits surligneurs, mauve, jaune, bleus, où sont les autres ?
– des règles graduées en plastique, cassées et intactes,
– un chiffon pour essuyer les écrans, et les lunettes, dans quel ordre ?
– une clé USB rouge vif,
– des recharges de roller, noires – bleues …
– une pile, HS ( ?) pour la souris de l’ordinateur,
– des trombones, petits, gros, reset, reset.
– Un nez de robinet mâle en plastique pour raccorder le tuyau d’arrosage du jardin, juste de l’autre côté du bureau, derrière la fenêtre, à droite.
– Un porte-mine, mine HB, trop dure, 0,7
– Un faux couteau-laguiole cassé,
– Deux capuchons bic bleu foncés sans stylos,
– Un micro-album photo noir et blanc le vercors, vient d’où ??
– Une vis,
– Un mètre souple castorama enroulé
– Un porte-clé éléphant d’inde (mariage !)
A côté une lettre : REPONDRE
Une clé, clé énorme, pesante, qui sent la ferraille, porte massive, château.. Mon père.

Pour qui pratique le nomadisme intermittent, la table de travail est une installation provisoire.
Elle n’existe pas avant d’être mise en place. Elle n’a pas de lieu. Elle se trouve. Elle est une réalité temporelle. Choisie dans la maison, toujours à l’écart du passage, de ce qui pourrait interrompre, de ce qui fait les contingences matérielles de la vie. Dans une pièce où elle ne sera sur le chemin de personne. Elle est souvent perchée. Quelque part à l’étage ou dans un endroit surélevé : la pièce où sont rangés les livres, les tapis de yoga, les instruments de musique, sur une estrade constituée par un coffrage en bois destiné à accueillir un couchage supplémentaire. Cette fois il s’agit de la chambre à coucher à l’autre bout de la maison, l’une des deux seules pièces de l’étage avec la salle de bains.
La plupart du temps, la table est fabriquée car elle n’existe pas là où elle devrait être : les autres tables font déjà l’objet d’une utilisation précise, celles qui pourraient être disponibles ne sont pas transportables. La table de travail est avant tout une disposition et un assemblage composite. Dans un premier temps, une verticalité et une horizontalité.
Deux tréteaux de bois pliables provenant du cabanon à l’extérieur de la maison. En bois clair, couvert de tâches de peinture blanches, bleues et ocres mais aussi de vernis, de différentes formes : des gouttes sur les traverses inférieures, des coulures sur les montants et des aplats à la jointure supérieure où les pinceaux sont venus s’essuyer. De la poussière, des charnières tordues et des compas en aluminium frêles et branlants. Les deux tréteaux sont relativement proches l’un de l’autre car le seul plateau disponible est une planche de bois carré d’environ 55 cm de côté. Elle est un élément d’un meuble-étagère qui n’a pas jamais été monté. Elle est quasi-neuve. Avec le reflet de la lumière en contre-jour se distinguent des traces de doigts et de paume qui ont pressé, glissé. Les tréteaux sont trop grands pour la planche, trop rapprochés pour que les jambes puissent bouger librement, mais dans un bon alignement pour le tronc et les bras. Par un heureux hasard de circonstances, la table de travail s’ajuste relativement bien avec le tabouret, lui aussi originaire du cabanon. Faire avec les objets disponibles car inutilisés.
Un tabouret lourd et plein, de style industriel. D’une robuste épaisseur, le plateau circulaire est composé de trois longueurs de menuiseries emboîtées et collées. Verni et aux contours arrondis, il est lui aussi tâché mais par ce qui a dû être du liquide. Des auréoles d’âges différents. Sur le revers, en son centre, une vignette précise la marque de fabrication : un rond de papier fin, vieilli, pas encore prêt à se décoller, bords cannelés jaunis, cercle rouge plein, deux lettres (MD) typographie années 30. Les pieds sont solidement ouvragés : fer forgé en trépied renforcé par des bases en triangle en haut et en bas. Une assise précise et campée qui oblige le corps : bien poser le plat des deux pieds au sol pour tenir le plus confortablement possible une position. Ce qui laisse peu de place au jeu et interdit de placer des jambes sous des fesses. L’assise doit comprendre la variable. Une autre solution peut toujours être trouvée.
Alors les objets peuvent arriver. Peu nombreux car ils doivent pouvoir loger dans le sac à dos. Peu nombreux mais toujours les mêmes ou presque. Ils sont choisis pour leur qualité. L’ordinateur portable est l’incontournable. Il est le premier à s’installer et donc définit la plus ou moins grande proximité avec le mur en fonction du branchement possible. Le cordon étend un rayon qui croise un autre paramètre de situation : la fenêtre. La table de travail est proche d’une ouverture, une suffisamment grande pour sentir la lumière - la table de travail ne fonctionne qu’à la lumière du jour. Suffisamment grande pour donner le sentiment de l’extérieur, du mouvement possible - aller vers. La table de travail n’a donc jamais le dehors dans le dos. Elle se dispose de côté, perpendiculaire ou de trois quart pour éviter l’écran en contre-jour, avec toujours l’extérieur en perspective. Le dos au mur, non pas contre le mur mais avec un espace réduit derrière, là ce sont des placards mais on peut imaginer un mur plein ou un angle. Cela serait tout à fait possible, ça l’a déjà été.
La table de travail est plusieurs. Elle est différente en fonction des lieux occupés. Une qui se trouvait presque à ras-du-sol sur un espace surélevé. Elle avait été fabriquée avec les deux extrémités d’un plateau de table de jardin en tek, alternance de lattes et de vides. Les deux extrémités du plateau rassemblées formaient un octogone. La surface reposait sur quatre piliers de briques trouvées près du muret de la terrasse. Cinq briques par pilier, hauteur pour y glisser les jambes en tailleur. Deux trois coussins calés pour l’assise vers l’avant. Le mur de pierres anciennes dans le dos, la large fenêtre sur la gauche, les toits blancs du village qui descendent en escaliers vers la baie encore verdoyante mais sèche et le bleu de la mer. L’ordinateur au bord de l’octogone, au milieu la ligne, laissait un vaste espace à l’arrière où poser. Mais aussi le sol comme une extension de la table où tout s’éparpille.
Les objets débordent, même peu nombreux. Avec cette table de travail pour cette migration, ce n’est pas sur le sol, trop bas, mais c’est sur le lit, tout proche, que cela déborde. De la table au lit, du lit à la table.
Un ordinateur portable, un câble d’alimentation branché, des écouteurs branchés le fil qui s’emmêle avec le cordon, un tissu pour essuyer l’ordinateur.
Un cahier Muji acheté il y a deux ans, couverture cartonné brun clair format A5, coins écornés, écrit à l’envers et à l’endroit, toutes sortes de notes et enflé d’autres feuilles volantes.
Un style bille Bic en plastique, toujours le même modèle : sans capuchon, un bouton pour faire sortir la mine, encre noir, transparent dans la partie inférieure de la cartouche et noir dans sa partie supérieure ; il tient bien dans la main et glisse sur la feuille.
Un petit carnet rouge notebook quasi vierge depuis cinq ans.
Une enveloppe en plastique transparente pour format A5 achetée à Rhodes début mai 2014. L’étiquette du prix au dos indique 0,45 €. L’épaisseur de l’enveloppe varie d’un voyage à un autre. Quand elle est trop remplie, il faut faire le tri, la vider des papiers qui n’ont plus rien à faire là. Les tickets partent en premier, poubelle souvent. Les feuilles volantes sont justes déplacées, elles viennent s’intercaler dans le cahier Muji.
Reste à l’intérieur quelques enveloppes à lettre : un stock de cinq enveloppes pour d’éventuels échanges épistolaires manuscrits, réalisées en papier recyclé à partir d’anciennes cartes IGN dont le tracé est visible à l’intérieur, une grande enveloppe carrée en papier satiné blanc toujours la même depuis trois ans, deux feuilles A4 pliées où figurent des exercices kiné en image pour le dos, la carte « postale » Etre là -Limoges de l’artiste Mathilde Roux servant de couverture à l’enveloppe par transparence. Des mouchoirs en papier, froissés, tous utilisés au moins une fois.
Des livres papier (deux par migration) : cette fois-ci Naissance de la gueule de A.C Hello (éditions Al Dante) et Création à seize mains. Micro-climats 2.0 zone de turbulences du Glob Théâtre (Les éditions Moires).
Un paquet de feuilles éparpillées, de format A5 repliées sur elles-mêmes et assemblées à la manière d’un cahier non relié, acheté tel quel dans le magasin général du village, oublié sur une étagère par la vendeuse et les autres clients : 17 lignes simples horizontales par page, tracé bleu clair très discret sur un fond beige, la surface comme poncée par le sable, la poussière, la chaleur et le temps, lignes effacées à leur début et à leur fin, contours et plis jaunis.
Griffonnées à chaque impulsion d’écriture. Comme à chaque nouvelle arrivée, un cahier à spirales neuf, 17x24 cm, acheté au magasin général du village.
Au milieu de tout cela, l’ordinateur toujours. Premier objet touché en s’essayant à la table : l’ouvrir, l’allumer, essuyer l’écran toujours sale, le clavier entre les touches, actualiser le post-it aide mémoire, lancer internet, vérifier les mails, écrire des mails, faire un tour sur facebook, lire la presse, ouvrir des onglets de recherche, lire les pages de recherche, écrire des mails, ouvrir les fichiers de travail, créer de nouveaux fichiers, déplacer les fichiers, écrire sur l’écran, écrire sur les feuilles volantes, rassembler des feuilles volantes, intercaler d’autres feuilles, écrire sur les feuilles volantes, écrire sur l’écran, étaler les feuilles autour de l’écran pour voir tous les mots.
La table de travail occupe les jours de cette chambre à coucher. Chaque soir elle disparaît, chaque matin elle est réapparaît.
La table de travail est plate et blanche. Longue. Contre le mur, calée. Et devant, enfin derrière, pris entre la table et le mur, un carton peint qui penche un peu parce qu’il n’est pas fixé. C’est un carton de 80cm par 60, peut-être. Un carton sur lequel on a peint du feu. Une étagère à sa gauche, le retient. Une étagère en métal gris, avec deux gros pots en zincs remplis de crayons, de petites feuilles et de notes calées entre, une carte postale représente un tableau rond, un tableau rond plein de tâches noires jaunes citrons vertes et bleues, puis deux autres pots en zinc de taille plus petite et plus larges, avec du scotch, un rouleau de chatterton, un compas qui ne sert à rien, des chiffons à écrans, à lunettes, des crayons encore et des cartouches d’encre, des feutres noirs, un pinceau au manche vert, et un pile de livres tout au bout, couchés sur le ventre. Laurence Nobécourt, Aba Kobo, Céline. Les autres on ne sait plus.
C’est une pile perdue. Une pile à lire d’il y a longtemps. Prévue. Parmi les autres piles de livres à lire, construites, assemblées, à des fins, étudiées. Mais perdues elles aussi. Ça et là, car là non plus on n’a toujours pas réussi à lire. Mais enfin, devant la pile des livres perdus donc, une lampe en fonte, grise elle aussi, comme les pots et l’étagère. Lourde si on la soulève. Comme si là devant, tout au bout de la table de travail, cette lampe tenait sur tout ou quelque chose, et faisait contre poids. Mais je ne saurais dire…Au-dessus en tous cas, un peu décalé à droite, un petit tableau rond comme une fenêtre de bateau. Un hublot en zinc. (Décidément.) Quatre marins à l’intérieur, en vareuse bleue et au sourire trop grand pour eux, sur un fond de ciel bleu pale. Ouessant ? Non, l‘île d’Yeu. Sous l’étagère, coincée en dessous, en dessous des marins et des pots en zinc, pour essayer de situer un peu, des boites en plastiques à tiroirs, et une en bois. Des carnets pas finis, petits, entamés ou tous neufs, des feuilles de brouillons A4 coupées en deux, un petite planche carrée d’aggloméré blanc, et des lunettes noires, amarrées à un cordon sans son cou, et des carnets encore, Moleskine, empilés, un chargeur d’IPhone, une pile de feuilles manuscrites, et de textes pas encore assemblés, en chantier pour un livre à venir près un stylo vert perdu lui aussi, et des lunettes en demi lunes, à côté d’un Robert jauni, au bout de la table, près de la lampe en fonte. Seulement pour situer. Mais tout cela est à porté de main. (Nécessité) Deux cartouches d’imprimantes vides, à jeter, sur un Jim Harrison tout corné, et une intégrale de la Saison 4 de Mad Men pas rangée par celui qui l’a regardée.
Quand on revient au centre, au centre de la table de travail, devant le carton où il y a du feu peint dessus et qui penche un peu, un Mac. Petit, grand ouvert, avec la mire dansant tout près du carnet où l’on écrit. Moleskine n°7 ou 8. On ne saurait le dire sans le retourner. Il est plus grand que les autres qu’on a trouvés sous l’étagère. On tourne la page. Et un crayon rose fluo, coincé sous le bras roule et crisse comme un bruit de roulette sur les graviers. Et soudain, dans le silence déployé, on tend l’oreille. Oui, la mire elle aussi fait du bruit. Danse en ronflant tout doux, tout doux. Il y a du bruit sur la table de travail. Et même autour. Loin, derrière les murs qui séparent du jardin. Des oiseaux aujourd’hui, qui chantent ou pleurent, ( on ne sait jamais) leur joie ou leur mélancolie.
A droit de la mire. Encore un carnet noir. Un cahier plutôt. Plus grand, avec un autre carnet coincé ouvert à l’intérieur. Travail, Moleskine encore, n° on ne sait plus, et un petit livre blanc avec un petit M tout bleu marqué en plein milieu. Pas besoin de le retourner, pour savoir que c’est Premier Amour de Beckett, il est tout corné, froissé et plié comme celui de Jim, puis un petit carnet encore, et des livres en dessous, et une autre pile de livres. Mais les Fleurs du Mal, ça on les a lus. Et bien relus. (Tant que l’on est ravi toujours.) Puis Tous les mots sont adultes (Je vous jure que c’est vrai). On s’amuse. Et par dessus tout ça, comme dominant l’ensemble, coincés sous le plafond penché enduit de peinture blanche, penché comme une cabane, là d’où l’on écrit, deux paniers d’osiers. Deux tiroirs. Pleins de carnets encore, de chemises, de dossiers de documents et de papiers sinistres importants ou désagréables, et une autre boite en plastique pour ranger les papiers pas encore rangés dans les classeurs et les dossiers de papiers sinistres, puis au-delà, derrière le dos, le dos de la chaise de travail de la table de travail, de longues étagères de livres, dictionnaires, boites à dessins, blocs, aquarelles, cartons, tubes de calque et autre panama. Un taille crayon, des galets, un bougeoir en terre cuite, bariolé, ramené du Portugal, des lettres sans timbres, un casquettes bleue des New York trucmuches, une hanche de jazz, un appareil photos, des lunettes de soleil, un vieux chiffon fripé, et des partitions de musiques usagées. Et sous la table de travail, quand le carrelage devient froid l’hiver, un coussin rouge et carré de 50cm par 50, épaisseur 10 (il faut bien ça) car l’hiver, le carrelage, c’est très très froid. Et là, on pourrait penser que c’est à peu près fini, qu’on en a fait le tour, mais non, il y a tant à dire, les fesses sur la chaise de travail, qui roule sur le carrelage blanc, pas les fesses, mais les roulettes, sur le carrelage trop blanc sous le plafond enduit de peinture blanche, devant le carton peint tout penché et coincé qui représente du feu, oui, bleu sur orange, oui bleu, et la mire qui bouge, dense, mais doit-on ?
Rêver un peu … Imaginer un espace de travail où tout est fluidité et harmonie
Un grand espace, mais il est aisé d’en faire le tour
Faire le tour de la table pour entrer tout à fait dans le sujet traité
Des carnets, des cahiers, des couleurs
Grains, lisse et fin, rugueux et épais,
Formats italiens ou paysage de préférence, gribouiller, ébaucher, travailler
Juxtaposer dessins, schémas, collages, textes
A spirales (pour écrire sans support), cousus mains (tendresse pour les mains habiles), en accordéon (pour se déplier à l’infini)
Feuilles blanches simples, n’intimideront pas
Feuilles blanc cassé, hésiter un peu
Feuilles épaisses, irrégulières, appellent un travail remarquable, oser
Couleurs intenses des couvertures
Un mur de toutes leurs couleurs, nuancier à idées, à projets, à textes …
Artist pen : choisir, mettre en perspective
Pilot 04 : très utile pour les petits formats, écriture fine, dense
Et puis décider qu’il serait temps d’accélérer sérieusement
Combien de lignes écrites dans cette unité de temps ?
Temps de suspension
Poser cahiers, crayons, objets choisis avec soin, au fil de pérégrinations, d’échanges, de conversations, coup de cœur
Ouvrir l’ordinateur (format italien lui aussi), outil à technologie changeante
Changements permanents
Espace fini, espace infini
Vertige
Revenir au format à la française ou portrait
Se concentrer
La théière n’est pas loin, rassurante
Jeter un regard sur les titres des livres posés sur les étagères
La bibliothèque Billy observe, narquoise ?
Se rappeler que les emails d’hier n’ont pas eu de réponses, faire fi, rire un peu
Se concentrer à nouveau
Les doigts galopent sur le clavier, corrigent, mettent en forme
Se relire Ne pas s’attendrir
La pendule tourne
Le smartphone se tait
Une porte claque, la vie autour
Faire une pause ?
A la radio, jazz à FIB, 96.7 MHz. Quelquefois la réception n’est pas bonne, il faut trouver le bon positionnement de l’antenne. Le programme est décevant depuis plusieurs semaines mais tout de même quelquefois, des pépites. Le carnet à spirales – ZAP book 100% recycled –dont les pages ne comportent ni lignes ni carreaux ; le format, l’épaisseur sont parfaits.. Seule change la couleur de la couverture. Un carnet dure de un à six mois, selon les périodes.
L’heure correspond à une heure décente pour commencer l’apéro, 19 h. Petit vin rouge biologique fruité, en général - rafraîchi avec un glaçon en période de grosses chaleurs. Un simple verre ballon, quelquefois un verre à bords droits, 10 cl. Il peut arriver que le vin soit blanc, sec toujours, ou rosé, de préférence un clairet. Avec le vin blanc et le clairet, il faut se méfier au bout de deux verres. Mais après tout pourquoi se méfier ? « Puisque nul ici ne peut te garantir un lendemain, - Rends heureux maintenant ton cœur malade d’amour. – Au clair de lune, bois du vin, car cet astre – Nous cherchera demain et ne nous verra plus. » Omar Khayyam.
L’esprit des maîtres…
La table est ronde depuis peu ; elle était rectangulaire avant. Le plateau de chêne marqueté était magnifique. Le merisier de la table ronde est un peu trop roux ; son vernis, surtout, dérange, trop miroitant. Pour le cacher, un tissu épais à grands carreaux irréguliers qui déclinent une gamme de rouge foncé.. La cuisine se trouve derrière, le salon à droite. Quelquefois, il y a du passage : les ados (les zados). Ils sont habitués. Sans doute se demandent-ils ce qui s’écrit là. Mais jamais une question. Discrétion exemplaire. Si la grande pièce, pour une raison ou une autre n’offre pas la solitude nécessaire à l’écriture, une retraite est possible dans la chambre. C’est rare.
En face de la table, les deux porte-fenêtre vitrées, un vantail pour celle de gauche , deux vantaux pour celle de droite ; entre les deux, un pan de mur avec le radiateur surmonté d’une affiche encadrée, géométrique, colorée, figurative : une femme de trois quart, assise devant une porte en plein cintre, une chaise, une toiture rayée jaune et oranger, un tronc d’arbre au premier plan. A travers les rideaux blancs, les plantes du balcon, quelquefois le sèche-linge.
Le carnet implique l’écriture à la main, bic à pointe fine au tube plastique translucide et oranger. Sinon, c’est l’écriture à l’ordinateur, un MacBook Pro. L’aventure de l’écriture sauvage au fil de la plume se fait à la main la plupart du temps. Sur le MacBook Pro, c’est plutôt l’’écriture à destination sociale.
Les jours sont tendus vers ce moment-là.
Ce n’est pas ce qu’on pourrait appeler un beau meuble : c’est un bureau assez moche, en mélaminé, bon marché, qui a maintenant plus de 20 ans. Symétrie de trois tiroirs de chaque côté. Il y a aussi une tablette qui coulisse, en dessous, pour y disposer le clavier de l’ordinateur. La tablette est cassée : il n’y a plus de butée d’arrêt sur la coulisse ; si on la fait glisser, elle vous tombe alors direct sur les pieds et vous les brise car elle est très lourde. Elle est pleine de poussière, la tablette, on ne pense jamais à l’épousseter. Des livres coincés entre l’imprimante noire, qui prend trop de place, et un serre livres Ikéa en bois. Trousse bleue en silicone. Un pot à crayons en plexiglas dans lequel du tri a récemment été fait. Des pochettes de plastique couleur. Des dessins de O. Un appareil photo. Deux bannettes en bois pour ranger des cahiers, des collections de blocs et de carnets qu’on n’a jamais utilisé. Deux presses papier en verre transparents : un grand et un petit qui servent à caler les courriers en attente de traitement, les vieux chéquiers, les papiers. Des petites boites, un peu partout, dans lesquelles il n’y a jamais rien. Un objet en bois à compartiments, auquel finalement il est difficile de donner un nom, dans lequel on trouve, dans le désordre : des clés usb, des piles, des trombones, du papier d’Arménie, des cartouches d’encre, des tampons hygiéniques, des toupies, des pin’s, des badges, des boutons, des boutons pressions, jetons de caddie, pinces à linge, du fil de soie, et un porte clé petit Noun, le petit hippopotame bleu de Mésopotamie. Et aussi un petit ange chiné il y a quelques années, qui devait finir accroché à un mur, mais qu’on a oublié là. Il faut juste trouver un ruban et le faire passer dans les ailes. A côté une collection de post-it, des cartes de visite, des tickets de caisse. Un tapie de souris : détail du Jardin des délices de Jérôme Bosch. Ordinateur portable en position centrale. Petite enceinte Bluetooth jaune. Disque dur externe gris métallisé.
Le bureau est collé contre le mur blanc, un peu sale, sur lequel se trouvent, à hauteur d’oeil, plusieurs autocollants (dont un qui dit "Veuillez. Merci" et un autre qui dit "Ça baigne dans l’huile") et les "supercoeurs" d’O. , dessins de super héros en forme de coeur, scotchés sur le mur, même leurs chaussures sont en forme de coeur. Juste au-dessus, une étagère, tablette en bois clair avec un petit rebord, longue d’environ 1 mètre et demi, et de moins d’une dizaine de centimètres de profondeur, sur laquelle s’expose une collection de bibelots : lettres d’imprimerie, cartes postales, photos d’enfants joufflus, vieilles photos de famille, en noir et blanc aux bords dentelés, poupée miniature années 50, Physalis séchés dans un petit vase, poisson en céramique de Porto, des fèves, un lance-pierre en bois, un oeuf peint qui vient d’on ne sait plus quel pays d’Europe de l’Est, un calendrier perpétuel en bois, un Peppa pig en plastique, couché car il ne tient pas debout, à côté d’un portrait de Pessoa façon Pop Art à la Warhol etc. Le charme des objets et de leur combinaison, association. Petit cabinet de curiosités suspendu dans lequel le regard se perd souvent. Car on tourne le dos à la fenêtre. C’est de cette étagère que tombent les idées, ploc, à force d’être observée. Un lampe-clip verte sur l’étagère murale qui arrose le tout d’une lumière jaune assez forte et qui finit par chauffer les joues, aussi. Depuis quelques temps, le bureau est rangé. ça n’a pas toujours été le cas. Pas trop de piles de papiers, pas trop de poussière, signe que ça va mieux, qu’on domine un peu le réel en ce moment.
Pas de tréteaux en pin massif ni de panneau en structure alvéolaire, blanc, brillant, léger, trop léger. Pas de joli secrétaire, précieux, en merisier, cuir et laiton ni cette place à négocier, les soirs d’écriture, entre le boire et le manger. Pas de bureau. Pas de table de travail. Pas de tiroirs à ouvrir, à fermer. Pas de bannettes superposées, de chemises à élastique ou de pochettes coin, transparentes et colorées. Aucuns manuscrits. Ni feuilles pincées, agrafées, maintenues, ni courriers ouverts, dépliés, repliés, aucuns papiers volants, froissés, à ranger, annotés. Plus de câbles, de rallonges, de prises, de souris, d’écran, de clavier. Aucuns livres empilés sous le philodendron. Pas de pendule à rouages, de lampe articulée. Ni cahier, ni bloc, ni carnet à spirale. Pas de Moleskine non plus. Pas de pot à crayons, de dévidoir de colle ni même une paire de ciseaux. Pas d’enveloppes, pas de répertoire à onglets.
Mais une tablette.

Liste de choses posées sur mon nouveau bureau dans la pièce-bibliothèque anglophone
– la vieille chaise de ma grand-mère recouverte de la soie bleu-nuit et or de mon amie indienne
– des boites en carton, rondes, colorées, dans le coin le plus sombre
– une boite en bois de chocolats Valrhona où sont jetés quelques stylos plume dont celui acheté au Temple de la littérature à Hanoi, des surligneurs bleu, vert, jaune
– un cendrier plein de mégots, des kleenex, un biscuit rassis
– d’autres boites sur chacune des trois étagères arrondies ; la trousse de Bamako, des cartouches grandes et petites, un caillou brillant comme du mica dont j’ai oublié la provenance
– au-dessus une boite ronde pleine d’encres de calligraphie qui sèchent et d’autres bouteilles voisines. J’ai gardé la grande bouteille d’encre Waterman que ma mère avait rapportée de son bureau il y a des dizaines d’années de cela. Une « bulle » de Polo R avec son Ganesh de l’an 2000 et un tube de gouache que j’avais trouvé avec lui : « vert de vessie », « sap green » qui me rappelait le « vert pituite » au début de Ulysses de Joyce.
– De l’autre côté un hommage aux femmes : le coffret vide – les livres sont dans la bibliothèque – de Virago, comme un rappel à la rebelle ou bien aux virages de l’égo
– Et par dessus tout ça, la malle aux carnets, l’une d’entre elles, près de Cupid with drooping wings, l’amour endormi, l’amour endeuillé de Didon et un hommage à Frank McGuinness et à sa pièce The Carthaginians.
– Sur le mur à gauche Alechinsky, le calendrier des phares, la lampe de bureau et tout ce qu’on ne voit pas sur le rebord de la fenêtre.
– A droite une gravure qui représente ma ville natale au 16ème siècle enserrée dans ses remparts, une feuille de riz où mon pinceau un jour a glissé et L’Intérieur aux Barres de Soleil de Matisse
– Reste la pile de cahiers, de carnets, de livres : des crayons marquent les pages, un autre retourné et cassé. Ils envahissent la place jusqu’à recouvrir insidieusement l’ordinateur
– L’imprimante noire mange l’espace.
Ma table de travail – plutôt une console, qu’une véritable table – est située au fond de l’appartement, au bout d’un long couloir, presqu’à l’opposé de la porte d’entrée.
Deux portes très lourdes, très hautes, me séparent, m’isolent, du reste de l’appartement.
Je m’aperçois qu’il y a des heures plus propices à être là et que c’est souvent vers la fin de l’après-midi que je m’installe à cet endroit.
Elle est blanche, en forme de S très aplati dont la plus longue branche est une horizontale, plus grande que les deux autres : celle du haut, plus courte et plus fine, se termine en un joli biseau, portant en dessous un renflement très léger, sans arêtes vives, mais avec des ombres portées qui la matérialisent sur le mur blanc contre lequel elle est fixée, et, en trois jolies courbes - la seconde courbe montante à ma gauche referme le plan du « bureau-écritoire » alors que la dernière chute à ma droite en un angle ouvert qui va s’effiler le long du mur. Les objets peuvent rouler et tomber de ce côté. Elle dessine une forme simple, élégante, qui contente mon œil et me donne, à chaque fois, l’envie de m’y installer.
Pas de tiroirs. Rien qu’un plateau lisse, dans un matériau s’apparentant à du plastique mais dont j’ai oublié le nom réel. Très agréable au toucher, au contact : lisse mais pas froid, d’un beau blanc mat qui ne renvoie pas la lumière, et avec, lorsqu’on s’approche pour la considérer de près, de très délicates – j’emploierai le mot « cicatrices », mais ce n’est pas réellement ce qui convient à cette surface sans accident – « marbrures », plutôt, d’un blanc crème, grège – parce que j’aime ce mot qui froisse un peu - d’un gris léger. La matière dans laquelle on l’a moulée est certainement issue d’une refonte, d’une réutilisation de matériaux plus anciens et de couleurs différentes dont elle garderait une lointaine « mémoire » sur sa peau.
Très peu d’objets sur cette console, par manque de place et aussi par volonté de ne pas les accueillir : une figurine de porcelaine japonaise représentant un très petit chat porte-baguette blanc rouge et noir, endormi, qui retient de son poids l’agenda rouge ouvert à la page de la semaine en cours ; un stylo en métal bleu qui écrit aussi rouge et qui a un porte-mine ; un petit carré de canevas blanc brodé en damiers blanc, beige et dégradé de bleu avec deux formes bleues évoquant des nuages, posé sur la page de l’agenda ; une main gauche d’artiste en bois blanc à laquelle je passe ma bague, portée chaque jour, mais retirée très souvent ; un petit livre pour enfant de Katsumi Komagata dont la couverture bleue s’orne de caractères japonais blancs très fins, et dans laquelle a été découpée une ouverture en forme de poisson qui fait apparaitre la couleur bleu marine de la page suivante ; deux gravures très minutieuses représentant chacune un arbre – un pin, un sapin – choisies parce qu’elles évoquent les arrières –plans des toiles des Primitifs Flamands, sont posées contre le mur, entre les deux étages de la console en attente d’être encadrées.
Le premier tiroir de la commode qui se trouve derrière moi, à ma gauche, est rempli de feuilles de brouillon, ici, est aussi rangé mon petit ordinateur.
La fenêtre, sur la gauche, juste avant la commode, donne sur le mur Est de la cour de mon immeuble. Depuis ma table, je vois deux fenêtres : celle de mon amie, et, au-dessus, celle de la chambre d’étudiant(e) que les locataires, se suivant en se ressemblant, gardent tous incompréhensiblement ouverte, été comme hiver.
Le problème est de m’asseoir, car je n’ai pas encore trouvé de chaise, de tabouret, de fauteuil, qui s’accorderait à cette table spéciale.
Pour l’instant un tabouret blanc en forme d’œuf, au sommet aplati, sur lequel je ne peux demeurer plus de deux heures, tant il est inconfortable, a momentanément – depuis quatre ans - répondu au cahier des charges : ne pas prendre trop de place et pouvoir se glisser sous la console.
Aussi, je dispose d’autres lieux : mon lit, tôt le matin ou la table de la cuisine ou bien celle de la salle à manger lorsque je suis seule, la table basse du salon, la cheminée près du piano, ou encore une table de café, la rue, une voiture, le train, l’avion puisque j’ai toujours et partout avec moi un carnet, une feuille ou deux, un livre – oui ! Je me suis donné le droit d’écrire (au stylo) dans les marges – fantasme longtemps refoulé - un crayon, un stylo et aussi ce nouvel outil indispensable : un portable, muni d’un dictaphone, à qui je peux tout confier.
La table est là, massive, grande planche de 1,60 m, du chêne ? fabriquée par un maçon devenu menuisier, un cadeau… deux tréteaux qui pourraient s’incliner pour le dessin. Deux grosses dalles dotées d’une pomme croquée sont posées côte à côte… une 27 pouces, une 24 sans doute, une en fonctionnement, l’autre vieille roue de secours inutile, obsolète qui ne sert plus qu’à graver les dvd, le graveur plus récent ayant cessé…
Elles occupent l’espace, l’esprit, reflètent la pièce derrière quand elles sont éteintes… le jardin et la rue pour celui de droite, plus proche de la fenêtre…
Autour, deux claviers deux souris un téléphone fixe qui ne sonne pas un disque dur en panne qui permet à la petite chatte de s’asseoir au chaud… un autre disque dur qui contient des films des séries des photos des débuts… un livre de Qi Gong avec son dvd des crayons à papier un marqueur pour Cd deux disques de Moondog un carnet moleskine nommé journal intime un agenda un livre qui vient d’arriver pas lu De nos frères blessés de Jospeh Andras qui refusa le prix… de la crème pour les mains deux flacons d’eau de toilette à base d’huiles essentielles des gouttes fleur de Bach Olive un pot contenant une paire de ciseaux des stylos rouges un lecteur de carte SD un téléphone portable une bouteille d’eau un galet rapporté de Bretagne ovale rose gris vert doux la carte de cinéma une pile usagée des papiers inutiles ou pas à jeter ou pas des marques-pages des carnets une boîte de Dalfagan vide…
Au-dessus des dalles, un peu plus haut que le regard une étagère noire qui va tout du long du mur et porte des boîtes qui contiennent des papiers factures feuilles de paye des piges déclarations Urssaf un graveur de CD un tableau posé contre le mur un Bose pour la musique la radio des classeurs encore et collées sur le rebord de l’étagère 7 cartes postales assez grandes : de gauche à droite une photo achetée au photographe de Vézelay sépia une femme assise de dos dans la basilique à contrejour – une en noir et blanc une route qui va vers l’horizon sous un ciel de nuages une voirture au loin sur la voie de droite – une reproduction d’un tableau d’Odilon Redon le Bouddha – un autre tableau de Redon représentant un homme de trois quart avec une sorte de bonnet rouge (un moine ?) regardant une plante étrange qui traverse de haut en bas la partie droite de l’image sur un fond gris clair – une photo horizontale en noir et blanc sans doute à Vézelay une route déserte ensolleillée sous de grands arbres – un dessin à la sanguine une femme de dos nue assise qui s’essuie les cheveux avec une grande serviette blanche – sépia la même femme dans la basilique de Vézelay en plus gros plan de dos la lumière descend du haut à droite en un rayon puissant.
Des câbles informatiques accrochés aux équerres qui tiennent l’étagère… des cartes postales des reproductions de tableau des photos posées.

Sans sa fine couche d’huile-cire protectrice, elle serait barbouillée de taches d’eau, de sauce, ou de café. Elle est veines, petits nœuds et taches de lumière, encore belle malgré les ans. Les jours de chaleur elle sent très bon, la planche de chêne solidement fixée dans la pente du toit.
A deux bras, deux boites de petits pois extra-fins en costume de scène, serrant quelques feuilles A4 pliées en deux : des papiers d’importance. Boites en fer blanc peintes à mi taille, et remplies de crayons, feutres « Paper mate », ceux aux deux cœurs, bleu, noir et vert. Une brosse à dent bleu ciel.
Appuyés sur la poutre, un carnet à élastique et une boite de 100 fiches bristol 75X125 non perforées blanc , « Quand le désir de prendre disparait, les joyaux apparaissent » : la traduction de Françoise Mazet des « yoga -sutras » de Patanjali, avec ce sutra hindi en couverture.
La réserve de papier blanc, très facile à atteindre car rangée sur la gauche dans le dos de l’imprimante.
Calendrier papier 21X29,7 estampillé DEMELEM, artisan déménageur . Une petite boite jaune diamètre 3,6 cm - 6g de confiseries à la réglisse posée sur une petite boite en simili cuir noir sorte de coffre- fort contenant 3 clés USB, une montre de bureau en panne, et le collier de jade à faire réparer. « Keep this surface clear of any object » dit le Portable Dell souvent fermé, et surveillé de près par la souris à tête de souris avec petites oreilles et molette roses.
Pour le compagnonnage, toujours 3 ou 4 livres de petit format à très belle couverture empilés sous la pente du toit.
Pour la beauté toujours à refaire : un élastique et quelques pinces à cheveux, le bracelet en argent à double tête de Ganesh.
Et , suspendu à hauteur d’yeux : « one Inch high, half an inch wide » , l’instrument du silence, un tout petit ange à la harpe, ange musicien : merveille tordue à mains nues offert par l’ artisan indien, et qui a bien failli cette année-là , nous faire rater l’embarquement.
Et il faut dire le bruit environnant, c’est la porte d’entrée, la principale - A l’heure à cette heure une scie circulaire dans l’air on ne sait où, on est samedi de presque été, velux et fenêtres sont ouverts- Quitter la place on y pense mais… plus tard car tout… absolument tout se situe à un niveau historiquement bas et … à cause du primat des intérêts individuels sur l’intérêt général, malgré la montée du niveau des eaux, l‘incendie est tout prêt. Du moins c’est que pense, Ian qui a fixé le détecteur de fumées à un bon mètre de l’ange.
Tout de même …Ici on aime vivre !
Et on y cultive… quelques tics et mauvais plis, quelques manies, … d’écriture.
Une table ancienne, pas assez pour avoir noblesse, une copie sage de bon artisan comme il s’en trouvait à Lyon ou au Faubourg Saint Antoine dans les premières années du 20ème siècle ou les dernières années du siècle précédent, avant que les ateliers soient repris, un temps, par des artistes, une copie sage donc d’une table à écrire restauration.. pas vraiment un bureau, elle est trop petite, mais en acajou, avec des talons de bronze et un plateau gainé de cuir vert bordé d’un galon de feuillages dorés, gainage qui aurait besoin d’être refait..
Une table héritée, évoquant encore le bureau de l’aïeul et ces cahiers – de quoi garnir deux ou trois des rayons de la bibliothèque qui couvrait deux des murs – sur lequel il a écrit ses mémoires – une faible partie lue il y a très longtemps avec passion, le début, 1940, il n’a rien laissé sur les rezzous, la guerre de 14, la Chine, le Chili, le premier séjour en Indochine etc.. – qui n’avaient pas vocation à être publiées et sont en la possession du fils, dont la découverte impossible, ou compliquée, est un petit désir sagement endormi.
Une table donc où la présence d’un ordinateur semblait, au début, une intrusion, intrusion qui, de portable en machines de plus en plus grandes, a fini par prendre toute la place, puisque de toute façon l’utilisateur avait changé. Une table à laquelle on ne demandait pas d’être pratique, en fait elle l’est, juste d’être un ancrage.
Et sur cette table un fatras,
– des carnets ouverts et abandonnés parce qu’une note est un ordre impératif à garder à portée d’yeux sans jamais le lire ou y obéir,
– un bic qui se cache ou un crayon, et on se lève pour aller en chercher un dans le minuscule pot en terre, où ils sont plantés comme des branches s’évasant, en compagnie d’épingles à cheveux en fausse écaille, sur le muret de la cuisine, ou bien on ouvre un fichier pour noter l’idée fugitive..
carnets aussi de notes prises debout, auxquelles on recourt ou non, ou griffonnées dans le noir, pendant un spectacle ou en écoutant de la musique, notes encore plus illisibles que d’ordinaire mais qui ont suffi, souvent, à ancrer dans la mémoire la formule qui était née de l’écoute.
– un plumier, artisanat tibétain, vrai ou faux, acheté dans une boutique près de Pompidou parce qu’une envie de le toucher, parce que la boite en marqueterie discrète dont on voulait faire un cadeau était trop chère, plumier qui a contenu des crayons qui se voulaient raffinés et qui ont disparu peu à peu.. plumier que l’écran cache et qui est là comme une petite présence oubliée, des dimanches après-midi parisien où savourer le droit de s’ennuyer un peu
– un rectangle métallique pour visionner des DVD
– un cahier sur lequel une histoire a été commencée il y a une dizaine d’années, présence figée
– une lettre d’un petit Chinois auquel il faudrait répondre, seulement que diable lui dire
– deux ou trois mouchoirs froissés
– une miniature de marmite en terre qui sert de cendrier, avec un cigare éteint en attente
La table a deux tiroirs qui ont perdu leur clé, mais celle du chiffonnier, qui est derrière la chaise permet de les tirer, quand un peu d’ordre y a été mis et qu’aucun papier ne les coince – toujours possible d’y arriver mais cela peut nécessiter patience, ongles retournés et force jurons – où s’entassent blocs de papier à lettres, trombones, crayons oubliés, enveloppes, sous chemises vierges, contrats d’assurance, bail, trucs pour l’électricité, l’eau, la retraite, etc... le surplus, les relevés de banque, factures etc... - périodiquement jetés - occupant deux des tiroirs du chiffonnier, les autres contenant l’argenterie, les foulards les plus précieux, pour la plupart si vieux que ne sont là que pour les souvenirs qui s’y attachent...
Présence derrière le crâne, sur le chiffonnier, de ce qui pourrait être des dieux lares, un petit bronze, une copie achetée à la boutique du Louvre et offerte au père, une copie aussi de tabatière chinoise offerte à la mère, une minuscule danseuse – de Ceylan je crois – qui est un héritage, un bol à bouillie en argent, une petite coupe vide trésors (collier de perles cassé) et un dessin offert par des neveux, le portrait d’une forte femme soutien de famille comme un modèle rêvé
En un demi pas et une torsion, passer de la table au lit ou vice versa.
Et tout autour l’antre, les paniers ou casiers entassés peu à peu pour y mettre des livres, livres qui ont été rangés il y a quelque mois – l’opération a pris une semaine – par ordre alphabétique, avec des exceptions, ordre en voie de disparition et, en en cherchant un, parce que soudain nécessaire, une trouvaille vient presque toujours détourner l’intérêt, l’idée, ce qui devait y prendre appui.
Pas une vie, mais dix ans d’une vie en lente construction, présence invisible le plus souvent, juste là pour nourrir, en bien ou en mal.
Et puis, devant la table de travail, le principal, un crâne qui dérive, ou tente de se fixer, qui se défie de soi, qui tant bien que mal finit par mettre des mots dans un ordre, lequel ordre ne le satisfait que quand il ne satisfait personne d’autre.
Aujourd’hui, face à un mur aveugle, paré de briques peintes en blanc. Le bureau est bien plus long que large. Quarante centimètres à peine sur cent vingt. Forcément, ça contraint. A gauche, navajo d’origine, une statuette en bois, à peine peinte. Très fine, haute et droite. Puis le portable. Un Macbook pro treize pouces, branché au seul secteur. A droite de lui, une boîte noire contenant un jeu de cartes, les stratégies obliques de Brian Eno. Elles font office d’oracle les jours sans. Puis, à plat, "Glitz" de Leonard, chez Rivages/Noir. Plus loin, une petite souche grise posée sur la tranche. Elle soutient les livres du moment. Pas d’ordre. Shakespeare, un ancien Robert, un vieux Hachette, puis Enns, Reeves, King, la Gîta, Chopra, Kerouac, ses journaux. Shaw, Arden, Pressfield, Godin, deux fois. Huston, Shakespeare encore, Levitt and Dubner, Murakami, Auster, Sartre, Lamott, Dylan. Les Chroniques, le volume un, si tant est qu’il y ait un volume trois. Konnikova, McKee, Millman, Truby et juste avant le pot avec la plante dedans, le John Hegarty dédicacé. "Don’t be ordinary" qu’il a marqué sur la trois à l’aide d’un ball pentel vert, mais à l’encre noire, comme ceux avec lequel le père signait les mots dans le carnet de correspondance.

Il s’agit d’un morceau de bois, rectangulaire, plus ou moins, une forme de léger trapèze, c’est installé sur l’entrée d’une fenêtre, ça repose sur des tasseaux, de section carrée, de deux centimètres de côté, il en est trois, deux plus courts où on a pratiqué deux trous à la perceuse, évasés vers l’avant afin que la vis qui y pénètre, une fois complètement introduite, n’en dépasse plus – sur le long, sous la fenêtre si on veut bien suivre, trois orifices de cette sorte ont été réalisés - le morceau de bois tout con fait quelque chose comme un peu moins d’un mètre de long sur soixante centimètres de large dans ses plus grandes dimensions, épaisseur quatre centimètres au bas mot, il ressemble à un plan de travail de cuisine (d’autant plus que c’en était un avant son usage récent et dévoyé, donc), on peut y voir en regardant bien quelques scories d’un crayon taillé tout à l’heure, le genre de crayon rouge d’un côté bleu de l’autre dont se servent menuisiers ou autres quelque chose (un exemplaire de ce type d’ustensile figure au journal, vert d’un sens et jaune de l’autre, plus rare, trouvé un jour dans l’un des caniveaux qui constituent le milieu de la rue bordée d’immeubles où, naguère ou jadis on ne sait plus le dire, se tenait (se tient toujours) l’un d’eux, du numéro vingt, au cinquième étage droite duquel, si on pouvait y entrer, on trouverait, dans le même état qu’il y a sept mois, les restes du vrai – ici on ne décrira que celui qui, dans l’esprit, sert aujourd’hui à produire ce texte - d’un genre directorial acheté au bazar, voilà plus de vingt ans, long de deux mètres large d’un trente, en beau bois blond, doté quatre tiroirs glissant sur des genres de rail à l’aide de petites roues de polystyrène blanc pour en faciliter l’ouverture – et par là, la fermeture – et sur le plateau duquel demeurent encore les trois tomes des lieux de mémoire, posés en pile sur laquelle reste probablement l’omnibus de l’atlas des noms des villes –le titre s’est échappé dans les limbes – qui repose sous le Bon Usage de (Maxime ?) Grévisse, le tout recouvert d’une assez épaisse couche de suie : l’évocation, plutôt pénible et blessante, de ces restes impose de s’en tenir là dans l’inventaire de ce meuble-ci et de fermer cette parenthèse qui n’a que trop duré).
Puisqu’il est devant une fenêtre, ce morceau de bois tout con, on n’y pose rien, sous peine de ne plus pouvoir l’ouvrir (la fenêtre, pas le bureau) (ou ce qui sert de, donc) , ou alors on travaillera fenêtre ouverte, laquelle donne directement – on se trouve au quatrième étage sur rue – sur le Magenta (ainsi que le Marengo, ce nom-là (si on voulait faire dans le pédantisme on parlerait de toponyme) évoque de nombreux autres déploiement dont on ne choisira ici qu’un seul, le titre d’un album de Willy DeVille) qui, outre la couleur certes, pointe directement sur ce que le chanteur avait retenu du Parisien : vers sept heures du soir, qui regagne quelque intérieur esseulé, familial ou qu’en sait-on ? tout en rognant sur la baguette peut-être molle et sûrement tiède achetée à peine antérieurement, laquelle baguette, très souvent de nos jours et dans ce quartier, se trouve affublé d’un « traditionnel » écoeurant rabougri en « tradi » à un euro vingt la pièce, et passant donc de la couleur à la baguette et à son prix, on se remémorera peut-être qu’en des temps anciens, les années oui (numéro deux mille chez folio), la presque même flûte de pain se négociait dans les cinquante huit centimes (on était en nouveaux francs, avant soixante, il se serait agi sans doute de cinquante francs, puis l’érosion, l’illusion, l’inflation ont eu raison de ces évaluations), ce qui indique qu’en quelques années, la culbute –si on ose- s’est effectuée plus de treize fois (à six point cinquante cinq quatre vingt quinze, approximativement – source institut national de la statistique et autres – cette baguette trade demandera plus de sept francs quatre vingt sept pour l’acquérir –virtuellement, certes – soit un quotient de treize et quelque sur le prix d’alors). Cette baguette était achetée, parfois, par l’auteur de ces lignes (il en faut un, malgré toutes les restrictions imposées par l’exercice) au coin nord-est du carrefour opéré entre les rues Merchier et Desmoulins d’une ville, A., du nord (le coin nord-ouest dudit carrefour était occupé par la maison des F., si on n’abuse pas trop sans balancer non plus, propriétaires de celle située sur le coin du même carrefour, mais sud-ouest) dans un magasin épicerie dépôt (donc) de pain nommé Familistère (dans les verts et les jaunes, comme le hasard fait bien les choses n’est-ce pas), prix reporté sur une note réglée par la maîtresse de la maison du coin sud-ouest (au coin sud-est, le quatrième, le dernier du carrefour, soyons précis et exhaustif, gît une autre villa maison construction immobile) maison du coin sud-ouest donc, et addition réglée en fin de mois ou début du suivant par la maîtresse d’icelle – bien qu’elle cessât ce règlement tempéré du fait des excès (notamment en gâteaux roulés aux chocolat, chips et tucs, semble-t-il) dus, plutôt, à la partie mâle de la fratrie qui vivait alors en cette maison de trois niveaux (numéro de rue : cent quarante et un) au deuxième étage de laquelle, au fond du couloir, à gauche, se situait la chambre dite alors verte. On n’avait pas à l’esprit, puisqu’il n’en était pas –probablement- question encore dans l’esprit tortueux courbe ou ondoyant du Truffaut de réaliser un film portant ce titre frappé au coin de la métempsychose (« La Chambre verte », 1978), de référence particulière et cinématographique pour la dénommer ainsi, mais simplement la couleur des murs, avant qu’elle ne fut repeinte d’un blanc tout con – au sol, un plancher de bois chêne - sur lequel on avait placé un lit (une place), une armoire plus une table qui faisait office de bureau (la provenance de cette table-bureau était la salle des vente de la rue de la Préfecture (la ville du nord s’enorgueillissait en effet d’appartenir à cette catégorie républicaine)) composé de quatre pieds plus un tablier en bois brut passé au brou de noix par ladite maîtresse de maison (laquelle disposait de ces lubies : brou de noix, pantalons courts – type bermuda - au dessus du genou pour les garçons tout autant que coupe de cheveux en brosse : d’où tirait-elle de tels hantises, l’histoire, ici, restera muette…) sur lesquels l’occupant des lieux placera, plus tard, bien plus tard et uniquement, les trois éléments de marque Dual composant une chaîne hifi (on disait ainsi, à l’époque), deux baffles plus une platine tourne-disque (ce qui fait trois) agrémentée en son axe d’une sorte de petit pylône sur lequel on pouvait entasser, si le cœur en disait, cinq ou six (je ne me souviens plus) disques trente trois tours afin de les écouter les uns à la suite des autres, vaguement effondré navré ou alangui sur le lit, fenêtre ouverte donnant sur un jardin au milieu duquel on peut discerner sur la photo (si l’hôte d’ici pouvait la poser là, on comprendrait mieux bien que l’arbre n’y figure plus, sinon se reporter en début (ou en fin ?) de billet texte article déploiement d’atelier d’écriture d’été) un arbre, un poirier qui ne donnait pas, ou jamais, ou alors seulement un ou deux fruits durs comme la pierre mais toujours, et cependant, attendus avec une sorte d’espérance qui ressemblait, en ces temps lointains, à quelque chose comme l’amour de la nature.
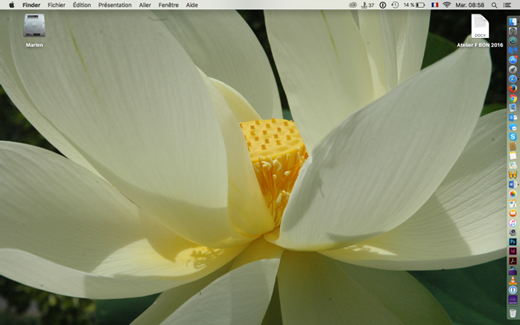
C’est un espace non confiné qui s’étire – de l’angle d’une pièce à quatre fenêtres où un bureau de bois gris en L s’ancre dans un mur – jusqu’à un autre angle où une bibliothèque domine une table ventrue en carton coloré, vert pomme et rouge framboise, débordante de livres en attente d’être lus ou à rendre. Sur le bureau de bois gris une trousse en cuir blond, deux vide-poches, deux plumiers, deux encriers, trois pots à crayons, une mémoire usée à trente-deux soufflets et autant d’années pour distribuer le travail du mois, des chemises rouges, vertes, bleues empilées dans un coin, une imprimante, trois disques de sauvegarde, un IPad, une lampe en métal blanc, une liste de numéros de téléphone scotchée au mur qui date du temps où elle n’utilisait pas de mobile, ni la fonction ad hoc du fixe, quand elle disposait encore d’un téléphone fixe ; c’est au mur un tableau métallique gris où s’accumulent les cartes postales les dessins les photos les mémos retenus par les magnets des Rencontres de la photographie d’Arles – le coq, la girafe, le rhinocéros, la banane… – et au-dessus, sur une mini-étagère, une boîte de papier et d’enveloppes, une boîte de cartes de visite, une boîte de cartes postales, trois photos d’enfants dans des cadres, une bonbonnière ancienne en verre remplie de petits galets et de coquillages ; plus haut encore, c’est une étagère de livres de poésie, avec une peinture qui représente une femme à tête d’oiseau et derrière le bureau une bibliothèque en pin brut pour les dictionnaires, les livres de référence, les brochures culturelles, une radio, les cahiers, d’autres chemises cartonnées multicolores, les classeurs blancs, jaunes et roses fuchsia, toute la papèterie vierge encore de marques, de traces, d’écritures, et se frayant partout une place au milieu de l’espace, ici sur le bureau, sur la table en carton, sur le lit de la chambre, dans l’herbe au dehors, un ordinateur MacBook Pro, son bureau mobile, sa table de travail baladeuse. L’icône du disque dur dans le coin gauche, à son prénom, le dock à droite et la corbeille en bas, aucun fichier sur cette métaphore du bureau, tout est rangé, impeccablement, seul parfois le document en cours est posé là sur la fenêtre de l’écran. Tout est dedans, l’ordinateur contient tout : son univers rêvé, toute sa réalité, virtualisée. C’est un espace qui transgresse les cloisons, ouvre sur la chambre et au-delà sur la nature, c’est un bureau dans la nature aussi.
Le clavier est bancal, il a les pieds sales, les touches de volume et de lecture sont inutilisées, donc poussiéreuses. Sur la Live box, vaguement cachée derrière l’enceinte droite, les emballages des vieux magasines s’amusent à défier l’effort de non-procrastination. Ils sont trois. Le petit dernier, celui qui n’est pas encore déballé, veille. De l’autre côté du disque dur externe depuis lequel, chaque jour depuis la lecture du Style et l’Idée, s’extraient les expressions musicales d’Arnold Schönberg. Et des post-it à l’envers, à l’endroit, jaunes et roses. Il y en a même un bleu, derrière l’enceinte gauche. Et devant, quelques disques audio avec le code barre de la bibliothèque.
À droite, la tablette éteinte enlève un peu de lumière à cette partie de la table de travail. Elle ne jure à pas entre les casiers de rangement tout aussi noirs, écrasés sous la paperasse en retard, et le petit carnet type Moleskine qui après des années de veille et de vide est devenu aussi indispensable que la foi en la consistance de ce qu’on y abandonne. Si on veut retrouver un peu de lumière, il faut prolonger le regard et alors, on atteint les polycopiés rangés, les cahiers en cours de remplissage et au milieu, l’écho obscur du casier et de la tablette, le Guide Officiel du jeu Skyrim, cinquième opus de la série Elder Scrolls. Un peu plus loin, quelques classeurs qui rassemblent d’une part les cours de l’année passée et les documents de travail du mémoire, principalement des textes épistolaires de Theodor Adorno, Thomas Mann et Arnold Schönberg.
Ce monde repose sur une table espagnole aux jambes de bois et de métal. Elle a remplacé le bureau orange dont s’est maintenant emparé le découvreur de monde de la maison, du haut de ses six ans tout neufs.
Pour en finir de faire le tour, il faut lever la tête ou regarder droit devant selon que l’on a choisi de profiter ou non de l’infatigabilité du siège ergonomique tout bleu qui n’en finit pas de s’éroder. On tombe nez à nez avec ce qu’il est difficile de dissocier ou d’associer à l’espace de travail : les livres. Quelques essais et recueil de poésie à gauche. Roland Barthes et Walter Benjamin s’embrassent goulûment, Pierre Hadot se repose sur eux, on se demande ce qu’il a en tête. Régis Debray va les rejoindre d’ici quelques heures ou quelques jours. Je suis rassuré, il ne sera pas le seul vivant du lot. Toujours plus haut, sont perchés ceux des mes livres à lire qui patienteront un peu plus que ceux de l’autre étagère, sur le mur opposé.
Les dictionnaires, les ouvrages de travail : Goethe, Mann, Hesse, Schönberg, Adorno et leurs copains. Les premiers sont au dessus, les seconds en-dessous, plus accessibles. Lorsque l’on fait pivoter le siège ergonomique en tâchant de ne pas le désolidariser de la paire de chaussons qui lui sert de chaussures pour éviter de rayer le plancher, on découvre l’espace de travail musical. Découvrir, ce n’est pas complètement vrai puisque c’est la première chose que l’on voit lorsque l’on entre dans le bureau. L’écran de l’ordinateur portable s’appuie contre le mur, sous la petit fenêtre, la seule qui était déjà là avant les travaux. Elle garde de l’œil constamment ouvert sur un cochon, une lampe torche sans piles, une toute petite paires de sabots fabriquée par un vrai sabotier, des pots à crayons inutilisables, un vieil enregistreur numérique, une flûte traversière en bois et son petit frère, le fifre, une bombarde à huit clés, une équerre, une bouteille de Perrier, un carnet Moleskine encore emballé mais qui n’aurait jamais été là s’il n’avait fallu vérifier l’orthographe de Moleskine, une boîte d’anches, une carte son externe, la lampe posée dessus. Si les chaussons n’ont pas encore péri un dernier mouvement dirige le corps vers la dernière partie de l’espace de travail : le piano numérique, le looper et l’octaveur de la flûte traversière. C’est le plus important. S’il est parfois difficile d’écrire avec musique, il l’est encore plus d’écrire sans. Le silence ne vaut que par sa musicalité, la création avec des mots passe par la création avec des notes. Une intrication de mots et de notes qui ne voyagent pas dans le même compartiment, parfois pas dans le même train, mais qui ont besoin d’être conscient de leur existence propre, de leurs existences. Improvisation, élaboration, structuration. Création. Dans un ordre ou dans l’autre. Les boucles au piano parfois, l’élancent après quelques tâtonnements. Elles ne sont pas propres, mais elles ne sont pas plus redondantes que la matière répétitive qui rythme son environnement : des livres, des livres et des livres. Mais le biais de la répétition, c’est la variation. Alors l’écriture et la musique prennent du sens. Et puis dans un moment beau, la variation s’individualise, pose sur la matrice le regard amusé et espiègle de l’enfant en haillons qui s’apprête à s’enfuir dans les bois et qu’on ne reverra jamais.
La table de travail est un bureau en plaqué chêne clair, de type IKEA, installé latéralement dans le renfoncement d’une alcôve, juste dans l’entrée de l’appartement.
Sur son côté gauche, celui de l’ouverture sur le reste, elle est bordée de deux tours de livres — environ 7 ou 8 — dans un équilibre précaire. Au sommet de la pile la plus extérieure, on peut lire de travers Un Privé à Tanger/Emmanuel Hocquard, tandis que sur la deuxième, Daniel Arasse, On n’y voit rien, est prêt à dégringoler. A la même hauteur, tout contre, une corbeille à courrier de bureau en métal déborde, le papier du dessus, un document administratif, arborant une typo Comic Sans orange (quelle idée ?). Lorsqu’on l’a déjà vue, on reconnait sans confusion possible l’en-tête de l’Ecole d’art de Grenoble. A côté de la corbeille, en contrebas sur table de travail, une boîte rouge en forme de cœur avec l’inscription « Lubeck » contient des trombones qui ont remplacé des chocolats. Encore à côté, dans le même esprit, une ancienne boite de thé « Harrods » est remplie de clés USB. Puis, on trouve éparpillés un bloc de post-it fluo séparé en plusieurs parties, dont certaines feuilles gribouillées, avec des occurrences rayées, d’autres entourées, ont été collées un peu partout.
Sur le côté droit de la table, quatre pots à crayons métalliques (assortis avec la corbeille à courrier) regorgent de feutres, de marqueurs, de stylos publicitaires, auxquels s’ajoutent une paire de ciseaux, du Typex, de la colle... Un crayon bleu avec une grosse gomme rouge en forme de dinosaure émerge et se distingue nettement de ses congénères. Tout au fond derrière, à l’angle du mur où est calé le bureau, quasi inaccessible, un encrier poussiéreux contient un peu de liquide. Devant les pots à crayons, la zone est occupée par une collection de marqueurs jaune, orange, vert et rose en forme de missile et une vieille gomme massacrée au compas et au stylo bille. Il y a aussi une agrafeuse et une perforeuse.
Au centre, dans un espace laissé à peu près vide, l’ordinateur constitue une table de travail en abyme. Sur un fond de cerisiers en fleurs, les dossiers bleus des travaux en cours sont alignés tandis que des icônes de captures d’écran, d’images et documents divers, Word ou PDF, sont restés dans la position où ils se sont affichés automatiquement. Sur le pied de l’ordinateur, un peu dans l’ombre mais bien au milieu, trône un petit éléphant en tissu rouge lamé or auquel est attaché une chaine et au bout un porte-clé.
Enfin, il ne faudrait pas oublier les murs qui entourent la table car ils sont décorés de plusieurs images, assez hétéroclites. De gauche à droite : une photographie d’un mur fissuré où est écrit « Repenti » ; dessous, sont posées trois cartes postales de paysage presque identiques ; de même, mais plus monumental, un livre est installé comme une stèle, ce qui contraste avec le texte qu’il porte en gros sur sa couverture, « salu poto voilà une recharge : 256686880 G vu les photos de paysage et g 1 idée… » ; un cliché noir et blanc d’Ernest Hemingway avec un espadon géant, dans un cadre argenté sur lequel est posé un poisson en plastique jaune et vert. Sur le mur perpendiculaire, est accroché en hauteur une grande peinture monochrome blanche avec juste un cercle noir au milieu et des trous au milieu, telle une cible atteinte ; plus bas elle est accompagnée de quelques cartes Pokémon fixées au mur par un bout de scotch, un tigre tracé au crayon sur un carré de papier calque et sur une feuille jaune une sorte d’animal avec des grandes oreilles dessiné au feutre marron portant en rouge la mention « Pour maman chérie ».
la table de travail c’est le bord de la fenêtre
une nuit il y a le feu sur la table de travail - le feu marque le bois c’est du chêne de Haute Savoie - longtemps la / cette table de travail c’est pour peindre sur des petits formats - et puis - je me souviens du bond de nos corps - la nuit avec le feu sur la table de travail - dans une pièce avec un fauteuil rouge un grand portrait de Kurt Schwitters sur le mur blanc et un portrait de El Cabrero et - je ne me souviens plus
un collage une main les sublimes noirceurs une photographie découpée dans Libération du 14 janvier 2015 un soldat armé tourne le dos à un homme - homme bras gauche levé- on voit l’ombre de l’homme sur un mur- Israël Palestine - des carnets pour écrire dans le noir des salles de cinéma au concert dans le tram dans le train dans la rue
sous la table de travail six tiroirs empilés deux avec des trucs administratifs - un avec des tubes de peinture des pinceaux - un avec des photographies et le dernier avec des carnets et une lettre - une lettre de Manchester d’un ami étudiant en cinéma
la table de travail c’est pour avant l’écriture - l’ordinateur (qui est foutu aujourd’hui) est sur une table rouge dans la chambre - d’ ailleurs si jamais vous avez un bon plan pour un ordinateur pas cher je suis preneuse - c’est infernal sans
il n’y a pas de rideaux aux fenêtres - pas de bibliothèque dans aucune pièce les livres sont maintenant dans des cartons, prêts pour un futur déménagement - dans chaque pièce des piles de livres restent là pour - couper le silence
Quand le propriétaire des lieux n’y est pas assis, on peut depuis cette position confortable (allongé sur la table de salle à manger à soixante-quinze centimètres du sol avec vue sur la cour et les oiseaux passant) voir ceci : une planche de bois clair non verni (bonjour les futures taches de café), clouée à droite à même un socle constitué de deux caisses de vins (notamment un Château Batailley, Pauillac, Grand Cru Classé) posées à leur tour sur une vieille caisse à on ne sait pas vraiment, qui contiennent vers l’extérieur (direction canapé et grand miroir de deux mètres de haut et un de large) une série de polars des Editions Viviane Hamy, quelques uns en format poche de la Série Noire, mais aussi posé horizontalement Le Quatuor d’Alexandrie d’un certain Laurence Durell, vers l’intérieur (direction sous la planche et dès lors pas facile d’accès mais ça le regarde, direction jambes du propriétaire plus simplement) des enveloppes blanches (une trentaine) qui peinent à tenir debout car négligemment coincées entre la paroi de bois et un dérouleur de papier collant inoccupé à l’heure actuelle, donc fort mal soutenues d’un côté (c’était prévisible), deux plumiers noirs bourrés de feutres, bics, crayons, marqueurs, gommes comme un bon élève se doit d’avoir, des carnets de tailles et couleurs diverses, bleu, fushia, vert, noir, certains vides (espoir d’avoir des projets) d’autres remplis de notes, croquis, remarques, commentaires (des projets concrétisés), et clouée à gauche sur une tablette à roulettes (elle-même bricolée pour être stable) qui sert essentiellement à supporter des plantes (treize pots), petits cactus, tombantes ou à larges feuilles, toutes de nom inconnu - et c’est peu dire que la plus grande devient clairsemée, aurait-elle une maladie - d’autres plantes d’envergure modeste se retrouvant sur le front de la table de travail, contre le mur qui surplombe un chauffage (peu utilisé, un autre dans la pièce faisant son office à suffisance) judicieusement disposées sur un montage de caisses en bois à nouveau, l’une ayant contenu une bouteille de Cognac (à peine bue et assignée désormais en cuisine), une autre étant un vieux classement pour fiches de carton en position debout (souvenir paternel et cela semble important) et enfin une caisse de vin rebelote (Château Croix du Casse, Pomerol, 1986, c’est comme ça). Certaines de ces plantes ont un cache-pot, qui bordeaux, qui brun terre, qui noir à arabesques turquoises, glanés sur des poubelles la plupart du temps mais également une petite casserole rouge qui a beaucoup plu à Philippe Girault-Daussan d’après ce qu’on a pu lire dans un commentaire sur Facebook. Derrière les plantes se plante (pourquoi pas) plutôt sur la gauche un miroir tout piqué aux formes sensuelles (encore une acquisition un soir de poubelles) au pied duquel on trouve un soleil doré d’une vingtaine de centimètres de diamètre, venu on ne sait plus d’où et ça n’a pas grande importance, un autre miroir plus petit et vertical, sans doute marocain parce qu’un encadrement métallique doré (mais rien ne l’atteste et c’est peut-être péruvien) qui fait pâle figure entre ses grands frères, disparaissant presque derrière deux tentatives de faire pousser des noyaux d’avocats, initiatives probantes pour l’instant, bien que l’une des deux souffre de taches brunes au bout des feuilles, une explication à trouver nécessairement. Trois cartes postales forment d’intéressantes pauses graphiques dans cet ensemble de chlorophylle : une photo de Jean Genet à New-York, noir et blanc, Genet étant légèrement penché vers l’avant (il est beau, plus trop jeune), un dessin représentant deux mantes religieuses qui discutent le coup au-dessus d’une phrase en anglais trop loin pour arriver à la lire et une jolie composition pleine de couleurs sous le titre New-Yorker. Cette dernière carte a le coin inférieur gauche rongé par la terre humide qui entoure un des noyaux d’avocat. Avant d’en arriver au plan horizontal en bois clair, relevons dans la caisse de Pomerol 1986 une série de livres et pages reliées par des anneaux en spirale où on découvre les noms de Georges Perec (trois fois : Espèces d’espaces, La vie mode d’emploi et L’art et la manière d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation), Annie Ernaux (deux fois : Regarde les lumières mon amour et Les années), Hubert Haddad (deux fois : Le nouveau magasin d’écriture et Le nouveau nouveau magasin d’écriture), Thomas Clerc (une fois : Intérieur), plusieurs fascicules encore (et notamment Ateliers d’écriture auprès de personnes fragilisées, édité par le réseau Kalame), et ce n’est pas rien, Candide, nom que l’on trouve aussi sur un carnet noir posé sur le plan, on y reviendra. A cette bibliothèque réduite, le propriétaire se consacre régulièrement et à toute heure du jour, on l’observe passer de l’écran aux livres derrière l’écran, rêvassant à la lumière de la fenêtre qui ouvre sur la gauche de l’ensemble dont question ici. Des câbles qui ressemblent à de piètres casques sonores, un chargeur téléphone avec sortie usb et quelques crayons et feutres occupent un pot à motifs bleus qui finit la partie murale de la table de travail. Posés sur cette planche au nom de table (un bricolage récent c’est indubitable) deux baffles en plastique gris destinés à améliorer le son venu de l’ordinateur mais s’étant révélés plus insupportables encore, on ne les utilise plus, on suppose que les voilà en attente d’être jetés un de ces prochains jours. A gauche de l’ordinateur portable, quel euphémisme pour un encombrant modèle en pathétique plastique noir d’origine chinoise, dont l’achat est regretté amèrement tant se révèle fastidieux le déplacement de la machine (projet d’acquisition légère taraude le propriétaire qui attend sans doute des finances plus ensoleillées), gisent quatre carnets noirs d’épaisseurs inégales, l’un porte la mention (sur la tranche) de Cour Intérieure et y logent des notes sur le travail théâtral de proximité, un autre Carnet 2 (toujours sur la tranche) ayant pour fonction l’écriture manuelle qui chatouille des fois, un troisième celle de Candide (on le savait et est-ce besoin de préciser sur ce qui y est écrit quand on sait que l’oeuvre de Voltaire est à quelques centimètres à peine) et le dernier aucune mention tant il est fin et abîmé (probablement que des séjours en poche lui ont fait la vie dure). Devant le quatuor de carnets et voisins des plantes mentionnées plus tôt, un tas (pas d’autre mot) de papiers dont les premiers visibles comportent des lignes rouges, des cases, des codes, une enveloppe brune et un mode d’emploi terne qui affiche Exercice d’imposition 2016 (piètre titre pour une oeuvre). Sur ces papiers non désirés s’appuie un ancien lecteur dvd blanc et noir de marque Panasonic, qui a bien servi lors des trajets en vacances quand les enfants s’impatientaient du temps infini pour rejoindre la région de Cahors tant aimée. Rien d’autre à gauche donc passons à droite du matériel informatique décevant et observons un globe terrestre lumineux, identique à celui de la chambre d’enfant, vestige d’une réalisation théâtrale qui vit une oeuvre de Jules Verne adaptée sur scène et son titre inutile de le citer, l’image est claire. Il se tient sur le coin supérieur droit de la planche/table quand on regarde d’en haut (pas inutile de resituer dans l’espace, on s’y perdrait) et sa lumière éclaire un pot jaune qui contient encore une plante aux petites feuilles grasses. C’est là que les plus futés remarquent caché par le pot un Stabilo Boss orange comme certains pays sur le globe, joli rappel somme toute. Un porte-mine noir accolé à un mince bloc de post-it jaunes, lui-même menant à un grand cahier noir ouvert sur une page qui voit deux noms affublés de numéros de téléphones portables (des personnes à appeler ou peut-être est-ce déjà fait, ça le regarde) et une carte postale représentant un trompettiste devant des têtes en contre-jour (et mention suivante : Vos bons plans de sorties sur culture.lozère.fr) complètent la description de cette table de travail. On sent bien que le tout hésite entre jardin d’hiver et bureau improvisé mais de toute évidence du temps est passé là et quand le propriétaire accueille une présence comme la mienne sur ses genoux, le boulot avance mieux, ceci dit sans prétention.
Un MP3 a été déposé sans précaution aucune sur un livre dont seules les trois premières lettres du titre sont lisibles « Esp… ». Sous le livre, plus exactement pris entre ses pages carnivores, un texte photocopié dépasse de chaque côté :« Ce fragile fut…. scène » par Edward Bond. La feuille est écornée et certains paragraphes cochés au stylo.
A côté, une plante échevelée a pris racine dans un pot noir. Les longues feuilles rubanées surplombent un cadre dans lequel tous les visages sourient. Telle est la vie que l’on encadre, celle qui chante le bonheur. L’autre, la réelle, est trop fuyante pour bien vouloir se laisser enfermer. Certains ont essayé pourtant.
L’écran de l’ordinateur a été ouvert et de ce fait cache une partie de la table de travail. Il en dépasse sur le coin gauche trois crayons à papier, deux stylos rouge, quatre bics, deux feutres noirs , une lime, outil indispensable pour stopper l’envie récurrente de se ronger les ongles et un marque page doré. Il manque à la panoplie le stylo à encre Mont Blanc car il n’est jamais placé à la verticale lorsqu’au repos et encore moins dans un pot avec les autres outils d’écriture communs. Il est probablement derrière l’écran souvent en première place.
Le porte lettre à gauche a été tellement rempli qu’il déborde de toute part. Le mot « porte lettre » n’existe sans doute pas, le cliquetis des touches du clavier de l’ordinateur vient de le créer. Il est en fer noir et représente un chariot amish dont l’immobilité évoque son contraire, le déplacement. Sont déposés en vrac entre ses 2 côtés un nombre impressionnant de factures, un marque page papier, un dépliant qui se donne à lire en bribes « de 10h à 20h, mardi 15, co-cuisine, réunion animation, groupe d’achats, 20h30 atelier
d’écriture ». Une enveloppe rouge tranche sur les couleurs de l’encre. Elle est fermée.
Devant le dit porte lettre, une pierre anthracite presque triangulaire a été placée sur sa base plate. Ses deux facettes suggèrent une montagne. Une main peu artistique a tenté d’affubler cette pierre d’un capuchon de neige avec ce qui ressemble à du plâtre blanc. Seul un grand rêveur peut imaginer qu’elle représente le Fitz Roy ou plus exactement le désir d’immortaliser un souvenir. Il manque à cette représentation sa vie intime, les nuages, qui toujours le protègent des assauts humains.
A côté de la pierre, une mappe monde dont la tête a boulé : le pôle sud trône en haut, l’Australie se lit à l’envers et la pointe de l’Inde montre du doigt l’Océan Indien. La Patagonie doit être sur la face cachée, le Fitz Roy impossible à situer ; il est par conséquent bien à sa place.
Contre le mur, l’ombre d’un bouquet de fleurs de montagne s’est projetée sur la pierre lorsque la lampe de bureau a été allumée. Les fleurs figées dans le vase sentent le salpêtre. Sous la lampe, trois fioles de sable- rouge, blanc, gris. Pourquoi ce sable y a-t-il été enfermé ? Peut être que cette poussière de terre déterritorialisée cherche à présent une histoire. Il faudrait jeter ces fioles à la mer.
La pile à gauche de la table de travail a été laissée en friche. C’est là que vit la vie, celle qui échappe, reprend ses droits, loin de la main qui pose et dispose, prend et enferme. Dans cette friche, des lettres adressées restées sans réponses, des enveloppes précipitamment déchirées, des histoires en points de suspension.
Sur la table de travail, l’ordinateur a été ouvert comme une huître car il en est une. A côté, un dictionnaire à la page 945 affiche en gras deux mots : humanisation, humeur. Ce dictionnaire-ci est un humble livre humanoïde, d’humeur toujours bavarde. Il classe en colonnes contrairement à l’ordinateur qui, lui, préfère la toile.
Point d’orgue.
Elle n’a pas de table de travail
Un jour, elle s’installe sur sa table de cuisine-salle à manger
Une table à tréteaux provisoire depuis des années
Un bouquet de fleur, des pivoines mélangées à des orchidées d’une même couleur rouge saumoné
Une corbeille de fruit, des bananes, des kiwis, du jaune du marron
Une tablette de chocolat cachée dans un tiroir derrière elle
Elle est assise sur une chaise, pas très confortable
Derrière elle, les placards, les plaques de cuisson, l’évier, le plan de travail, le four, le frigo qui ronronne de temps en temps, le grille pain, la bouilloire, la cafetière, une plante, des dessins d’enfants, des photos de désert, des affiches de film « de l’influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites », « les ogres »...
Devant elle, le dos du canapé qui fait face à la baie vitrée derrière laquelle des fleurs, œillets, fuchsias, campanules, géraniums, chèvrefeuilles égayent le ciel gris de la ville
Elle voit les arbres
Elle entends, les enfants qui jouent, les passants qui parlent, les motos qui roulent
Elle branche son ordinateur, elle ouvre une page blanche
Elle prend des feuilles de brouillons, un stylo à bille, elle en a un stock
Elle écrit des mots, des sensations
Elle écrira sur son ordinateur après
Elle n’a pas de table de travail
Un autre jour, elle s’installe sur son canapé moelleux
Elle s’installe confortablement, un coussin au creux des reins, un coussin derrière la tête
Un coussin sur le ventre, son écritoire
Elle écoute de plus en plus loin la musique qui joue sur son lecteur de CD
Elle écoute ses sensations
Elle écrit sans savoir quoi
A sa droite sa table basse, un verre est posé de l’eau le plus souvent
Son téléphone est à porté de main
Son ordinateur est branché pour le moment où elle transcrira son ébauche d’écriture
Elle aime être allongée pour écrire
Le repos de son corps laisse place à la rêverie
Derrière elle un secrétaire sur lequel est posé une lampe, un masque africain, un coq portugais, une plante
Sur le mur sont accrochés d’autres masques, une aquarelle
Devant elle une peinture, œuvre contemporaine, dominante rouge, éclaire le blanc des murs
Elle n’a pas de table de travail
Elle aimerai s’installer à une table de travail
1. Sur le bureau juste avant les notes,
lampe : pied inox flexible, dépôt de fine poussière grise, abat-jour conique ferraillé marron, photo aimantée de Toute Petite, abeille joufflue magnétique bleue ailes violettes, girafe-serpent magnétique, spirale de lumière basse consommation ton chaud,
calendrier grand format « La Route du Rhum-Banque Postale 2011 » : balafres au stylo, crasse grise à la posée des avants-bras,
petite trousse bleu sale : bouts de crayons, grosse gomme triangulaire blanche traces noirâtres,
pot de fleur terre cuite rouge bariolée coups de pinceaux enfantins : feutre bleu V5 Hi-Tecpoint Pilot, deux stylos bleus Bic M10 Clic -un niveau encre bas-, marqueur noir 1,8-2,5 Posca, paire de ciseaux inox plastique noir Major 17, bâton de colle petit format jaune Uhu,
pot de confiture verre transparent : quatre marqueurs fluorescents orange bleu jaune rose Schneider, trois marqueurs fluorescents fuchsia vert bleu-vert Stabilo,
galet de granit : rond rugueux pâle,
empilement instable carnets multicolores : répertoire rouge 192 pages 11x17 coin enfoncé étiquette « Livres lus » Oxford, carnet marron faux cuir 192 pages veloutées 14,8x21 Clairefontaine, carnet spiralé rouge vif à carreaux 100 pages 11x17 Clairefontaine, carnet spiralé avec élastique vert tendre à carreaux 100 pages 11x17 Clairefontaine.
2. Sur le bureau juste avant les textes
icône ordinateur icône raccourci Launcher ombre tilleul
icône dossier Bureau icône Digital Photo Professional
icône raccourci Corbeille icône Box-sync Toute Petite et Petite dans hamac autoporté
icône Réseau icône dossier Zone non sauvegardée
icône dossier Jérôme icône fichier Notes de lecture Poezibao vert du pré icône Dropbox
Barre grise : grosse icône ronde multicolore fenêtre Windows, icône rectangle bleue Afficher le bureau, icône ronde bleue Openoffice 4.1.0, longue icône rectangulaire insertion petite icône ronde rouge Opéra Le tiers livre, web & littérature back to basics, 1[Notes sur ma table de t, langue blanche : FR, icône verte 100% Battery MaxiMiser Gauge, icône grise et verte Retirez le périphérique en toute sécurité, icône bleue Dropbox 4.4.29, icône carrée orange Mise à jour de Javascript disponible, icône ronde orange Avast Antivirus Gratuit Vous êtes protégé, icône ovale bleu marine Périphériques Bluetooh , icône rectangle bleu clair Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile, icône blanche bleu clair batterie + prise Chargement terminé (100%) Plan d’alimentation actuel : Performances élevées, icône ordinateur-globe-ordinateur Actuellement connecté à : Livebox-1a70 2 Accès : Réseau local et Internet, icône blanche haut-parleurs SoundMAX Integrated Digital HD Audio Volume 46, horloge blanche : 23H27.

murs carrelés trône de porcelaine récuré à la javel caleçon sur les chevilles serviette de bain bleue bouteilles parfums de luxe crèmes périmées panière en osier humide tableaux du père énième paysage du Gers rouleau de papier toilette entamé cuisses de chair velues en short noir débardeur mur blanc photos de famille lit deux places lumière sombre peau mate torse nu petit ventre sans abdominaux constellation de grains de beauté sur torse imberbe étouffante moiteur drap sur les genoux coussin derrière la tête respiration ronflements voix échappée du rêve de celle tournée de son côté du lit vue sur fleuve la nuit les bateaux meuglent comme des vaches le cri des coqs ressemblent à s’y méprendre au hurlement du loup bébé pleure interrompt la nuit d’écriture jusqu’au petit matin banquette rectangulaire en marbre vert mur en miroir le fleuve et son reflet à l’infini vue sur ciel couvercle noir de l’orage qui gronde aboiement du chien voisin dans le couloir le vent claque les portes made in china en fond téléfilm chinois doublé que personne ne regarde bruit de tire-lait on dirait les battements de coeur d’un robot murs de vieil immeuble ciel ouvert pas pressé en retard chemise rentrée dans le pantalon café dá à 10 000 dôngs ventilateurs poussiéreux livres de FLE oranges tableau blanc date du jour aux feutres noirs déjà secs salle vide sur la carte de France la ville natale n’est plus qu’un nom fenêtre sur parking d’une centaine de mob’ attendre que l’heure vienne qu’elle passe sortir marcher devantures des boutiques postures de vendeurs ambulants arriver murs parmes aquarelles à vendre immense ardoise noire des plats du jour à la craie bleue jaune rose chaise peu confortable béton ciré cercle de bois pieds en fonte bol tasse de café théière cuillères baguettes salière poivrière serviettes pub du vin du mois serveurs à l’affût de la moindre main levée bribes de paroles en vietnamien mandarin anglais français coréen "com Tam" oeufs Bénédict sans sauce hollandaise burger gras sandwich aux légumes à la Feta Perrier citron manger sortir se poser enfin plus de murs banc de pierre blanche grisonnante arbres verts immatriculés comme des prisonniers fleurs mortes avant d’avoir écloses hurlements de gamins déchainés gardiens retraités le nez dans les journaux locaux à l’air climatisé silence de médiathèque profs préparent prochain cours étudiants concentrés endormis sur cahier ouvert et un enfant toujours le même qui jamais ne joue avec ses camarades qui préfère lire seul au calme en attendant papa au coeur des livres de poésie jamais empruntés lire écrire paresser jusqu’au soir jusqu’à que le ventre grouille à nouveau rentrer moto traverser la lumière des ponts après l’orage prendre le tronc d’un arbre mort pour la sculpture d’un cheval noir s’arrêter sur un bord de route mi-ville mi-jungle échouer à photographier l’odeur de pluie repartir rentrer entre nos murs blancs trois esquisses de Paris nature morte des trois citrons odeur du bon dîner bébé dort vue sur la rivière Nhà Bè dans les miroirs reflet des lumières de la ville illuminée sofa en bois de rose hors de prix petite bibliothèque 50 livres pas plus pas pu amener plus en partant il y a dix ans tant pis désormais tout est dans l’écran de lumière l’encre noire les livres romans poésies essais dictionnaires la langue des autres en partage l’anonyme fraternité ce qui se passe dans la vie le quotidien des jours travaillé archivé ici dans ce rectangle blanc posé là n’importe où dans Saigon un café un appartement au jardin au bureau à la bibliothèque au restaurant dans la rue sur les routes aux toilettes dans le lit de jour comme de nuit pas de table mais une tablette de travail en perpétuel mouvement à portée de main corps numérique qui note trace des mots des voix des images solitude mise en partage parce-que vital est le désir de partager...
Caisse militaire ayant servi de secrétaire de campagne, armée française, bois fer laiton cuir, dimensions : L : 0,69 x l : 0,49 x h : 0,49 m,
achetée 85 euros sur Amazon à un surplus de Carrières-sur-Seine,
livrée à la Poste de Villejuif et transportée à l’aide d’un diable avec le remords de ne pas avoir envoyé cette idée absurde au diable (poids, pénibilité pour la tirer-pousser et hisser jusqu’au 7e étage).
Posé sur une table récupérée dans le garage familial mais de celle-ci il ne sera pas question. → Formule : Table < table de travail.
5 compartiments, dont un occupant tout l’espace de droite, 1 tiroir à clé.
Dans la partie fermée les passeports, monnaies étrangères, cartes usuelles pour téléphone et transports des voyages les plus récents tels que : SIM Ulysse mobile, Oyster card, plan de ville de Marrakech, pass Viva Viagem, etc. Loisir versus travail d’écriture.
Dans la plus grande case de gauche : papiers administratifs dans pochettes à rabats et élastiques de couleur, non classés à l’intérieur –même système que le père : « Impôts », « Appartement », ENGIE toujours nommé « EDF-GDF », « Cantine-Centre de loisirs 2015-2016 », « Bulletins de salaire »…
Dans la plus petite : chargeurs, disques durs, clés USB. Lunettes de soleil (ce qu’il est très pénible de perdre, alors même la région n’offre que grisaille, même en juin).
Dans le compartiment à droite, courrier intime en deux piles –chacune seulement tenue par une feuille A4 avec les prénoms écrits au feutre–, celle du fils et la pile personnelle. Alors même que la vie du plus jeune est plus courte, plus élevée est sa pile ; le tri appliqué à l’autre n’a conservé que 2012-2016 (les hauteurs de piles confirment que la vie entière de l’enfant est plus longue que la nouvelle vie de sa mère).
Les tentatives d’écrire au lit ou dans le mini-salon se sont révélées infructueuses.
L’abattant de la caisse, achetée pour la praticité de cette partie amovible, reste donc toujours ouvert, accueillant pour l’ordinateur toujours branché. Le code de déverrouillage conservé depuis 15 ans est le même que le matricule de télémarketing fourni par la Lyonnaise de banque à toutes les Virginie Latour. Ne jamais oublier le travail alimentaire, vraie lutte versus caprice d’Estivant.
Sur le dessus de la caisse :
– une photographie offerte par A., très aimée (A. ou la photo ?) : cadre argenté en délimitation d’une terrasse d’Istanbul où fascine un jeu de reflets dans une vitre ; ciel et Bosphore qui se confondent ; confusion encore accentuée par des silhouettes hologrammes. Souvenir de quelqu’un qui devient rêve de quelqu’un d’autre, en gigognes.
– Une lampe sous forme d’ampoule plantée dans un carré de béton ; si ça n’est pas une métaphore…
– Les bijoux les plus fréquemment mis et enlevés qui traînent là.
Justement, au sens littéral, sur chaque côté de la caisse pendent asymétriquement des sautoirs.
La caisse est collée au mur du fond mais pas au mur de droite : il reste la place pour une colonne de livres IKEA1er prix, qui accueillerait toute la famille des Violette et des mauves.
On peut donc retenir : malgré l’apparence d’une vie en boîte, plutôt un perchoir d’écriture au 7e ciel où palpitent les combat livrés aux textes et à soi-même, l’évasion par les villes étrangères, les colliers de mots, et « l’étagère hypothétique », la fameuse.
Annexe
Dans la bibliothèque forcément un dictionnaire, Lettre « C », Entrée « Caisse »,
Caisse de :
– résonance
– claire
– enregistreuse
– noire
Ma table de travail n’est pas une table mais un dessus de bahut libéré de son haut, une vitrine montée dans le grenier. Devant ce bahut je suis debout, toujours pour une écriture debout. Je ne sais plus pourquoi c’est arrivé.
Il y a les livres, ceux lus et les autres, des rendez-vous en attente. Trois ou quatre piles de livres, des colonnes instables qui m’accompagnent. Je n’ai pas de fauteuil ou de chaise, pas de dossier où m’appuyer.
Si on ouvre les portes de mon bahut de travail, on entend d’abord le bruit grinçant de vieille porte, genre porte de château hanté. Et puis on voit toute la vaisselle qui n’est pas quotidienne. Les très belles flûtes à champagne pas pratiques du tout à essuyer, les belles assiettes, les beaux couverts, un petit plat à la tête de canard pour le foie gras.
Il y a aussi des petites poussières du temps, le travail du vieux bois qui s’égrène dans tous les récipients des jours de fête.
Depuis un mois j’ai posé sur les assiettes mon ancien note book rouge dont je me suis séparée à cause de Windows 10 qu’il ne pouvait accepter. Je l’ai remplacé par un note book blanc qui vit bien avec Windows 10. Je le protège d’une petite housse à cause des crottes de mouches. Les mouches c’est parce-que dehors il y a des vaches. Je couvre mon ordinateur comme je couvre le linge qui sèche dehors, à cause des mouches parce-que il y a des vaches.
Sous mon note book il y a une planisphère parce-que je suis bizarre en géographie et parce-que j’espère toujours les fiançailles de l’humanité et de l’alphabet. Sous la planisphère où il est écrit entre autres que les mers occupent 361 000 000 de kms sur une superficie mondiale de 510 000 000 de km2 je glisse des petits papiers genre pensées de papillotes, des adresses, des numéros de téléphones à ne pas perdre. Tiens je soulève le monde je prends un petit papier découpé « les souvenirs sont nos forces, Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates, comme on allume des flambeaux ». Victor Hugo sous ma planisphère. Si je n’ai pas le temps de lire aujourd’hui j’aurai au moins lu une phrase de Victor Hugo. Ce n’est pas rien.
Sur ma table de travail qui n’est pas une table mais un dessus de bahut, il y a une lampe blanche avec un abat jour blanc que j’ai repeint à la bombe il y a un an. C’est un peu bizarre aussi, l’abat jour blanc devient marron quand la lampe est allumée. C’est la bombe. Un voisin l’avait fait, une nouvelle jeunesse pour ton abat jour m’avait-il dit, mais il n’avait jamais allumé sa lampe et n’avait pas vu l’effet marron. En tout cas les mouches n’aiment pas le blanc de la bombe, elles n’ont fait aucune des décorations tant redoutées je crois que ce n’est pas très rassurant.
Juste à côté de la lampe il y a un petit calendrier offert par une amie en 2014. Hier il était encore arrêté sur le mois d’avril avec la pensée"celui qui veut voir l’arc-en-ciel doit apprendre à aimer la pluie" de P. Coelho. Je me suis dis en ce moment, trop de pluie, pas d’arc-en-ciel, alors j’ai choisis mars et sa pensée "qu’il s’agisse de la terre ou du coeur, c’est quand on s’aime qu’on récolte" de C. Frisoni.
Tout cela ce sont les petits gestes, les petites brèches qui m’emmènent plus loin que mon dessus de table de travail qui n’est pas une table mais un dessus de bahut. Et puis il y a un tampon orange d’auto entrepreneuse pour tamponner les reçus quand les participantes à mon atelier d’écriture me donnent leurs euros.
Quand je suis sur mon bahut de travail, je tape les lettres qui font les mots.
Dans les deux tiroirs du bahut au dessus des portes, il y a des chargeurs, des clefs USB, des cordons, une machine à calculer, des ciseaux, de la colle, des notes de dépenses, des bons de réduction toujours oubliés. Et puis à côté du note book, il y a des cahiers, des journaux pour le monde en mouvement, des mots à ne pas oublier, des articles collés.
Ma table de travail n’est pas une table, c’est un dessus de bahut, un héritage, un passé présent où j’écris debout.
C’est sa table de travail, mais on ne la trouve pas chez lui. Il ne travaille pas chez lui. Chez lui, il cherche tout ce qui peut retarder le moment de se mettre à écrire. Il lui faut un lieu de travail en ville, un endroit où se rendre pour écrire, et ne faire que ça. Si possible. C’est une planche de bois blanche – blanche d’un côté, noire de l’autre –, couchée sur deux tréteaux, et sur laquelle est posé, central, un PC portable Packard Bell en fin de vie. Disons même : en soins palliatifs. Ce PC repose sur un ventilateur externe, comme un malade relié à un respirateur artificiel. À gauche de l’ordinateur, à portée de main (il est gaucher), un mug Breaking Bad rempli de café soluble, et un couteau au manche blanc qui lui a servi à remuer son café et a laissé quelques éclaboussures brunes lorsqu’il l’a reposé. Sur l’angle en haut à gauche de la table sont posés, les uns sur les autres, plusieurs livres et une chemise cartonnée bleue. Le livre du dessus : Histoire de Laval, de Jacques Salbert, éditions Siloë. Au dessous : Essai sur les rues de Laval, d’Olivier Chiron (ouvrage illustré de 8 dessins inédits), chez Yves Floch, imprimeur-éditeur, Mayenne, 1982. Au dessous : un hors série de la revue L’Oribus : Laval et les routes du futur, 1760-1860. Enfin, au-dessous, la chemise cartonnée bleue porte la mention manuscrite Projet Laval, et renferme un cahier et une pile de feuilles dactylographiées, ébauches et premières pages d’un livre en cours sur sa ville natale.
Table fonctionnelle, prévue pour le travail et rien que pour ça (hum !), elle évite l’encombrement mais pas les objets inutiles. Vers le milieu de la table, caché par le large écran (17 pouces) de l’ordinateur portable, un gadget idiot, fleur en plastique qui s’agite quand le soleil vient frapper sa plaque photosensible. À droite de celle-ci, un taille-crayon à boîtier. À côté du taille-crayon, un porte-crayons noir contenant : un Tipp-Ex en forme de stylo, deux Posca blancs, un crayon à papier et cinq stylobilles de toutes formes, récupérés un peu partout. Il n’utilise jamais aucun de ces outils : ses crayons de prédilection (les indispensables Pilot V Ball 0.5 noir) ne quittent pas le sac à dos qui ne le quitte pas. Il n’utilise guère plus souvent l’agrafeuse qui attend pourtant fidèlement au pied du porte-crayons. À l’angle de droite de la table, contre le mur de crépis blanc, un autre tas de documents, plus confus. Papiers de toute sorte, liés au Bocal, cet espace de coworking qu’il loue avec des amis, ou à d’autres projets personnels : articles, textes divers, un « feuilleton » pour une revue locale, le tout reposant sur une boîte de marqueurs Posca (« peinture à base d’eau, tout support », 8 couleurs : noir, blanc, rouge, jaune, vert foncé, bleu foncé, bleu clair, rose). Cette boîte repose elle-même sur d’autres papiers, qui reposent sur une autre chemise cartonnée, verte celle-ci, portant sur l’étiquette la mention manuscrite : le Bocal, et qui repose sur d’autres papiers. Achevant ce tour de table, une bouteille d’eau en plastique de 50 cl, toujours la même, qu’il va remplir au robinet dès qu’elle est vide.
Une table de travail exige un siège de travail, confortable, à roulettes, avec un dossier suffisamment haut et une teinte gris clair parce qu’il ne l’a pas trouvé en noir. À droite du fauteuil, une grande fenêtre dont la moitié inférieure, opaque, le dissimule à la vue des passants. À ses pieds, le sac à dos qui ne le quitte jamais, la housse de l’ordinateur portable, le cube blanc de la livebox. Sous le bureau, la multiprise, comme on dirait sous les pavés, la plage. Devant lui, au-delà de l’écran de l’ordinateur, les bureaux des autres « coworkers ».
Le bureau ? OK, le bureau. Fatras de papiers, bordereaux de remise de chèques à droite, coincés sous l’encrier — encre bleu nuit, le flacon en verre encore au trois-quarts plein, acheté il y a plusieurs années, mais certaines habitudes sont tenaces ; fétichisme des objets : stylos-plumes (il y en a trois dans le tiroir, et chacun a une histoire à raconter), appareils photos argentiques, caméras super-8, magnétophones à bandes, tout ça plus ou moins hors d’usage, conservés pour leurs valeurs symboliques, stimuli d’imaginaires.
Quatre disques durs externes et une clé USB dans l’axe de vue, sous la dalle de l’ordinateur dédié au traitement des photos. À gauche, papiers encore, tubes d’aspirine, quelques livres récents et le dernier numéro de Mojo. Une tasse de café vide sur un bock en plastique mou représentant un vinyle des Beatles, ramené de Liverpool par un ami. Et aussi, posé sur l’un des disques durs, une figurine — un homme assit, pensif, en train de fumer — réalisée à partir d’un manga dont on ne sait rien, mais elle aide à se mettre en condition pour écrire. Et tout autour, des bibliothèques. Livres plus ou moins classés dans les étagères, beaucoup entassés à même le sol qu’il faudra se résoudre un jour à trier. Et au milieu de la pièce, un petit tapis persan, dessus, un pupitre sur lequel est fixé un micro, pour quand l’écriture prend voix.
Le bureau ? Non. Le bureau, c’est le sac en toile posé par terre. La table de travail : l’ordinateur portable ou l’appareil photo, parfois le téléphone, de temps en temps le carnet — le dernier tout récemment acheté, format bloc-note à couverture souple, qu’on ne finira jamais, on le sait —, tout ça qui tient dans le sac. Le bureau ? Le disque dur externe, avec le double des photos et des textes (et qui pour dire, à l’âge du numérique, si les originaux sont sur l’ordinateur, sur le disque externe ou sur un serveur distant ?). Pareil pour la bibliothèque : les livres, parfois les mêmes, parfois dans une autre langue ou une autre traduction, sont aussi dans la liseuse numérique.
Le bureau ? Le bureau tient dans un sac, tient dans un disque dur, tient dans la main. Le bureau est en ligne, dans les nuages, il transite par des satellites géostationnaires, des câbles sous-marins, des fermes de données, stocké dans des machines aux quatre coins du monde, équipées de processeurs qui comportent entre quatre et dix cœurs, ce qui est plus que l’on n’aura jamais.
Le bureau voyage plus vite que la lumière. Le bureau est agile, nomade, virtuel. L’auteur lui-même est nomade, il virtualise les données, il est à l’écoute des signaux faibles, échafaude des milliers de scénarios dynamiques qu’il oublie parfois presque aussitôt. Stratégie de création. Souvent, on ne le comprend pas, et il n’a plus le temps d’expliquer : « something is happening, and you don’t know what it is, don’t you, mister Jones ? » Il repense à ça. Parfois il se sent seul, mais il sait sa solitude partagée. Les signaux faibles annoncent le changement.
Le bureau ? Il n’y a pas de bureau.
« En d’autres termes, les signaux faibles seraient de l’éveil et non de la veille. » (Wikipedia)
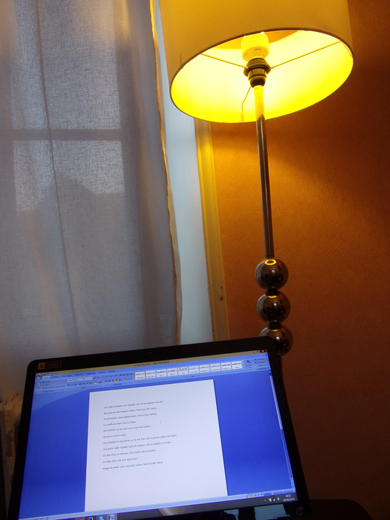
Une table en bois.
Des livres. Des factures. Du courrier en retard.
Le souffle du chien arrivé à l’étage.
Des fenêtres sur les toits.
Dix ans écoulés.
Une table réglable.
La rue d’un côté, les arbres de l’autre.
Le fleuve, la blancheur des mouettes.
Un objet d’un ami, jour après jour.
Visage du matin.
Une rose juste éclose.
Boire un thé chaud.
Ma table de travail n’est nulle part ou partout... n’importe où... ma table de travail est le plus souvent une tablette, qui a pris le pas sur l’ordinateur portable que déjà je trimballais presque partout... encore plus portable, plus légère, plus discrète, presque transparente, juste ce qu’il faut comme écran réflexif entre le monde et moi... derrière le paravent de cet écran, je rêve, je divague, je ramasse les forces de ma pensée, je fais venir au jour des mots, je forme des phrases, je les efface, je recommence... et je n’écris plus jamais seule... car à tout moment et d’une simple pression de mes doigts sur l’écran tactile, je sors de mon texte et le glisse vers les fenêtres ouvertes de mes ami-e-s présents sur les réseaux du web... ils et elles me liront, je le sais, avec attention et passion, avec le sentiment de vivre une relation intense à l’écriture, la sienne, celle des autres, frères et sœurs reconnaissables entre mille à cette incroyable profondeur de l’être qui les rend étonnamment si légers... Depuis l’invention du web, le lecteur et le scribe tiennent plus que jamais le monde entre les paumes de leurs mains... tels le penseur de Rodin, ils s’abîment dans sa contemplation, courbent le dos devant la monstruosité de ses imperfections, tentent parfois un geste ou un regard pour arrondir quelques angles... l’engagement consiste à suivre une ligne partie de je ne sais où pour une destination hautement improbable ; seul compte le chemin, la ligne... et le paysage qui se dessine, ligne après ligne... Je ne suis pas capable de dessiner sur une tablette... je n’ai pas encore appris... je ne sais d’ailleurs pas très bien dessiner... il m’arrive de manipuler des craies de couleurs, des bâtonnets de pigments friables qui abandonnent leurs poussières colorées sur des supports qui ne sont pas virtuels... je m’installe alors sur un coin de table, n’importe lequel, du moment qu’il est abondamment éclairé, de préférence par la lumière du jour... je malaxe les couleurs, j’obtiens des fondus, il est rare que mes dessins soient précis... je suis devenue myope il y a très longtemps, je suis habituée à cette façon de voir, j’aime que les frontières ne soient pas clairement délimitées... mes dessins ne sont jamais terminés mais, à un moment donné, ils me plaisent assez pour que je décide de les prendre en photo et de les rendre virtuels à leur tour, pour les offrir ainsi en partage, comme les textes que je mets en ligne, à qui veut bien les lire ou les regarder...
J’ai toujours eu un bureau personnel. Enfant, des caissons et sa planche remplissaient un mur de ma chambre. Une lampe au dessus formait une auréole de lumière. Deux fenêtres aux extrémités me donnaient une lumière assez dense tard les soirs d’été. Etudiant, c’était une simple planche en bois soutenue par trois murs face à une fenêtre. Aujourd’hui, c’est le bureau de mon grand-père que je maltraite. Un écran me fait face avec son clavier et sa souris. L’informatique domine : deux disques durs externes, un cable de connexion, trois écouteurs, une paire d’enceintes et enchevêtrement de cables reliés à l’ordinateur, soit un carré de 10 cm sur 10 cm estampillé d’un logo en forme de pomme croqué.
Mon fils amène sa super souris une semaine sur deux. Chacun sa session. C’est la mienne qui me permet d’écrire. Aujourd’hui il n’est pas là. Sa présence demeure sur la table : un yoyo, une figurine en plastique verte, une brique de logo. A gauche du clavier traine des restes de repas. En fonction de l’heure, c’est une tasse de thé et sa cuillère ; une planche à découper, sa saucisse sèche et son couteau ; une bière et des cacahouètes. Une boite de cachou vide, un mouchoir et un cure dent en plastique attendent d’être jetés à la poubelle. Devant moi, un livre sur l’ile de Crête et un courrier de pôle emploi. Le quotidien et les vacances s’entremêlent.
Le bureau peut s’agrandir grâce à deux tablettes situées à chaque extrémités. Malheureusement, mon appartement est trop petit. Des tâches d’eau et de gras parsèment le bois. Il faudrait penser à le poncer et nourrir le bois d’une cire d’abeille. En disant cela, je revois mon grand-père, digne, lire le journal local. Ce bureau me fascinait enfant. A l’usage, il est trop bas. J’ai ajouté des cales en bois pour le surélever. Les deux tiroirs servent de débarras. Ce bureau est une madeleine de Proust. Ma table de travail est avant tout virtuelle.
Nomade, je change d’ordinateur et de lieux en fonctions de mes envies. La table de travail est ronde à la terrasse avec sa soucoupe, sa cuillère et sa tasse de café qui refroidit. Alors quel inventaire choisir ? Les lieux en mouvement ? métro, toilette, rue ? Les lieux où une idée jaillit et où il est nécessaire d’écrire une pensée sur le document qui sera repris plus tard ? Un lieu stable et lisible ? Une table rectangulaire dans un café parisien ou le bureau de la maison ? Il est à l’horizontal quand me viens l’idée de me coucher. Un dernier mot sur le smartphone.
Le bureau est une suite de synchronisation.
Traits tirés des voyages
Un ronronnement régulier. L’impression de glisser dans l’espace, à la fois hors du monde et au monde reliée. De façon ténue et dense.
A gauche, un couloir ou une allée, puis deux fauteuils inclinables.
Devant, un dossier (cuir, plastique, velours), une vitre qui ouvre sur l’infini du ciel et de la route. D’autres dossiers. Quelques têtes, avec des cheveux, parfois des casques sur les oreilles.
A droite, un fauteuil, avec tablette rétractable et porte-godet – comme une palette à huile ? –, une prise électrique, une prise électronique. Une large vitre regarde défiler des champs, des haies, des bois, des villages avec clochers, terrils, panneaux indicateurs, et petites routes qui s’échappent dans les collines. Le vent incline la folle avoine de juin, par vagues. Le ciel y répond par des traînées blanches sur fond azur : traits tirés des voyages, nuages avec perspectives.
Derrière, d’autres fauteuils de part et d’autre du couloir. Un homme allongé sur ceux qui forment banquette, à l’arrière. Il dort. Ses cheveux blancs, son visage fatigué, sa peau noire - tout indique l’immense lenteur de son voyage.
Dans le bureau posé sur la tablette inclinable accrochée au dossier qui fait face, les courriers du jour. Répondre à qui se trouve encore à Paris ou ailleurs ; recevoir confirmation que la déclaration d’impôts est bien reçue par les services compétents, écrire à D. pour le lui dire, D. qui, depuis Abingdon (Royaume Uni), front face au jardinet qui borde la maison d’E., a rempli la déclaration en ligne avec l’aide du comptable qui se trouve, au même instant, et encore au moment où arrive dans ce bus, sur cette route entre deux pays, confirmation de la bonne réception du document, près Carcassonne (France). Trois points d’émission + un qui a bien reçu : une illustration dans le temps des traits qui se dessinent dans le ciel : croisements, rencontres et lignes de fuite. On écrit solitaire, mais l’on n’est plus isolé : travail d’équipe composée de personnes éloignées, mais qui se rapprochent l’espace de quelques minutes, quelques heures pour une tâche précise. Trois petits tours, et puis s’en vont. Densité de l’échange. Fragmentation du temps. Multiplication de l’espace.
Sur le bureau, sous l’écran : des images – tikis, massues, boomerangs et churingas ; pagaies, pédales d’échasses et bouchon de flûte ; statuette Fly-river, crânes surmodelés, collier royal composé de 300 mètres de tresse et d’ivoire, pectoral rei miro et statuette rapa nui ; Uli, sur son bureau. Sur cette photo, il fait face à la figure kareau, grimaçante, dents découvertes, langue tirée, bras levés : Océanie. Peur et émerveillement. Objets à double lecture. Chacun des fétiches avec son double ou son complément. Talismans et racines, chiens et gardiens, pierres et terres, figures et photos. La famille au centre, les trois âges de la peinture surréaliste scandés par des boucliers plus ou moins votifs et un tambour. Elisa, Jacqueline et Aube entourées d’objets qui rassurent, qui protègent. D’objets qui émerveillent et qui font peur. Devant eux, on imagine AB, gardien tutélaire lui-même protégé par ce manteau qui le recouvre des objets qui l’entourent. AB blotti rue Fontaine. Mur d’énigmes, mur intime, reflet magique, miroir du Mur.
Mises en ligne des notices rédigées par Meyer et relues la veille. Ici, sur l’écran, s’affichent instantanément sous les images correspondantes ces nouveaux textes : au même instant, au musée, à Paris, face aux véritables objets exposés, une tablette les dévoilent au public. Le site indique l’endroit où voir l’objet, le musée qui expose l’objet renvoie au site qui le décrit. Miroir du monde. Complémentarité des supports et des surfaces.
Connexion interrompue puis relancée toutes les heures. Le bus avance vers Bruxelles. Le travail s’étoffe, les perspectives prennent sens. Derrière la vitre, le paysage change : des arbres, larges pignons de briques peintes à la chaux, prés et bois. Peu de terres cultivées, comparées aux grandes plaines picardes.
Préparation de la soirée à venir aux Gendelettres. Dans la salle, au mur, derrière, cachant la tapisserie des romantiques, à partir d’un ordi placé sur un guéridon Art Déco en loupe d’orme, on projettera le Mur AB, que celui qui s’adresse au public devrait voir dans le miroir du fond de la salle, sur la cheminée Louis XVI. Si l’écran de l’ordi plante, la cabine enverra toujours l’image derrière. Image qu’on verra inversée dans la vitre argentée. Reste qu’il faudra régler son doigt sur le trackpad en fonction du reflet. Pas simple. Faudra veiller à ne pas inverser les directions, ne pas montrer un objet à gauche du Mur quand l’intervenant parle d’un objet à droite. Choix d’une liste, plus sûr. Courrier aux organisatrices, aux écrivains invités, réponse immédiate de quelques-uns d’entre eux, avec lien vers vidéo – dont on ne donnera que le son –, liste des objets choisis sur site de vente en ligne (moule à gaufre, poupée maya, tableau surréaliste, etc.), création d’un album en ligne qui permette la projection d’images, copie des images de l’album dans dossier au cas où la connexion...
Le bus ralentit. Il tourne. Retourne. Les voisins s’agitent. Se lèvent. Voix dans le micro. Arrivée. Fermeture du bureau. On aura pris soin d’enregistrer.
Ça s’impose, ça déborde. Deux ouvrages en souffrance, des essais, attendent l’extrême urgence de la ligne à ne pas franchir, lecture reportée et sur reportée, parce qu’il le faudra bien, un jour.
Des stylos, des paperasses, pêlemêle, portent la trace des chèques à remplir, un dossier à compléter, trois lettres à classer pendant qu’il en est encore temps, que tout ne s’est pas mélangé, qu’il reste une idée pour qui les a reçues de ce qu’elles supposent comme connaissances préalables et traitement adéquat.
Un cahier et un carnet rêvent du bon vouloir d’un stylo. Hélas, les blocs sont plus pratiques pour les notes rapides, et même le cahier, glissé dans le sac, recueille plus souvent des notes de conférence que de la vraie écriture, qui a choisi le clavier.
Vue plongeante sur la campagne. Au duel avec l’écran, le vieux bureau en bois gagne à tous les coups ; les rangées d’arbres, les prés et les champs, le château d’eau à l’horizon, martèlent de leur épaisseur la platitude des photos qui habillent le fond d’écran.
Les doigts s’agitent sur le clavier, un œil sur l’écran, l’autre sur la fenêtre, ils ont tellement à dire, les doigts. Ils dérangent la pile de romans posés en déséquilibre sur un coin du bureau, à la recherche d’un exemple, une page défile, des dialogues, ce n’est pas ce qu’ils cherchaient, ou alors, peut-être, oui, Sarraute, un dialogue qui fait récit :
— « Oui, et cette fois, on ne le croirait pas, mais c’est de toi que me vient l’impulsion, depuis un moment déjà tu me pousses…
— Moi ?
— Oui, toi, par tes objurgations, tes mises en garde… tu le fais surgir… tu m’y plonges… »
Ils continuent à chercher, les doigts ; des descriptions, c’est ce qu’ils veulent, des objets, des lieux qui s’imposent pour donner à penser. « Cruche d’abord est vide et s’impose en chantant » ; facile, Ponge, trop facile ; ils ouvrent n’importe quel volume et l’ont, leur réponse, mais trop simple ; même si « tout ce que je viens de dire de la cruche, ne pourrait-on le dire, aussi bien, des paroles ? ».
Trop simple pour donner voix à leurs paroles, d’autres descriptions peut-être, ils frémissent, les doigts, s’enfoncent dans les pages, s’assèchent au papier poussiéreux dont ils finissent par tirer des perles de pluie, Rouaud embue les lunettes de son myope de double, Echenoz réfugie les passants sous les marquises des Champs-Élysées.
Ils cherchent encore, tapotent sur la tablette, les pages défilent, s’accélèrent, le logis saumurois se dessine, aride et silencieux, la rue déserte « remarquable par la sonorité de son petit pavé caillouteux » nous façonne peu à peu Eugénie, rêveuse et triste sur ces « appuis de fenêtres usés, noircis… ».
Ils reviennent à la pile de romans désormais disloquée, La-Ville-de-Montereau appareille, les berges de la Seine sont calmes. Cette semaine, Frédéric ne serait pas parti, il n’aurait pas quitté « l’ile Saint-Louis, la Cité, Notre-Dame », la crue lui aurait barré l’accès à son apparition.
Mais ça c’est dans les journaux. Sur le clavier, les fleuves sont sous contrôle, les doigts décident, de créer des paroles avec des rivières, des arbres immergés sans en être noyés, et l’arbre surgit, refuge d’Ernesto au livre brulé, cèdre géant de Robinson.
L’arbre divague, ambitionne, il se plante là, au milieu du bureau, il n’en bougera pas. Les doigts s’affolent, ils le poussent, le malmènent, rien n’y fera, les branches font dans la démesure, les rameaux partent dans tous les sens, la récolte est bonne, l’écran se réjouit, les mots pleuvent, ça fictionne…

Sur une table à jeu plus que centenaire :
– un tapis de souris
– un boîtier contenant un CD d’installation de Windows 7
– une calculette
– une lampe de bureau
– une enceinte bluetooth
– un sachet de lavande offert par une amie en perdition (j’ai mal pour elle à chaque fois que je le regarde)
– un cahier de prises de notes en réunion. Rouge.
– une brochure titrée Les bœufs d’Hélios, à re-maquetter
– une clé USB
– un agenda. Noir.
– une souris
– une assiette vide , une fourchette
– Juste à côté, une table en bois à cinq pans, très ancienne elle aussi. Héritage familial.
Entre les deux un ordinateur portable posé en équilibre, car momentanément relié à l’imprimante par un câble trop court.
Sur la table à cinq pans :
– un clavier et une souris
– une petite pile de notes diverses destinées à être classées ou saisies. La plupart seront jetées.
– un disque dur externe
– une agrafeuse
– un sous-verre décoré de fleurs et papillons de couleurs vives
– une chemise en carton bleu titrée LAP DOC
– une boîte ouverte où s’accumulent : les agendas Photographies &Co, #7, #6, #5, #4, janvier-avril 2015, septembre-décembre 2014, un petit carnet rouge destiné à recueillir des idées de projets. Presque vierge. Deux notices concernant les Tillandsias – Plantes de la famille des bromiliacées, achetées cet hiver. Un éventail récemment offert par une voisine coréenne.
– un pot en terre rouge d’origine asiatique contenant quatre feutres rouge de différentes marques et usages, dont trois indélébiles, dix feutres et stylos noirs dont deux indélébiles, deux stylos Bic bleus, un Bic quatre couleurs, cinq crayons à papier dont un ,bleu, sur lequel est écrit « La chasse au papillon » offert à Sète en sortant du musée Georges Brassens. Un crayon à dessin bleu, un autre rouge, une craie blanche, un capuchon de stylo Bic noir, et 6 petits bouts de crayon à papier à peine utilisables.
– trois petits agendas 2015 dont un dans lequel sont consignés une série d’anniversaires.
– un carnet dans lequel sont notés une série de mots de passe rarement mis à jour
– un pot en terre d’origine kabyle contenant un marqueur rouge, deux surligneurs rose et jaune, un crayon et un feutre blancs, un feutre cuivre et un autre argenté. Un gros stylo doré avec petit vaporisateur intégré, sans cartouche d’encre. Une gomme
– un paquet de notes de frais en attente de classement depuis deux ans au moins. Certaines commencent à se décolorer.
– un petit pot en terre contenant un mini bloc de Post It rose, trois clés USB, une carte SD dans sa boite, une boite sans carte SD, une touche de clavier d’ordinateur, un truc que je n’arrive pas à identifier marqué Samsung. Un petit sachet en plastique avec des boutons pressions
– un répertoire téléphonique
– deux enceintes
– un écran d’ordinateur
– beaucoup trop de câbles
– une tasse à café. Vide.
Table en bois blanc et brun, surplombée du plan de travail perpendiculaire : le grand écran de l’ordinateur. Surface de reflets sans miroir, c’est ainsi que le Mac trône. Droit, en face, suffisant. Imperturbable. Écrins des écrits passés. Ultime destination des textes à venir.
Si seulement. Mais l’écriture est morcelée par l’encombrement de l’infime, prétextes à l’évasion sans imaginaire. Sans suite. Pour éviter d’empoigner les mots.
De la poussière aussi. De la poussière surtout, ponctuée de traces éparses. Empreintes de doigts aveugles à la poussière quand ils touchent les objets sur la poussière posée. De poussière, recouverts.
Table de poussière. Particules, jamais les mêmes. Ostentatoire présence du quasi rien. À peine un voile.
À gauche, un cheveu, ondulé d’un côté. Tombé il y a des mois, sans bruit ni douleur. Il se tortille encore, animé d’un souffle qui persiste malgré le déracinement.
A ses côtés, un ongle cassé par maladresse, oublié depuis. Il se confondrait avec les traits de gomme noircis par le labeur des corrections.
Un bout d’aluminium : résidu de l’emballage d’un médicament au nom tronqué.
Un autre cheveu.
L’auréole d’une goutte de café.
Parsemés ci et là, quelques miettes sans d’autre parenté qu’une destinée commune : chute de bouchées trop voraces pour les retenir, sous des yeux ailleurs occupés…
Tant de débris ignorés... ce n’est plus de la poussière… ces petits riens obstruent la pensée quand ils s’emparent de la conscience.
Emballage de bonbon vide, en papier glacé. La bande bleue brandissant son "sans sucre" est déchirée en deux : sans d’un côté, sucre de l’autre. Sans intérêt.
Tasse tapissée de résidus de café ; le fond toujours délaissé par dégoût de la dernière gorgée. Sans raison.
Vitamines du matin.
Canette de coca-zéro vide. Sans calorie.
Verre d’eau rouge fumé. Bouteille d’eau en plastique, au tiers pleine.
La règle transparente qui sert de gratte-dos.
Sur des espaces lézardés par les câbles, ces frontières hasardeuses et sans contrôle de passage. Chargeurs, cordons électriques... par un seul bout reliés, dans la sage attente d’un prochain usage. S’en détachent des tracés de couleur : les fils du casque orange et noir à l’armature souple, modèle pour sportifs. Ici avachi.
Un cahier en spirale ouvert, traversé de lignes manuscrites qui ne suivent aucune horizontale. Plus loin, le bloc-notes de poche ; il n’a servi que le jour de son achat. Un crayon à mine. Des stylos-bics, trois ou quatre. Pourquoi autant ? Le stabilo jaune fluo.
Un autre cheveu en mouvement.
Une enveloppe encore scellée, au contenu sans mystère, derrière la photo qui regarde. Rescapée de la poubelle, elle sert de sous-verre de fortune.
D’autres amoncellements de feuilles disparates : factures en attente de paiement, courrier administratif parcouru d’un regard vague et fuyant. D’un regard qui y revient et aussitôt repart. Remettre à plus tard. Plus tard. Plus tard. Jamais, si possible.
De droite à gauche. De gauche à droite, l’œil s’affole à repérer les intrus qui se raccrochent. Brassage de contradictions sur cette table de création disputée par des objets aussi disparates que les pensées incoercibles qui s’éparpillent dans l’esprit pour esquiver l’engagement.
Rien, le quotidien. Banal désordre du quotidien, installé malgré les petites variations fortuites de sa composition. Permanent et pourtant invisible tant qu’il n’est pas regardé dans ces détails. Le quotidien, diffus comme la vie. Comme les humains.
L’aire d’écriture est territoire de fuite. La table, cette grande coupable.
L’espace impossible. Saboté. À droite, à gauche, devant… partout les objets et leur prosaïque insolence.
Comment écrire quand il reste si peu de place pour l’émergence ? Surface supposée plane, encombrée de volumes.
Avec d’impuissantes sentinelles : des piles de livres. Entassés sans logique, sans raison. Différents volumes, différents formats. Autant d’univers valsant entre philosophie, littérature, correspondance… rivalisant de visibilité, en se masquant les titres par superposition. Pourquoi eux, sur cette table. À proximité ? À portée de mains. Contre. Nécessaires. Jusqu’à la gêne. Jusqu’à l’asphyxie. Tandis que tout près, les autres livres débordent des étagères et calfeutrent les murs de papiers, paroles, pensées.
A l’image de l’esprit, la table de travail est encombrements.
Et la table rase, fantasme.
Officiellement, un plateau de verre sur armature métallique et dessus un fatras de choses accidentelles. Un écran carré et une unité centrale, deux casques (un blanc, un noir), un appareil photo, une paire d’enceintes en mauvais état. Un album de Claude Ponti, un bracelet, un trousseau de clef, un carnet Ikéa, deux étuis à lunettes, l’un est vide. Des crayons éparpillés, des papiers qui auraient dû être classés depuis longtemps dont quelques feuilles de soin, un post-it vert (quelques dates et les heures d’ouverture de la crèche). Une petite boîte à parfum qui contient des mèches d’encens népalais, une vieille trousse remplie de stylos qui ne fonctionnent plus, un porte-feuille, un rouleau de papier à dessin, une tablette tactile, trois boîtes. La première est une sorte de valisette à charnière avec une poignée en cuir. Elle contient des crayons, des bics, des gommes. Près de l’unité centrale, une boîte en bois type porte revue (talon de chéquier, agenda jamais utilisé, étuis à lunettes - encore, feuilles blanches, quelques notes en anglais sur une page de cahier, un jeu de carte divinatoire, un énorme anneau de papeterie). Une dernière boîte, pot à crayon rectangulaire à plusieurs casiers, noir, coutures apparentes façon sellier, très laid. Dans le plus haut, des enveloppes (krafts, blanches, pré-timbrées). Un document bancaire intitulé "Déblocage des fonds", une règle à calculer, un rapporteur. Les plus petits contiennent un tube de colle forte, des feutres fins, quatre paires de ciseaux de tailles variés des crayons à papier et un énorme pastel bleu.
Dans les faits, l’espace constitué par mes deux genoux réunis et un sac en coton épais. Dans le sac, l’indispensable minimum de fournitures qui me rassurent. Colis de secours, canot de sauvetage, permet de tenir mes positions quelque soit la conjoncture de la guérilla domestique et le programme de la journée. En cas de déplacement : portable, chéquier, portefeuille et trousseau de clefs. Toujours, deux bics quatre couleurs : l’un traditionnel (rouge, bleu, vert et noir), l’autre fantaisie (rose, parme, azur et vert pomme). Un feutre fin noir de marque Pilot et un critérium pour dessiner. Un carnet non ligné (format A5), un livre entamé, un marque page. Un ou deux ouvrages en cours et une pochette contenant le nécessaire pour crocheter (crochets de tailles variées, fil de coton ou laine - une ou deux pelotes -, quelques marqueurs, une grille ou un modèle imprimé en qualité brouillon). Une tablette tactile, un casque, un flacon de vernis à ongle. Sur la tablette (suppléée éventuellement par le téléphone), un logiciel de traitement de texte (OmmWriter), un minuteur réglé par défaut sur des périodes 25 minutes, un carnet virtuel (Evernote) rarement utilisé, une application qui gère les listes de tâches, Pinterest, Instagram, un dictaphone, un appareil photo, Spotify, une application bancaire, Google Maps, Gmail, une lampe torche, Skype, Marmiton, Trip Advisor, un traducteur et une espèce de calendrier de grossesse.
Table de travail si peu, à bien regarder, une table où s’entassent toutes sortes d’objets qui servent à passer le temps, à éviter La chose, la grande affaire. Mais aussi à permettre de tourner autour, d’être près d’elle quand même.
D’abord lui, l’ordinateur, qui siège, vibrant, brillant, bourdonnant, mais sous les onglets de jeux, de recherches variées, de messagerie, tout en bas, dans un cercle bleu ciel, deux oiseaux blancs : OpenOffice est ouvert.
Ensuite, posés au hasard et formant pourtant des cercles concentriques, comme des ricochets, autour de l’ordinateur : une tasse de café, un flacon de liquide pour cigarette électronique, une petite bouteille d’eau, un paquet de mouchoirs en papier, une paire de lunettes, un téléphone blanc sur un socle rouge, une clé usb collée contre la tranche d’un exemplaire abîmé de la pièce Le roi se meurt, que chevauche à demi une feuille pliée en deux sur laquelle se lisent des noms, en regard desquels des adresses de messagerie et des numéros de téléphone. Après un reste de laine rose, un téléphone portable, une fleur au crochet jaune et violette, un élastique pour les cheveux, tout au bout de la table se trouve une sorte de long vide-poches en céramique — fleurs vertes et bleues dans un style provençal — plein d’une multitude de petites choses, dont un bonbon au chocolat dans un emballage transparent, un tube de rouge à lèvres, trois galets, un bouton de rose sec et un peu poussiéreux, des piles sans doute usagées, des pièces détachées de cigarettes électroniques, une pince à linge miniature en bois, quelques petites bobines de fil, une cacahuète dans sa coque, des post-it jaunes, un badge « Non à la corrida », une minuscule pomme de pin, et une quinzaine de fiches cartonnées pêle-mêle. Celles qui sont visibles laissent apparaître chacune un numéro et quelques mots énigmatiques qui semblent résumer des scènes : 4- Visite à ND, jusqu’à « pour étouffer ma joie », 5-Les gardiens (devrait être au passé, cette scène), « Je disais que la vie... », 13-Retour au Présent, de « Jusqu’à ce regain de désir », à « parce que rien ne le peut ».
Contre le mur blanc auquel la table est accolée, on dirait même soudée, un livre, De veille et de sommeil, un flacon à l’écriture or sur fond noir « Télomères ADN » (une tentative d’immortalité ?), une enveloppe qui porte les mots « Estimation Maryvonne », un lapin en laine avec de gros yeux tristes.
Au-dessus, scotché sur le mur, un planning fait au crayon, jours de la semaine en haut sur toute la longueur, heures à gauche sur toute la hauteur. Entre les lignes qui dessinent des rectangles inégaux, les mots « Écriture, atelier, préparation »reviennent sans cesse.
Un peu plus haut, sur une étagère du même bois que la table, solidement accrochée au mur, une étagère où ont été posés une lampe à l’abat-jour de guingois, un petit vase vert olive plein de stylos et de crochets (décidément, les travaux manuels semblent l’apaiser), un porte-crayons en verre justement rempli de crayons et stylos, un cahier rouge ouvert mais replié, un très léger foulard rouge et jaune, un petit éléphant en tissu chamarré, une télécommande, un chéquier, un bouddha en bois qui ressemble à un enfant — rondeur de la joue, yeux fermés, la tête inclinée doucement, presque posée sur une main — et un thermomètre à quartz.
Posée au bord de l’étagère, une structure métallique plutôt destinée, semble-t-il, à accrocher des verres dans une cuisine, suspend au-dessus du bureau un long gant noir, un câble et, tenue par une pince, une feuille pliée en deux couverte d’une écriture noire orageuse et extrêmement raturée, peut-être là pour ne pas être oubliée, pour que ses mots, un jour, passent du brouillon au texte retravaillé sur écran.
Espace de travail qui pourrait en valoir un autre mais non, un mur pour écrire, non, il faudrait absolument qu’il y ait une fenêtre devant avec des arbres — ou même un seul — et un morceau de ciel, fût-il gris. Mais sous ce toit, pas de fenêtre à hauteur de regard, alors pourquoi pas un mur ? Il y a des gens comme ça, en vérité c’est sur les feuilles des arbres qu’ils écrivent, et le ciel les console de ne pas y arriver.
C’est une table de chêne ronde à rabats, ayant appartenu aux arrière-grands-parents de Bonifacio. Une table qui a traversé la mer, qui a été entreposée chez des amis, qu’on a transporté de Cannes à Nice, de Nice à Paris, du 18ème au 19ème arrondissement, dont on a replié un battant pour la caler contre un mur entre deux fenêtres rue Meyerbeer, contre un autre mur également entre deux fenêtres rue Eugène Sue et qui est déployée au milieu de la salle à manger dans l’actuel appartement.
Car ici aussi la table de travail est désormais la table où sont pris les repas, d’où il faut retirer ordinateur, livres, journaux, pour y disposer assiettes, verres, couteaux, fourchettes, serviettes, bouteilles… Et vice versa.
Une fois débarrassée, une fois essuyée, elle se découvre surface libre, parcourue de mille veines de bois, de stries infimes, de nœuds, d’entailles.
L’envie de faire table rase parfois.
Il y a moins d’un an, la table de travail était encore permanente. C’était un lourd bureau de pharmacien aux tiroirs profonds, posé dans une pièce claire et calme. Même si la table ronde de la salle à manger servait déjà parfois à l’écriture. Sur le bureau, il y avait un porte-document en bois hérité de Suzanne qui contenait des cartes postales, des récépissés, des petits dessins et de courts poèmes d’enfants, des papiers de différents formats disposés selon une tentative de classification dont le caractère illusoire (pour ne pas dire désespéré) sautait aux yeux (d’autrui). Il y avait une photo de la Pietà de Michel Ange, des portraits des filles encore petites, une reproduction du Soir Bleu, une photo en noir et blanc prise à la pointe de la presqu’île de Conleau. Il avait une boîte contenant des câbles, un disque dur externe, des clés usb. Il y avait de nombreuses pierres, des galets pailletés de mica, des cailloux volcaniques et le coquillage hélicoïdal ramassé à San Erasmo. Il y avait des pots remplis de crayons et de feutres de couleur. Il y avait le petit Asus blanc.
La pièce claire et calme est devenue la chambre de l’ainée et le gros bureau a été déplacé dans une pièce plus sombre et passante. Jamais on n’a replacé sur son plateau le porte-document de bois, ni les photos, l’envie de faire table rase… on voulait un bureau clean, désencombré des strates de souvenirs qui s’y étaient accumulés. Les galets, les pierres volcaniques sont restés dans le sac de plastique au fond d’un panier où ils avaient été rangés pendant l’interversion des pièces, la Pietà et les autres photos sont sans doute dans un tiroir, on n’a plus effleuré les rainures du coquillage de San Erasmo.
On a peu à peu délaissé le bureau, on a entreposé sur son plateau de gros classeurs, des livres, des dossiers, on a renoncé au fantasme d’un bureau zen, le petit Asus blanc est resté dans son étui, trop lent finalement, on a préféré le Dell du travail salarié et on a migré vers la lumière, vers un wifi moins aléatoire, vers la vue des toits de la ville.
Pendant quelques mois il y a eu cette légèreté vagabonde, de venir travailler sur la table de chêne dès que possible, d’ouvrir le portable et reprendre le fil des phrases, plus tard refermer l’ordinateur et chercher du calme, se replier dans la chambre, sur le lit. Puis la légèreté s’est écrasée sur la question de la place. Ne pas trouver sa place… ne jamais être à sa place… se demander s’il y a une place quelque part pour soi.
La table de travail s’estompe, elle se dérobe… elle est multiple, bureau, lit, mobile… Surface pour le geste d’écrire qui articule l’immatériel au matériel en attendant la technologie qui transposera directement nos phrases du cerveau sur l’écran. Medium pour atteindre un lieu mental, espace que souvent l’écriture substitue au lieu matériel, aux coordonnées spatiotemporelles qu’occupe le corps, on ne voit plus ce qui se trouve devant nos yeux, c’est parfois un jardin où on descend, rien de bucolique c’est le cœur d’une centrale, c’est parfois la ville où déambuler nous perd, peut-être un ravin au bord duquel on se risque.
Etagères sans battants, tiroirs sans serrures, boîtes d’archives ouvertes classeurs vides chemises grosses de paperasses. Formica et bois d’un seul tenant, planches pleines planches ajourées, sur deux cartons sur caisse à vin sur marches d’escabeau sur livres papier, feuilles. Les unes sur les autres, cornées pliées découpées entières, chutes immobilisées, sur quatre pieds creux et rouillés feuilles manuscrites, feuilles imprimées, livres made in Saint Aubin, la Flèche, Monts, made in Saint Amand Montrond - stabylo trombones, ciseaux taille-crayon : l’horizontal prime et l’horizontal est silencieux. Ici aucun intermédiaire autre que l’oeil pour monter le volume. L’oeil branché par injonctions électriques car l’oeil quel que soit l’angle adopté, il ne suffit pas qu’il s’y pose, doit s’y poser tout le cerveau attentif, doit s’y poser la fonction lecture car selon distance pour le cerveau qui ne sait plus ne plus lire noirceurs restent incompréhensibles. Vierges : angles de feuilles bord de tasse. Chiffonnés : kleenex, gants. Les paliers de l’escabeau : inclinés incliné le bandeau d’un magazine littéraire numéro double apocalypse. Livres et tranches sur l’étagère : épanchement des noms titres découpes de visages, agglomérés de figures rognées. Hérissés de papiers à la déchirure à peu près régulière. Inclinaison made in RPC de l’écran portable, du deuxième clavier et verticalité de l’écran de bureau. Surface lumineuse à l’aplomb du silence. Fenêtre ouverte. Plafonnier éteint icônes non connectées. Aux alentours aussi un dictaphone à l’armature fissurée, un codex ouvert trois fermés liasses sans câbles ni lumière interne, feuillets d’une autonomie supérieure à l’oeil qui les consulte. Partout l’alphabet en vrac, à l’écran vingt-six des trente-et-une lettres AZERTY, soit é è ç à a z e r t y u i o p q s d f g h l m c v b n Hémisphère Nord – mois jour année slash slash slash made in USA 21:59 Temps Universel.
Le secrétaire de Mémé qui a perdu la peau de son écritoire et dont les charnières ont été réparées maison. La fermeture éclair ouverte, la trousse exhibe un taille crayon double lames, un tube de Dermophyl indien qui n’en est pas un, un bout de craie rouge de la taille de l’ongle d’un petit doigt.
A proximité, une paire de ciseaux d’écolier, le capuchon du stylo, un rouleau de scotch. Le portable encore en surface sur un bloc de papier à lettres Country bleu, une bandelette provenant d’un TIP de facture, une lettre de la maîtresse annonçant que mardi il n’ y aura pas école pour cause de grève.
Les tiroirs du coeur du meuble heureusement fermés.
Dans le renfoncement rectangulaire avec son fronton en découpe en violon, un vrai petit théâtre : des pattes de sauterelles réduites à une ligne, dessin d’enfant qui a saisi son sujet, un vase de mariés avec les médaillons des époux à vingt ans quand ils ne se connaissaient pas, les même sculptés dans
la résine, en vis à vis des carnets, des carnets et une photo de Sergio Larrain où deux fillettes de dos descendent un escalier l’une dans l’ombre, l’autre dans la lumière.
Une lampe accordéon en surplomb prête à lâcher sa flaque.
Sur le faîte du meuble, une miniature de Punch et Judy , dont les têtes montées sur des ressorts branlottent, les livres en cours servent d’appui au porte-livre gonflées de courriers en attente, une orchidée,une mappemonde vue en contre plongée essentiellement bleue sauf l’orange de Madagascar et le blanc du plâtre des terres perdues d’Afrique Orientale.
A proximité une table ronde, laquée, chinoise et mate avec l’ordinateur : la chambre noire.
Sur les rebords de la fenêtre, les dictionnaires, une machine à calculer verte, une boite rectangulaire en bois vernis, un porte-lettres bourré de cartes postales gratuites, la ligne de fuite de la rue avec ses immeubles en escaliers, les cheminées de brique et le ciel où l’on aimerait entendre le sifflements des martinets.
On a ouvert l’ordinateur sur les genoux sur le fauteuil unique, ouvert le traitement de texte les notes sur la femme sous verre. Est-ce qu’on est seul à l’avoir vue qui hantait le Crédit Agricole, le corps dans la nuit des phares et tailleur gris assis sous la vitre et plusieurs fois ensuite qu’on y est retourné au pied de l’immeuble, plusieurs fois on en a fait le tour, rien, le mobilier, lueurs glauques des issues de secours et des économiseurs d’écran. Et derrière paysage intérieur train trouvé sur life of pix, mis là parce qu’il rappelle un trajet qu’on aurait fait, mieux car il les condense tous, à ce moment précis où roulant depuis plusieurs heures dans une tranché morne le paysage rejaillit par dessous. Se sentir comme depuis l’intérieur du Rain Steam & Speed et être étonné de trouver là un wagon restaurant avec nappes tissus blanches et carte des vins et icônes fichiers suspendues aux rideaux, captures d’écran Google Earth sur la bordée lumineuse des plafonniers, texte de Deleuze .doc sur la ritournelle au montant de la fenêtre où sont les essaims de mélèzes et la lumière masse des nuages. Et d’autres choses, deux dossiers bleus, WirelessDiagnostics_W78...14.23.52, un second nommé l’étang, on est tenté d’aller relire, Sous la véranda ouverte il est installé là. Il n’y a pas de table. Seulement une chaise à haut dossier transportée depuis la salle à manger. Parfois il sort. Le long jardin s’enfonce sous l’étang. Au sol, les feuillets tiennent grâce à une pierre. Hypothèse qu’il y a sans-doute une pièce aveugle au centre pour la femme sous verre où se retirer, et qu’une fois entrée elle ne puisse être vue que depuis ce bureau du 3ème de la Caisse d’Epargne rive opposée de la route. Que puisque les cloisons intérieures sont transparentes elle n’a pu se cacher autrement que dans la perspective.
Il n’y a pas de table, l’espace est mal divisé, on dort, on mange, on écrit là, la vie le travail s’encombrent l’un l’autre. Sans-doute habiter devenant temporaire on a plus osé amener avec soi les meubles. Chambres, garages, greniers où sont restés les bureaux avec nos fantômes y travaillant toujours, gorgés de mémoire.
La fenêtre peut-être, qu’on emporte et ce sur quoi elle ouvre vers dehors les morceaux de rues, jardins, cours intérieures, façades hantées, rivières, hôpitaux dont on dirait qu’ils défilent pendant la replongée dans l’écriture. Combien de temps alors entre chaque mot.
Une planche noire, posée sur des tréteaux métalliques de la même couleur, bien qu’un peu plus brillants puisque pas usés par la peau des mains sans arrêt posées sur ce qui était le vernis de la planche. Ce n’est pas une planche, on devrait dire un plateau. Ça s’appelle comme ça. Il faut nommer les choses par leur nom, mais je ne connais pas le nom de toutes les choses. Ce serait plus simple, de bien connaître le nom des choses. Ainsi, cela éviterait des descriptions tarabiscotées pour les décrire. Comme cette règle métallique triangulaire avec ses six faces aux graduations différentes dont je ne me sert absolument jamais. Je ne fais que tracer un trait ou deux de temps en temps, avec, mais elle est très stable, très large. Elle doit bien avoir un nom, une appellation, une fonction, cette règle.
Comme tout ce qui se trouve sur ce bureau, peu de choses servent.
Dix pots occupent l’angle de droite, huit sont en terre cuite, un en verre transparent, pots de yaourt, achetés exprès pour leur fonction future, parfaitement indépendamment du parfum mais pas de la couleur puisque vert, orange, noir, jaune, violet, rouge, terre, bleu, transparent, gris, et un en plastique blanc, plus haut.
Un grand pour les ciseaux, tourne-vis, cutters, coupe-papier. Les autres pour les outils d’écriture, crayons, stylos, feutres, stylos plumes, de tailles diverses, couleurs variées, marques internationales, avec ou sans capuchons, et sont des dizaines. Tellement, que peu servent. Ou alors toujours les mêmes, les plus proches, les vite pris, les habituels, les préférés, ceux à la mode du moment, ceux qui marchent, ceux qui sont remplis, ceux qui sont de la couleur souhaitée.
S’il y a beaucoup de choses, sur cet espace, en effet, peu sont vraiment utiles. Elles sont là, c’est tout. Cette boite « La Vosgienne » remplie de trombones, punaises, vis, épingles, si rarement ouverte. Je me souviens que ma mère faisait la caisse tous les soir, après la fermeture du magasin, et qu’elle confectionnait des liasses de billets reliés entre eux par une épingle. Je n’utilise jamais d’épingle.
Des blocs de papier, de plusieurs formats, tous entamés de quelques notes sur les premières pages. Sans projet. Parmi une pile de chemises, violettes ou jaunes, des dossiers d’affaires en cours, d’impôts, de transfert de compteur d’eau, de l’opération de mon œil, de recueil de mails imprimés venant d’un ami à l’autre bout du monde pour quelques mois, quelques livres, des magazines, un catalogue. Une autre pile, du même acabit, mais bien plus basse, juste à ma gauche, avec ce qui est actif parmi les affaires en cours, dont le grand cahier de jardinage, dans lequel sont consignées les activités de plantation, semis, coupe, élagage, tailles, traitement, récolte.
Il reste de la place, au centre, et au plus près du mur, l’écran connecté à l’ordinateur portable posé sur une caisse à roulette sous le bureau, fabriquée avec des morceaux de palettes récupérés dans un entrepôt voisin, et dans laquelle est planquée l’imprimante. Au pied de l’écran, des carnets, un chéquier, un étui à stylos, un paquet de mouchoirs en papier, un porte-monnaie, des clefs de voiture, de maison, deux mètres enrouleurs qui n’ont rien à faire là, une petite enceinte bluethooth noire pour fournir le son des vidéos. Et, des cartes postales, parce que je fais presque tous les jours des cartes postales. Une boite en carton des Éditions « Temps Zéro », avec 21 cartes, il y en avait 22, mais une a été expédiée hier, je ne sais déjà plus à qui.
Il reste un espace de 30X50 cms sur le bord avant du plateau, toujours dégagé, car toute chose qui s’y trouve se voit repoussée vivement vers le fond ou les cotés, selon ce qu’elle est.
Là, c’est le petit clavier sans fil, pavé numérique intégré, avec lequel est tapé ce texte, qui occupe 11X34cm. L’espace restant profite à la souris, également sans fil, pour ses pérégrinations.
Elle est bien pleine, la table de bureau. Je viens d’y poser un appareil photo, mes anciennes lunettes, mon carnet d’adresses. Elle me sert bien davantage de vide poche que d’espace de travail, à proprement parler, car d’ailleurs, si j’y passe tant de temps, y fais tellement de choses, ce que je n’y fais jamais, c’est travailler.
Elle est au midi.
Au milieu, un ordinateur écossais plein de pouces, peut être pas le modèle avec le maximum, mais pas loin.
Sur le bureau de l’ordinateur écossais une photo de Polly Jean H, Euterpe et Vénus.
À gauche un amplificateur à pile, le Pignose 7-100, Jimmy Page, Frank Zappa entre autres l’ont utilisé.
À droite un coffret multicolore avec 6 petits tiroirs (accessoires guitare, boutons de manchettes, pin’s) une boîte en bois sans doute précieux.
Derrière l’ordinateur, en hauteur, un thermomètre qui marque 32°, devant lui une petite lune jaune qui devient verte quand on l’allume. Tous les noëls, elle quitte la table d’écriture pour aller au pied du sapin. À sa gauche une reproduction miniature de la cheese guitar de Ron Thal. À chaque extrémité, les enceintes. À droite le la table une main sort du mur.
Sous la table une large étagère de petite hauteur où sont rangées en ordre sentimental des modes d’emploi, des factures, différentes pochettes contenant différents documents annuels, c’est-à-dire que si on ne les a pas consultés dans l’année, on peut les jeter. Il faut simplement noter sur une feuille la date à laquelle on met le document dans l’étagère et ranger la feuille dans une des pochettes. Toute vérité est courbée disait le nain à Zarathoustra.
À l’Orient la fenêtre, emplacement idéal pour l’écrivain droitier. À gauche de la fenêtre une armoire, au-dessus de l’armoire un aquarium sphérique complètement scellé avec deux crevettes sans nom broutant une gorgone. Il ne faut jamais fermer les volets, sinon la gorgone ne produira plus les aliments des crevettes qui alors, ne feront plus les déchets qui nourrissent la gorgone, et c’est ainsi qu’il fait 32°, toute vérité est courbée…

Du côté des sept taureaux, un tableau de fox-terrier jouant de la guitare est entouré de couvertures d’album de Tintin : les sept boules de cristal, coke en stock, l’étoile mystérieuse, Tintin au Vietnam (oui, c’est un faux). À ses pieds un national resophonic comme celui de John Lennon (Attica State, John Sinclair…), une Taylor 512, une Révérend, Une strat.
À sa droite, un tableau de P Sougy de 1947 sur la division cellulaire, mitose, méiose.
À droite du tableau, une haute armoire étroite avec des étagères et des tiroirs. Dans un tiroir une urne funéraire avec les cendres d’un être cher fauché en pleine vieillesse à 18 ans. L’urne est entourée d’abrégés de philosophie chacun traitant d’un auteur. Olly ne s’était pourtant pas trop intéressée à la philosophie (comme la plupart des chiens)
À l’occident, encore des étagères avec 3 coléoptères sud américains colorés, deux albums de Tintin inédits : Zinzin maître du monde et le Lac de la Sorcière, trois sculptures.
Enfin l’horloge, il est tard.

La table de travail, c’est celle qui est face au mur, s’y trouvent l’ordinateur, une petite étagère dans laquelle sont rangés quelques livres et divers papiers, des périphériques pouvant être utilisés ponctuellement avec l’ordinateur… sur l’étagère sont posés une lampe pour avoir plus de lumière en cas de besoin, la box et un appareil Bluetooth car le son de l’ordinateur est trop mauvais et écouter au casque est pénible voir parfois douloureux.
Là, sur la photo, il manque l’inséparable appareil photo, il est justement utilisé en vue de faire les clichés du montage qui accompagne ces notes.
Toujours sur la table, un peu partout, traînent des post-it et des morceaux de papier, recyclage de feuilles déjà utilisées et déchirées -pas découpées ce qui et réservé aux personnes soigneuses- en deux ou en quatre sur lesquelles sont notées des to-do lists, des pense-bêtes et des morceaux de textes épars. En ce moment, l’espace fumeur, à main gauche, regroupe le traditionnel paquet de cigarettes et les accessoires du vapoteur. C’est là aussi que sont posées diverses télécommandes : radio, télé, lecteur DVD… et qu’atterrit inévitablement le téléphone portable.
A main droite, l’indispensable théière et sa fidèle compagne la tasse, une boîte de mouchoirs en papier placée sur une panière dans laquelle s’entassent les paperolles pré-déchirées et des notes qui pourraient encore servir.
Derrière l’écran, le téléphone fixe, les lingettes pour nettoyer les lunettes et les écrans ainsi qu’une ancienne boîte en métal Craven A qui accueille les cartes mémoire ; elles servent aussi bien pour le Panasonic et le Nikon que pour le Zoom Q3 HD qui n’ai pas souvent utilisé.
Mais l’appartement est petit, alors très vite dans l’exiguïté de la pièce principale, la pieuvre table de travail tend ses tentacules vers la grande table ronde sur laquelle s’accumulent les documents de travail en attente de rangement et les médications quotidiennes, la grande soupière qui vient de la grand-mère paternelle et qui contient pêle-mêle divers petits objets réunis là par le hasard : élastiques, trombones, centimes d’euro en cuivre, boutons, pressions, cartes inutilisées,... S’y déroule le plus souvent la gestion des papiers administratifs et les étapes intermédiaires de l’écriture manuscrite ou sur écran.
Une autre annexe intérieure de la table de travail est la méridienne. C’est un luxe, le seul dans cet appartement modeste où l’espace le plus important est réservé aux livres. Presque allongée, y lire et y annoter livres et documents… peut y être adjointe une petite table roulante qui supporte une pile de documents, les lunettes réservées à la lecture… une fois retiré tout ça, y installer l’ordinateur pour une consultation ou une notation rapide.
Enfin, ce petit deux pièces en rez-de-chaussée -même si ça n’a rien à voir avec le numéro 22 de la Ruelle d’Or, visité il y a quelques années, où séjourna Kafka durant l’hiver 1916-1917, aujourd’hui une minuscule librairie consacrée à son œuvre- c’est sombre. Alors, quelquefois, le besoin de lumière élargit la table de travail vers celles des terrasses des cafés, si possible chauffées à la mauvaise saison pour lutter contre l’humidité et le froid le cas échéant… De toute façon, toujours à l’extérieur car il faut pouvoir fumer ou vapoter. Là, l’écriture, le plus souvent manuscrite s’accompagne d’un thé, d’un soda, d’une bière ou d’un verre de vin en fonction de la température et de l’humeur. Il arrive même que cette table soit celle d’un fast-food voisin de l’appartement ; le bruit extérieur -métro et voie rapide- contribuant à un repli sur soi, en soi favorable à la décantation des idées et à l’écriture. Aux tables de travail extérieures, s’élaborent le plus souvent les premiers jets ou se finalisent les dernières mises en forme sur l’ordinateur.
Ne laisse pas traîner ton désespoir sur la table. Cette phrase accompagnée de quelques autres dans un petit carnet de vocabulaire bleu ; j’ai repéré son jumeau sous une pile de dossiers, de choses à faire et sur le tas des papiers en souffrance, mon passeport tout neuf, tout frais, valide dix ans.
Sous le passeport, un cahier d’écriture quadrillé devenu par nécessité cahier de commandes rempli de prix, de quantités, de références, de listes, numéros de téléphones clients, annotations et au début, quelques feuilles squattées par une prose qui maintenant m’indiffère. Des pages en transit vers l’oubli. Fixer le contingent, le désordre d’où je vous écris.
Du temporel dans le temporel ; du qui passe brossé sur la toile de ce que l’on suppose passer moins vite et au demeurant, l’intemporel nous est-il accessible autrement que sous la forme vague d’une notion imprécise émanant d’un réel insaisissable ?
Ma table de travail se compose de cinq éléments. Trois accolés et deux légèrement espacés du bloc principal, en l’occurrence un bureau plat Empire aux tiroirs difficiles en raison de l’absence des clés non pas perdues ; rangées mais où ?
Un lampadaire 1930, cuivre doré, patiné, à la tombée du jour éclaire, tout en les séparant, le bureau Empire et caisson à roulettes, élément bas, mobile d’un bel ensemble fonctionnel des années 70, lequel supporte l’imprimante, le boitier internet, une carte postale pour ne pas oublier la mer, quatre petits écrins dont un minuscule offert par ma fille cadette à son retour d’Amsterdam.
Adossé au caisson, un meuble radio tourne-disque avec chargeur automatique de 45 tours. Idéal pour les surprises-parties, les boums ou surboums. Le blason blanc, le chien au gramophone, s’est envolé pour atterrir sur le plateau du pick-up.
Beromünster, Belgrade, Vienne, Italie, Athènes, Roumanie, Stockholm, Paris, Yougoslavie, Rabat, Sottens, Tunis, Saïgon, Monte-Cénéri, Bruxelles, Allemagne, Andorre, Maroc, Limoges, Moscou, Monte-Carlo, Vatican, Algérie, Dakar.
La radio fonctionne encore. Hier, en direct de Radio Sottens, j’ai capté les infos. Bonne nouvelle ! Le général Joukov avance sur Berlin. Les jours du troisième Reich sont comptés ; Brexit ou pas ? Les britanniques passent au vote dans trois jours. La télévision couleur débarque en France. L’actualité mondiale à portée de clic mais elle me sert à quoi, l’actualité mondiale ? Et j’y peux quoi aux crises de rages gouvernementales, révolutionnaires, idéaux logiques ou pas. Je reste parfois plusieurs semaines sans savoir que partout sur terre les gens se déchirent, ont peur, se jalousent, sont tristes, souffrent même dans l’abondance, je ne sais pas ; je dois me tromper, une telle absurdité ne me semble pas viable. Et si les trente-six justes de la tradition juive existaient et que le monde tienne grâce ou à cause d’eux, en passant à trente-cinq ou trente sept justes, le monde changerait-il de base ou ses bases se déroberaient-elle sous le poids de nos certitudes et du reste ?
Le « La voix de son Maitre » accueille, là ou l’on aurait pu poser un bouquet des champs, une grenouille desséchée en provenance d’un petit lac de montagne situé à une heure de marche de la station spatiale qui me sert de chambre et de bureau ; le batracien semble poursuivre un scarabée vert mais peut-être jouent-ils ? Sur le meuble à musique roupille un cendrier-bougeoir, un bougeoir-cendrier selon l’usage ; sa bougie blanche poussiéreuse, à moitié fondue remonte vers les sables de l’enfance. Dans la partie cendrier, quelques billes attendent des joueurs. A pas deux centimètres une figurine érotique népalaise. Pas antique du tout. Derrière, un gros feutre vert. Que fout-il là ?
L’écran domine et ordonne l’espace. L’ordi repose sur une plaque de verre censée protéger des brûlures de clopes, des inondations thé à la bergamote, taches et accrocs supplémentaires, le revêtement cuir et la marqueterie du plateau.Trois zones se répartissent la surface vitrée.
A l’angle supérieur gauche, un petit baffle. Devant l’enceinte une boite cylindrique ; du cuivre joliment ciselée, quatre à cinq centimètres de hauteur, art nouveau fin XIXième au couvercle orné d’un entrelacs d’ailes de papillons exotiques ; couleurs changeantes sous l’incidence lumineuse.
A coté d’un mobile offert à Split par une amie chère, une paire de ciseaux jaune, un morceau d’échelle légo et son chevalier désarmé, couché sur le dos souriant au plafond ; sous la main, le thé, le tabac, les feuilles, le cendrier « je fume bio », le téléphone et le clavier. Ce dernier masque en partie une carte postale ; une reconstitution du palais de Dioclétien dont la vue me transporte, de suite, dans les rues resserrées de Split que j’arpenterai sous quelques jours avant de retrouver le bureau de la mer, dépouillé, dégagé, délesté de tout courrier administratif ; bleu-vert-émeraude il a pour nappe immense et salée la peau transparente de l’eau mêlée à celle azurée du ciel. Un pli dans l’oubli. Près du personnage légo, un petit canif artisanal en provenance de Goa. Cadeau d’un ami.
Sur la droite, du bazar empilé. Au sommet trône donc mon passeport neuf, sans additif, sans conservateur, biodégradable, biométrique (l’ombre de la phrénologie s’agite dans les couloirs) et juste en-dessous, ce cahier bleu entamé, quelques pages racontant je ne sais quoi, puis recyclé en carnet de commande. Plus bas, du courrier, deux factures plus.un PV gratiné ; excès de vitesse frôlant l’annulation de permis. Je dois me calmer toutefois survivre paisiblement dans un monde violent est un exploit difficile sinon impossible (pour l’heure et pour moi) à plein temps faute d’un lessivage, rinçage, essorage de cerveau. Ainsi fatalement, l’irritation, la colère parfois prennent le volant si je songe au monde des hommes et si en plus je balance « High way to hell » dans le lecteur CD, la vitesse gagne du terrain d’autant que la caisse confortable n’en laisse rien ressentir. Du blues, de la country et du folk pour conduire et le régulateur de vitesse. Dans les villages, toujours. Un autre PV, deux cents euros ; indiquée en gras, la possibilité de saisir les meubles en cas de non-paiement. Bye bye bureau Empire ? Je vire les factures, les PV, les comptes rendus d’assemblées (à faire signer par les associés) à la cuisine. Apparaissent des cordons. La prise USB du mobile, des écouteurs que je place ailleurs, un paire de lunette de lecture, pas une des miennes ; un tirage numéroté de chez Denoël , mille cinq-cents exemplaires : « Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France. » Doit rejoindre le secteur Blaise Cendrars. A ranger, de même ces lunettes.
Encore un petit carnet bleu. Intact. Un de ceux que je glisse toujours dans une poche avec un stylo plume, un bout de crayon des fois qu’il me viendrait une idée, comme ça, en marchant et je pense à ceux qui ne marchent plus. Un autre cahier de boulot me rappelle que je n’ai pas terminé de tout saisir et rassembler ; un chéquier mes paiements, Une enveloppe vide, une feuille avec des comptes de tarot et un bout de commande terminée, je froisse, poubelle. Encore une carte postale pour ne pas oublier la mer ; un stylo « chevalier- templier » acheté à Heidelberg lors d’un après-midi au château. Un regard vers l’université. Un autre PV, un rappel peut-être ; à contrôler. Un agenda et à plat, enfoui sous la paperasse, un numéro hors-série de Rock and Folk « Psychédélic Shit. » Couverture de Solé ; Morisson, Hendrix, Jagger. Tout un programme.
Au pied de la seconde enceinte, des cartouches d’encre pleines de mots à naitre ; entre les deux hauts-parleurs, l’écran, le centre de la scène. Devant le clavier. Dessus les doigts suivent le fil des idées ou, suspendus en guettent la suite voire, à défaut d’idées, la reprise de l’inventaire.
Un curieux petit meuble évoquant un porte-journaux relie le bureau plat à une table d’appoint Louis XV en noyer. La table sert de cimetière à paperasse quant au petit meuble intermédiaire, j’y répertorie : une trousse d’écolier bourrée de stylos dont je serais supposé vérifier, un jour, le bon fonctionnement : une coupelle signée, artisanat breton vraisemblablement et dedans la carte d’un cercle littéraire, une plaquette de quatre timbres, un taille-crayon, un crayon, une cartouche blanche d’encre noire ou bleue, un petit coeur en tissu blanc orné d’une perle rouge, quatre cure-dents dans leur étui, un sachet plastic refermant quelques écrous, ( un mec entrant en taule ou en sortant et dont on énumérerait le contenu des poches ; voilà à quoi je pense en déclinant ce matos) deux autres sachets contenant des images pieuses chrétiennes des années cinquante, deux auto-collants ; l’un représente Shiva et l’autre Gao Mata, la Vache Mère ; blanche et sur son corps sont peintes des divinités hindoues ; d’une fleur de lotus au coeur ouvert, un lingam s’élève à la verticale d’un yoni ; des quatre pis de Gao Mata le lait coule sur l’union sacrée du principe mâle et femelle ; semence cosmique, Hathor, Apis, Mithra, Zeus en taureau blanc, Europe, Pasiphaé, la Vache est un curieux personnage. Divinité, fécondité, générosité. Tout ça ne nous vient évidemment pas à l’esprit en arrosant les pop-corn du petit déjeuner ou en avalant un yaourth et ce que devient un animal dans une société industrielle, on y pense ? et nous ? Sur ce meuble encore, une baguette chinoise, un repose-poignet endormi, de la menue monnaie de plusieurs pays en vrac, un feutre noir, une paire de lunettes, un étui à lunettes vide et plus loin, le garage, le parking longue durée, la casse à papier ou s’entassent l’inutile, le « je le garde mais pourquoi ? » cependant dans le paquet, peut-être quelques documents à conserver sinon à traiter.
Des cahiers à embarquer, le numéro deux d’une série manga, un bouquin sur Hugo Pratt, un vieil agenda, des feuilles échouées à trier, la plupart à virer, j’y vais.
Marrant de faire le ménage en écrivant ou d’écrire en faisant le ménage... Du reste écrire, n’est-ce pas faire une sorte de ménage ? Dépoussiérage de la forme, des idées, briquer le fond ! L’exhumer du néant, le faire advenir par la magie, la danse des signes, des sons, ceux-là même que vous lisez, entendez en vous et qui deviennent des mots, des phrases, du sens et captent ou non, votre attention. D’où l’importance de ne pas raconter n’importe quoi et si n’importe quoi, de le faire bien ; rendre attractive la banalité, celle que l’on oublie, que l’on ne voit plus à tant la voir et qui passe sans nous voir quand chaque objet, le plus insignifiant soit-il, se rattache et nous rattache, par la considération que nous en avons, à l’univers tout entier. Ainsi un récit peut démarrer sur n’importe quel gadget inutile lézardant dans la poussière d’un bureau, croupissant sur une étagère, un couteau tiens, voilà qui me ramène à cet espèce de porte-je-ne sais-quoi et près des images pieuses chrétiennes des années cinquante, ce couteau de cuisine au manche joyeusement coloré me rappelle la tendresse et que je suis père.
Bon, au tri,c’est pas tout d’écrire, faut bosser.
Les cahiers ont rejoint le carton de bouquins que j’emporte, deux cartons en fait, je crois que c’est beaucoup, je devrais sélectionner plus rigoureusement ; le bouquin sur Pratt est allongé à plat sur un autre bouquin de Pratt, dans le secteur Pratt déjà plein. Ce qui me fait penser à la nécessité de ranger la bibliothèque, une sorte de chantier perpétuel… Deux copies de bilans de société à jeter. Des documents que je n’aurai pas à réimprimer, chic. Un sous-verre retrouve une relative utilité ; un jeu offert par mon petit-fils, remisé avec les cahiers et les livres du voyage me fait penser que je dois acheter des jeux de tarot puis viennent des factures clients ; question : les ai-je envoyées ? Oui, certainement puisque j’ai déjà été réglé de certaines ; à vérifier cependant ; à conserver.
A jeter, deux vieux bons de commandes. Une facture à expédier, celle-là c’est sûr. Voilà le monde dans lequel on se débat, un monde de papier, monnaie ou non. A jeter ; l’adaptation de plusieurs interviews parus dans un manga traitant des problèmes du nucléaire. Sous les pages pliées de l’adaptation, quelques cartes postales dont une de Sardaigne ; des vacances, avant, une autre voiture, beaucoup de vent, un temple perdu dans le printemps auquel ne manquait ni pâtre ni Pan, l’éternelle fête d’un instant ; une ancienne représentation des ramendeuses au boulot sur le port du Croisic ; les couleurs passées, délavées, trempées dans le bassin du soleil repoussent la scène des années soixante vingt ans en arrière ; un opuscule non daté (années quarante sans doute) : « comment guérir les maladies du foie. » A ranger avec les ouvrages de naturopathie, médecines douces et traditionnelles. Provisoirement sur une pile d’ouvrages à dispatcher.. .
Deux petits carnets, encore des carnets, de vocabulaire bleus vont avec ce que j’emmène. L’un contient quelques lignes. Parfois, à relire, je me dis : « tiens j’ai écris ça ? » Billets de train pour Milan, poubelle. Une veille commande manuscrite, poubelle. Tilt ! Je reprend le papier, le défroisse ; ce client a précisément une commande en cours. Fichtre ! Je l’appelle, reviens de suite. Voilà qui est fait. Avec le rappel de ce client, m’est remontée toute une flopée de tâches à liquider avant de boucler pour trois mois. Les cartes postales à plat sur la tranche d’un rang de polars. Une poignée de feuilles vierges que j’ajoute à celle de l’imprimante, un dossier de télésurveillance à archiver, un inventaire datant de 2006 que je garde pour mémoire. Une gomme et crayon balancés dans la coupelle bretonne, un clavier poussiéreux, et dessous, enfin dégagé, ce dessin à l’encre de Chine blanche réalisé sur un sous-main noir. Œuvre d’un ami et présent de ce dernier. Un étrange artiste dont le travail consiste a créer puis à détruire ou compresser ; des dizaines et des dizaines de cahiers couverts de ses écrits prennent la poussière sur ses étagères sous forme de briques. Un mot que l’on devine, une syllabe parfois émergent d’une des faces de la compression.
Construire avec les briques des mots des récits inatteignables, des tables, des chaises, des rangements, un cheval de Troie et les briques de la table stimuleraient l’imagination. Quels sont ces contes à jamais scellés ? Est-il possible de les retrouver ? Une porte s’ouvre sur le désert des livres perdus ; peuplé de fantômes cités par d’autres en ayant entendu parler ou même, ayant eu le livre entre les mains, Longévité des ouvrages...
Je déplace la chaise cannée au dossier fragile ; j’y pose ce qui est à conserver du capharnaüm viré de la table aux pieds qu’on dirait dressés, droits, des cobras aux capuchons à peine déployés. Le travail de mon ami apparaît, superbe, captivant ; un coup de dépoussiérage et le voilà comme neuf. Je le redécouvre. L’impression de libérer des forces, de l’énergie pure.
Difficile d’en expliquer le thème complexe, une sorte de spirale où l’ombre le dispute à la lumière, les anges aux démons, des personnages, des abîmes, la volonté d’un départ pour l’infini ; des galaxies fuyant dans les profondeurs d’anneaux se refermant ou, possible, en expansion ; chaque écaille profile une silhouette humaine, certaines bénéfiques d’autres pas du tout . Ainsi, par la grâce de l’art, d’un sous-main exhumé, je finis dans l’infini et l’amitié cependant finir ; comment finir dans l’infini ? Ne contient-il pas tous les débuts ? Danser peut-être…..sur les ondes aléatoires de nos destinées, marcher sur des chemins qui n’existent pas et les rendre, par les passages successifs de nos pas, visibles et praticables.
D’une manière générale, je n’aime pas les bureaux. Peut-être parce qu’un bureau n’est rien d’autre qu’une table de travail. Et le travail, je ne l’aime pas non plus. Je m’efforce de le tenir à distance. Les bureaux me rappellent le bureau, c’est-à-dire l’endroit où j’avais coutume de me rendre chaque jour, du temps où je travaillais. Maintenant, tout cela est derrière moi, heureusement. Chez moi, il n’y a pas de bureau, je veux dire qu’il n’existe pas une pièce spécifique pour y caser un bureau. C’est bien trop petit. Le bureau est dans mon salon et le salon, c’est la pièce unique où je vis. Du reste, je m’y sens bien car j’y vis seul et peu de gens viennent troubler ma quiétude. Le seul meuble que j’estime, c’est la bibliothèque, parce qu’elle rayonne de l’âme de tous les écrivains que je chéris, Victor Hugo, Balzac, Huysmans, Baudelaire, Lautréamont, Flaubert, Maupassant, Dostoievski, Chandler, Melville, Jack London, Bukowski, Camus, pour ne citer que quelques-uns d’entre eux. Ma bibliothèque est vieille et se remplit de livres poussiéreux, ce qui augmente l’excitation que je ressens lorsque je m’en approche. Face à ce meuble antique, il y a mon bureau que j’exècre, lui. Je l’exècre parce qu’il prend trop de place. J’avais opté pour un modèle suffisamment grand pour que je puisse y poser un ordinateur, une imprimante, un modem, un téléphone, une boîte contenant des stylos, des crayons, et même des tournevis. Enfin je souhaitais des tiroirs à portée de main pour fouiller dedans et y trouver tous les objets qu’il est impossible de ranger ailleurs : gomme, colle, timbres, typp-Ex, stabilo boss, étiquettes auto-collantes, clés usb, lampe de poche, lacets, scotch, loupe, agrafeuse, élastiques, cendrier, porte-clés, cadenas, nettoyant pour lunettes, chargeur d’appareil-photo, appareil-photo, photos d’identité de ma pomme, photos d’identité de ma dulcinée, et même, à l’abri de tous les regards, photos d’identité d’une ex ou d’une ex-ex ? Imaginez un bureau qui n’aurait pas de tiroir ! Imaginez un tiroir qui n’aurait pas tous les objets que je viens de vous citer ! Je ne l’aime pas ce bureau, mais il me rend bien service après tout. Et puis, c’est derrière cette table de travail que je passe les deux tiers de mon temps, le nez collé à l’écran de mon ordinateur. Je vous l’ai dit, je n’aime pas ce bureau. Il est moderne, « design », et moi, j’affectionne le style colonial, l’odeur de la palissandre mêlée aux relents de cire et d’encens.
J’aurais voulu un très vieux meuble comme ces reliques qui sont conservées, dit-on, à Lambaréné, dans la maison du docteur Schweitzer, transformée aujourd’hui en musée. Imaginez une contrebasse géante coupée en deux et vous obtenez typiquement la forme du plateau de mon bureau. Des angles et des courbes à la mode des années 70. Rien à voir avec le bureau de mes rêves, mais il est léger. Depuis toujours, je tiens à ce que mes meubles puissent être facilement transportés car j’ai dans l’idée que tout homme doit rester mobile et apte à déménager prestement lorsque l’occasion se présente. Soyons lestes et pour cela, contentons-nous du minimum ; éloignons-nous de tout ce qui est pesant car tout ce qui est encombrant nous enchaîne irrémédiablement sans que nous puissions même en prendre conscience. Mon bureau, disais-je, est fonctionnel avec un écran d’ordinateur de 17 pouces qui trône en son milieu et qui pourrait laisser à penser (je précise qu’il s’agit d’un Mac) que j’exerce une profession stylée comme web designer ou monteur, graphiste, architecte, écrivain ! Et pour lui donner une touche « arty », j’ai ajouté, pêle-mêle, deux petites figurines, l’une représentant un moine Shaolin dans la position du Mawashi-Geri, l’autre un marquis en livrée avec tête de chien. Il y a aussi des objets que je préfèrerais dissimuler, notamment des cure-dents que je ne trouve jamais lorsque je les cherche, mais qui refont surface lorsque ma compagne me fait le plaisir de me rendre visite . Quand je suis enrhumé, et cela m’arrive souvent, il y a aussi, parmi les objets « nuisibles », des kleenex usagers ou des trombones qui ne servent à rien, des post-it sur lesquels j’écris des petits mots qui ne doivent surtout pas être lus par quelqu’un d’autre que moi. Et il y a enfin mes petits talismans : les coquillages que j’ai ramenés de la Pointe de Mousterlan, la tourmaline et la turquoise, cadeaux porte-bonheur de ma bien-aimée, et une pomme de pin qui ne ravive même plus le moindre souvenir (d’où vient-elle ?). Je ne m’en étais pas vraiment rendu compte, mais cela contient tant de choses, un bureau, tant de petites choses de nos petites vies. Finalement, nous ne sommes que de la matière et le moindre morceau de matière nous renvoie à nous mêmes.
Ma table bureau est ronde avec un pan rabattu côté mur et je déplace mon fauteuil au long de la rondeur, je cherche l’angle.
Elle est en merisier, une de ces tables qu’on peut allonger pour y installer 20 personnes. La mémoire de ces moments se promène tout autour. Achetée aux Puces de Clignancourt il y a quarante ans, une de ces tables un peu bancale, juste imparfaite la vie y a inscrit ses traces, je la caresse souvent j’en aime son épaisseur, elle murmure tellement d’images.
Elle est pleine et je la voudrai vide. Paradoxe.
A droite des classeurs transparents avec des étiquettes
A main droite des feuilles pleines de choses à faire, faites, des mots des phrases glanés ici ou là.
Sur le devant une lampe Ikea noire basique à laquelle sont accrochés toutes sortes de rubans, de fils tressés, auxquels s’ajoutent des photos, de petits origamis faits par les enfants maintenus par de minuscules pinces à linge. De ces choses petites un jour importantes dont il ne reste que le souvenir du geste, la carte d’un photographe oublié le nom, elle est belle, l’émotion est toujours intacte.
A côté un « mug » rapporté de Prague avec en vert et en allemand un fragment de texte de Kafka, les stylos s’y entassent, plus loin le « mug » noir à crayons, des carnets, des feuilles une carte Michelin.
Des bouchons de bouteille en verre, une boite d’allumettes.
A gauche un empilement de livres, un rempart, une présence amie.
Sur le mur un joli portrait de femme de Petrus Christus découvert à Berlin dans un musée en même temps qu’un autoportrait de Rembrandt, à côté la photo de ma mère à un Noël si peu de temps avant son départ et pourtant bien présente tout proche la photo de son arrière petite fille de trois ans qu’elle n’aura pas connue.
Et encore une gomme, une agrafeuse, un carreau rapporté de Porto avec le profil aigu de Pessoa, et quelques mots « se ha autras materias et autros mundos Haja ».
C’est un bureau, une improbable juxtaposition du temps.
Je le voudrais vide et lisse et silencieux
Je voudrais qu’il arrête de me parler
Qu’il s’efface qu’il soit simple écritoire
Pour accueillir ce qui voudrait s’écrire
Et ce vide appelé
Est plein, trop plein et
si nécessaire
Le bloc quadrillé, le crayon qui hésite
Les feuilles du chêne agitées par le mistral naissant
Un rayon de soleil
Il fait bon
Glissement du temps
Les feuilles scandent les mots
L’ombre s’entrouvre.
Vous n’allez pas le croire, mais des tables de travail, il lui en faut plusieurs. Elles se justifient toutes très bien et elle en est fière de tous ses tables.
− Suivant que sa jambe veut bien ou non monter l’escalier montant à la mezzanine ;
− Suivant qu’elle doive ou non surveiller l’arrosage des oliviers ;
− Suivant le temps qu’elle a pour écrire.
Une seule chose en commun à ses différentes tables de travail, son ordinateur portable, son Acer avec ou sans son alimentation reliée à une prise qui la suit partout ou l’attend parfois.
Dans le jardin, il ne faut pas pousser, on ne se branche pas encore sur la cuve des mille litres d’eau qui se délivrent lentement au pied des oliviers. Donc laisser l’alimentation à sa place à l’une des autres tables de travail.
Elle aime bien ses deux tables de travail du jardin :
− Soit la ronde en fer forgé blanc à la chaise peu confortable, sous le grand chêne ;
− Soit la chaise longue bain de soleil, où elle s’assoit à califourchon, la faute des ânes et des chèvres qu’il faut surveiller en même temps. Il faut être prête à bondir.
Ce sont les tables d’écriture du 15 mai au 15 septembre.
Elle les prête ou les partage avec ses hôtes qui viennent écrire au détour d’un séjour ou d’un atelier d’écriture de Mots Voyageurs.
Elles sont là et parfois se trouvent bien solitaires, recouvertes du sable du Sahara ayant volé jusque-là ou des cadeaux déposés par les tourterelles ou pigeons de passage en son absence.
Mais soyons plus sérieux, il y a les deux autres, celles de la maison.
L’ordinateur en commun, branché en permanence et toujours à gauche de la grande table, trônant tour à tour sur l’une des deux grandes tables.
L’une en teck à l’étage, patinée par le temps, et croulant sous les papiers, les notes à ranger, les livres, les boites en fer de tout format où se cachent chocolat ou gâteaux secs, que parfois elle oublie là. Deux mètres sur quatre-vingts centimètres avec un fauteuil à roulettes qui, plus d’une fois, a failli la faire tomber, se prenant les pattes sur des feuilles enfuies de l’imprimante installée juste derrière. Elle cherche toujours un crayon, elle garde même ceux qui sont vides, pour le plaisir, même un vieux Bic… elle garde, elle garde tout dans son ordinateur aussi.
En face de la table, un bout du Mont Aurélien, à sa gauche un bout de la Sainte Baume. Deux fenêtres ouvertes sur la nature. En regardant à droite et en montant sur un escabeau, tout cela en imagination, elle verrait un petit bout de la Sainte Victoire, si chère à Cézanne. Et dans son dos, c’est le gros Bessoude, croit-elle mais elle lui tourne le dos.
À sa droite, des grandes bibliothèques, des livres de sa vie d’avant qui sont là pour lui rappeler qu’ils l’ont suivie dans ses déménagements. Classés par ordre alphabétique pour la plupart mais il y a son étagère préférée, celle consacrée à la collection du Mercure de France, « Crime parfait », écrits policiers d’écrivains rompus à d’autres techniques, qui date du milieu des années 80. Quel régal d’avoir découvert il y a bien longtemps maintenant cette collection, trop vite arrêtée. Quel plaisir d’en relire certaines pages comme cela par hasard. Elle côtoie les nombreux livres de la collection Suspens.
Ne pas oublier aussi toute la partie réservée aux livres sur les chats… c’est assez pour la mezzanine où d’autres livres s’entassent sous la grande table de travail, en mauvais équilibre que Isa, la chatte noire s’amuse à fragiliser encore plus. Quoi dire encore sur cette table de travail, qu’elle l’a débarrassée dernièrement de tout pour pouvoir chasser els miettes des gâteaux qui y traînaient. Grand ménage de printemps pour l’arrivée des mots nouveaux ou prochains projets.
Maintenant l’autre table, celle de la grande pièce à vivre, au rez-de-chaussée. Celle qui l’accueille quand l’ordinateur n’a pas trop le temps de s’installer. Il est juste en transit pour une soirée alors l’escalier… il faut lui faire une place, il faut aussi la place pour les cahiers où elle a écrit pendant un atelier, il faut taper… avant de repartir au théâtre ou à l’atelier informatique dans les préfabriqués de la ville. Et la table, il faut la partager avec l’assiette du repas rapide ou du petit-déjeuner car moment idéal pour écrire. Pas la même vue là au ras du sol. Le poulailler dans le dos et en face l’enclos des ânes et chèvres et le parterre de lavande. Et aussi très important à droite le poêle à bois. Pas de fauteuil, non un grand banc encombré de son cartable, de quelques numéros du 1, pas tous encore déballés donc lus. Et encore des boîtes en fer de toutes couleurs et formes, ses réserves à énergie plutôt du genre salé ici. Et ne pas oublier, ses orchidées.
En y réfléchissant bien, faudrait vraiment qu’elle range un peu et s’organise mieux.
Mais ce sont souvent, le temps à passer ou sa jambe qui décident pour elle.
Fini pour les tables de travail.
Elle admet qu’elle est privilégiée car parfois elle se pose aussi, sur la table de la véranda, partie prenante de la maison, pour profiter de la pluie qui frappe son toit et pleinement du paysage.
Il faut ranger les livres destinés aux enfants pour les leur faire découvrir lors des séances autour du dispositif Lire et Faire Lire. Ils sont de plus en plus nombreux sur els étagères. Elle ne préfère pas savoir leur nombre. L’ancien fonds de la MJA, les récupérés ici ou là, les donnés aussi et les siens, car les livres d’enfant ont toujours été sa passion.
− Des caisses de pommes de terre primeur en guise de bac de rangement, qui s’entassent avant de trouver preneur ;
− Leurs couvercles deviennent intercalaires ;
− Les contes sur les étagères de gauche (plusieurs versions pour le même, pour comparer, pour laisser parler l’imagination) ;
− Puis les animaux sauvages, et plus loin ceux de la ferme, attention la cohabitation est plus qu’improbable ;
− Les séries de Caroline, Martine, Tchoupi, Oui-Oui, Babar et Cie et autres petits animaux d’Antoon Krings ;
− La mer et ses poissons ;
− Le loup sous toutes ses formes (deux étagères complètes pour ce héros que les enfants adorent) ;
− Et les sorcières qui côtoient les géants, les monstres…
Chut ! Elle approche, s’empare d’un des livres à sa portée, tiens…
Chut ! on ne la dérange pas.
Partons du plateau de cette table à écrire sur laquelle rien n’est posé.
Un assemblage symétrique agence huit pièces de cerisier roux clair : quatre rectangles et quatre tours qui composent un ensemble incurvé. La courbure extérieure, à droite et à gauche, reprendre les quatre angles arrondis comme des petits beurres. Sur l’arrière et le devant, un petit gonflement reprend le rond de l’angle et redevient plat où s’ouvre le tiroir. Les pieds, ronds comme des pattes de lion ou des longues tiges de fougère enroulées en crosses, sont chacun ornés en leur sommet d’une feuille d’acanthe en relief. Haut de soixante-cinq centimètres, d’un plateau de 90 de long sur 54 de large, je le verrais bien supporter un écritoire de cuir lie de vin et un soliflore d’Emile Gallé. On l’imagine donnant sur un jardin, derrière un grand rideau de lin brodé et l’une de ces croisées comme celle du petit pavillon où il se trouve aujourd’hui, au 7 rue des Romains : le fer s’enroule sous la barre de bois dans une convolution semblable à la branche d’un liseron.
Ce bureau simple, sans être l’un de ces petits secrétaires à rouleau où l’on pose à peine un papier tant la tablette est étroite devant sa suite un peu ridicule de petits tiroirs à boutons, est un meuble de femme, original ou copie, l’antiquaire le saurait sans doute, datant d’une époque qui pourrait être celle de Sido ou celle de Colette.
Ce meuble a une finesse d’inspiration qui permet d’imaginer qu’il fut jadis conçu pour un être aimé, une jeune femme qui aimait écrire des lettres, et qui y travaillait longtemps. Sa conception-même l’indique, le soin dans l’assemblage de chaque pièce de bois, le choix d’opposer les veines à l’oblique, en quiconque, alternant les biais autour du centre comme sur un cadran, et reprenant, à l’inverse, l’opposition des veines, sur le tour, puis sur les côtés du plateau.
La tablette, assez large, permet de poser l’ordinateur et, de part et d’autre, des feuillets A 4 ou à trois, quelques piles de même taille derrière, pour qui le voudrait. Rien d’autre n’est jamais posé, quand le travail est fait, sur la tablette. Rarement, l’écran, demeuré là, montre un paysage de forêt dans la brume, opaque le jour, opalescent le soir tombé. Il n’y a rien non plus de posé, jamais, sur ce bureau-là. Dans le petit tiroir, restent toujours un stylo bille noir, un crayon à papier, un coquillage (une porcelaine) et un petit sac de sable, deux petits flacons huiles essentielles pour le brûle-parfum, lavandin et cédrat.
Y sont posés, parfois, quand l’occasion veut qu’un dîner occupe la table ronde du salon, un globe de verre bleu et une coupe danoise, du même bleu vif, le cœur d’une plume de paon. Le reste du temps, le plateau reste sous la lumière sans filtre du jour. Un ordre, semblable à celui que tous les tableaux présentant Saint-Jérôme respectent, s’impose, celui du rectangle de la table, de la tablette, ou tombe la lumière, tout droit. Le jour, transparent ou opaque, ombreux d’un jour gris d’orage ou lourd de la poussière d’or du soir, y révèle les taches tavelées des âges.
Il révèle l’histoire de ce bureau, qui semble reprendre, dans le chaos de la vie, la symétrie des veines du bois, élément essentiel qui sans aucun doute présida à sa conception. Le plateau en son cœur est couvert de minuscules traits verticaux, allant contre le cours du bois, le rayant de manière imperceptible, sous l’effet d’un frottement ou d’un geste d’enfant, symptôme traversant, encore visible à l’œil nu pour qui se penche, l’encaustique blond, après avoir été poli et repoli à la ponceuse à main, sans doute.
Désormais, qui l’effacerait effacerait aussi la veine du bois, qui l’entrecroise de biais, comme ces traits de crayons qui, sur un visage, dessinent aussi l’ombre de la paupière et le bistre des cernes. Ainsi, l’on suit leur fil comme l’origine d’un geste d’écriture, comme le doute dans le raisonnement, comme l’herbe folle dans le parterre de roses bien tenu, cette force qui fait retour, tel l’estran sur le bord de l’eau, telle le souffle qui palpite sur la feuille, telles les rides sur la peau, les marques du passage du temps, et plus certainement, les vibrations d’une machine à coudre où les petits coups obstiné d’un enfant boudeur, qu’on aura enfermé et qui, muni d’une minuscule aiguille qu’il aura trouvé au fond du tiroir, à tenu le compte des secondes qui une à une s’écoulaient, telles l’entrelacs de la paille de fer, telles les gouttes d’eau sur la vitre, telles les insensibles vibrations digitales qui font tomber les caractères à la surface de l’écran et les transportent, au-delà du rivage, dans l’invisible maelstrom des mers et des cieux. C’est ainsi toutefois, hasard et nécessité, que j’imagine les tables de la loi, celles où, dans la courbure du temps, entre l’aube et le crépuscule, je passe au sablier du temps.
La table de travail ? Mais c’est mon lit, ma table de travail, c’est mon lit ou... pourquoi ma table de travail, pourquoi y en aurait-il qu’une ? Et ces innombrables tables des bibliothèques, des médiathèques, la salle étroite au fond du couloir du collège de Noyant où personne n’allait j’allais à l’accueil je demandais la clé à j’avais mon sac à ordinateur sur l’épaule et beaucoup de temps enfin avant le prochain cours.
Ma table est vagabonde et changeante – il y avait une table que j’aimais sur le campus de l’université de Belle Beille il y avait une table une table immense telle que quand tu t’y assois tes jambes elles touchent pas le sol mes jambes elles touchaient pas le sol par conséquent il y a ces petites chaussures que j’aime bien même je rachète les mêmes quand elles sont foutues petites chaussures qui tombent et je les laisse tomber faisant mine que je m’en rends pas compte alors que c’est pas vrai que j’ai l’habitude que j’attends que ça qu’elles tombent que j’en fais même un peu exprès juste pour sentir le vent qui souffle j’aime pas tout à fait avoir les pieds enfermés tout le temps et je redeviens petite fille à la grande table toute vide mais plus maintenant maintenant que j’y suis et je commence je commence par effleurer les fissures qui font de la table un pays traversé de crevasses et de gouffres table itinérante c’est ça ma table de travail même si j’ai pas l’impression d’y travailler mais bon une table où on se hisse avec un peu de peine quand même et qui nous fait nous rappeler ce que c’est que d’être enfant cette table elle avait pas tous ses pieds qui touchaient le sol ou alors c’est le sol qui était pas droit ou les deux et les étudiants l’emmenaient où ils voulaient là où ils étaient bien à l’ombre au soleil sous les arbres aux quatre coins du campus si bien que parfois je voulais bien m’y asseoir mais je savais pas où elle était cette table c’est ma table de travail moi j’ai pas de maison pas de maison pas de bureau qui soit vraiment à moi – je loue encore des meublés et rarement plus d’un an le même meublé c’est dire que j’ai bien du mal à la décrire ma table de travail c’est pas la table qu’il faut décrire c’est pas la table c’est le sac encore que lui-même c’est pas toujours le même c’est pas toujours seulement le sac à ordinateur encore que parfois j’en ai deux parce que je trimballe des livres des livres qui sont pas tous numérisés comme par hasard c’est ceux-là qui m’intéressent il y a sac à dos sac à ordinateur en bandoulière sac et sac deux en bandoulière un à droite un à gauche pour tous les carnets où il y a des fragments des notes à partir de quoi ça commence à écrire – il y en a quand ils parlent et qu’on prend des notes c’est comme un poème – je pars en voyage il y a des crayons de toutes sortes souvent je vous avoue des crayons qui sont même pas à moi que je me souviens à peine si c’est à un collègue ou à un élève que je l’ai piqué mon préféré en ce moment c’est un crayon six couleurs qui se voient à peine le genre rose orange turquoise et vert pâle mais heureusement y a couleurs qui se voient bien normal bleu foncé noir mais celui-là je le perds moins souvent je l’ai pas encore perdu parce qu’il est plus épais que les autres et j’ai pas besoin de le gratter à la semelle d’une chaussure ou sur le bois de la table pour lui rappeler comment il faut faire pour écrire il démarre au quart de tour il y en a d’autres qui sont cassés mordillés certains qu’on m’a donnés que j’ai toujours pas perdus et puis ces petits bleus que j’achète par quatre que je laisse trainer partout trois mois plus tard il faut en racheter les crayons disparaissent de mon sac de travail parfois le seul qui reste c’est le rouge pourquoi il y en a toujours un rouge qui reste je m’en fiche du crayon tant qu’il me dérange pas le rouge ça me dérange un tout petit peu le vert non mais le rouge... pas que des crayons des livres aussi j’en ai déjà parlé mais je vais en reparler des livres que j’ouvre même pas en plus ceux-là qui ont des mélodies singulières que j’ai besoin d’avoir avec moi pour me rappeler – pas de leur véritable mélodie pas de la vraie mais de celle que je leur ai prêtée avec le temps mélodies imaginaires que je cherche à imiter je parle de celle qu’il y a dans ma tête il y a des lunettes un agenda pour rien pour gribouiller ce petit carnet rouge bousillé que j’emporte toujours avec moi et le chargeur et l’ordinateur, surtout quand il y a pas d’internet. Internet c’est bruyant. Il faut du silence à la table à écrire, sinon, ça va pas. Il faut même pas de table, un lit, ça suffit, parfois j’ai même une table et j’écris sur le lit.
Il n’y a pas de table de travail. Qu’un sac et du silence.
Il s’agit ici de différencier le bureau de la table de travail. Bureau à l’étage. Table de travail au rez-de-chaussée. Bureau à destination alimentaire. Table de travail utilisée comme table de vie. Pour que la table de vie, ronde devant la porte-fenêtre, au beau milieu du coin cheminée, fasse office de table de travail, il suffit de la débarrasser, la nettoyer en prenant garde à ne pas trop frotter son revêtement rouge vermillon et s’y installer, avec pour toute munition, un ordinateur portable connecté, une clé usb, une bouteille d’eau (sans verre), et le cahier de notes en cours, format 21x29,7.
Ici, il y a pour l’écriture, un caractère nomade, minimaliste, ouvert sur le monde extérieur (actuellement le jardin de derrière) à respecter. Car la table de travail est, par définition répétons le, l’opposé du bureau dont l’usage surabondant se trouve être en voie de disparition, l’âge du capitaine aidant. Sur le bureau, une accumulation d’objets papiers dont les strates se sont épaissies et emmêlées au fil des ans ; d’objets fournitures dont le classement est visiblement sans cesse repoussé. La table de travail elle, reste vierge, rouge, ronde, joyeuse, partagée en son milieu en deux hémisphères identiques se prêtant à un déplacement d’un coup de main pour, soit se rapprocher du feu l’hiver, soit se placer dans l’angle de vision du dehors l’été - geste à réaliser sans même se lever de sa chaise. Et de là, contempler l’avancée du hérisson se dandinant jusqu’à la gamelle de croquettes, comme dérivatif au jet de mots, ou tout simplement, s’emplir la rétine de la couleur verte, diluant et réactivant la matière à sentir. Cette table de travail là, comme dématérialisée, a vocation à voir le jour partout. Elle tend vers le déplacement, l’envol, le pliage, le dépliage, l’adaptation. Son environnement est à récréer sans cesse. Comprendre que la table de travail peut, sans préjudice pour le résultat jamais final, se résumer à l’ordinateur portable. Cette affirmation est, disons le, relativement nouvelle et se prêterait à une évolution dans le temps consistant à seconder l’ordinateur portable par le téléphone pour prise de sons-mots en direct (si déplacement), sans parler de se filmer à coup de caméra vidéo à la François Bon, qui redynamise l’espace mental de tout un chacun se faisant. Pour l’heure, rien à décrire, rien à dire. Les objets qui font face sur la cheminée, seront autres sur un autre parcours. Le disque dur externe prêt à servir, dans un tiroir du bureau. Quant aux dico, de toutes sortes, homonymes, synonymes, noms communs et noms propres, ils sont désormais intégrés. Et si la connexion venait à manquer ? EFFROI. Faudrait-il alors revisiter l’émoi de la table à soi, grotte perdue suspendue dans la forêt préservée, lichen pour se sustenter ? Ou nouvelle épopée d’expériences au milieu de tous, théâtre vivant et lectures au sein surprenant du troupeau de moutons ? Mais où sont-ils donc ? Le fournisseur d’accès dont on taira le nom vient d’ouvrir un dossier incident sur la ligne. Transport immédiat du bureau machine à écrire dans une campagne environnante.
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne et dernière modification le 7 janvier 2016
merci aux 98 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page

