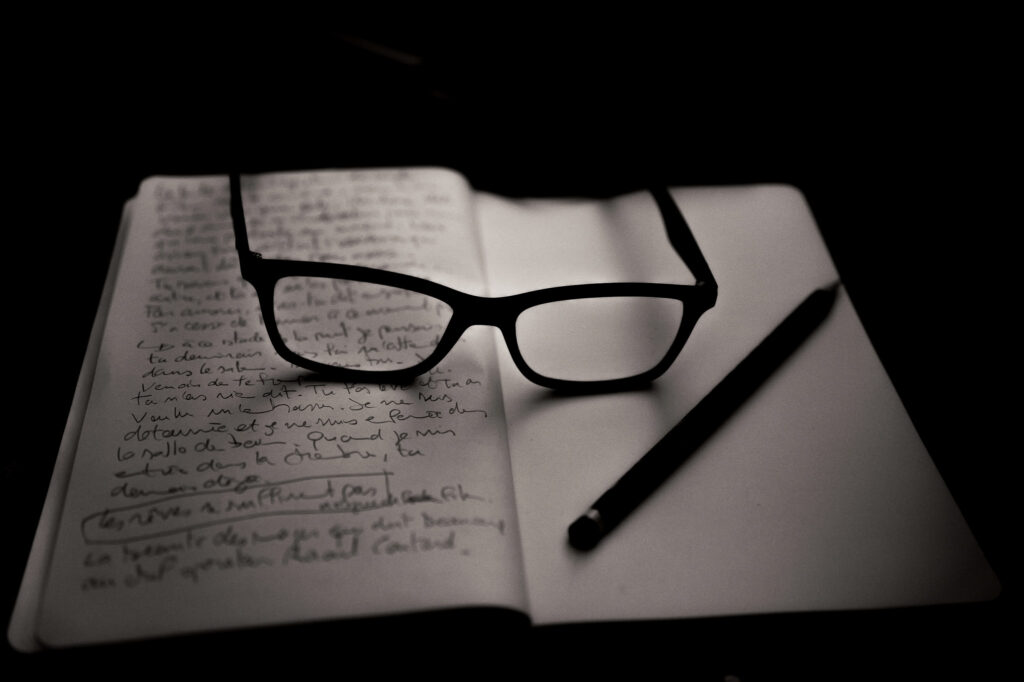
à ce stade de la nuit, je dormais d’un sommeil paradoxal et je m’étais réveillée d’un coup, le souffle court et trempée de sueur. J’avais rêvé de ce garçon rencontré la veille à la soirée qu’avait donnée Serge. Les rêves érotiques n’arrivent pas par hasard. Ils sont le fruit de désirs éprouvés au cours de la journée.
à ce stade de la nuit, tu ronflais déjà et je n’arrivais pas à dormir. Quelque chose a dû se briser en moi à ce moment-là. Mon père ronflait, ma mère s’en plaignait le matin, et je détestais quand il faisait la sieste le dimanche dans le fauteuil devant la télé. Mais toi ? C’est stupide, je sais. Injuste, certainement. Mais tu ne pouvais pas ronfler. Tu m’avais juré de m’enlever à ma vie, promis la réalisation de mes rêves, notre rêve commun. Tu y croyais, comme je croyais en toi. Je vivais encore chez mes parents, en banlieue, et toi, tu avais une chambre sous les toits à Paris. Nous avions diné et bu un peu. Il était trop tard pour que je rentre seule, tu m’avais entrainé dans ton lit. Et maintenant, tu ronflais lourdement, couché contre moi, et je n’osais pas bouger pour ne pas te réveiller (plus tard, je n’aurai plus les mêmes prévenances). J’avais les yeux grand ouverts sur la nuit. La lucarne au-dessus de ton bureau laissait passer une lumière blafarde à travers le rideau jauni et la chaleur du mois d’août m’étouffait : j’y voyais les présages de promesses déçues.
à ce stade de la nuit, les contractions s’étaient espacées, suffisamment pour que nous décidions finalement de nous recoucher. Et puis voilà, tout à trac, j’ai perdu les eaux. Je t’ai réveillé. Je n’ai rien eu besoin de dire. Tu m’as aidé à m’habiller. Tu as enfilé ton jean et le t-shirt de la veille. Les affaires pour la clinique étaient prêtes. Bêtement, j’avais peur d’accoucher dans l’ascenseur et tu m’as aidé à descendre les marches des deux étages. Tu m’as dit d’attendre devant la porte de l’immeuble, et tu n’arrivais pas à partir chercher la voiture. « Dépêche-toi, idiot ! » Tu as souri et tu es parti en courant, te retournant au moment de tourner au coin de la rue. Il nous a fallu à peine quinze minutes pour arriver à la clinique, et encore cinq heures à notre fille pour venir au monde.
à ce stade de la nuit, notre fille avait fini par s’endormir, et elle ne se réveillerait plus avant deux bonnes heures. Tu dormais toi aussi. La chatte s’est frottée contre mes jambes. Elle m’a entrainé dans la cuisine. Je n’ai pas voulu allumer. La lumière de la rue suffisait à y voir à peu près. J’ai mis de l’eau à chauffer. Un sachet de thé dans une tasse. Quand la bouilloire a sifflé, j’ai eu peur de réveiller la petite, mais non, le silence est retombé aussitôt. J’ai versé doucement l’eau sur le thé. J’ai senti la vapeur sur mon visage, en même temps que l’odeur végétale et terreuse du thé mêlé à la bergamote. L’eau frémissait encore dans la tasse. De petites bulles remontaient à la surface où déjà flottait mollement le sachet. Je me suis glissé dans le salon, j’ai caressé ma planche à dessin pour me rassurer, posé la tasse fumante à côté. J’ai allumé la petite lampe au-dessus du bureau et je me suis assise en face du dessin en cours. La chatte s’est aussitôt blottie sur mes genoux. Je me suis brûlé la langue en buvant trop vite une première gorgée de thé. J’ai pris la gomme, effacé ce que j’avais dessiné la veille et j’ai tout repris à zéro.
à ce stade de la nuit — était-ce vraiment la nuit ? —, il était un peu plus de 23 h 30, et nous regardions un documentaire consacré à Robert Crumb que diffusait Arte. La maison était vide. Notre fille, chez mes parents pour les vacances. J’avais décidé de m’essayer à la bande dessinée, lassée de mes échecs. Et Crumb me plaisait. J’aimais son style, ses lignes hachurées, ses personnages déformés. Il y avait une forme de classicisme chez lui. Une élégance du trait au service d’une œuvre transgressive, brutale, nourrie de ses obsessions et fantasmes. Ce que je voulais et que je n’osais pas exprimer à travers mes propres dessins. Je t’ai regardé. Je t’ai regardé regardant les femmes pulpeuses, les seins et les culs énormes qui naissaient sous la plume de Crumb, et je savais que ça ne te laissait pas indifférent. Ça m’a touché. Depuis combien de temps n’avions-nous plus fait l’amour ? Je me suis assise sur tes genoux. Tu as fait mine de protester, bien sûr. Je t’ai embrassé. Tes mains hésitaient encore. Depuis combien de temps n’avions-nous plus fait l’amour ?
à ce stade de la nuit, je savais que je ne pourrais plus dormir. Une nuit d’insomnie. Une de plus. Toi, tu t’endormais toujours à peine la tête posée sur l’oreiller. Je t’en voulais pour ça. Je t’en voulais pour tout. Tu me disais qu’il ne fallait pas s’en faire si nos comptes étaient dans le rouge. Tu trouvais toujours des solutions, disais-tu, et c’était vrai. Je t’en voulais pour ça aussi. Et tu m’aimais. Tu disais que l’amour était plus fort que tout, qu’il permettait de surmonter toutes les épreuves. Tu disais l’amour. Tu ne disais plus « notre » amour. L’amour dont tu parlais était à sens unique, moi, je ne t’aimais plus. Et c’est pour ça que je t’en voulais le plus.
à ce stade de la nuit, je vivais mes mille et une nuits. Je m’imaginais des histoires dans les bras de ce garçon pour retarder ma mort. Ma mort : ma vie avec toi. Ce type, je l’avais rencontré la veille à un salon de bandes dessinées auquel je participais. Oh, je n’avais toujours rien publié, non. Je faisais de la mise en couleur pour un éditeur indépendant, et j’aidais à tenir le stand. Il m’avait abordé, avait fait mine de s’intéresser à mes prétentions artistiques. La manœuvre manquait de subtilités, j’avais besoin d’envolées, je me laissais faire. Très vite, on avait parlé de pratiques artistiques. Il employait de grands mots. Il parlait de sémiotique, de conception du monde, il me parlait de lui. Il s’écoutait parler. Je faisais mine de l’écouter. Sa chambre d’hôtel était un théâtre d’illusions auxquelles je me raccrochais pour quelques heures. Je m’oubliais dans ses bras. Pour quelques heures, je nous oubliais.
à ce stade de la nuit, sans doute que tu avais fini par t’endormir. Je ne t’entendais plus gémir dans la chambre dont tu avais volontairement laissé la porte entrouverte. Je dormais sur le canapé du salon. Mon choix : j’avais besoin de me retrouver seule. Que tu me laisses respirer. Tu faisais mine de comprendre. Tu gardais le secret espoir que tout s’arrangerait une fois encore. Tu espérais m’attendrir. Tu me faisais pitié, le pire des sentiments quand on a aimé. Je me suis levée. J’ai parcouru les livres de la bibliothèque en faisant glisser mes doigts sur les tranches. Je ne comprenais rien à tes classements. Je ne trouvais jamais rien. Je me suis arrêtée sur un livre de Moravia. Une édition de poche, Garnier Flammarion, avec une photo de Bardot en couverture. Je me suis souvenue que nous étions allés voir le film à l’occasion d’une rétrospective consacrée à Godard, les tout premiers films que nous avions vus ensemble : À bout de souffle, Une femme est une femme, Vivre sa vie, Bande à part, Alphaville… Et Le Mépris, donc. Piccoli et Bardot. Tu m’avais dit que je lui ressemblais, à Bardot. Tu disais aussi que je ressemblais plus encore à Anna Karina. Que j’étais belle comme Jean Seberg. Ça n’était pas moi que tu aimais, c’était Jean-Luc Godard. Je ne t’en veux pas. Nous rêvions tous deux d’une vie d’artiste. Tu t’identifiais à l’écrivain que jouait Piccoli dans le film. Mais, éblouis par les couleurs de la Méditerranée, les images de Capri, la villa Mallaparte, emportés par la musique de Delerue, nous n’avons pas su voir alors que le film racontait notre histoire en devenir, et le mépris qu’éprouve Camille pour son mari, parce qu’à force de l’aimer il en est venu à ne plus la comprendre —, ce mépris, c’est le même que je ressens envers toi aujourd’hui.
à ce stade de ma vie, mes jours ressemblaient à des nuits. Une longue nuit sans lune, une nuit sans espoir. La nuit froide et dure de la dépression. Un long tunnel dans lequel j’avançais en me cognant aux parois. Je me croyais forte. Je t’avais dit crânement que je voulais vivre ma vie aux côtés d’un compagnon qui serait comme mon double, qui ne serait pas toi. Tu étais parti. J’étais seule, nous nous partagions notre fille une semaine sur deux. Je faisais bonne figure quand elle était avec moi. Les cachets m’aidaient à tenir.
Je n’ai revu Claire que plusieurs mois après la soirée chez Serge. À cette époque, je venais de quitter Isabelle. Claire s’était séparée de Serge. C’était à Paris, un soir d’hiver, rue Git-le-Coeur. La librairie Un regard moderne exposait de jeunes artistes dans une petite salle adjacente à la boutique, et un tableau m’avait particulièrement attiré. Sur un fond bleu saphir, une forme féminine alanguie, aux courbes généreuses, était tracée à grands traits. Les volumes étaient modelés par des aplats de couleurs, jaune vénitien, ocre, rose thé. Du visage, on devinait seulement les yeux, tracés en amande.
Je pensais aussitôt à une toile de Picasso, Femme nue allongée ; aux photos de Bert Stern de Marilyn, prises quelques semaines avant sa disparition. Je me suis penché pour lire le nom de l’artiste. C’était Claire. Je me retournais. Claire se tenait derrière moi. Elle me souriait.
Elle tenait ses mains devant elle, les doigts entrelacés, qu’elle ne cessait de tordre machinalement. Claire, si sûre d’elle quand je l’avais rencontrée la première fois… Mon cœur s’est emballé ; c’était mon cœur, entre ses mains, qu’elle broyait. Ses cheveux bruns retombaient en boucles sur ses épaules. Ses lèvres brillaient sur sa bouche entrouverte. Ses seins lourds se soulevaient au rythme de sa respiration. Je la dévorais tout entière.
Nous sommes sortis de la galerie. La rumeur de la ville nous faisait cortège. La foule s’effaçait. Paris était à nous, et nous étions l’un à l’autre.
Il avait plu et nous courrions main dans la main, riant et sautant à pieds joints dans les flaques, éclaboussant les trottoirs de gerbes aux reflets rouges et verts. Nous avons marché le long des quais de Seine, remontant jusqu’au pont des arts, puis redescendant par la rue Bonaparte jusqu’à Saint-Germain-des-Prés. Rue Guillaume Apollinaire, un cinéma jouait Le Mépris de Godard. Nous étions à l’heure pour la séance. Claire s’est serrée contre moi tandis que Bardot, mutine, taquinait Piccoli. En sortant, un peu pour rire, j’avais dit à Claire qu’elle était « ma » Bardot. Plus tard, je réaliserai qu’elle était vraiment mon Anna Karina. Leur ressemblance me frapperait alors. Godard avait eu pour modèle Orson Welles et Rita Hayworth. J’avais Birkin et Gainsbourg, Godard et Karina. L’ombre portée était sans doute trop lourde pour nous deux. On pense qu’il faut avoir un grand amour, on n’en est pas capable. J’apprenais à aimer, et j’oubliais de vivre. Animal sans raison, je ne voyais plus qu’elle, et désertais ma vie.
C’est très simple, j’aime beaucoup votre texte. Grand plaisir à le lire. Sensible et rythmé à souhait.
Merci beaucoup Pascale.
Un modèle impressionnant de construction narrative. Et ce souci du détail dans l’écriture, admirable. J’aime tout ! Mais particulièrement le renversement au dernier paragraphe du recto : « à ce stade de ma vie, mes jours ressemblaient à des nuits. » C’est très fort de bout en bout. Merci !
Merci beaucoup Serge.
la nuit, plus forts la vie la mort l’amour
on glisse, on passe en revue diverses scènes douces (dans l’écriture) bien qu’il s’agisse souvent de séparation en vue ou déjà effective
j’aime beaucoup ton verso, comme pour y croire encore…
salut Philippe
Merci Françoise…
Ce texte me donne l’impression d’une vie double: le désir intense de vivre ce que l’on nous montre dans l’art face à la réalité qui continue après la fin du film. En fait, on ferait de la vie notre tricot scénique. Quand on regarde de loin ça paraît maladroit mais ce serait oublier l’amour bien réel pendant ces quelques mailles. Superbe.
Merci Arthur
Emportée par cette déclinaison de la vie et son versant miroir
Merci beaucoup Muriel
Le temps qui avance en nuits . Ce qui naît et se défait . Elle. Lui . Vivre sa vie et Le Mépris. Beaucoup aimé les deux versants .
Merci beaucoup Nathalie !