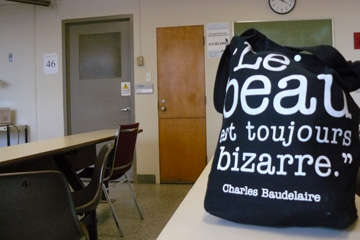
archéologie personnelle de lecture : les années 70 – l’étiquette Nouveau Roman a tendance à pâlir, mais pas les auteurs
Je reçois message ce matin me demandant de communiquer mon adresse postale pour envoi des actes de ce colloque, où paraît ma contribution ci-dessous. J’avais d’ailleurs complètement oublié que ce texte était destiné à parution imprimée. Moins de deux ans pour parution d’actes de colloque, on reconnaît bien qu’on est dans l’université anglophone et non pas le rythme Fr. Mais quand même, dans les urgences qu’on traverse, la nécessité vitale de réflexion et partage, et d’imaginer même le destin matériel de ces actes de colloque dans lesquels l’ensemble des universités continue d’engouffrer ses subsides, uniquement pour valorisation de points de carrière, littérature morte qui sera vite enterrée dans les réserves d’une poignée de bibliothèques universitaires, resurgiront éventuellement dans telle maîtrise d’étudiants s’il s’agit de citer les oeuvres non-périssables de leurs propres enseignants, un peu dérisoire au regard de ce à quoi on oeuvre, mais sans les universitaires, dans l’espace virtuel. Rien là qui concerne l’accueil si chaleureux de Christian Milat lors de ma venue à Ottawa. 1378 personnes m’ont fait ici l’honneur de passer, à ce jour, plus d’une minute sur cette page : on a changé d’ère.
note de présentation initiale (5 juin 2009)
En même temps qu’à Montréal on discute si l’ancienne séparation éditoriale entre les livres d’un auteur et leurs "entours", préfaces, entretiens, paratextes divers, interventions en revue, gardent pertinence avec l’irruption du numérique, se tenait ces trois jours à Ottawa un colloque sur Robbe-Grillet, à l’initiative de Christian Milat : Robbe-Grillet, balises pour le XXIe siècle. Y participaient des amis comme Dominique Viart ou Patrick Rebollar (dont l’actuel retrait web est bien regrettable...).
En mars dernier, Christian Milat m’avait proposé une rencontre avec ses étudiants, centrée sur l’idée d’une petite archéologie personnelle de la lecture, quand, dans nos 17 ans de l’année 1970, nous découvrions non pas le "Nouveau Roman", mais leur tête armée, les fictions de Robbe-Grillet. Et d’en faire une trace écrite qui serait jointe aux actes de ce colloque.
Si ensuite (mais bien plus tard), mes lectures m’ont mené plus vers Claude Simon et Julien Gracq, puis Nathalie Sarraute), et que je me suis éloigné du parcours de Robbe-Grillet, impossible de nier – pour tous ceux de mon âge je suppose – ce choc sismique. A condition d’en rebâtir le contexte...
Alors exploration à partir d’un curieux passage, où il est question... de bouts de ficelles.
Photo : fac d’Ottawa, mars 2009.
François Bon | Robbe-Grillet et bouts de ficelle
archéologie personnelle d’une lecture décisive
C’était Le Voyeur bien sûr. Et bizarrement, à quarante ans près, il y a des passages que je reconnais, qui pour moi étaient restés liés au livre. Ainsi, obscurément, mais avec évidence :
Dans la mémoire telle qu’elle se fixe à rebours sur ce passage, je retrouve l’ancrage : un livre avec « profession d’électricien ambulant » je n’en connais qu’un, et cette profession me parle. En 1955, ce n’était pas comme je pouvais l’imaginer en 1969. Prestigieuse était alors la fonction de l’électricien, n’était-il pas celui qui allumait littéralement nos village avec la télévision ? Marchands de bracelets-montres on respectait, aussi : il y en avait au moins deux ou trois, au premier mardi du mois, sur le marché. Et puis bicyclette, et puis cambouis. Le roman était venu dans notre aujourd’hui, même l’humble aujourd’hui des villages. Mais ce dont je me souviens, c’est la fierté qu’on avait aux coups d’éclat. Rien que dans le paragraphe, la didascalie entre parenthèses : le « il montra » appartient au cinéma, et pas à la littérature. Et l’interruption pleine phrase « et quand il… », non, on ne l’avait jamais vu et le pied de nez était fait en notre nom.
Qui étions-nous ? À y repenser, c’est le statut même du mot roman qui était différent. On avait peu voyagé. On avait rituellement, avec la deux-chevaux familiale, chaque vacances de Pâques, une excursion dans une des provinces, parfois jusqu’en montagne. De notre coin de côte, on avait vu se bâtir le paquebot France, on avait vu le navigateur solitaire Le Toumelin revenir sur son Kurun de son tour du monde. Des hommes du village avaient « fait » la guerre d’Algérie.
Si la télévision commençait à nous rapporter le monde (l’assassinat de Kennedy, mille fois repassé, avec le rebondissement Oswald-Ruby cette fois quasiment en direct, et puis en 1969 Armstrong qui avait marché sur la lune) et instituait une sorte de communauté à échelle de la nation (les enterrements commentés par Zitrone), ce par quoi nous pouvions nous approprier le monde, et constituer notre propre identité à rebours des schémas adultes dominants, c’était par le livre, et donc par le roman, qui en créait l’illusion.
C’est dans ce contexte, et lui seulement, qu’on peut appréhender Robbe-Grillet comme élément d’une négation (mais qui était certainement bien plus large, et ailleurs probablement plus radicale : ainsi chez Michaux, par exemple, y compris dans les catégories narratives), mais d’abord comme l’instance symbolique de cette négation. Un peu comme les Beatles la représentaient en musique, et c’est cela aussi qu’il y aurait à considérer : est-ce que Robbe-Grillet n’a pas été, en ces années, l’ultime occurrence de la littérature comme principe de subversion ? Les faibles succédanés industriels que l’édition en a produit récemment ont certainement hérité du rôle, mais, malheureusement, pas avec des livres qui tiennent la rampe. Ce que nul jamais n’a contesté à l’auteur du Voyeur.
Ainsi, ce tour de force au grossissement de zoom. L’instance d’un niveau de réalité dans la phrase, que nous n’aurions pas su formuler ni théoriser, et dont nous n’aurions même pas pensé qu’elle avait toujours été un principe premier de rupture dans l’histoire des formes littéraires. Principe de réalité accru chez Balzac (la phrase magique relevée chez lui par Ernst Curtius : « Toute poésie procède d’une rapide vision des choses »), ou l’obscénité vue par le procureur Pinard chez Flaubert comme chez Baudelaire (« Il inondait de sang cette peau couleur d’ambre »). Et Robbe-Grillet dans ce passage se souvient à la fois des zooms majeurs de Proust (le baiser à Albertine endormie), comme de la célèbre réaction de Gide aux vertèbres sur le front de la tante Léonie (« Elle tendait à mes lèvres son triste front pâle et fade sur lequel, à cette heure matinale, elle n’avait pas encore arrangé ses faux cheveux, où les vertèbres transparaissaient comme les points d’une couronne d’épines ou les grains d’un rosaire. »), quand tout cela nous était dans d’inaccessibles limbes.
Et que le mot voyeur, ou ce dispositif de vision camouflée que sont les jalousies, ou l’idée centrale de labyrinthe, parce qu’elles étaient constitutives de notre rapport au monde (se constituer voyeur au monde, se préserver labyrinthe en monde), faisaient de ces livres le vecteur de notre appropriation du monde – et du « contemporain » le court-circuit essentiel, leçon qui vaudrait pour tous les autres.
Donc nous apprenions le monde par le roman, et il n’y avait pas d’autres voies. À preuve comment ils nous parvenaient : j’ai découvert Anna Karénine et David Copperfield dans des livres de prix distribués aux élèves de l’école normale d’institutrices de Luçon, et qu’avait conservés ma mère. Je n’ai pas souvenir au lycée qu’on nous ait parlé de Rimbaud (dans les programmes scolaires depuis 1954, mais timidement). Mais notre prof de français choisissait lui-même les livres de prix et nous les attribuait : ainsi, en quatrième, j’aurai reçu, lu et relu quasiment chaque année Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme et Steinbeck, qui ne me serait jamais arrivé par le biais familial. En classe de seconde, j’emprunte à mon grand-père maternel, instituteur aussi, son Balzac en 18 tomes pour me venger de ce que mes parents m’emmènent en vacances sur le bassin d’Arcachon, quand les copains gagnent leur argent de poche en s’embauchant à la coopérative agricole. Je souffrirai beaucoup, plus tard, du mépris affiché par Claude Simon et Robe-Grillet à l’égard de Balzac (mais Claude Simon se rattrapera, dans son Discours au Nobel par exemple).
Lorsque, interne au lycée Camille-Guérin de Poitiers je lis pour la première fois Alain Robbe-Grillet, je suis donc déjà lecteur de Tolstoï, Dickens, Dostoïevski, Balzac, Stendhal et Kafka (par hasard, mais hasard déterminant). Mais dans le contexte de cet immédiat après mai 68, ce n’est pas une performance : c’est tout simplement que les livres sont notre principal apprentissage de ce qui n’appartient pas directement à notre expérience sensible.
Ainsi, donc, lire Robbe-Grillet indissociablement lié à ce qu’il était comme image sociale, et pas seulement littéraire, de la subversion. Et qu’à la subversion déjà entamée quant aux mœurs (cheveux sur les oreilles, pantalons pattes d’éléphant, lecture de Rock’n Folk et identification non raisonnée et générationnellement globale à la musique pop), s’ajoutait la volonté de porter cette rupture dans l’univers de la transmission, des valeurs les plus apparemment stables : il fallait lire Robbe-Grillet.
L’idée du contemporain, aussi : je suis né en 1953, j’avais donc à peine mais sérieusement mes dix-sept ans, et c’était pour nous le contemporain absolu. Ni Projet pour une révolution à New York ni Topologie pour une cité fantôme ni Souvenirs du triangle d’or n’étaient parus (je crois que c’est à Souvenirs…, en 1978, que j’arrêterai définitivement de lire Robbe-Grillet), mais La Jalousie, Dans le labyrinthe et Le Voyeur étaient nos obligatoires. Je veux dire, pas seulement à moi, qui n’avais d’ailleurs aucune idée de ce que l’écriture prendrait comme place ultérieurement : mais à toute cette frange de notre classe d’internes (un tiers ? – mais un tiers dans tous les lycées du pays…) qu’on retrouvait dans les manifs contre la guerre au Vietnam et les meetings itinérants de Jacques Duclos. Je revois ces couvertures abîmes des 10/18 qu’on se repassait, et faisaient partie comme les disques de Cream et des Rolling Stones de nos meilleurs trésors.
Et ce serait la dette irréductible à Robbe-Grillet : avoir ajouté à notre lecture du roman comme mimesis la lettre manquante de son alphabet – le défi formel, et la question de la représentation. Qu’on ait à travailler l’espace même de la représentation était une clé définitive. À partir de là, et donc de lui, nous aurions accès à la peinture de notre siècle (et les étapes n’en étaient pas balisées comme aujourd’hui), et à la littérature même, prise comme chemin de transgression.
Évidemment (mais méfions-nous de l’adverbe), cela nous conduirait vite à une conception plus globale de ces ruptures : Céline viendrait bien plus tard, et Proust aussi, mais nous prenions le surréalisme en pleine tête (la tête lisant et voyant), l’expérience du rêve, les exercices et le droit d’écrire. Même aujourd’hui, quand je me remets au travail sur Char et Breton, ou Lautréamont, j’ai intérieurement l’image d’un long couloir aux portes multipliées, où chacun de ces auteurs ont leur établi ouvert, mais l’image du couloir qui y donne accès, pour moi est liée à Robbe-Grillet.
Aussi bien, et quitte à enterrer d’une phrase l’expression Nouveau Roman que je n’emploie plus jamais, c’est vers ceux-là que m’a conduit Robbe-Grillet, que j’associe encore à sa lecture, et non pas aux marchandises fortes et saturantes qui, depuis, ont pris bien plus de place dans mon atelier à moi, Claude Simon le premier, Beckett pour ces figures de l’extrême, et, plus récemment, mais avec une insistance conceptuelle définitive, Nathalie Sarraute.
De la même façon, deux œuvres désormais majeures dans mon paysage de travail, Gracq et Michaux, n’entrent pas en communication avec le fil Robbe-Grillet, quand elles dialoguent avec Simon, Sarraute et Beckett. De même, c’est Claude Simon qui me mènerait à Faulkner et à Proust : on était dans un monde où on faisait confiance, il y avait cette continuité des œuvres – on commençait avec le contemporain et il n’y avait qu’à remonter le temps, ils se passaient tous la main, on dirait.
Et si Robbe-Grillet ne menait pas à Faulkner, mais m’avait mené à Breton, c’est peut-être aussi pour l’idée sous-jacente dans le livre du grand écrivain, et qu’elle s’y rejouait peut-être une dernière fois ?
Nous étions d’un monde très loin, c’est cela qu’il faut comprendre. Ce n’est pas le lieu d’exposer le souvenir personnel et intime qui me relie à ce passage, mais quand même :
Paradoxalement, dans ces livres lus à dix-sept ans et que nous imaginions comme ayant été écrit la veille, et presque par quelqu’un de notre âge (il avait l’âge de mon père, mais mon père n’aurait jamais lu Robbe-Grillet), ce que nous découvrions, par ces coups de zoom, par ce saut en avant dans l’instance de la réalité, par la mise à nu du montage et ce qu’il autorisait de fragments séparés, c’est la littérature comme expérience. Pas n’importe laquelle : l’invention de forme trouvant son effective matière dans notre expérience. Comme l’électricien ambulant et le marchand de montres. Peu importe que Robbe-Grillet traite ici – et classiquement au plus haut, voire proustiennement – d’un souvenir d’enfance personnel : le souvenir est mien, comme le baiser sur l’épaule au début du Lys dans la vallée, ô Balzac qu’il aura toujours à tort méprisé, et, ce mystère-là, ça a nom littérature.
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne 5 juin 2009 et dernière modification le 7 octobre 2016
merci aux 2629 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page


