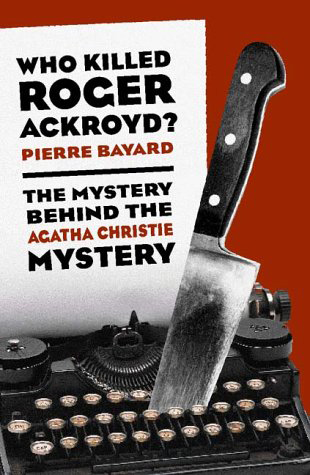
Pierre Bayard continue de secouer notre bibliothèque
Dans cet hommage à Pierre Bayard, paru il y a 2 ans, je suggérais qu’on s’exerce chacun à lui proposer des titres pour ses livres à suivre. L’exercice a réussi : personne n’aurait songé à lui proposer l’évidence de celui qui paraît ce mois-ci, Comment parler des lieux où l’on n’a pas été. Mais est-ce que Pierre Bayard [n’] est donc [pas] allé à Kemerovo ?
note de présentation, août 2010
Pierre Bayard est l’auteur d’un de nos meilleurs feuilletons théoriques. Rien que découvrir, via le nouveau titre, la nouvelle idée sur quoi il s’est embarqué, c’est déjà une fébrilité qui ne nous est plus coutumière dans l’attente des livres.
L’hiver dernier, Laurent Zimmermann, spécialiste de Bataille, sollicitait quelques auteurs pour un hommage à Pierre Bayard, et depuis Québec, sans livre (bon, m’aurait suffit d’aller en bibliothèque, mais j’ai préféré une autre règle du jeu), je rédigeais bien sûr avec plaisir le texte ci-dessous. Donc, en attente de parution écrite (on aurait provisoirement diffusé sur publie.net, Laurent, ce serait déjà sur les routes intellectuelles ?).
On peut lire les premières pages de Et si les oeuvres changeaient d’auteur sur le site Minuit – à propos donc du grand roman de Tolstoï, Autant en emporte le vent et de l’oeuvre majeure de Nietzsche, Les frères Karamazov.
À noter que, désormais, une des meilleurs approches de la force critique de Pierre Bayard, c’est-à-dire l’activité spécifique qu’il prend dans notre temps d’écriture, c’est sa présence tout au long du dernier roman d’Olivier Rolin, Bakou derniers jours : le jeu d’emboîtements n’en finit plus.
Illustrations : quelques couvs et adaptations films ou théâtre du célèbre roman policier par plagiat qui a inauguré la carrière de Pierre Bayard : Qui a tué Roger Ackroyd ? (voir notamment site HerculePoirot).
François Bon | haïr Pierre Bayard (mais le haïr bien)
Cet hiver je suis loin. Loin de quoi ? Je ne suis pas attaché à une maison, à un pays, ni même mon petit canton natal. C’est même ce qui est bien au Québec, avec les distances et la jeune histoire : où qu’on soit, on s’y ancre dans l’espace. Plutôt une durée : parti pour un an, je n’ai pas emporté mes livres. Si, quelques dizaines de kilos de livres, bien sûr. Des indispensables, mais en rapport au travail à faire. Puis un certain nombre en secours dans la petite tablette numérique. Loin, mais avec une bibliothèque. Michaux, Gracq, Borges sur les étagères. Balzac, Proust, Saint-Simon et bien d’autres dans la tablette numérique, qui devient objet familier, nécessaire.
Mais la bibliothèque qu’on quitte, c’est une histoire : celle de la totalité de ses lectures. Dans l’arborescence de ces lectures, là où il y a Agatha Christie et Simenon comme ce premier Verlaine aux pages transparentes, par quoi on l’avait découvert il y a si longtemps. C’est une géographie (savoir précisément où sont rangés et classés les livres) qui organise un temps : le souvenir matériel de quand et comment on a lu tel livre, comme si le livre lui-même en était la trace matérielle, objet qui s’agrandit de notre lecture.
La bibliothèque est donc autant ce qui inscrit notre relation aux livres, que la simple accumulation qui nous les rend disponibles : là, dans cette ville qui m’accueille, je peux retrouver n’importe quel livre, il y a des bibliothèques, des librairies, des moyens de se procurer les livres par Internet, je dispose de ressources essentielles sur ma tablette numérique, avec le même confort que le livre, mais ce que je n’ai pas pu déménager c’est ce que ma bibliothèque inscrit de relation à mes livres.

Et puis l’autre versant. Il ne sera pas d’accord, et moi-même je pourrais trouver des contre-exemples, mais ça simplifie. Vient un jour, et c’est un livre posthume, qu’au moment où on achève de lire À la Recherche du temps perdu, le narrateur commence d’écrire le texte que, nous, on vient de lire. Dans cette immense boucle qui sans cesse atteint au réel parce qu’elle le décompose, le subvertit, l’interroge en permanence depuis cette distance par quoi le langage – qui le nomme – ne le rejoint pas (l’exemple des sept descriptions successives des poiriers en fleurs, jusqu’à cette seule masse langagière bruissante et argentée, mais où toute mimesis est absente), au bout du compte une seule instance est réelle : nous, qui avons lu, et parce que nous avons lu. Ce que Proust inaugure en grand, et qui devient aussitôt paramètre élémentaire pour toute la littérature qui va suivre (qu’on lise Sarraute à ce propos), c’est que la relation au lecteur est partie organique du travail littéraire, entre monde, représentation, et l’aventure langagière qui les traverse.

Et c’est pour cela que nous haïssons, avons haï, haïrons Pierre Bayard.
Un espace neuf était ouvert à la littérature, mais un espace insaisissable, parce qu’il nous inclut. Rien de ce que Pierre Bayard n’a écrit n’est vrai (Proust non plus). Rien de ce que Pierre Bayard a écrit n’était caché ni ne supposait un chemin ardu pour le conquérir (mais nous ne nous en sommes pas saisi, et la Lettre volée d’Edgar Poe n’était pas mieux cachée).
Pour cela que je ne peux prendre d’autres raccourcis : l’espace de la relation à notre bibliothèque, en tant qu’assemblage d’histoires, de singularités, accumulation de la relation personnelle que nous avons constitué avec chacun de ses livres (qui de nous n’a pas, dans sa bibliothèque, des livres non lus ?). Et la mise en fiction – parce que plus haut moyen de rationalité et d’investigation – de ce rapport complexe et neuf sur quoi les livres désormais établissent leur puissance (illusion, effectivité, emprise, pérennité, je garde puissance), de ce rapport, la façon dont notre relation de lecteur au livre fait partie de son dispositif même.
Bien sûr, pas besoin pour autant qu’Agatha Christie ait lu Marcel Proust (j’en doute), ni qu’Arthur Conan Doyle ait pensé spécialement à nous dans la fabrique de son chien fantasmatique. C’est que nous-mêmes, les lisant, incluons à cet endroit un corps de lecteur qui est lié à notre propre contemporanéité de lecteur, et donc nous est partiellement inconnu, inouï. Ce n’est pas Agatha Christie ni Conan Doyle, ni Shakespeare ni Kafka ni les autres que va chercher Pierre Bayard, mais ce pourquoi nous aimons lire : et pour nous prendre comme atelier et laboratoire, à notre corps défendant, c’est précisément ce fait établi dont il se saisit. Il sait que nous avons lu et relu Le chien des Baskerville ou Roger Ackroyd – et même : sinon, nous ne serions pas déjà à le lire, lui, Pierre Bayard. Quelle facilité, à savoir que nous sommes public potentiel de ses livres, si bien évidemment nous le savons, qu’il existe des livres dont nous avons parlé sans les lire.
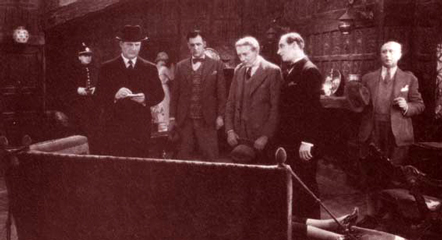
Rien ici qui soit dit à la légère. Il y a trop d’inconnu dans la littérature. Est trop fragile le mystère qu’elle ait encore à signifier, dans un monde qui l’ignore autant, et où la condition même de la lecture est soumise à tant d’érosion, tant de pourrissement des racines par une industrie qui s’en moque, et – dans le grand bruit du monde – des satisfactions plus immédiates. Nous sommes, lecteur, le corps de ce qui nous la rend si vitale, si précieuse. Kafka, dans ces trois jours qu’il passe à Paris en 1909, contraint de repartir si vite à cause d’une crise de furoncles, achetant La Chartreuse de Parme en français, langue qu’il ne sait pas lire, à cause de sa vénération pour Stendhal, n’a jamais pu avoir accès à cette phrase de Vie de Henry Brulard, comme quoi « on devrait relire Don Quichotte tous les ans », et il écrira pourtant textuellement, dans son Journal, « on devrait relire Don Quichotte à chaque étape de sa vie ». La littérature est trop impalpable pour qu’on n’aille pas sans cesse au contact, qu’on ne soit pas sans cesse dans sa quête. Reste qu’aujourd’hui c’est avec plus d’urgence, et qu’aujourd’hui c’est avec ce fait neuf, qu’il n’y a pas la bibliothèque d’un côté et nous de l’autre, mais que la bibliothèque nous inclut, tout comme nous sommes elles en marchant, voyant, lisant.
Je n’aimerais pas être à la place de Pierre Bayard. J’achète tous ses livres depuis que j’ai lu son Qui a tué Roger Ackroyd : encore un axiome, on a peu, chacun, d’auteurs dont nous achetons systématiquement les ouvrages, mais chacun a sa liste. Parfois, là où il creuse, ça m’intéresse un peu moins (la psychanalyse, c’est pas mon truc). Mais je lui en voudrais que ce paysage ne soit pas désormais exploré avec systématique : un jour, cela se rejoindra, s’assemblera, et cet univers encore non déchiffré de cette relation au livre, considérée depuis là où elle nous inclut, sera remise à notre disposition.
On en veut à Pierre Bayard de s’être campé dans ce jardin avant qu’on ait l’idée de s’en saisir. On lui en veut d’aller nous chatouiller là où on n’aime pas, où nul de nous n’est indemne (Comment améliorer les oeuvres ratées). On voudrait exiger de lui qu’il nous offre maintenant, à l’avance, la liste de ses cinq prochains livres, et la certitude qu’avec ces cinq prochains livres il aura bouclé son affaire.
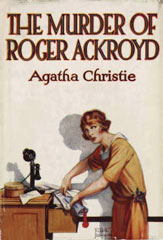
La littérature – et la plus populaire même – est chose infiniment commune, parce que la langue est chose commune (et la littérature le fait élémentaire de sa mise en réflexion, son écart devant le bruit du monde), et parce que le rêve, l’imaginaire, voire simplement le temps de nous-mêmes que nous avons déposé dans les livres, est notre plus précieux viatique. On n’aime pas voir cela mis sous la lumière crue du bloc opératoire. On sait pourtant que l’opération était nécessaire : parce que trop souvent l’impression que c’est cela qui est mis à mal, dans la vie dite courante, et la pression du monde.
Je n’ai pas eu besoin, pour cet hiver au Québec, d’emporter les livres de Pierre Bayard, restés dans ma bibliothèque, et pas non plus besoin, pour écrire à son propos, d’aller les feuilleter en librairie (à Québec ils sont chez Zone, chez Vaugeois, chez Pantoute), ni d’aller les emprunter à la bibliothèque : c’est depuis mes propres livres, qu’il ricane. C’est dans la mémoire de tous les livres lus, et de notre propre et éternelle passion du livre à venir, du livre à lire, du livre jamais trouvé et qu’on espère, voire même : du livre qu’on va écrire, qu’il a greffé la mémoire des siens, les a incrustés comme nécessaires.
C’est pour cela que nous haïssons, avons haï, haïrons Pierre Bayard. Pour cela qu’on continuera fermement à le lire.
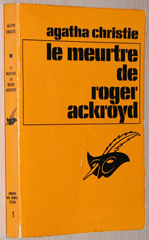
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne 12 août 2010 et dernière modification le 29 janvier 2012
merci aux 6246 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page

