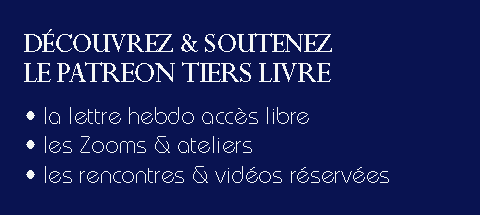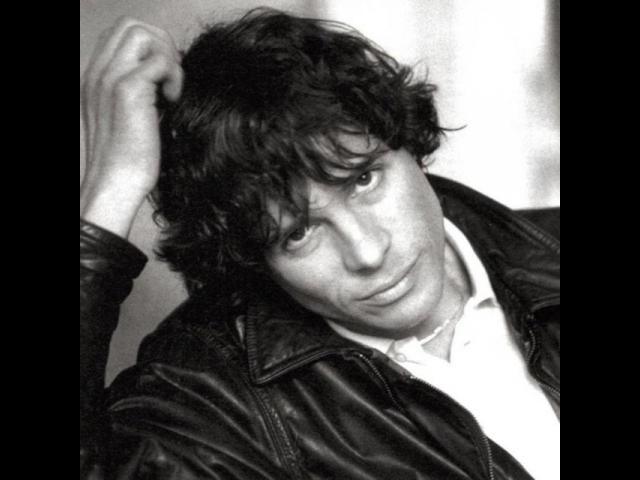
reprise numérique révisée et augmentée de l’hommage "Pour Koltès" paru aux Solitaires Intempestifs en 1999 – 1, sur "Une part de ma vie"
Ce qui change la littérature dans ses possibles et ses formes s’annonce d’abord souterrain et fragile. Non pas comme livre tout entier naissant de ce changement accompli, mais comme tension sous la surface du texte, de linéaments d’autres sortes sous la phrase, et les territoires qu’elle dessine. Il y a quelques exceptions, comme Les Illuminations, les Chants de Maldoror. Mais c’est ce cheminement souterrain et continu, de glissements et de failles, qu’il est plus important de saisir. L’œuvre de Koltès est de celles-ci, où on devine intuitivement que, sous ce qu’on comprend, sous ce qu’on interprète, est un décalage neuf des masses, une organisation autre des forces, qui n’emporte pas encore forcément toute la surface du texte, mais suffit à en faire cet objet autre, et résistant. On est dix ans après qu’on l’a vu, une seule fois, première et dernière, et ces textes restent là tout auprès, à cause de ces décalages, de ces glissements. On a entendu, bien d’entre nous, dans nos travaux personnels, tout au long de ces dix ans, à mesure, ce qu’on devait à cette tonalité parce que si nettement décalée, cette rupture neuve de rythme. Alors on se promet de mieux la nommer, à cause de ce qu’on croit proximité, à cause de ce qu’on cherche dans l’instant d’aujourd’hui pour soi-même. FB.
table des matières du livre
– 1, Seulement envie de raconter bien
– 2, Devant un mur d’obscurité
– 3, Territoire d’inquiétude et de solitude
– 4, Le commerce du temps
– 5, Le grand cri de la faim des chiens
les citations de Bernard-Marie Koltès renvoient aux livres suivants
– QO : Quai Ouest, Les éditions de Minuit, 1985.
– S : Dans la solitude des champs de coton, Les éditions de Minuit, 1986 (avec C pour client et D pour dealer).
– N : La nuit juste avant les forêts, Les éditions de Minuit, 1988.
– C : Combat de nègres et de chiens, Les éditions de Minuit, 1989.
– Pr : Prologue et autres textes, Les éditions de Minuit, 1991.
– PdV : Une part de ma vie, Les éditions de Minuit, 1999.
Non pas parler directement du sens et de ce que disent les livres, plutôt de comment ils se forment et comment ils présentent forme. Descendre dans des éclats qu’on laissera sans qu’ils se rejoignent, pour comprendre de plus près cette obscurité qui nous est nécessaire : uniquement la langue et comment elle s’agence et ce qu’elle déplace, tâchant de préserver aussi ce qui en elle murmure, au nom de ce qui est urgent, nécessaire.
L’interrogation que la qualité rythmique d’une prose puisse s’affirmer comme son caractère dominant, de façon plus tendue que dans les états historiques de ses précédentes tentatives. Que cette dominante de l’engrènement rythmique sur ce qui pourrait être défini ailleurs comme mélodique : art de la combinaison de sens, de la composition des contenus, est liée en profondeur au réel qu’on nomme, le monde dans son instant présent, la difficulté esthétique (donner au nom sa forme et matière esthétique) de former en langue sa nature contemporaine, dans sa norme et ses géométries, dans ses monochromes et ses vitesses, ses translations et ses attentes, ses objets, ses murs et ses enseignes, la façon dont on marcher et la façon dont on se regarde comme, du monde où on passe ou on roule, ses odeurs et ses villes, ce qui le ronge comme ce qu’il promet : territoires et blocs quasi vierges, à réinventer.
Qu’une œuvre vraie soit reconnaissable à ce qu’elle puisse énoncer elle-même son projet, et notre interrogation que la réalisation soit pourtant évidemment chaque fois ce projet trompé, en échec ou cassé. Que cet échec même, rapporté à son intention, témoigne de la plus haute fidélité, du caractère nécessaire et obligé de ce qui fut dit, tel que cela a été dit. Que c’est ce caractère nécessaire et obligé, rapporté à ce projet énoncé, dans la plus haute fidélité et dans l’échec et la cassure, où il faut, pour examiner, attendre.
Comme des plongées étroites et successives, chaque fois parcellaires et ne désignant, de façon artificielle, qu’un fonctionnement monodique séparé de la prose, quand tous ces fonctionnements séparés agissent évidemment ensemble en chaque point de la surface de l’œuvre. Plutôt une constellation sur fond occulté, dont on voudrait que lentement les éclats agissent les uns avec les autres, pour désigner avec plus de précision la lumière propre d’une gestation, d’un mouvement. Et donc un paysage lacunaire et partiel dans l’œuvre, pour se concentrer sur les émergences, les bascules, plutôt que sur l’accomplissement ou même les contenus. Aller vers ce dont on hérite, trace fragile, mais disposée au front même où nous sommes, dans ce rapport toujours poreux et mouvant de la langue et du monde, où c’est la langue qui change.
Mystère de son lieu personnel d’écriture, qu’on y trouve l’obstacle précis à vous réservé. S’il y a nature propre de l’écrit de théâtre, c’est peut-être ici qu’elle est dite : non pas que contrainte ou techniques seraient des mots qu’on aborderait avec la volonté ou la réflexion consciente, mais que l’art du temps que représente la forme close de la pièce rejaillit en amont sur le temps même où naît l’écriture : attente et réalisation brusque, une réplique, et attendre le lendemain pour la suivante. Ce qui distinguerait ce mystère du théâtre, la rareté plus grande qui distingue ses productions (avec le paradoxe inverse que, pour qui atteint le fil, tout s’y dresse d’un bloc, avec du rebut très peu), serait la façon dont à chaque instant de l’écriture est exigé cet en amont technique, de la réflexion, des leçons. A considérer alors la valeur symbolique que Koltès accordait aux arts martiaux : Dans la Fureur de vaincre, on a filmé un enchaînement de katas par Bruce Lee au ralenti. Il paraît que ce n’est pas pour le goût de l’effet, mais uniquement parce que Bruce était capable de donner un coup à une telle vitesse que la caméra n’avait pas le temps de l’enregistrer. Pr 118. Préparation qu’on se fait, dans la vie et dans les livres, et techniques qu’on doit développer dans l’écart, comme ces batteurs qui se plaignent de ne pouvoir travailler leur instrument que lors des répétitions du groupe et pas chez eux tout seuls : cela qui va sous-tendre l’instant de l’écriture parce que justement on pourra tenir dans cette précision et cette rigueur, même le temps bref du travail, pour n’avoir pas à y revenir. Non pas cent fois sur le métier remets ton ouvrage et bien le contraire, pour que s’écrive encore une fois la leçon : et l’étude en amont, ce qu’on examine alors, dans ce même ralenti, de l’état accompli, non pensé, du rythme et de la tension, de ce qui s’est déposé de langue parmi le champ des contraintes. Que ce qu’on examine alors, ensuite, c’est justement et toujours ce malgré moi.
Que se définit donc clairement (il y a ce mot choisir) dans l’intention du travail ce qu’il vise, l’étrangeté de ce qui est là, du comment on le vise, non pas directement mais par ce rituel déployé où on fixe dans l’écriture ce qui précèdera qu’on la profère sur scène, langue qui passe outre à l’immédiat pour y attirer comme jusqu’au plus près mais gardant cet infime écart où parle la continuité accumulée du temps, souvenirs et passé, et la fantasmagorie du dedans par le rêve et ce manque, et le procédé majeur de territoire (désert) et de temps (cette heure) qui en sera le mécanisme, le temps du dire superposé au temps du théâtre pour optiquement démultiplier le réel complexe de l’instant immédiat. Par ce recours récurrent à la description d’un affrontement, en miroir offert à ce que dans l’écriture soi-même on affronte, et qu’il faut bien s’inventer prise (si la phrase est toujours double mouvement de la fixation de cette prise et qu’on l’abandonne encore pour plus haut).
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne 25 novembre 2013 et dernière modification le 6 janvier 2014
merci aux 836 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page