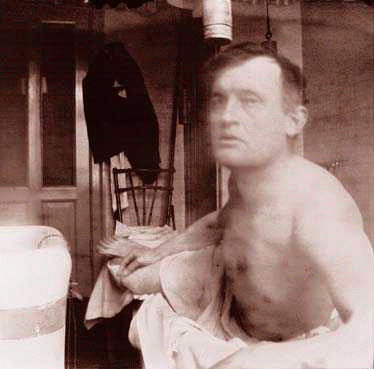
si c’est l’enfer qu’il voit
Pour ceux de ma génération, nés dans des villages, l’appropriation de l’art n’allait pas de soi, simplement parce qu’on ne nous mettait pas en présence. Les grandes villes étaient loin. D’une expédition enfant au Louvre que peut-il rester sinon le dédale et l’ampleur des bâtiments, et du voyage de trois jours l’idée même de Paris.
Il y en a toujours quelques-uns pour franchir ces barrières via zones blanches ou vides, via la musique, le dessin ou les livres, et de façon irrépressible. C’est pour ça que Chaissac m’importe tant, écrits et oeuvre. Et Balzac aussi.
C’est sans doute différent aujourd’hui. On conquiert l’art dans les villes à mesure qu’on conquiert les villes elles-mêmes. Donc tout cela venu biographiquement dans le même mouvement, par exemple : Leningrad en 1978, l’Ermitage, et les musées de Moscou, le même été, j’étais prêt. L’année suivante, je commençais de m’approprier ceux de Paris. En littérature non plus, on ne se presse pas tant que ça : je découvrais la même année la correspondance de Flaubert, et tant mieux si ça s’organise du même point d’appui. D’ailleurs, il suffit de suivre les livres pour prendre l’art en chemin, et remonter ou suivre : à commencer par le surréralisme.
De la même façon le cinéma m’est resté étranger, à part un bref temps de découverte l’année 1971, j’avais déjà presque dix-huit ans et pas assez de vocabulaire de base pour y rien comprendre. J’ai vu Fellini, à Rome en 1985, avant d’avoir vu aucun de ses films. Je ne m’en culpabilise pas, le rapport aux livres a toujours été d’autant plus continu et plus fort, mieux hiérarchisé et dans une volonté tendue. Je ne réponds jamais à ceux qui me reprochent de trop citer des livres que j’aime, c’est juste que je me suis moins dispersé dans d’autres disciplines.
L’autre intermède c’était précisément Paris cette année 1977, la figure de celui avec qui je partageais cette mansarde rue Lafayette, et si sa figure ne peut être évoquée plus, lire mon bouquin l’Enterrement pour comprendre. J’ai souvenir cet hiver-là de deux films vus avec lui (on était dans le même quartier que Bernard-Marie Koltès, et même si on se croisait on ne risquait pas d’entrer en contact, c’est la ville : je n’ai pas été mis en présence de sa Nuit pourtant venue à Paris cet hiver-là), il y a le Gurdjieff de Peter Brook et cette séance dans une salle moitié vide, c’était vers Étoile, sans savoir pourquoi — pour une fois — je l’avais accompagné au cinéma, la plupart du temps c’était mieux qu’il y aille seul il n’y avait pas à se partager la piaule, mais c’était le cas et donc j’ai pris connaissance d’abord par l’écran de l’œuvre et de la vie d’Edvard Munch : je n’avais jamais entendu avant 1977 même son nom, rien vu d’aucune toile même si cela paraît 30 ans plus tard invraisemblable.
La même année je me préparais à un premier séjour de quatre mois à Bombay, je ne sais pas si le mot art vaut lorsqu’on visite Ajanta ou Ellora : la ville – et celle-ci si forte que souvent je rêve encore en elle — est art en elle-même, et pour chacune je sais encore les livres que j’y ai lus — par exemple je n’avais pas encore lu Proust, ce serait Bombay au second voyage), ce mois de décembre 1978 j’étais à Göteborg en Suède, il y avait un peu de jour entre la fin du matin et le début d’après-midi, on faisait des essais de soudage sur une machine destinée à des réparations sous-marines dans un chantier naval quasi désert, un soir j’étais allé au musée et face à la porte je l’avais immédiatement reconnu qui m’attendait, Munch.
C’est depuis ce moment qu’il m’accompagne, violence intacte. Deux ans plus tard, je commence la lecture de Strindberg, en particulier ces drôles de livres écrits en français et que l’éditeur avait cru bon de corriger, mais laissant en annexe les si maladroites mais belles tournures de Strindberg, son combat contre la peur, cette situation d’homme seul dans la ville et la langue étrangères : et bien sûr alors la figure de Munch surgissant à son côté tout auprès. Parce que ces livres de Strindberg je ne m’en suis plus jamais séparé, la figure de Munch solidifiait encore, tout près de moi, de plus en plus près.
On a chacun quelques peintres rares. Et d’autres peintres, comme Van Gogh ou Monet, que certainement on tient tous en partage. Dans ces attachements aux faiseurs de figures, cette affinité reste un mystère. On comprend celle ou celui qui va vers Renoir parce qu’on a ce même mouvement vers Hopper.
J’ai régulièrement acheté, depuis lors, tous les livres que j’ai pu trouver sur Edvard Munch ou reproduisant ses œuvres, en particulier dans cette année où moi-même j’étais à Berlin, en 1988, et que ces bistrots où au soir ils se retrouvaient, lui, Munch et les autres, je cherchais à les identifier et tâchais de les retrouver.
Par exemple, je sais que ce gros livre anglais par lequel j’ai découvert les notes, carnets et lettres d’Edvard Munch, toujours non traduit en français alors que c’est considérable, c’était dans une librairie de Chelsea le jour même où j’allais voir pour la première fois le 102 Edith Grove des Rolling Stones.
On a toujours le rêve de livres. On porte en rêve des livres que peut-être on écrira, peut-être on n’écrira pas. Il y a des territoires, aussi bien légers et lumineux que sombres et tragiques, dont on sait qu’on ne pourrait en prendre possession qu’à condition d’architecture préalable. Qu’à condition de les aborder par l’écriture, la préparation et l’accumulation préalable qu’elle suppose, puis la répétition des jours et le ressassement du travail, enfin d’accepter que ce qui s’écrive soit si abruptement distinct de l’intuition préalable.
A cause de ce manque en notre langue, à cause de Strindberg, et pour ces couleurs et le tragique d’Edvard Munch, j’avais toujours rêvé d’écrire un livre sur Munch. On ne sait pas pourquoi on diffère ces projets : parce que, simplement, ils ne sont pas biographiquement prêts ? Pour d’autres hasards : les éditions Flohic faisaient cette proposition, et surtout aux auteurs qui avaient déjà travaillé avec eux (mon Hopper, justement), de prendre une image photographique et de l’explorer par l’écriture. Bergounioux y a répondu avec son B 17 G. J’avais proposé à Catherine Flohic d’y répondre par l’image d’Edward Munch que vous allez trouver ci-dessous. Il y aurait eu, dans ce texte, tout ce qu’évoqué ci-dessus. Ça ne s’est pas fait, ça aurait pu : c’est simple comme ça. Mais l’image est toujours là, dans mon dossier projets où je mets des textes et pas d’images.
Cette photo est un autoportrait : ce qui veut dire que Munch l’a construite et voulue telle. Il s’affiche non pas nu mais en caleçon (plutôt étrange pagne mal clos), en position parallèle à celle de son modèle lui entièrement nu. Le modèle est un homme solidement bâti : en fait le maître nageur de la plage de Baltique allemande où Munch réside cet été-là. On remarque d’autant mieux le corps trop mince de Munch : pas seulement la légèreté musculaire, mais le corps mangé par l’alcool, et le visage au contraire durci.
Pour sa pose de profil, Munch garde sa palette, le pinceau et le geste de peindre, mais l’adresse au bord gauche de l’image, espace non défini, hors cadre : on peut supposer que rien, en fait, le vide. La toile qu’il travaille, pour la photo avec retardateur il lui a tourné le dos. Normalement, il est de face devant la grande toile, pour voir le modèle de profil. Sur la toile il y a le travail d’Edward Munch : les raclements, les recouvrements, les superpositions et les flous. Non pas la construction d’une toile, mais la toile comme travail. Ainsi se construisent les toiles qu’accepte Munch comme siennes : étapes fixées d’un travail qui lui n’a pas de terme ni jamais ne s’achève.
Il me semblait que ce détournement, la mise de profil, le dénudement, et la palette gardée alors que ce qu’on construit ce jour-là c’est une photographie pour la série de ses auto-portraits, me permettaient l’entreprise du livre, celui qui ne s’est pas fait.
J’ai d’autres projets de cette sorte. Et dans ma bibliothèque l’assemblées des livres de Munch qui aurait dû le nourrir.
Un livre est venu prendre la place libre : Si c’est l’enfer qu’il voit, et peu probable, maintenant que l’espace langue qu’on pouvait dans la nôtre associer à Munch a pris forme de livre, que mon propre projet prenne corps. L’urgence d’autrefois c’est qu’il nous semblait qu’on était si peu nombreux, à connaître ou défendre Edvard Munch. Le Cri l’an dernier a été volé, puis retrouvé (un des quatre Cris. Munch a pris sa juste place : celle des peintres universels, des peintres importants.
Pourtant on le connaît encore trop peu, ce qui veut dire : le laisser accomplir, au fond de soi, le travail qui lui-même le rongeait, où il y a de la mort, où il y a de l’alcool et même l’âge, l’étrange monsieur digne, et où il y a ces danses, ces bals, et l’ombre partout mouvante de la mort. C’est cela, Si c’est l’enfer qu’il voit.

Si c’est l’enfer qu’il voit
extrait
En janvier 1890, avec ses toiles, son chevalet, ses tubes de couleur et ses pinceaux, carnets de croquis, bagages et dans la compagnie du poète danois Emanuel Goldstein, il franchit la Seine, place entre la mort et lui la surface bleue d’un fleuve, s’installe à Saint-Cloud : hôtel-restaurant du Belvédère, 12, quai Carnot. Prix modérés. Confort moderne. Téléphone 0.60. Une carte postale de l’époque montre la Seine bordée d’arbres nus, une terrasse couverte au premier étage, des plantes en pot, un chien. Il occupe une chambre du deuxième étage.
Deuil. Anxiété financière. Le docteur Christian Munch n’a laissé ni argent ni héritage. De l’honorable famille de Christiania, seul Andreas obtiendra, à force de sollicitations, une petite somme afin d’achever ses études de médecine. Pour survivre, Inger va donner des leçons de piano, Karen fabriquer des articles-souvenir pour le magasin Husfliden. Et il faut payer l’institution psychiatrique où Laura est soignée. Les bourses d’études que recevra Edvard devront lui suffire, elles ne suffiront pas.
Deuil. Anxiété artistique : « On ne peut plus peindre des intérieurs avec des hommes qui lisent et des femmes qui tricotent. On peinra des êtres vivants qui respirent, et qui sentent, qui souffrent et qui aiment. Je sens que je le ferai — que ce sera facile — il faut que la chair prenne forme et que les couleurs vivent » (manifeste dit de Saint-Cloud).
Nuit à Saint-Cloud, huile, 64,5 sur 54, Galerie nationale d’Oslo (acheté en 1917). La chambre est bleue. Une silhouette een pardessus et haut-de-forme est assise sur une banquette, à gauche, le coude appuyé sur le rebord de la fenêtre. Sur la droite, on distingue les formes d’un rideau et d’un meuble. A l’avant-plan à gauche, un rideau à motifs établit un parallélisme de lignes avec le rideau droit de la fenêtre. Au plafond, une suspension éteinte. L’homme a regardé les heures de la nuit tomber une à une derrière la fenêtre. Là-bas, sur la Seine qui réfléchit la lune tel un monet, se profile un bateau dont une ligne jaune et un point rouge sont les seules notes vives du tableau. A l’intérieur de la pièce les heures ne s’écoulent pas, ne disparaissent pas avec le temps. Heures du deuil, elles s’inscrivent sur le sol de la chambre bleue, y dessinent un espace, ressortissent de l’espace — pas du temps. Le temps, lui, file dehors, sur l’eau, avec son jaune et son rouge. L’homme n’a pas de visage, n’en a plus. Avoir un visage supposerait des traits, des expressions, des sentiments ou des états d’âme, peut-être une ressemblance avec des morts. Mais il n’est plus que regard et ce regard le sauve, car s’il n’entrevoyait pas une lune, un bateau, un Monet par-delà la mort, il serait englouti par les masses épaisses que composent le mur derrière lui et les rideaux, absorbé par l’ombre de la banquette. Se faire regard porté sur l’extérieur et détacher sa silhouette sur le bleu plus clair que découpe la fenêtre est l’unique moyen d’échapper à la nuit définitive, celle qui a emporté sa mère, sa soeur, son père, qui sera le prochain, se faire regard pour retarder le temps, sinon il ne saurait que se jeter sur le sol de la chambre bleue, s’enchrister sur la croix que forment les montants de la fenêtre, s’enkyster autour du pinceau, non, voir est tâche de vivant, voir sans penser, sans parler, sans pleurer, voir l’ombre du ciel se poser sur le genou, attester l’existence. La mort désoriente, l’espace déverrouille. « J’aime la vie, écrit-il, la vie même malade. »
© Dominique Dussidour, Gallimard, L’un et l’autre, 2007.
– musée Edvard Munch
– photographies et autoportraits de Munch et Strindberg
– une exploration interactive de Dance of life
– autres textes de Dominique Dussidour sur remue.net, dont elle est actuellement responsable du comité de rédaction et présidente de l’association
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne et dernière modification le 16 février 2007
merci aux 5696 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page

