
le lieu au microscope : les visites de Perec à la rue Vilin
– retour au sommaire général du cycle « écrire les lieux »
– retour au sommaire général de l’atelier hebdo & permanent
à chacun sa rue Vilin | la proposition
Le point de départ :
– dans Espèces d’espaces, énonce le protocole de son projet Lieux destiné à durer 12 ans, « jusqu’à ce que tous les lieux aient été décrits deux fois douze fois ». Je ne propose pas cet extrait (je le lis dans la vidéo) mais vous invite à le relire dans son contexte, depuis le livre même, indispensable.
– deux corollaires sur ce projet : destiné à être archivé, à mesure qu’il avance, dans une série d’enveloppes scellées, Perec l’interrompt avant qu’il soit fini. Les enveloppes resteront très longtemps (et volontairement) closes à la BNF, mais lui-même s’autorise deux exceptions : la publication d’un des relevés pratiqués au carrefour Saint-Sulpice, et ce sera Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, et la reprise, dans W et dans L’Infra-ordinaire des fragments concernant la rue Vilin.
– de même que La vie mode d’emploi s’écrira depuis le « cahier des charges » inventé dans Espèces d’espaces au chapitre précédent, aucun doute sur le fait que Lieux était destiné à construire un livre. Depuis 2 ans il est prêt à être édité, et bloqué pour des questions de droits par son ayant-droit (nièce de sa tante adoptive je crois ?) : that sucks, comme on dit en bon français.
L’élément déterminant, qui renvoie à ce point-source autobiographique présent chez Perec bien au-delà de W (comme la Disparition, en s’écrivant sans la lettre e, la plus fréquente en français, s’interdit aussi les 2 lettres du mot père, du mot mère, et du patronyme Perec), c’est bien la présence, parmi les 12 lieux parisiens choisis, de la rue Vilin.
Là, au n° 24, habitait la grand-mère maternelle de Perec, là le salon de coiffure où travaillait sa mère, là le petit appartement où il est né, et a vécu de 1937 à 1941.
Le trauma de la guerre, la disparition de sa mère à Auschwitz ont effacé de lui tout souvenir conscient de ce qui précède l’adieu à la mère, sur un quai de la gare de Lyon, pour l’enfant de quatre ans.
Le protocole de Lieux est donc aussi ce qui doit lui permettre, vingt-quatre fois en douze ans, d’écrire sans empathie, selon la seule contrainte énoncée, un lieu dépositaire d’une mémoire inaccessible. Les vingt-quatre prises d’écriture sur la rue Vilin reconstitueront ainsi l’autobiographie impossible.
À preuve que lorsque les bulldozers s’emparent pour démolition de la rue Vilin, c’est la totalité du projet qui s’arrête. Attendons le bien vouloir de l’ayant-droit pour enfin comprendre plus.
Voici donc notre point de départ :
– en tête de L’Infra-ordinaire, après la fabuleuse introduction et son célèbre « Questionnez vos petites cuillers ! » (Ce qui nous parle, 1ère publication Cause commune n° 5), les concepteurs de ce recueil de textes publiés de Perec, Eric Beaumatin et Marcel Benabou, donc en septembre 1989, exactement sept ans après la mort de Perec, reprennent le texte éponyme, La rue Vilin publié sous ce titre par Perec dans L’Humanité le 11 novembre 1977, contexte donc très différent des deux autres textes sur la ville repris dans le recueil, sur Beaubourg et sur Londres, commandes du magazine Air France, ou du texte sur le « bureau » écrit pour Vogue.
– impossible, en attendant la publication de LIeux, et contrairement à Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de savoir ce que le texte préparé pour L’Humanité reprend, sélectionne et récrit des notes censées être dans les enveloppes scellées.
Ce que nous savons, c’est que Perec décide de publier, dans un quotidien alors populaire, et dans le contexte politique de l’avant-Mitterrand, le journal de 6 visites à la rue Vilin : 27 février 1969 (le plus long et détaillé, repris dans les fiches extrait), 25 juin 1970, 13 janvier 1971, 5 novembre 1972, 21 novembre 1974, et celui qui tient en 3 lignes, à 2 h du matin le 27 novembre 1975, quand les palissades de la démolition ont définitivement enlevé la rue à son histoire.
Tout ce détail pour bien insister sur ce seul fait : la contrainte protocolaire (la rue remontée numéro par numéro), l’attention au relevé des signes (traces d’anciennes inscriptions, formes des escaliers, boîtes aux lettres et compteurs à gaz dans les entrées), à l’ensemble du contexte perceptif (musique de jazz lointaine, une autre fois musique arabe, coups de marteau) à sa propre déambulation (s’il entre, s’il traverse, s’il attend). S’y ajoute l’arbitraire de ce qui advient : silhouette brièvement aperçue derrière un rideau, petite fille qui court, homme portant un ballot.
Ajouter encore, et on sera dans notre consigne, l’obligation qu’il se fait de maintenir son relevé descriptif même là où les signes se retirent : volets fermés des hôtels ou maisons ou ateliers déjà fermés, terrain vague (« avec des caillasses et de l’herbe pelée »). Et de ne pas contourner la part autobiographique : souligner l’existence du secret mais sans le nommer : « À droite un long bâtiment à un étage (donnant jadis sur la rue par la porte condamnée du salon de coiffure) avec un double perron de béton (c’est dans ce bâtiment-là que nous vivions ; le salon de coiffure était celui de ma mère). »
Ce qui permet accessoirement de noter le rôle des parenthèses pour inclure dans la phrase flux (déplacement linéaire du narrateur-observateur) ces zooms immobiles, soit sur le dehors et la réalité des signes ou des choses, soit vers l’intérieur et sa réflexion propre.
J’insiste, dans la vidéo, sur le caractère éventuelle déceptif d’un tel exercice. Contrairement aux deux précédents, on se force à cette réalité minuscule mais prise à la loupe. Un relevé immobile de choses qui – retour au texte d’intro à L’Infra-ordinaire – nous sont invisibles parce que permanentes, banales, habituelles. Précisément ce que, dans les deux premiers exercices, nous n’avons pas eu besoin d’écrire. Rien n’interdit d’ailleurs, bien au contraire (et dans l’éventuelle perspective, augmentée de notre premier apprentissage), d’un livre collectif en conclusion de ce cycle) de repartir d’un des lieux que vous avez utilisé pour une des deux premières propositions. J’insisterai tout aussi bien, à l’envers, sur le fait que ce caractère déceptif, pour la simplicité et l’humilité des éléments qui feront votre texte, n’auront pas la même banalité pour quiconque viendra lire à neuf, sans connaissance du réel source, et devra – à partir des mêmes éléments – mentalement le construire. Et c’est bien l’enjeu d’une contrainte qui nous force à venir plus près du réel.
Alors quel timbre-poste (expression de William Faulkner) choisir ? Oui, il peut être déjà contenu dans vos précédentes contributions.
Mais il peut être un défi dans l’humilité des trajets du présent. Un hall d’immeuble. Le coin de trottoir où on gare sa voiture. Un auvent de station-service. Un arrêt de bus. Un portail d’école. le feu rouge où chaque matin on est coincé une minute à ce carrefour. Il est forcément hors de l’espace privé. C’est le lieu de la ville : le lieu de la rencontre et de l’écoute des signes arbitrairement laissés par les autres.
Tout cela, l’envie de revenir explorer ensemble ce texte décisif (et, j’y insiste, la préparation pour publication non pas vers le livre, mais dans le coup de poing d’un journal politique, de notes dont l’étendue nous est encore celée), je l’avais en tête dès le départ comme passage obligé de cette séquence sur le lieu.
Mais, à y revenir, c’est la partie journal qui s’imposait pour moi aussi de façon de plus en plus déterminante. Et notamment les deux premières occurrences, février 69 et juin 70. Avec par exemple aussi la distorsion qui les frappe : un relevé beaucoup plus massif chaque fois pour les premiers numéros de la rue, comme s’il fallait préparer le regard avant d’arriver au lieu par excellence, celui du secret, l’escalier qui menait à l’appartement familial et qu’on n’empruntera jamais. Puis, ensuite, on continue le protocole mais il ne cesse de s’élargir et de se dissiper.
C’est une autre lecture possible du texte préparé par Perec pour L’Humanité : comment s’écrit à chaque passage la cour du 24, où il habitait. L’effacement, un chat, des ouvriers. Ce vieil homme qui descend les marches, là où lui n’entrera pas : fantôme ? Puis pour finir, en novembre 1974, ce Encore debout.
Un point précis suffit donc, c’est ça qui compte, être devant cet escalier, et non pas le relevé linéaire. C’est un texte d’ancrage, et pas de mobilité.
L’idée du diptyque est venue à ce moment-là. Je ne sais pas si elle fonctionne. On le saura après l’atelier. Je voulais vous le proposer comme piste, question, exploration – ne pas en manquer la chance. Selon ce qui s’en révélera, on aura alors inventé une proposition d’écriture dont chacun pourra à l’envi se resservir.
Le même point précis du réel, l’ampliation due à la technique d’écriture. Mais le faire deux fois. Rien ne change, tant mieux. Mais vraiment, rien, rien de rien n’aurait changé d’une occurrence à l’autre ? Pas besoin que ce soit long, c’est l’acuité du regard, et la radicalité de la perception sensible sur un point très limité du réel qui va compter.
Toutes les armes sont à votre disposition, photographies, Street View, souvenir et puis se payer un ticket de métro pour aller voir en vrai, là où vous n’étiez pas retourné depuis quand. Tout, à condition d’aboutir à ce diptyque. Et que l’humilité apparente des choses se révèle détentrice du secret.
Alors on sera digne de Georges Perec, et ce qu’il nous lègue avec la désormais mythique rue Vilin.
FB
• Complément et hommage : FB, entretien sur Espèces d’espaces à la BNF avec Paulette Perec, récemment disparue.
• Photographie ci-dessus : Georges Perec dans la rue Vilin, planche-contact de © Pierre Getzler, 1970.
l’ensemble des contributions reçues
Sortir à l’angle nord du jardin des plantes (cette fois sous le ciel clair et dans l’air plus froid encore de décembre), ce mardi vingt-sept où je passe ici, pour – un jour après hier et à la même heure – vérifier que la ville est à sa place et ses vivants et ses morts.
Elle fait là un angle étrange quand on passe la grille et laisse derrière soi le jardin et ses labyrinthes (j’apprends que l’endroit où j’aimais tant aller est désormais fermé : le petit labyrinthe laissé sauvage pour observation naturelle : et que des oiseaux rares ou espèces végétales disparues sont revenues ici ; sans doute faut-il emporter cela avec soi aussi, dans la ville : ces endroits concédés à la sauvagerie désormais insondables et qui reprennent ses lois propres ; puis songer que bientôt toute la ville sera cette jungle sauvage, affaire d’un siècle ou deux), les statues des deux lions sous lesquels on devine, surgies de ma propre imagination peut-être, des pieds d’homme dévoré.
L’angle de la ville soudain revenue à son échelle dessine un triangle parfait : main droite, la rue Cuvier s’enfonce vers le quai et son fleuve, la ville médiévale autour de Notre-Dame. En face, la rue Lacépède va remonter vers Monge, la Contrescarpe et tout le quartier latin de mon année de Licence. Mais à l’intersection exacte de ces deux directions, la rue Linné trace le sillon d’un désir et d’un autre passé.
Le désir, c’était celui d’hier, lundi : remonter la rue jusqu’à Jussieu. Cette rue, je la connais par cœur, mais depuis son envers : depuis Jussieu jusqu’ici, vers la statue de Cuvier qui déchire l’angle de ces rues. Dette à mes années d’études supérieures où j’ai appris à lire : à me défaire de mes lectures anciennes, à apprendre la ville aussi, et à écrire tout cela à la fois, depuis le Deuxième arrondissement où de l’autre rive du fleuve, rue Beauregard, j’aurais écrit les nuits la brûlure de ces années (où qu’elles soient encore), à cette rue Linné où le jour apprendre l’art de passer le temps sur quelques rues lance la blessure d’écrire.
Nous sommes mardi.
Je reviens à l’angle des rues et remonte rue Linné : je sais pourquoi cette fois. Je refais le trajet à l’envers de mon passé : depuis le trottoir de droite quand on s’enfonce vers Jussieu, je vois les cafés du trottoir de gauche où j’ai, sur chaque table autrefois, épuisé un livre : Marot, Molière, d’Aubigné ou Chateaubriand colore chaque mur de chaque façade. La rue est longue et droite ; un coup d’œil suffit : dans l’ordre depuis le Trois rue Linné, j’aperçois les Arènes (où s’était nouée immédiatement mon amitié avec LB, qui rencontrerait un succès littéraire foudroyant trois ans plus tard, au moment où il s’éloignerait), puis l’Inévitable (les cafés seul de dix-huit heures), L’Epsilon enfin (ce thé brûlant avec EM où elle m’avait confié son projet d’une biographie mystique de Dylan). Dix ans plus tard, les cafés sont les mêmes : comme les jeunes garçons et les jeunes filles qui le soir parlent de la vie à écrire, qui ne s’écrira jamais comme les désirs de les jeter sur la table, à vingt ans.
Sur le trottoir de gauche où je suis, la liste de ce qui parsème la rue raconte l’histoire de cette ville et de ses mutations : une pharmacie ouvre la rue, suivie d’un café Les Trois Carafes (devant lequel un arrêt de bus se dresse, dans sa modernité d’apparat : invisible et conçu pour se rendre hostile aux mendiants), puis c’est La Clé du Barbier (n’existait pas il y a dix ans : n’existera plus dans dix ans – c’est à cela qu’on reconnaît une ville, dans son obsolescence programmée immédiatement) ; l’hôtel Timhotel Jardin des Plantes ; et c’est déjà le Cinq : une première pizzeria (Girasole) (nous, on allait plutôt plus bas) ; au Sept, une de ces enseignes dont j’ignore et la nature et la fonction : Pro BT Conseil – possible qu’elle était déjà là dix ans en arrière, et c’est à ce genre de signe invisible qu’on sait la ville bruissante autour de nous, là, pour d’autres, s’ils le veulent.
La rue est déserte malgré le ciel, mais le froid est si vif (vers Jussieu, je croiserai tout à l’heure de nouveau du monde : des étudiants dans les trois ou quatre imprimeries : l’heure est aux révisions avant les partiels : je les regarde de l’autre côté symbolique de ma vie, alors que tout en moi me rend contemporain d’eux) ; SOFIPACC dresse ses lettres d’or sur une façade bleu : que fait-on ici, de l’immobilier, de l’assurance, du conseil : c’est mystère, mais un mystère sans désir au contraire : je passe : le trottoir est large et la ville est si claire ; une autre façade bleue, mais sans inscription, sans rien sur la porte qu’une étrange sonnette, rideaux tirés sur un mystère plus singulier encore ; c’est le Neuf (« vieille maison – lis-je sur Wikipedia – qui a dû appartenir au couvent de la Congrégation Notre-Dame, établissement d’instruction pour jeunes filles. Cet établissement, fermé en 1790, rouvert en 1821, a disparu en 1860 par expropriation. » – et il faut imaginer ici, s’agissant de ces couvents qui étaient des camps de redressement, les jeunes filles hurler) : suivent le restaurant Les Oliviers et une alimentation générale (un dépanneur), un restaurant Libanais, L’Étoile du Liban (c’était soit L’Étoile soit Le Cèdre), et la pizzeria où justement j’allais, et qui était la frontière de mon territoire d’étudiant.
Je n’étais jamais allé au-delà.
En-deçà de la rue Linné, à partir du Quinze et jusqu’en bas, je connais chaque façade et intérieurement parfois je me refais le trajet. Je sais les éditions Galilée tout près (disparues aujourd’hui), et les boulangeries à éviter, celles où aller ; les bars où la bière est tiède, et les cafés plus ou moins serrés. Mais du Quinze au Premier, ce pan de rue que je viens de remonter, j’ignorais tout : je m’arrête au Treize.
C’est pour y lire la plaque apposée à hauteur d’homme que je suis revenu – plaque que je n’avais jamais vue avant hier, et que je regarde longuement, non en souvenir de l’homme ou de la date sa mort (un an juste avant ma naissance), mais parce que j’aurais marché ces années durant jusqu’au seuil de cette façade, et qu’il m’avait fallu passer à l’envers de la rue et de ma vie pour la voir seulement.
Je regarde les étages.
Je cherche à deviner la fenêtre où. Rideaux clos au deuxième, à demi-ouvert au troisième. C’était peut-être au troisième. Ou vue sur cour, comme savoir.
Je pense à l’homme qui dort, à toute cette année qui aura été celle de vouloir le rejoindre dans l’écriture d’un récit aujourd’hui mort. Je lève les yeux encore mais le soleil m’éblouit et je continue la route.
Lundi. Il pleuvait à peine, pluie fine et froide, presque de la brume. Je sors par l’entrée aux Lions (une enfant s’épouvante en riant : est-ce qu’on verra des lions à la Ménagerie ?). La statue Cuvier à l’angle de la rue Linné et Cuvier. J’ignorais qu’en sortant par ici, on faisait face à la rue Linné : celle qui descend vers Jussieu. J’aperçois la tour aujourd’hui désamiantée. Et si je descendais jusque là ? Je traverse : reconnais au loin les cafés, mais ici : non. Je n’allais pas jusque là. Je cherche l’endroit jusqu’où j’allais, à rebours de mes trajets d’étudiants (suis-je si étranger de celui qui l’était et marchait ici ?). Je remonte façade par façade, jusqu’à reconnaître les rebords rouges d’une pizzeria où parfois le désœuvrement conduisait. Je me retourne, par curiosité pour apercevoir l’immeuble au-delà duquel la ville était terra incognita. Sur le Treize, la plaque :
GEORGES PEREC
a vécu
dans cet immeuble
de 1974 à 1982
Il faudra revenir.

1- La haie de mon voisin
La haie de mon voisin d’en face est pleine de trous. Je peux voir à travers : sa pelouse, le portique installé pour ses enfants, une cabane, un conteneur à compost, un tas de bois très ancien recouvert d’une bâche en plastique, un portant pour étendre le linge (de ceux qui s’ouvrent en parapluie inversé et que l’on ne referme jamais), sa terrasse et sa baie vitrée, son chemin d’accès dallé depuis la rue. Rien à voir cependant avec la vue que je pourrais avoir sur la maison de mon voisin si j’habitais en Allemagne ou au Canada, une vue entière et confiante, sereine et apaisée. J’habite en France, pays de bocages et de haies. J’ai quand même une vue partielle sur le dedans de chez mon voisin, la seule permise dans tout le lotissement.
Mon voisin a passé une partie de l’été à enlever les branches mortes des tuyas malades et à arracher les arbres morts, puis il a replanté de jeunes tuyas qui, il l’espère, ne prendront pas la maladie. J’en doute et nous en avons parlé ensemble. Près du portail, il a comblé le trou dans la haie avec des palissades en châtaigner comme on en trouve dans les jardineries. Beaucoup moins solides que son portail en métal à mécanisme et moins belles que des végétaux.
C’était la première fois que je parlais à mon voisin d’en face qui s’est installé il y a cinq ans au moment de mon départ en retraite. Je m’en souviens car je les ai vus, lui et sa compagne, à l’unique réunion de copropriété à laquelle j’ai assisté (quand j’ai eu du temps, à la retraite), ; à l’époque ils n’avaient pas d’enfants et vivaient avec un autre jeune (avaient-ils acheté en copropriété ?). Ils ne parlaient pas alors que le reste de l’assemblée tenait facilement deux heures à débattre de la tonte des pelouses du lotissement, de la mousse qui envahissait les cheminements privatifs en pente et risquait de faire glisser M. X et du renouvellement du mandat du syndic.
Dans notre chemin de lotissement (qui s’appelle chemin mais est en fait une rue accessible à tous et pour cela cédé à la commune depuis peu), les haies sont réglementées : pas plus de 2metres de hauteur derrière un muret qui ne doit pas dépasser 50cm. Une clôture en bois peut remplacer la haie. Il y a diverses interprétations de la règle : muret + clôture + haie, muret + grillage + haie, muret + haie, mais ce qui domine ce sont des haies parallélépipédiques, massives et dépassant souvent allègrement les deux mètres. On dirait des remparts. Beaucoup sont de tuyas, mais il en existe de lauriers comme la mienne ou très exceptionnellement d’arbustes à fleurs en mélange, les plus agréables et les moins opaques. Tuyas et lauriers poussent vite et drus ; ceux qui rénovent leurs haies actuellement penchent pour des espèces à pousse plus lente, moins protectrices mais moins coûteuses en entretien. Un propriétaire a même remplacé sa haie par un mur en dur qui dépasse le mètre cinquante ; l’application du règlement de copropriété n’est pas scrupuleuse vis-à-vis des copropriétaires mais les haies ou les arbres isolés plantés sur les espaces communs du lotissement ont du souci à se faire, les unes parce qu’elles peuvent dissimuler aux regards des activités illicites qui se dérouleraient dans ces espaces communs, les autres parce qu’ils risqueraient de tomber sur les maisons des copropriétaires. Il n’y en aura d’ailleurs bientôt plus aucuns (ni haies ni arbres) et beaucoup de copropriétaires rêvent de vendre les pelouses communes et de s’en partager le produit (à 1 400 euros le m²), mais ils n’ont pas encore la majorité.
La haie de mon voisin est misérable et chétive ; son muret ne vaut pas mieux : revêtu d’un crépi rosâtre, il est tout boursouflé d’attaques d’humidité. Mais c’est bien qu’il ait changé le crépi car j’ai perdu un chat écrasé par une voiture et les traces du choc sont demeurées longtemps sur le muret de la maison de mon voisin. Tous mes chats adorent la haie de la maison de mon voisin, premier refuge après avoir traversé la rue en sortant de chez moi. Son trottoir inégal se couvre de mauvaises herbes qu’il ne coupe pas pensant que c’est le rôle de la mairie, mais la mairie a abandonné depuis cette année l’épandage d’herbicide (heureusement). Il n’a pas l’air de le savoir et a de toutes façons bien du travail avec sa haie.
Je vois aussi sa pelouse très laide et mitée que son père vient tondre parfois. Et puis, il y a les arbres de sa pelouse, un bouleau, un conifère indéterminé mais qui n’est pas un sapin de Noël replanté, un saule tomentosa, des pins rouges qui comme dans toutes les pelouses du voisinage pourrait permettre de dater l’aménagement du jardin en fonction des modes botaniques. Les terrains étaient auparavant des vergers (nous habitons dans le territoire de la capitale de la poire) mais très rares sont ceux qui ont conservé les arbres fruitiers, ils les ont remplacés par des arbres d’ornement (moi aussi d’ailleurs, même si j’ai gardé quelques cerisiers qui meurent petit à petit de vieillesse)
Je n’aime pas vraiment les goûts de mon voisin en matière de décoration, le père noël de sa façade est bien niais, les lampes qui bordent son accès dallé (à recharge solaire) itou. Mais mon voisin fait partie des rares jeunes couples avec enfants de notre lotissement. Tous les autres sont là depuis la création, pas encore assez vieux pour le quitter, mais seuls dans de grandes maisons vides dont les enfants sont partis depuis longtemps, loin car l’apparition des petits enfants est rarissime. Les changements de propriétaires sont encore rares car les terrains sont chers dans ma banlieue.
Enfin ce n’est pas tout à fait vrai : les voisins de derrière ont changé déjà deux fois depuis que nous sommes là. Et puis, plus loin il y a une veuve qui se débat dans des affaires de succession et devra sans doute partir : son mari n’était pas divorcé lorsqu’il a acheté avec elle et les enfants ne la laisseront pas profiter de ce que la loi les autorise à conserver bien que leur mère n’en ai jamais payé un sou. Juste à côté, des voisins peu causants qui se sont séparés et ont vendu ; elle s’est aperçue qu’il avait une maîtresse depuis longtemps , cette dame qui venait le voir sur son lit d’hôpital après sa crise cardiaque. Tout le lotissement était au courant de son accident de santé car l’hélicoptère avait stationné sur la pelouse commune. La suite on l’a apprise à la fête des voisins. La fête des voisins qui se tient généralement sur une de nos pelouses collectives, c’est le moment de partage de l’histoire des uns et des autres, en plus des thèmes récurrents que sont l’entretien des haies et celui des piscines. Et puis il y a aussi les nouveaux installés qui viennent du lotissement d’à côté, moins côté, qui ont migré de 200m de la rue M. au chemin de la T. (un couple de médecins et un chirurgien dont l’épouse est femme au foyer et référente de « voisins vigilants »).
2- avant, c’était comment ?
Avant, la maison de mon voisin était la résidence secondaire d’un chirurgien lyonnais et sa haie était parfaitement opaque. C’était un petit homme fluet et taciturne que sa femme asticotait toute la journée d’une voix de poissonnière. On ne voyait rien mais on entendait tout. Je les avais invités lors de notre installation, c’est pour ça que je sais qu’il était chirurgien ; ils m’avaient offert une azalée agrémentée de leur carte de visite.
J’avais invité ce jour-là, très ignorante des coutumes et de la géographie du quartier, tous les pires voisins, ceux dont j’ai appris après que personne ne leur parlait. Un vieux légionnaire en retraite, grand ami du chirurgien, qui est mort depuis en hôpital psychiatrique après avoir eu plusieurs fois maille à partir avec la gendarmerie ; il détestait tous les chiens et n’hésitait pas à envoyer des pétards par-dessus les clôtures pour les faire taire, sans succès. Mademoiselle M. propriétaire dans le village depuis quatre générations dont les propriétés (diverses maisons, granges et hangars à l’abandon) jouxtent la mienne ; elle habite au bout de son terrain dans une maison « neuve » qu’elle a fait construire il y a au moins cinquante ans ; elle n’entretient plus jamais le bout de terrain qui jouxte ma terrasse où les ronces, sureaux, clématites se sont installées et prospèrent. C’est encore dans la petite ville une personnalité redoutée, une héritière, qui a refusé de me vendre son bout de terrain et m’envoie des courriers de ses gestionnaires de patrimoine quand elle soupçonne une incursion de ma part dans ses propriétés. Mais elle vieillit et j’entretiens désormais secrètement le bout de terrain qu’elle a refusé de me vendre pour un pas perdre ma vue sur l’horizon. Et je ne désespère pas d’acheter à son gendre le bout de terrain qu’il se hâtera de vendre avec le reste de l’héritage.
Ils étaient tous venus à mon invitation mes pires voisins car c’était une aubaine de voir comment nous avions aménagée la ruine (et la maison en chantier) que nous avions acquise d’un couple divorcé, en guerre pour le partage de ce bien dans lequel seul le mari campait encore.
Je me suis toujours demandé comment mes voisins d’en face avaient acquis la maison du chirurgien. Ils sont tous les deux de jeunes enseignants et les parents qui sont souvent venus les aider dans leurs travaux ne semblent pas riches à millions. Un héritage sans doute ? Ils ne viennent jamais à la fête des voisins. Pourtant ils reçoivent beaucoup aux beaux jours, bière et barbecue ! Ils sont même les seuls à inviter autant d’amis, un peu tout le temps, des amis qui habitent dans les environs sans doute. Les autres voisins, nous compris, donnons plutôt dans les fêtes de famille, ou les fêtes commémoratives (le départ en retraite, les dix ans de ceci, les vingt ans de cela, les trente ans d’amitié, les retours des enfants expatriés, la fête annuelle du club photo ou de l’association culturelle).
Avant, j’habitais la ville, un appartement dans une tour du XIII éme arrondissement de Paris et je n’imaginais pas revenir vivre à la campagne où j’avais passé mon enfance et mon adolescence. Mes textes préférés dans « Espèces d’espaces » de Georges Perec était ceux très courts du chapitre La campagne qui commencent par cette phrase « Je n’ai pas grand-chose à dire de la campagne : la campagne n’existe pas, c’est une illusion ». Le goût d’y retourner m’est venu tard après un divorce et une nouvelle rencontre. J’habite ma fausse campagne avec mon regard de petite fille de paysans, sans illusion sur la propriété et la convivialité. Rien ne résiste au passage du temps, il serait ridicule de se sentir enraciné ou de renier son statut de nomade. Mais les ciels sont beaux, l’air y est doux et l’espace est à ma porte pour promener mon chien.
Je me suis plongée dans les recherches sur ma maison et l’origine de ce lotissement, à partir du cadastre napoléonien (où la maison existait déjà) et des premiers recensements de la commune. La maison a effectivement été occupée par deux familles parentes pendant un siècle, sans doute locataires de terres du château voisin. Elle était une de ces rares maisons isolées du bourg dans cette commune peu peuplée (qui était passée de 300 à 600 habitants pendant le 19eme siècle) et entièrement consacrée à l’ agriculture et aux parcs des châteaux. Ils ont été jusqu’à quatorze dans cette propriété, puis le phylloxera, l’exode rural et la proximité de Lyon ont fait leur œuvre. En 1921, il ne restait que trois personnes, une veuve et son fils célibataire, et un lointain cousin. J’ai visité le cimetière du village et leur tombeau familial est imposant, beaucoup moins que celui de l’ancien châtelain, mais tout de même. Les trois lotissements de la commune se sont implantés sur le démembrement des grands domaines de la commune qui compte maintenant plus de 3000 habitants. Il reste encore quelques vergers et des prés pour les chevaux en pension des urbains. L’aménagement du territoire, les luttes pour le refus des logements sociaux et des immeubles collectifs font les beaux jours du conseil municipal même si le vieillissement de la population et la fermeture des classes des écoles primaires publiques en inquiète certains. Bien peu car les écoles privées prolifèrent
Je n’en veux pas à Georges Perec d’avoir nié l’existence de la campagne dont il n’avait rien à dire. Et puis il m’a bien fait rire aux dépens des propriétaires de résidences secondaires ou des rêveurs d’installations champêtres. Mais il avait tort de sous-estimer la vie de nos campagnes qui ont bien changé depuis les années 1970. La littérature en témoigne encore trop mal, entre détestation des banlieues résidentielles et exaltations des chemins noirs. ça bouge, ça vit, ça meurt, ça vote, il faut l’inventer et le raconter.
J’aime bien vivre dans mon lotissement, dans ma maison qui a une longue histoire, ce qui ne me protègera pas de devoir la quitter un jour, comme les autres. Depuis le départ des enfants, nous l’avons partagée en appartements indépendants et louons ce que nous n’occupons pas ; une façon d’habiter comme dans les chroniques de San Francisco d’Armistead Maupin.
C’est une tombe. Une dalle parmi les dalles. Sauf que celle-ci porte ton nom. Des chiffres pour se repérer, éparpillés alentour, sur des pancartes, des cadrans, des plaques : allée 6, rangée 12, 9°, 11h23, 1849-1870, 1860-1901, 1911-1912, 1888-1915, 1890-1915, 1910-1942,… Une pierre d’un mètre sur deux, une croix presque aussi grande que toi. Du gravier rose et bleu (ne te mouche pas comme ça, on n’utilise qu’une main, ne sois pas vulgaire), les bottines vernies et pointues, le collant qui gratte, son odeur de lessive, laque et crème, le moineau qui sautille, picore, sautille, picore, sautille (ah là là, comme j’aurai froid là-dessous. Je le sens déjà, tu sais ? Dans les os… Tu me mettras mon châle, le mauve.) Ses mains fragiles sortent du manteau de fourrure et fouillent dans le sac en cuir (ah c’est moche de vieillir, je te le dis. Ne froisse pas ton front, ça te fera des rides). Elle prend deux bonbons et t’en offre un. Une femme passe en parlant étranger à un homme qui te regarde. Le caramel réchauffe et adoucit. La pierre, son grain, son gris, son usure aux coins, sa netteté de porte, pilier, pont. Elle y dépose les chrysanthèmes avec cette grimace de quand elle se penche. Tu fermes les yeux et elle fredonne (quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur…)
C’est une tombe. Une dalle parmi les dalles. Sauf que celle-ci porte ton nom. Un ange déploie ses ailes immenses et scintillantes à travers l’allée. Son corps mince et pâle s’efface presque au visage. Il s’élance les bras levés et les pieds joints, comme pour plonger dans le ciel, mais ses ailes le retiennent, prises aux branches noires et nues d’hiver qui portent des étoiles. Les chiffres : allée 6, rangée 12, 3°, 17h15,… 1935-2013. Les mêmes initiales que toi, tu n’y avais jamais pensé. Tu lui as mis son châle, comme promis. Le ciel a un bleu de velours. La ville clignote de guirlandes et de phares. Elle se vide, Noël approche et tu n’as pas de fleurs. Tu éclaires avec ton portable : Claude, Jeanne, Justine, Xavier, Henriette, André,… Elle. Le gravier n’a rien de rose et bleu. Un écureuil se faufile entre deux pots, s’arrête sous la croix, puis repart. Dans le noir il ne reste que les chuchotements des derniers visiteurs, le crissement de leurs pas qui s’éloignent. Le cimetière n’en est plus un. Ses masses se transforment et s’animent, comme les vêtements en tas sur la chaise qui se changeaient la nuit en sorcière crochue. Tu sursautes à une explosion lointaine qui te semble intérieure. Il te vient de fredonner : quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur…
Dix-sept heures, un jeudi, en automne.
Ciel gris-doux au-dessus du Palais-Royal. Sous les arcades, lentement, s’allument les suspensions électriques. Au long des promenades alternent les bruns tachés, les rouges matures, les jaunes vieillissants.
Galerie de Montpensier. Devant moi, un petit gabarit en bottes nerveuses et sac trop grand jette un coup d’œil à la vitrine Marc Jacobs. Puis reprend sa marche, rapide, sonore. Elle n’a pas, comme moi, pris le temps de détailler la robe étendue sur un long plateau de verre. Satin couleur ivoire pour le haut, souligné d’une large ceinture, en vinyle, un peu clinquante. Matière dense et noire, pour le bas, rehaussée de pois, de paillettes, surpiquée de motifs Art nouveau. Sur un bristol, discret, le prix de l’ensemble, écrit à la main.
Jardin du Palais-Royal. Un vendredi matin, en mars.
Le printemps badigeonne d’un vert tendre, lumineux, le bas des tilleuls. Retour du ciel laiteux, cependant. En frissonnent les jonquilles blanches et les tulipes rose bonbon.
Au numéro 34, devant chez Marc Jacobs. Sac mauve et chocolat, top en cuir couleur crème, col en V bordé de fine dentelle. Pour la jupe, je demande son avis au couple de quinquagénaires qui se penche avec moi sur la vitrine du couturier.
— Je dirais du plastique, des franges de plastique, propose l’homme un peu surpris par ma question, par ma désinvolture.
— De plastique teinté, précise madame, prise au jeu.
— C’est en fil de nylon, affirme une maman à son fils, sans nous regarder.
Pour sa couleur, je choisis marron glacé. Comme la peau de l’unique chaussure qui l’accompagne, sur talon haut.
mercredi 28 décembre 2016 – ici le monde ne fait pas beaucoup de bruit – 14H44 une voiture attend au feu rouge, la rue AB est vide (du nom de la rue du nom de la place du nom de la ville) – ici la place du Bon Coin ou place Paul Pain - Levé – du nom d’un ministre de l’air du nom d’un ministre de guerre du nom d’un mathématicien (consultation de l’ encyclopédie libre Wikipédia) – je marche du numéro 2 au numéro 10 – ici la rue Aristide Briand - je prends en photo chaque façade – façade lisse façade blanche façade avec briques façade de grès vosgien façade avec porte noire façade avec porte brune façade avec porte bleue – je plaque mon corps contre le muret du garage attenant au numéro 10, je lève la tête, j’ évalue la hauteur du muret – je voudrais comprendre, m’imaginer, voir, décomposer les mouvements de ce corps qui – monté sur le muret est parvenu sur le bord de la fenêtre et a – d’un coup – 14H50 un homme me regarde prendre une photo du magasin de produits lorrains, puis la laverie puis la pizzeria fermée puis la porte d’entrée du 10 dans sa façade gris passé - le soleil flanque sa lumière sur le sol – je vais de l’autre côté de la rue – là où le tailleur de costumes pour homme travaillait tard le soir – aujourd’hui la boutique vend des cadres sur mesure
Al Jezita Alameda Alameda de Obispo Alamedilla Alamo Alanis Albajedo Albaida Albaida del Aljarefe Albendin Alberite Albolote Albondon Albox – je me souviens de peu de choses - je recopie les noms des villes jusqu’à – Albox – j ’ai quitté la ville de Metz un matin je suis partie en stop - quelques mois après j’ habitais là – je sais d’où je viens pendant plusieurs mois je ne sais pas où je vais – je me suis précipitée d’une ville à une autre ville un matin – Albunol Alcaide Alcala Alcala de Guadaira Alcala de los Gazules Alcala del Valle Alcarazejos Alcaucin Alcaudete – je recopie des noms de ville après Albox – city Andalucia Spain – 1746 kilomètres et seize heures me séparent de – adieu au loin – la rue d’ Alban est un peu éloignée du centre de la ville, il y a des arbres, un café fait l’angle un café avec terrasse – on court souvent dans cette rue souvent la nuit la nuit tue l’assassine nocturne – sourd sud sourd sud rouge sourd sud rouge rage sourd sud rouge rage sombre sourd sud rouge rage sombre roule et tombe danse presque la peur dans les bras brûlés de la nuit sourd sud rouge sangle la marche sortent les songes la roue s’orne des morts dans les rues sans place où roulent et tombent dansent presque la peur dans les bras brûlés de la nuit aux cris aux cris déportés déplacés désarmés sourd sud rouge rage sombre rage et roulent et tombent sous l’orage sous l’ivresse de l’orage ordre et chaos silhouettes noires et tourbillonne trace traverse le cri sourd sud rouge rage et le visage renversé sous le feu flamme soleil – alchesirasas Alchezira Alcolea Alcontar Alcornocalejo Alcudia de Guadix Alcantara Aldeire Aldeilla Alfacar Alfaix Alfarnate Alfarnatejo Alfaiz
(Note : Le grès, ou Sandstein (pierre de sable, en Allemand) est un ancien sable soudé. Cette roche est composée de grains de quartz, de feldspath et de micas liés entre eux par un ciment siliceux, ce qui assure sa résistance et sa dureté. Proche de la composition des granites, on en déduit que les grès proviennent de l’érosion des roches granitiques.)
Couloir, porte numéro 33, côté impair, lundi 19 décembre, 8h30, l’appartement au rez-de-chaussée en face de l’ascenseur. Fenêtres côté jardin, couleur paille sous le plafonnier, les murs, les portes et puis les poignées. Comme dans un hôtel, le tapis devant chaque porte et puis le couloir encore qui fait un angle plus loin, tous là, dès le matin, à la sortie du parking. Bientôt Noël. Trouver à tâtons sa clé pour ouvrir la porte du bureau.
Couloir, porte numéro 33, côté impair, lundi 19 janvier, 8h30, après les fêtes de fin d’année. Derrière le couloir. La porte une fois refermée. Morceaux de mur, morceaux de cube, encore couleurs paille, aux volumes prédécoupés. A l’intérieur, sur la table, des lettres et du courrier accumulé, avec des écritures à faire, fragments de vie, en suspens depuis cette fin d’année où tout dort encore. Une carte de vœux, deux cartes de vœux, des vœux accumulés qui rejoignent les vœux de l’année dernière. Des chats, des sapins, des flocons qui tombent, parfois même des vierges à l’enfant. Des cartes effacées, retrouvées dans la poubelle de l’écran, avec des visages qui repassent devant les yeux et l’écran toujours qui observe et puis qui lit et se souvient des mains qui les ont écrites.
Couloir, porte numéro 31, côté impair, mardi 24 mars, 11heures 45, une dame dans l’appartement d’à côté. Ses cheveux sont blancs, son visage est fripé, son regard opaque. Elle a une baignoire faite douche avec sa chaise arrimée au mur. Dans le salon, des photos de famille. Le mari décédé. Et des enfants et des petits enfants. Tous au loin. Ou n’est-ce photos de vacances lointaines.
Couloir, porte numéro 31, côté impair, mercredi 24 avril, 11heures 45, A l’heure où passe le facteur, debout dans l’entrée, elle fait la conversation avec d’autres habitants de l’immeuble qui attendent eux aussi leur courrier. Convivialité bavardages. Restes, restes. La porte reste ouverte, l’air frais aussi dans le couloir toujours. Couloir paille. C’est le printemps. Giboulées. Et la pluie et le beau temps encore. Des lettres arrivent. Factures EDF, service des impôts et puis une carte postale mais de qui est-ce donc ? Des visages l’ont pensé et des mains l’ont écrite. C’est une chanson qui tourne en boucle. Paroles, paroles. Dans la radio. Toujours en sourdine.
Couloir, porte numéro 29, côté impair, mercredi 14 novembre, 7h29. Après la Toussaint et puis l’armistice. Que de morts en novembre. En arrivant du garage, une porte qui claque. C’est une dame tous les jours, qui verse un peu de lait, pour les chats qui passent dans le jardin. C’est une soucoupe sur le rebord de la fenêtre, à côté des géraniums aux pétales rouges, pourtant novembre déjà. Ce sont des présences si chaudes qui ne se laissent pas toujours approcher. Son fils est loin. Elle erre dans le jardin, Alzheimer à ses débuts que le gardien ramène parfois chez elle. Il est 16h.
Couloir, porte numéro 29, côté impair, mercredi 14 décembre, 7h 29. Une infirmière vient tous les matins, et au moment où elle franchit la porte, à 7h30 devient la persécutrice, à 7h35 ressort harassée, sa voiture est en warning devant l’immeuble, elle ne fait que passer tous les matins. Visites quotidiennes. Pouls, tension et puis médicaments. Dans les protestations de l’intéressée. Qui se sent encore agressée comme tous les jours. Tout l’agresse. Avec ce temps qui s’en va. Et qui emporte la mémoire. Cette fichue mémoire d’un présent immédiat qui rend pérenne le monde autour de soi. Qui êtes-vous donc ? Où sont les lunettes et puis les clés et puis le sac et puis les enfants et puis le chat noir et puis et puis.... et puis quoi encorvcore. Qu’est-ce que je cherchais déjà ?
Couloir, porte numéro 27, côté impair, jeudi 24 octobre, 17h. Des rires, des voix et de la musique. Ils viennent du T4. Ce sont des jeunes en colocation. Ils se font polis, ils rasent les murs quand ils croisent les vieux soit tous ceux qui ont au moins trente ans. Mais une fois la porte refermée, ils parlent fort, ils crient, ils font du bruit, ils jouent au ballon dans l’appartement. Dans un immeuble où l’on entend jusqu’au microonde du voisin.
Couloir, porte numéro 27, côté impair, jeudi 24 novembre, 21h. La rentrée est bien avancée. La porte s’est refermée. Couloir paille clair. C’est une drôle de musique qui sort de l’appartement. A 22h interdit que tout ça. Mais ce sont des basses continues encore. Rythme harcelant, résonant dans les murs. De phrases inutiles qui ne veulent rien dire et qui racontent le sang et puis les déjections et qui croient toucher au vrai, vrai de vrai, vréel peut-être. Mais le vrai ne se laisse pas attraper. Carpe vérité que rate l’appât du mensonge. En ses mots à la dérive. Dans un couloir aux portes numérotées. Côté impair. Casiers de la vie.
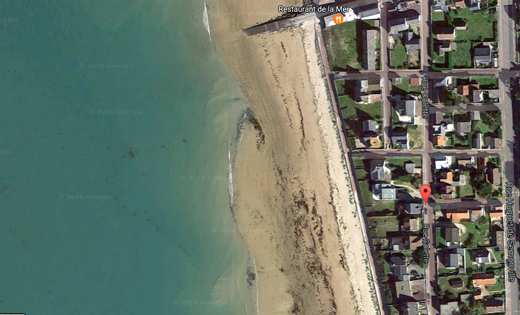
Rue Colette, 1 | été 1989
De la mer, pour rentrer, on monte un escalier en se tenant à une rampe en métal, l’été, elle brûle les mains. On rejoint en haut de l’escalier la rue maréchal Foch (plus petite que son nom pourrait le laisser croire, rue de la mer aurait été aussi bien) qu’on descend sur trente mètres (la rue était toujours à l’ombre, à cause des palissades en béton, de part et d’autre ; on y avait froid, le vent s’y engouffrait, faisait voler les serviettes que nous tenions d’une main ; la rue résonnait, le claquement de nos tongues était amplifié, on s’amusait à les faire claquer plus fort) et on arrive rue Colette, on prend à droite, on fait à nouveau trente mètres (ça sentait toujours le genêt quand on arrivait rue Colette). Sur notre gauche, on passe devant deux petites maisons (la dernière c’est la maison du percepteur ; je n’ai jamais connu son nom , c’est comme ça qu’ils disaient, tous) ; de l’autre côté de la rue Colette, à notre droite, ce sont les maisons de bord de mer, villas crèmes, barrières blanches, chemins gravillonnés, propres, neuves, bateaux posés sur le gazon, pas notre monde). Après la maison du percepteur, la rue Vauquelin, qui descend pour rejoindre en contrebas la rue Huguet de Semonville. A l’angle de la rue Vauquelin et de la rue Colette, il y a la maison, le Roof. Le trottoir devant la maison est défoncé, les trous dans le bitume sont remplis de sable. . Un muret bas en béton gris entoure le petit terrain sur trois côtés, la maison étant mitoyenne par l’arrière, côté rue Vauquelin (on s’écorchait les cuisses sur le muret quand on s’asseyait dessus). Aucune haie n’avait été plantée pour nous protéger des regards. Le terrain d’une cinquantaine de mètres carrés est couvert de sable, parsemé de quelques rares plantes aux fleurs jaunes et de quelques oyats. (l’été, quand on arrivait, il fallait nettoyer les déchets qui avaient été jetés ou ramenés ici par le vent : papier toilette, paquets de cigarettes, bouteilles de bière, emballages d’esquimaux, crottes de chiens, cotons tiges etc.). Devant la maison, une dalle en béton. Il n’y a pas de portail pour entrer, juste une ouverture dans le muret. Le sable du terrain était sale, foncé, plus foncé que celui de la plage ; on s’installait rarement dehors car alors les passants, les voisins étaient au spectacle ; on y faisait juste sécher les serviettes de plage, à l’odeur âcre, sur des chaises en plastique). La maison de forme carrée est de plain pied, petite, crépis blanc cassé, quelques trainées noires, porte fenêtre à deux battants , quatre vantaux au centre de la façade faisant face à l’entrée, rue Colette. Deux larges marches, en béton gris, encore, devant la porte fenêtre. Des volets blancs dont la peinture s’écaille. Sur le mur de la façade, une petite pancarte blanche, "Le Roof" peintes en lettres noires, caractères d’imprimerie, écriture inclinée remontant vers la droite. Un toit de tuile oranges. Sur le coté gauche qui donne sur la rue Vauquelin, il y a une porte blanche par laquelle on ne passait jamais, qui devait être, un jour, la vraie porte d’entrée de la maison. Au dessus, une petit auvent en béton.On passait toujours par la porte-fenêtre. Sur le côté droit, un appentis en dur, attenant à la maison dont la porte en bois, gonflée d’humidité, s’ouvrait difficilement (on y stockait les filets de pêche, les hottes en plastique, ça sentait le moisi). En face, la maison des Espagnols, un pavillon moche. Et à côté des Espagnols, c’était la maison du veuf. Je n’ai jamais connu leur nom aux Espagnols, ni au Veuf. C’est comme ça qu’ils disaient, tous. Du côté droit, dans la rue Colette, qui finit en cul se sac, un petit chemin sépare la maison d’une grande maison surélevée, la maison des Legoubey (ils étaient tous roux, les parents tenaient le Bazar de la plage). J’observe tout, je veux pouvoir me souvenir. Je sais qu’on ne reviendra pas. Ma tante, dans la maison, nous voit arriver, elle vient à notre rencontre.
Rue Colette, 2 | samedi 11 juillet 2015
Sur la digue, je cherche quel escalier prendre, il y en a plusieurs à quelques mètres d’intervalle, si je le rate, je vais aller trop loin. Je le trouve, il est raide, dur à monter, il faut vraiment s’aider de la rampe. Rue du maréchal Foch, les palissades en béton sont toujours là, même pas repeintes, toujours ce même gris mais les maisons, elles, sont en travaux, des tas de sables dans les jardins, des tubes en plastiques sortent de partout, les anciennes maisons ont été rasées ou tellement refaites que méconnaissables. Rue Colette, la maison du percepteur a été recouverte de clins de bois peints en vert d’eau, la barrière blanche en PVC est toute neuve. Je ne sens pas l’odeur du genêt dans la rue, je voulais en couper une petite branche pour pouvoir continuer à respirer l’odeur. Je ne reconnais pas le feuillage du genêt, je respire chaque haie pour tenter de le reconnaître. . Je m’attends à voir arriver les trois filles rousses des Legoubey. La rue Colette est déserte. Pas de gamins jouant au Jokary, très calme pour un samedi de juillet. J’arrive à l’intersection de la rue Collette et de la rue Vauquelin, je suis devant le Roof. Il y a quelqu’un, un homme, dans le jardin qui fait des travaux avec un outil qui fait du bruit (un lapidaire, une scie sauteuse, je n’y connais rien, je ne sais pas). Sur la rue Vauquelin, le muret en béton gris est toujours en place ; sur la rue Collette, il y a un nouveau mur en parpaings gris qui est en train d’être monté, plus haut et qui se poursuit sur le côté droit. Il y aura aussi un portail. Sur le terrain, dans un angle, un tuya a poussé. Il n’y a quasiment plus de sable, mais un gazon fatigué ; il n’y a plus ni fleurs jaunes d’or ni oyats. Devant la porte fenêtre, une dalle en bois recouvre l’ancienne dalle de béton. Un store en PVC blanc est descendu sur la porte -fenêtre. Je n’ose pas aller plus loin pour regarder le côté droit de la maison, je ne veux pas croiser le regard de l’homme, encore moins lui parler. La maison a gardé son crépis blanc cassé, mais toutes les fenêtres sont encadrées de liserés de peinture bleue. La porte côté rue Vauquelin est peinte en bleue. Le haut de la façade, sous les toits, a été recouvert de bardage de bois. Dans le toit orange, ont été installés des Vélux : deux de chaque côté. Sur la façade, plus de pancarte, plus de nom.

Tôt le matin, ce passage que l’on appelle ici La Voute n’est pas directement éclairé par le soleil.
La Voute est de pierres dorées, anciennes et inégales. Dans l’épaisseur du mur a été creusée une niche portant, entre deux étoiles, un monogramme en fer forgé rendu illisible par sa complexité ,et, au-dessus, une statue de la Vierge encadrée de délicats pilastres ioniques - le visage à l’ovale parfait est très légèrement penché sur le côté et les deux bras sont ouverts dans un geste d’accueil vers celui qui s’engagerait sous ses jolis pieds - invisibles.
Sur l’un des murs, juste à la sortie de la Voute, quelqu’un a écrit
Mexique, invité d’honneur du 14 Juillet, 43 étudiants DISPARUS
On retrouve le début de la même inscription quelques mètres plus loin, mais incomplète.
La rue qui suit ce couloir était autrefois un cloitre mais aujourd’hui, l’alignement des poubelles, même vidées et rangées à l’arrière des cuisines du restaurant « La Voute - Chez L », accentue l’impression d’arrière-cour toujours nauséabonde, odeur souvent relayée par celle des égouts qui s’échappe, les jours de vent du sud, de la grille tordue sous le passage.
Le boyau assez court est en biais, rétréci à mi-hauteur par une sorte de muret de pierres plus larges. C’est là que, après le coup de feu de midi, parmi les odeurs de sauce Nantua, de viande et poisson grillés et de friture, les cuisiniers ou les serveurs s’assoient à tour de rôle pour fumer et reposer leurs jambes. On entend derrière eux, amplifiées par le goulet, les voix tonner depuis la cuisine, parfois couvertes par les chocs d’ustensiles métalliques.
Face à la voute, le jardin rectangulaire, semé de massifs aux plantes recherchées, à la fois sauvages mais bien coiffées, avec une grande vasque en terre cuite bleu en son centre, est cerné de grilles sur tous ses cotés, sans aucun accès - simple transition, respiration ménagée dans le tissu urbain – mais pour la vue seulement.
Ce lieu est un théâtre où l’on peut croiser toute sorte de gens comme cette jeune fille que l’on aperçoit, adossée au mur, l’un de ses pieds est replié contre la paroi de la courte allée et ses lèvres mâchouillent un chewing gum de mots collants
Unepetitepiècepourm’aidersiouplait ?
C’est ce qu’elle murmure à chaque passant, mais si doucement que personne ne l’entend. Sa nuque est offerte aux bourrasques de vent parfois violentes qui, en toutes saisons, soufflent en tournant autour de la place et sous la voute.
L’hiver, des gifles d’aiguilles, minuscules et précises, s’insinuent à travers les tissus les plus épais et trouvent toujours un coin de peau tendre à piquer.
L’été, le même vent, mais brulant, vient bâillonner le promeneur en le suffoquant.
Ou bien ce groupe derrière lequel on s’engouffre, à la suite de leurs dos réunis - mur mobile frotté puis engagé de force sans qu’aucun ne cède - ils laissent des mégots encore allumés, jetés d’un geste bref et étudié, de leurs deux doigts pouce index réunis en rond, zéro propulsant comme on crache, et des paquets de gâteaux vides, des miettes, dans le sillage de leurs paroles d’adolescents, des mots qu’ils n’ont pas encore usés mais déjà salis comme leurs chaussures de marque et leurs jets de salive giclent en étoiles mortes contre le mur du passage.
Le soir, bien après l’heure à laquelle une ou deux femmes - d’un âge qualifié de mûr et que l’on sait attendant leurs clients - s’encadrent discrètement dans l’embrasure des portes d’allées ; aux sorties du théâtre de la place des C, une foule plus ou moins dense et bavarde s’éparpille par petits groupes pressés de plus en plus silencieux à mesure de l’avancée dans ces rues sombres où rien n’invite à la flânerie mais qui permettent aux habitants du quartier d’A un gain de temps considérable par rapport à l’itinéraire habituel empruntant la rue Z et traversant la trop large place à statue équestre.
Dans les cuisines de Chez L il y a encore de la lumière et les mêmes odeurs que le matin.
Sous l’éclairage – un simple tube néon fixé sur le mur - La Voute semble alors devenue une pièce minuscule au plafond bas. Après le passage, comme on prendrait une bouffée d’oxygène ou comme s’ouvrirait une large fenêtre dans cette petite chambre, on découvre la colline toute illuminée contre le ciel nocturne. Et c’est avec un certain soulagement - comme à la sortie d’une épreuve - qu’on laisse filer le regard vers le galbe de pierres blanches du pont B, le chevet éclairé de la cathédrale et la haute colonnade claire du palais de justice sur la droite, couronnés par la basilique de F.
Il y a le même flot de voitures venant de la place et deux ou trois véhicules sont toujours arrêtés moteurs tournant en face du Tabac ouvert jour et nuit.
Un hôtel particulier a été construit ici, il y a très longtemps. On voit encore son portail à deux colonnes et la cour qui a accueilli les plus belles réceptions de la ville. Transformé en Hôtel de voyageurs après la ruine du propriétaire, il accueillera Bonaparte, Joseph II, Alphonse XIII, souverains de passage dans la ville.
On murmure que d’importantes fortunes locales viendraient discrètement en ces lieux déposer leur argent au comptoir d’une très discrète banque suisse.
Lorsque sa compagne raconte le travail de Georges Pérec, lorsqu’elle décrit son entreprise d’exploration minutieuse des lieux, lorsqu’elle explique qu’il est retourné plusieurs fois rue Vilin, elle précise en passant dans le petit documentaire vidéo, que les souvenirs ne lui sont pas pour autant revenus. Je l’entends presque ajouter intérieurement « bien sûr … » ou peut-être même l’affirme – t’elle. Alors je me redis que l’écrivain a malgré tout tenté « d’épuiser » les lieux - les fatiguer inlassablement comme le vieux pêcheur et son espadon. Leur faire rendre gorge. Qu’ils exposent et célèbrent. Qu’ils nous délivrent enfin de leur malédiction souveraine de décor invisible. Emerger enfin à travers eux comme on se dissiperait d’anesthésie – étonné soudain d’être là.
Elle avait vu sa plus jeune sœur morte et défigurée – momifiée de maigreur et de douleur, le masque tordu du visage tuméfié de deux pommettes saillantes et des trous à la place des joues, et des trous à la place des yeux, enfoncés loin ; alors elle n’avait plus su dormir pendant de nombreuses nuits. Avec ses yeux à elle, qu’ils soient ouverts ou clos, elle la revoyait. Et lorsqu’à mon père on a également noué ses mains blafardes et tavelées sur la poitrine - elle a largué peu à peu d’autres amarres, elle est partie tout doucement à la dérive dans sa maison fantôme. Un jour elle a dit depuis l’intérieur d’un infini déchirement – écartelée contre la béance qui s’ouvrait au-devant d’elle, arc-boutée à l’orée du gouffre jusqu’à la nausée … mais si, enfin, c’est sûr, je peux bien rester à la maison, je me mettrai au lit comme ça il m’arrivera rien. Et cette horreur, cette panique de noyée ça me flanque toujours un reflux de nausée ; une odeur d’éther qui retourne l’estomac, ça aussi, elle le répétait souvent, elle le disait depuis très longtemps.
Dehors aujourd’hui il fait gris. C’est de saison. Un immense crachat entre blême et bientôt noir, empaqueté de voiles humides enroulées autour des lampadaires de l’allée, une haleine chargée de brouillard, de la poisse tombant des arbres luisants et maigres – un calque glacé à courber le dos – rentrer la tête dans les épaules (un bandeau gelé au front, une poigne glacée aux tempes) – resserrer frileusement les pans du manteau - presser le pas jusqu’au sas d’entrée. Les deux jeux de doubles portes vitrées coulissantes à ouverture automatique, leur froissement bref suivi peu après le passage du petit clac de fermeture. Sous les pas les grands carreaux gris de l’entrée, passer devant les bureaux à droite : « secrétariat – comptabilité - accueil », c’est placardé sur les portes - juste avant cette sorte de meuble malingre sur lequel repose le calendrier perpétuel à photos d’animaux ; à gauche les large baies vitrées, ouvertes sur l’immense salle-à-manger aux tables rondes - dispersées comme les pions d’une partie de dame entamée puis abandonnée. Juste après le sas - à gauche - le salon d’accueil – épaisse table basse en bois massif, revues, fauteuils profonds, parfois des qui feuillettent (familles, visiteurs) - une dodelineuse engoncée dans son fauteuil roulant ; deux mains au repos sur le pommeau de la canne coincée entre les jambes d’une autre. L’aquarium bleuâtre, ses fonds sablonneux – ses prétentions d’algues vertes et dentelées - ses reliefs sous-marins en plastique sous l’éclairage fluo, les poissons brefs et lumineux (tetras néons, poissons arc-en ciel, Guppys rouges, Ramirezi bleus électrique) et plus loin, toujours là-bas dans la pénombre et de profil, assis raide sur une chaise, avant que le couloir ne file d’un côté en angle droit vers l’aile ramifiée de chambres, de l’autre vers la chapelle austère et au-dessus, la chambre funéraire (ou l’inverse), cet homme noir aux cheveux crépus coupés très ras, improbable cerbère, la cinquantaine, qui ne répond à notre bonjour que par des grognements gutturaux et de brefs hochements de tête, tout en écarquillant les yeux autant qu’il le peut pour bien nous l’assurer : lui aussi il salue. Se dévide alors le fil d’Ariane d’une poursuite de couloirs anciens resserrés en maigres corridors. (A cet instant, comme en tous ces lieux d’ombre et de mélancolie, je pense étrangement à de multiples et successives mains fines et grises allongées de candélabres. Leurs lucioles fébriles captivent le regard de la Belle, guident son avancée solennelle et effarouchée dans le hall obscur et mystérieux du château, l’aspirent irrésistiblement dans leur houle sûre et lente, suivant une immémoriale trajectoire, un flux aquatique et sévère d’avant-bras surgis dénudés des murs ; à leurs extrémités ondulatoires les bouquets rigoureusement identiques de bougies tremblotantes, comme les feux à éclipses des naufrageurs derrière les giclées d’embruns – au devant d’elle le couloir se déploie morceau après morceau puis derrière elle se replient sans bruit ses tentures d’ombres épaisses – elle le devine, le sent, mais l‘ignore encore. Volontairement ? )
Juste après l’ouverture des portes de l’ascenseur (doublure de la voix métallique et hachée de l’annonce enregistrée : Premier-Sous-Sol) je traverserai la salle commune jaune citron, (ses tables rondes et beiges, les chaises simples à l’assise et au dossier rembourrés couleur ocre, les fauteuils oranges et lavables, toujours comblés de corps immobiles) - après le bureau infirmier vitré, je tournerai à gauche dans le couloir. (A l’exact opposé de la salle télé, toujours allumée la télé - et autour depuis toujours aussi des vieux et des vieilles que nous serons - on fera pas mieux que les autres, hein, on n’est pas plus malins ! - échoués dans le flux des images et des sons placardés.) Je continuerai, jusqu’à la troisième porte, à main gauche, toujours fermée, sauf si, par hasard, un chariot métallique chargé de draps ou de linge venait signaler la présence de soignants. En quelque sorte celle-là vient très précisément ajouter son alignement à d’autres identiques, aux panneaux également indécis entre le bleu très pâle et le gris clair, dressées à intervalles réguliers, des deux côtés de ce couloir blême, avec son sol de saignée en lino couleur brique et tout au-dessus, parce que c’est de saison, les guirlandes touffues et argentées accrochées et suspendues aux dalles perforées du plafond. Tout le long du corridor une rampe en bois, au-dessous, plus discrètes, de longues plinthes également en bois, en rangées parallèles, protégeant le quart inférieur du mur des roues des fauteuils roulants et autres chariots et lève-malades. Tout à l’extrémité de ce couloir une fenêtre petite et carrée encadre son tableau de nature morne : sur la colline en face les vignes décharnées et tordues, silhouettes estompées dans le brouillard loin derrière la haute haie de thuyas. De temps en temps un cri ou un appel répété, une litanie que personne n’écoute. Maman. Maman. Un bruit de fond. Des ombres en marche.
Au milieu de la porte, à hauteur de regard, je verrai ton visage sur la grande photographie insérée dans son cadre plastique vert-foncé. Les lettres découpées dans le vert, comme à l’emporte-pièce, indiquent : allée des JONQUILLES, en capitales les jonquilles. Puis le nom en grosses lettres noires : Mme D…… Studio 3107. Le prénom je n’en lirai que la moitié … tte. La première partie est ensevelie sous la photo, ton visage large apparaît en gros plan, entouré d’un nuage vaporeux de fils blancs (mais je sais tes cheveux si fins – clairsemés – la peau visible au travers). Derrière les grosses lunettes ovales à monture plastique translucide, on dirait que tu me regardes « par en-dessous », je ne sais pas dire si tes lèvres serrées frémissent dans l’attente d’un sourire ou se méfient. Je ne saurai pas.
Aujourd’hui tu dis : j’ai plusieurs maisons, c’est bizarre, elles sont toutes pareilles. Il y a les mêmes choses dedans. Tu me montreras les tableaux, la table surchargée, les étagères couvertes de dessins superposés, emboîtés, empilés. Les oiseaux coloriés - tu ne sais plus avec quel fils ni quel mari - éparpillés en volière sur les murs, plantés au sommet de l’armoire, dressés sur la table, coincés contre l’étagère, le tout rouge à aigrette qui vient du nord, le tout bleu qui a un drôle de regard, la cigogne dont tu oublies toujours le nom et le macareux pareil, la girafe, la chèvre, la vache et son veau, le chat, l’éléphant au-dessus de l’étroit lit médicalisé métallique, couleur crème, poussé contre le mur jaune vif – sa barrière repliable – toute cette ménagerie te met en joie et tes yeux brillent « j’aime les regarder, j’aime ça. »
Moi, c’est toujours dans « le petit salon » - minuscule - que je te revois, parfois assise dans un fauteuil d’osier cannelé puis en est arrivé un nouveau, bien plus imposant et confortable, avec le nouveau mobilier : un divan trois places coincé sous la bibliothèque fabriquée sur mesure pour l’occasion, les deux fauteuils, l’ensemble en faux cuir marron sombre, boutonné, avec des plis serrés en étoile sous les boutons et en tirant, dessous, une pellicule de poussière, un peu chatouilleuse au doigt ; fauteuil recouvert ensuite d’une petite protection en crochet sur l’appui-tête, et d’une couverture style patchwork en tricot pour l’assise, dont je crois qu’elle se terminait en égrenant des pompons minuscules mais peut-être juste une frange épaisse. Une fois, dans l’interstice des coussins entre le dossier et l’assise, une pièce jaune.) Moquette bleue, très foncée, panier du chien, en boule hirsute et poils devant les yeux, bien sûr Pilou, table basse ronde, plateau noir en verre et plus de place pour rien. C’est vieux, c’est à contre-jour, la lumière m’éblouit depuis la porte vitrée un peu à gauche et au fond : l’accès au jardin ; je te devine en ombre chinoise, vue de trois quart - arrière, un gros livre sur les genoux, ou bien tournant les pages d’un magazine (Mon jardin et ma maison – femme actuelle), tiré du porte-revue en V parcouru en longueur d’une anse, également en osier, ou bien c’est un tricot qui occupe tes mains et t’absente en cliquetant. Une forme de moue concentrée crispe tes lèvres – comme une rancœur – un écoeurement presque on dirait – visible seulement quand je change de place.
On sortira tout à l’heure – je refermerai derrière nous la porte et verrai pour la première fois à son sommet, pour décorations de Noël, ces dessins affichés, un de chaque côté : à gauche le bâton de sucre d’orge et son nœud de ruban, en face la botte zébrée de couleurs en zigzag.
Alors on ira lentement s’installer dans la grande salle à manger à l’étage vers l’entrée – comme dans les tasses et soucoupes de ces manèges pour gosses – et tourne - pour le repas du jour de l’an, après toute une déambulation à l’envers, à rebours de ce labyrinthe de lino rouge ou jaune, de murs jaunes et gris pâles, d’ascenseur - de parois rayées de rampes en bois, de couloirs occultés de doubles-portes coupe-feu et leur petit digicode métallique à touches rigoureusement alignées, carapaces de tatou miniature collées sur la paroi. Depuis ta chambre 3107 baptisée studio on ira - mais tu diras - comme chaque fois - que tu as peur de te perdre, alors on te prendra la main, ou le bras, ça dépend, parfois si tu es trop effrayée tu riras pour faire diversion ou juste une manière de bruit, pour dissiper un peu d’angoisse, te-nous faire semblant.
Oui on sortira tout à l’heure – je refermerai derrière nous la porte et verrai pour la première fois à son sommet, pour décorations de Noël, ces dessins : le bâton de sucre d’orge et son nœud de ruban, la botte zébrée de couleurs en zigzag. C’est de saison.
La rue remonte du centre bourg et passe devant la barrière verte du jardin. Ce n’est pas tout à fait vrai, elle descend avant de remonter. Mais ça n’a pas d’importance, c’est juste pour ne pas aller directement à l’essentiel. La barrière verte avec sa poignée horizontale. Tout à côté, le lierre envahit les gonds, ce qui n’empêche pas la porte de s’ouvrir. Mais elle reste fermée quand même, le temps de l’observation. Elle est coincée entre la cabane à bois à sa droite, vide, et le muret de la partie du jardin en surplomb. La charnière du bas est plus rouillée que celle du haut. La poignée horizontale donne l’impression de ne servir à rien. Il suffit de la tourner de quelques millimètres pour que la porte s’ouvre, mais pas maintenant. La peinture semble est d’origine tant elle est bousculée. Il y a des tâches de vieillesse, blanches et vertes. Vieillesse vieillissante, elles s’agglutinent là depuis des années, une bonne quarantaine, je dirais.
Derrière le portail que j’appelle barrière ou porte de manière indifférenciée (mais j’ai tort car aucun ne ces termes n’est équivalent), la pente remonte légèrement pour atteindre le niveau du potager. Elle est très courte, constituée des brisures d’une plaque de ciment (je n’ose pas l’appeler dalle) dont certaines se sont émergent tandis que d’autres plongent sous la terre. Enfin, tout ça de manière très modérée. Entre elles, la terre surnage. Et sur la terre, pousse de la mousse et d’autres petites herbes.
Je ne trouve pas les petites fleurs violettes sur la photographie. Peut-être qu’elles n’y étaient déjà plus quand je l’ai prise. Maintenant que la maison a été vendue, je ne sais pas si j’oserais y retourner. Ce serait quand même une bonne chose pour la proposition d’atelier d’hiver n°3. Et pour moi. Surtout pour moi, en fait. Pour les autres, ça ne fait pas grande différence.
Tout ceci paraît vide. Depuis août 2016, plus personne n’habite là, mais le monde autour de la barrière est mort dix ans avant. Au moins. Le problème de la photographie, c’est qu’elle ne montre que les feuilles envahissantes du lierre. Comme sur le reste des images, c’est la verdure éblouissante qui frappe.
Je focalise sur le lierre. Il occupe au maximum un cinquième de l’image. Je ne m’attarde pas sur le muret de pierre à gauche qu’on devine à peine, ni sur le mur de la cabane à bois, dont les planches bleues (mais je pense qu’’en réalité elles sont blanches) ont été recouvertes d’une pellicule noire et verte par endroits.
J’ouvre le portail (il y a une photographie qui montre le portail ouvert), je traverse et je me retourne. Bien sûr, la perspective révèle. J’ai des réponses à mes questions, même celles que je ne m’étais pas posées.
On ne voit plus le lierre, mais on ne voit pas non plus les petites fleurs violettes. Mais elles sont contenues par (pas dans) l’image, beaucoup plus que sur l’autre photographie. Le mur de la cabane à bois, à gauche, est un ensemble de trois séries de planches du même matériau. La première est noire, la seconde bleue (blanche) et la troisième marron. Entre les deux premières séries, les couleurs s’entrecroisent. Les noires sont tâchées de blanc (sec) et les bleues (blanches) tâchées de noir dilué. La dernière est une anomalie (elle doit avoir une valeur symbolique mais je n’ai pas envie de savoir).
Les plantes vertes sont envahissantes mais discrètes. Il y a un pot vert de plantes rouges. C’est la première fois que je le remarque. Pour me consoler, il y a des reflets violets sur la couche de ciment qui recouvre le muret à ma droite. Des reflets que j’invente, encore une fois c’est la faute de la photographie et, peut-être, au fait que mes lunettes sont posées sur le bureau et que j’ai laissée l’image dans un cadre minuscule sur l’écran de mon ordinateur. Ce jardin, ce portail c’est ce cadre minuscule dans mon cerveau, ce mausolée qui ne rend aucun souvenir. En attendant, le lieu est bien vivant. Une vie qui ne me concerne pas.
Dans quelques mois, quelques semaines, quelques jours, il sera envahi de coups de débroussailleuse et de faucilles qui montreront à quel point ce jardin qui paraît si petit a été si grand. Le portail sera matraqué par le pinceau sauvage des nouveaux propriétaires. Peut-être même le peindront-ils du violet qui manque à la l’image qui me sert de support. Ou en bleu. Et s’ils le changeaient ? Un portail en fer forgé, noir. Une allée bétonnée, avec de longues marches de quelques centimètres à peine de hauteur. Et la cabane en bois, rasée, puis remplacée par une autre cabane en bois. Le portillon sera plus grand que le vieux car il faut pouvoir faire monter le tracteur tondeuse. Le motoculteur passait, lui. Pourquoi vont-ils planter de la pelouse, juste au-delà du muret, là où le long des branches plantées en terre poussaient des petits pois sucrés ?
Ça fait longtemps qu’il n’y a plus de fantômes en ces lieux. C’est sûrement ça, le privilège de la vieillesse, libérer les lieux de soi, les laisser à ceux qui viendront, des lieux déchargés de l’emprise de la mémoire, redevenus neutres, objectifs.
La musique rythmée des sabots. Un jour, j’étais dans une chaussure immense.
Je ne me souviens pas m’être réveillé mais de m’être confondu avec un écureuil.
Une allée. Juste après le portail. Une allée contourne la grosse bâtisse. Elle dessine au sol un rectangle.
Sur une longueur - pas celle que l’on aperçoit de la petite route escarpée, pas celle de l’entrée principale - sur cette longueur, à l’arrière, ce qui frappe d’abord, c’est le parc.
Un grand terrain pentu et boisé. Arbres immenses. Ombres et lumières virent selon l’heure du jour. Un peu plus loin, les montagnes. Et le ciel.
L’air est plus chaud que dans la vallée. Il fait toujours ici quelques degrés de plus.
Juste au bord de l’allée, devant le parc, il y a un parking. Avec des lignes blanches. Une quinzaine. Peintes récemment.
Chacun trouvait jusque là une place au hasard. Maintenant un petit panneau indique un emplacement réservé aux familles. Personne d’autre ne s’y gare. Si aucune famille ne vient, cet endroit nommé reste vide.
Les voitures trouvent à se loger souplement. Se garer sous un arbre pour la fraîcheur est tentant. Mais il y a le risque d’un dépôt de résine sur le capot.
Sur ce parking, pas de place spécifique marquée pour le médecin. Pas de petit panneau. Rare.
Sur la droite de l’allée, une grande façade blanche. Le soleil vient l’éclairer dés le lever du jour.
Au rez de chaussée, quatre fenêtres. Ce sont des bureaux. Volets ouverts ou fermés selon l’emploi du temps de quelques uns.
Au milieu de la façade, toujours à droite de l’allée, trois marches, un perron et une porte. C’est l’entrée de ceux qui vivent ici plusieurs mois. Et celle de ceux qui travaillent là. Marches montées et descendues. Porte poussée dans un sens et dans l’autre. Maintes fois.
Un hurlement. Parfois. Coupant l’air au fond du parc. Ou à l’étage - ça ne glace plus le sang, mais ça touche. Bien sur. Ça touche toujours le cœur-
Après cette porte, deux fenêtres et une terrasse. Une table et des chaises. Un auvent en tissu.
On lève la tête, encore deux étages, 8 fois 2 fenêtres. Semi bloquées. L’une reste allumée toute la nuit. C’est l’infirmerie. Puis le toit. Gris.
Fleurs au pied du mur. Bordure colorée suit les saisons. Fleurs parfois violemment arrachées. Replantées. L’hiver, pas de fleurs. La terre seulement.
Sur l’allée, sur ce segment qui longe la grosse bâtisse, à l’arrière, il y a des feuilles, des gravillons, des branches remués par le vent et des bruits souterrains, conversations et pas de ceux qui sortent, de ceux qui reviennent.
Une allée. Juste après le portail. Une allée contourne la grosse bâtisse. Elle dessine au sol un rectangle.
Sur une longueur - pas celle que l’on aperçoit de la petite route escarpée, pas celle de l’entrée principale - sur cette longueur, à l’arrière, ce qui frappe d’abord, c’est le parc.
Un grand terrain pentu et boisé. Arbres immenses. Ombres et lumières virent selon l’heure du jour. Un peu plus loin, les montagnes. Et le ciel.
L’air est plus chaud que dans la vallée. On s’en étonne. C’est toujours ainsi. Il fait toujours ici quelques degrés de plus.
Juste au bord de l’allée, devant le parc, il y a un parking. Avec des lignes blanches. Une quinzaine. Peintes récemment.
Les voitures trouvent à se loger souplement. Se garer sous un arbre pour la fraîcheur est tentant. Mais il y a le risque d’un dépôt de résine sur le capot.
Un hurlement. Parfois. Qui coupe l’air. Ça touche toujours le cœur.
Sur la droite de l’allée, une grande façade blanche. Le soleil vient l’éclairer dés le lever du jour. .
Au rez de chaussée, il y a d’abord quatre fenêtres. Ce sont des bureaux.
Des fleurs au pied du mur. Bordure colorée suit les saisons. Fleurs parfois violemment arrachées. Replantées. L’hiver, pas de fleurs. La terre seulement.
Au milieu de la façade, toujours à droite de l’allée, trois marches, un perron et une porte.
Sur ces marches, tôt le matin, deux ou trois silhouettes accroupies fument. Face au ciel aveugle. On les salue doucement. Leurs têtes s’inclinent dans un chuchotement.
On pousse la porte. La porte d’entrée. Celle de ceux qui vivent ici plusieurs mois. Et celle de ceux qui travaillent là.
Sur l’allée, sur ce segment qui longe la grosse bâtisse, à l’arrière, il y a des feuilles, des gravillons, des branches remués par le vent et des bruits souterrains.
A l’extrémité de la rue des H, côté impair : deux maisons séparées par une cour étroite. La première donne en réalité sur la place du Commerce et ne comporte aucune ouverture sur la rue des H, façade aveugle couverte d’un crépi dont l’émiettement permet de voir dans la partie basse les pierres qui constituent le mur.
Le crépi est particulièrement abîmé en bas du mur, à partir d’1m50 environ au dessus du sol (des marques horizontales proches de cette hauteur laissent à penser que l’émiettement est dû au frottement répété de véhicules trop gros dans cette rue étroite).
Dans la partie droite du mur, un peu au dessus de la hauteur du regard, il y a les traces rouges et blanches presque effacées d’une ancienne publicité peinte (à peine visible sur ce qui reste de crépi). Un câble électrique court depuis le sol dans une gaine puis à nu le long du mur jusqu’à un support fixé sur la façade, et de là-haut partent des fils qui passent au dessus de la courette et viennent rejoindre un poteau en béton situé contre la maison suivante.
Une femme sort de la courette avec un chien et s’éloigne. Plusieurs portes et fenêtre donnent sur cette cour bien plus longue que large, un peu d’herbe y pousse, les façades sont d’un blanc sale.
La maison suivante est le numéro 1 de cette rue. On n’y voit pas de porte mais une haute fenêtre à une vingtaine de centimètres du sol (peut-être peut-on la traverser comme une porte si le sol à l’intérieur n’est pas plus bas que la rue). Cette fenêtre est fermée par un lourd volet blanc. La façade (où les pierres sont partout apparentes) se prolonge à droite par ce qui semble être un appentis, à gauche par un muret de pierre comprenant une porte dont l’huisserie est en plastique. En haut à droite de cette porte figure le chiffre 1 en blanc sur fond sombre.
Le bâtiment comprend deux étages en plus du rez-de-chaussée, à chaque étage une fenêtre fermée par des volets blancs.
Au début de la rue des H, côté impair. La façade du bâtiment d’angle donnant sur la place du Commerce est étroite, celle qui donne sur la rue des H est longue, large et massive. Absence de porte. Teinte rouge sombre (lichen, algue ou champignon) et balafres sur l’enduit. Les pierres se détachent très visibles (comme taillées dans le mur) dans la partie basse où l’enduit est parti.
La courette qui sépare ce bâtiment de la maison suivante est profonde et bien entretenue. Deux poubelles à l’entrée, des plantes vertes à côté des portes (surtout au fond). Un panneau “impasse privée des Hortensias”. Sur l’une des maisons de gauche une lampe “à l’ancienne” (lanterne à plusieurs facettes), fixée au dessus d’une porte par un support qui l’éloigne du mur. Le niveau de la cour est une cinquantaine de centimètres en dessous du niveau de la rue. Aucun fil électrique visible (le vieux poteau en béton armé a été enlevé, les fils enterrés).
Du côté gauche de la cour, il y a un vieil appentis accolé à la maison donnant sur la cour et sur la rue des H. Il est en partie couvert de peinture blanche, son toit est bas, un velux au milieu. Côté rue des H, le mur de l’appentis est un fouilli de pierres, de peinture, d’enduit. Une grande gouttière blanche le sépare de la maison elle même où la pierre est partout apparente (un ravalement a été fait il y a une dizaine d’années peut-être pour enlever l’enduit).
Trois fenêtres sur cette façade, les deux du haut ne sont pas dans l’alignement de celle du bas (la fenêtre du bas, très près du sol, est probablement une ancienne porte transformée en fenêtre lors du ravalement). Les volets sont de plastique blanc.
A gauche de la maison un mur de pierre avec une porte, en haut à droite de la porte, le chiffre 1 et une petite peinture sur ardoise représentant un bateau aux voiles rouges sur une mer verte (au dessus du bateau, à gauche : le chiffre 1 ; à droite : une mouette).
Date : 02/01/2017
Méthode : relevé de souvenirs
Période : de 1987 à 1994
Rue : Chemin du Canet
Carte : mentale
Après l’école, je rentre fréquemment à pied. Du Cours Moyen jusqu’à la Terminale. De l’Externat au 1340 Chemin du Canet. J’emprunte toujours le même itinéraire. D’abord le tram puis l’autobus 33, jusqu’à ce coin de verdure qu’aucun transport ne dessert. Je dois finir la route à pied. Le bus me dépose au sommet de la Route de Lyon, juste devant l’auto-école. Je demande l’arrêt au chauffeur. Je descends et je monte. La route monte d’emblée. Sur le trottoir de droite, il y a un tabac-presse. Je m’y rends chaque samedi pour acheter 10 francs de tagada, bananes, bouteilles coca et schtroumpfs. Je les prélève un par un dans des bocaux plastiques et je ramène le Daubé à mon père. Je continue par le trottoir de droite, jusqu’au premier virage. La route se plie en deux, semble faire demi-tour. Dans ce passage aveugle, les voitures annoncent leur passage à l’avance (le jour en klaxonnant, la nuit par des appels de phare). Plus loin, les riverains se garent sur la chaussée, ce qui empêche les véhicules de se croiser. Je traverse la route pour prendre un raccourci sur le trottoir d’en face. C’est un chemin non carrossable, raide. Il y a un plateau au milieu. J’y fais souvent une pause pour reprendre mon souffle. À l’autre bout, je reprends le chemin. Il n’y a plus de trottoirs. Ici je marche sur la route. Je tourne à gauche et franchis deux dos-d’âne, distants de quelques mètres. La route est bordée de hauts murs. Pas d’autres paysages que le béton des murs (étant donné ces murs, que se passe-t-il derrière ?). La route descend jusqu’à un lotissement de maisons neuves (avant c’était une forêt), elle devient presque plate. À la sortie du prochain virage, elle remonte déjà. Il y a une maison sur la gauche, gardée par des « chiens dangereux » (c’est indiqué sur le portail). En longeant la maison, j’essaye de marcher le plus doucement possible pour qu’ils ne me remarquent pas. Immanquablement, les chiens me repèrent. Ils hurlent à mon passage en me montrant les crocs. Plus loin, il y a un banc de pierre, posé entre deux arbres. Je m’y arrête souvent. Le banc repose sur deux boules de pierre. Je peux m’asseoir au bord du bitume ou bien tourner le dos à la route pour regarder les arbres et la vallée. Peu à peu, les maisons s’espacent. La route grimpe en lacets jusqu’à un pont coudé. Le pont enjambe une rivière. Il y a un banc de bois avant le pont-virage. Je m’arrête parfois sur le banc. Ou bien je jette des cailloux, à l’aplomb du cours d’eau. Les rambardes en métal ont été plusieurs fois repeintes, mais les barreaux manquants n’ont jamais été remplacés. J’entends les cailloux fendre l’air, fendre l’eau et le fond. Chemin faisant, je ne croise pas grand monde. Parfois quelques voitures. Rarement des promeneurs. À part les chiens de Mme Druel (qu’elle fait courir bon train derrière son rutilant 4x4), je croise peu d’animaux. Même les oiseaux se cachent dans la forêt. On peut deviner leur présence, on les entend chanter. La fin du chemin est la partie la plus pentue. C’est le dernier effort avant d’arriver à demeure. Parfois, je m’aide d’un bâton. La route traverse un sous-bois ombragé. L’air est soudain plus frais. On sent d’emblée une impression d’humidité sur les bras nus, les jambes et le visage. Il suffit de passer le pont pour sentir cet écart. Il est notable durant l’été, accentué par le roulis de l’eau qui rafraîchit rien qu’à l’entendre. Une rigole en béton longe la route à droite. Elle laisse s’écouler les eaux de pluie vers la rivière. Tout en haut de la côte, un séquoia domine l’asphalte. On ne voit que le tronc à hauteur d’œil, il faut lever la tête pour deviner les branches. Juste en dessous, une maison où je me rends parfois, chez les Moinot. Après l’ultime virage, c’est la maison des Desamit. Semblant surgir de la façade, une fontaine-grotte dont le goutte à goutte s’écoule de larges stalactites recouvertes de mousse. J’arrive au 1340 : c’est la distance en mètres qui sépare la maison de la mairie. À cet endroit, la vue se dégage d’un coup, elle s’échappe des arbres, l’œil enfin fuit jusqu’au point de départ. Ma maison se tient sur la droite, dans un ancien corps de ferme. Elle est mitoyenne à une ferme de taille égale, toute en longueur. Les murs en pierre sont recouverts d’une couche de crépi grise. Au-dessus court une vigne vierge que butine chaque été un peuple d’abeilles. De l’autre côté de la route, il y a un muret. On peut s’y asseoir à l’arrivée. C’est le meilleur endroit pour voir la ville dans la vallée, entre ces montagnes immenses qui l’enserrent.
Date : 03/01/2017
Méthode : relevé visuel
Rue : Chemin du Canet
Carte : Google street view
La mairie de Saint-Martin-le-Vinoux a été déplacée en bas de la commune. La numérotation du Canet se rattache-t-elle désormais à l’église (située en face de l’ancienne mairie ?). La ligne 33 n’existe plus. Une nouvelle ligne de bus s’élance de la mairie 2.0 jusqu’au Col de Clémencières. En prenant la ligne 55, je pourrais m’épargner la marche. L’arrêt de bus n’a pas changé d’emplacement. Il s’appelle « Résistance ». Tout comme la Route de Lyon, renommée « Avenue de la résistance ». L’auto-école a été remplacée par l’entreprise ATBT : « Nettoyage de toitures / Isolation des combles ». Deux vitres ont été réparées avec du ruban adhésif. Le jaune du ruban semble presque assorti à l’enseigne. Au numéro 33, le tabac est fermé. Aucune trace n’atteste de son passé : on dirait un garage, un cube de crépi fermé par un rideau de fer. En face, deux sapins colossaux. Vient le virage aveugle. Les portails qui le longent semblent arrondis, à moins qu’il ne s’agisse d’une illusion d’optique. Au 18, la porte du garage a été taguée d’un yin et yang surmonté de trois lettres (ATH). Le raccourci démarre au 16. Dans mon souvenir, il y avait une murette. En fait, ce sont trois marches. La troisième est protégée par un arceau. De l’autre côté, il y a bien une murette, un arceau, pas de marches. On rejoint à ce point le Chemin du Canet. Une ligne blanche a été matérialisée sur le côté gauche, avec un logo de piéton. Il y a les hauts murs de chaque côté. Ils ne sont pas tout à fait gris, il y a du vert dans le gris (des feuillages s’échappent du haut des murs). La vue se dégage sur la gauche. Plus loin, une vigne vierge a colonisé toute une murette et un lampadaire, de bas en haut. La route se sépare en deux. Celle de gauche dessert le « Clos du Daim ». Il y avait un panneau qui annonçait le Clos. Les lettres, irrégulières, étaient sculptées dans le bois. On aurait dit une enseigne de saloon, gravée de façon malhabile, presque grossière. L’enseigne est recouverte par les feuillages. À gauche, un escalier en linteaux descend vers le lotissement. Je continue sur le Chemin du Canet. En s’engageant dans le virage, la route devient sauvage, elle semble passer par les champs. Plus de maisons ni de voitures. Le chemin est bordé de buissons et d’arbres de différentes hauteurs. Des fleurs jaunes et des graminées envahissent les bords jusqu’au ras du goudron. À la sortie du virage, les maisons ressurgissent. Au 431, la route se divise à nouveau. De chaque côté de la chaussée, deux chemins caillouteux desservent des garages. D’ici, j’aperçois pour la première fois ma maison, sur l’autre versant du massif. À droite, une maison qui m’a toujours semblé en travaux. Au 519, une maison tout droit sortie des sixties (plain-pied, marron, semble aplatie). La suivante doit être de la même époque (garage en bas et pallier à l’étage). C’est la maison des « chiens dangereux ». De deux choses l’une : ou bien les deux arbres qui entouraient le banc de pierre n’ont jamais existé ou bien ils ont été coupés. Chaque hypothèse me scandalise. Quelque chose est coupé. J’ai oublié le « Beaumanoir » situé sur la droite. C’est une demeure impressionnante, très haute, étrange. Je la croyais hantée pourtant je n’ai jamais croisé quelqu’un aux alentours. Il y a des balcons aux fenêtres et des rambardes en fer forgé. Elle ressemble un peu à une hacienda, avec ses volets rouges et ses murs blancs. Plus loin, deux maisons plus récentes se font face. Il y a un chemin bitumé sur la droite avec 4 plots de chantier qui barrent la route. Les gens doivent se servir du chemin pour faire demi-tour (mais où peut-on faire demi-tour ?). Il y a une toute petite maison sur la droite, au 364. Avant elle n’était pas crépie. On voyait les moellons à nu. Le pignon ne contient qu’une porte et une fenêtre étroites. Est-ce une cabane (il y a un potager derrière) ou un logement ? Le chemin redevient inhabité. Une forêt de bambous, très haute et dense, a poussé juste en face de la maison des Solvit. Ça doit être une curiosité pour les promeneurs : la plupart des tiges ont été arrachées sur le bord. Le banc de bois, avant le pont, semble s’être affaissé vers l’arrière. On pourrait chavirer d’un coup vers la rivière. J’ai oublié les deux chemins de chaque côté du pont. L’un monte vers une « propriété privée » (ne pas faire demi-tour). L’autre, très raide, suit le ruisseau. La rambarde du pont semble avachie de chaque côté (à moins que ce ne soient les caméras qui affaissent l’image). La fin du chemin semble moins boisée que dans mon souvenir. À droite, des arbres paraissent manquer. Ou bien n’ont-ils jamais existé (comme ceux du banc de pierre) ? La rigole est remplie de graviers bitumés. J’avais oublié ce parking sur pilotis, posé à flanc de montagne : un tronc surgit du milieu de la chape. Le séquoia semble moins haut que je ne l’imaginais. À la sortie du virage, la maison apparaît. Juste après celle des Desamit. La mini-grotte est asséchée, la mousse est encore verte. D’un clic, j’arrive au 1340. Il y a un panneau « Voisins vigilants » accroché à un lampadaire. Deux containers juste en dessous ont fait leur apparition : un gris, un vert. La vue est toujours aussi dégagée. L’œil porte loin. Sans la présence des chèvres qui le débroussaillaient, le champ du dessous est devenu une jungle de ronces. Le portail de la maison a été repeint couleur olive. La haie de thuyas et la vigne vierge ont été arrachées. Une partie du crépi a été retirée sur un mètre de hauteur, laissant apparaître les pierres massives de la façade. Un tilleul a été planté au bord de la route. L’été, il offre son ombrage à la terrasse. L’hiver, il offre le couvert à une nuée de mésanges.
supermarché ; un coin du parking ; les trois conteneurs à recycler ; lattes de bois gris- beige souillées de coulures noirâtres ; armature acier et gros anneau sur le dessus pour la grue du camion ; sur chaque un panneau avec les images des objets à jeter ; « 360 » écrit sur un ; plusieurs centaines dans la commune de ces points d’apports volontaires ; fentes à hauteur d’homme ; symétriques par paires de chaque côté ; quatre rondes pour le verre ; deux carrées pour emballages et papiers ; « merci de vider le contenant » ; derrière autre pancarte interdisant les dépôts à côté ; à menacer aussi d’une caméra à vidéo surveiller ; invisible celle-là ; sur le dessus ou au sol autour ce qui n’a pas pu entrer ou est tombé ; petite plaque de polystyrène ; éclats de verre ; embout plastique orange d’un pulvérisateur ; capuchons multicolores ; une fois derrière un gros homme bedaine au soleil à cuver ; moi presque à le piétiner ; lui au milieu de cannettes de bière à prétendre faire une petite sieste ; ce jour une vieille femme très maigre à jeter des bouteilles en plastique vides d’eau ;
les trois mêmes cette nuit dans la lumière des lampadaires du parking ; toujours à vous regarder avec leur gueules presque cubistes ; voir dans leur ventre ; plonger à l’aveugle la main dans l’œil gauche du dernier ; à remonter un bout de papier rose graisseux imitation bois ; en rouge « Boucherie-Charcuterie-Volailles-Traiteur Viandes de choix supérieur » ; dessin ; une vache à regarder un boucher lui tirer la queue ; « Maison Gu... » ; plonger alors dans l’œil droit du deuxième ; ne rien remonter faute d’allonge pour atteindre le niveau des déchets ; plonger maintenant dans l’œil gauche du premier ; odeur marquée de vinasse ; à la remontée la main sanguinolente agrippée à un tesson de bocal ; l’étiquette verte à pendouiller ; en jaune « Bio Bio Cornichons au vinaigre de cidre savoureux » ;

Deux pavés d’un dallage.
C’est le sol d’une cathédrale. Dans cette cathédrale tous les pavés se ressemblent.
Deux pavés seulement, l’un à côté de l’autre. Leur surface, ancienne, est lisse et dure, blanche. Leur surface souffre d’usure, elle est abîmée, mais chacun leur confie son pas.
Une des pavés est rectangulaire, l’autre presque carré.
Deux pavés à côté l’un de l’autre, un ciment gris les joint par une droite épaisse. Ciment en piteux état dans sa surface, mais les pavés sont bien assis, ce ciment dans sa profondeur doit être solide. Je ne sais pas la profondeur.
Je ne sais pas la profondeur. En surface les deux dalles ne sont pas usées de la même manière, comme si elles étaient dans des cathédrales différentes.
Pourtant elles sont là toutes les deux, dans la cathédrale, à Chartres, voisines ;
un même pied de catholique peut se poser à cheval sur les deux. Celle qui est rectangulaire est écorchée de balafres, comme si des mollusques s’y étaient accrochés, en un temps d’océan originel. Un mollusque plus gros a formé un trou près d’un coin ; un trou, au toucher, on sent qu’il abrite la poussière. Sur la dalle carrée je vois un dégradé, les écorchures se disposent des épaisses vers des fines d’un côté à l’autre.
Ces dalles composent, par leur répétition irrégulière, un sol. Je me suis assis à même ce sol. Je le sens froid sous mes fesses. Je me suis assis par terre pour être proche des dalles. Les gens qui visitent la cathédrale circulent autour de moi. Leurs pas couinent sur la pierre, comme si leurs chaussures étaient neuves. Ils composent par leurs déplacements et chuchotis un brouhaha feutré qui flotte au-dessus du sol, dans une atmosphère recueillie. Ces dalles leur donnent l’appui. Ces deux dalles génèrent par leur esprit incarné en pierre l’appui pour le ciel, une base ; le familier, le pays, le sûr, la foi, le bouc émissaire. À chaque pas elles donnent à tout être une onde et lui disent : « va ».
La rectangulaire est la plus abîmée ; elle a vécu un mouvement ; une torsion. Elle présente des bosses. Elle a ses angles arrondis. La carrée, à part des échancrures modérées, est plane. Ses angles sont droits.
Au touché encore je retrouve vite la poussière, je retrouve les aspérités plus marquées de la rectangulaire, un glissant plus régulier de la carrée, les angles arrondis de la rectangulaire et son trou, la rugosité variable de la carrée. Je retrouve le ciment liant sur le bord qui me fait passer à une autre dalle, puis une autre, puis une autre… il gratte il est friable et lâche vite des grains si on presse du doigt.
Les deux pavés ont une même couleur : marron très clair, presque blanc crème. Ou ocre ? J’aime le marron très clair. Le marron, le blanc. Pour le ciment la couleur est grise très foncé, mais je ne peux pas dire noir. Même couleur pour les aspérités des dalles. Ce gris très foncé sur fond marron très clair forme presque écrit ; on dirait un sol parchemin, on dirait une histoire. Pourtant, que dire, quelle histoire ?
Il y a longtemps je traversais régulièrement cette cathédrale en courant à toute berzingue. J’aimais cette fantaisie : courir dans ce lieu de recueillement, slalomer entre les piliers, les touristes spirituels, et sortir et disparaître comme un courant d’air. Peut-être ma course s’est-elle appuyée un jour sur ces dalles-là ? J’habitais Chartres, en un appartement, si je traçais sur un plan une droite de chez moi jusqu’à la gare, et bien la droite passait dedans la cathédrale ; donc, si vous comprenez, pour aller prendre le train, je passais normalement par le dedans de la cathédrale, et si j’étais en retard comme toujours et bien forcément je devais courir pour attraper mon train et voilà pourquoi j’entrais comme un pétard dans la cathédrale et fusais au mépris de toute civilité et sortais comme un bouchon de champagne pour attraper mon train et ça me faisait marrer, et je retrouvais le train pourri dans la banlieue puante du Paris glauquasse, voilà : je me marrais.
Et dans le processus ces deux dalles ne jouaient absolument aucun rôle particulier. Elles n’ont aucun rôle particulier ni pour cette histoire, ni pour moi, ni pour personne, ni pour rien.
Peut-être, ces dalles me reconnaissent-elles aujourd’hui. Je les ai choisies... au hasard, mon hasard ; peut-être, une autre volonté a pu se glisser dans ce hasard. C’est moi qui a choisi ces deux dalles, choisies parmi la multitude de dalles, comme on choisit des carreaux d’une mosaïque pour essayer de percer le mystère de la mosaïque. On sait que ces carreaux vous emmèneront ailleurs, mais on joue le jeu. On parie.
Je les regarde. Je les fixe jusqu’à ce qu’elles soient incarnées en moi, que je puisse les reconnaître entre toutes, que je les aime. Que je les devine.
Je les repère dans l’allongement d’une ligne de piliers.
Coté gauche cathédrale en regardant le chœur ; selon le plan en croix, au croisement, coté gauche, dessous ; proche d’un des gros piliers solides qui tiennent toute la cathédrale ; les pavés disposés en ligne, cinquième ligne en partant de l’alignement des piliers ; dans cette cinquième ligne le carré est le douzième en partant du gros pilier. Le pavé carré fait une de mes chaussures de long ; le rectangulaire un petit peu plus d’une chaussure.
Je m’éloigne. Je les observe en m’éloignant. Je ne cesse de les fixer. Je m’éloigne à reculons pour ne jamais les quitter. Celle qui est rectangulaire prend un aspect torturé avec l’éloignement. La lumière des bougies de la Vierge noire, juste derrière, s’y reflète, envoie du feu sur cette dalle-là.
Je m’éloigne encore, jusqu’à l’extrême limite où je devine encore mes deux pavés. Quelqu’un s’arrête juste dessus. Je suis passé.
Deux jours après.
Les griffures entaillent la face ocre clair, elles pleuvent en diagonale. La pierre garde par moments sa surface lisse et neuve, « d’usage ». La surface est légèrement bombée. Après la droite les griffures sont douces et plus petites. Elles sont de petites éraflures. À un moment elles s’étalent plus régulièrement et la surface est plus plane, si elles étaient des sons elles seraient un disque rayé qui grésille. En ce temps il n’y a pas de musique il y a juste silence et grésillement. Partant d’un ovale dont la surface est bien nette et presque épargnée, autour interviennent des entrelacs d’ocre clair et gris foncé. Tout est net, bien défini, mais tant de traces existent qu’il est vaniteux de distinguer chacune. Chacune devient nette par un regard. Le blanc est blanc par analogie avec la feuille de papier écrite, en réalité ocre clair. Le blanc est entaillé d’inserts noirs. Le noir est en réalité gris foncé. Le gris très foncé, non pas le noir, montre le temps, il est une dimension du temps. Une aire presque blanche. Dans l’aire, des inserts gris isolés au milieu – ce que l’on dit le milieu. Autour des inserts gris des mouvements gris. Ils sont des formes zodiacales : un chien, un moine, un cheval, une ville. La Lune peut aider à dire aussi. Une Lune qu’on n’aurait jamais vue, quand on ne connaissait pas l’existence des cratères ou des mers. En complément de ce descripteur Lune on peut aussi utiliser l’idée des empreintes de pattes d’animaux. Le plus évident : des pas d’oiseaux. On dirait que des oiseaux se sont posés et ont laissé leurs empreintes ici, en un temps. Mais de l’autre côté de la droite l’écriture ressemble à une giclée d’acide et la peau s’est rétractée sur la morsure chimique. Dans les éclats, un quasi-trou. En sortie de ce trou part une ligne de tâches sombres et une autre encore elles se distinguent par des interventions nettes, des ondes de diagonale qui ménagent un calme relatif puis après comme un saut, d’autres entailles d’acide se relancent, et apparaît une surface apaisée juste piquetée de gris.
Derniers jours de décembre 2016, le 30 je crois, oui
laisser se fermer la porte derrière moi, faire face à la façade de l’hôtel, sur le trottoir, plus large le trottoir devant nos maisons, celles du début de la rue - dalles claires, au niveau de la chaussée, de plusieurs tons de gris, un peu irrégulières, devenant beiges ou d’un autre ton de gris - c’est assez indécis - à gauche, là où le trottoir a été agrandi il y a quelques années pour obtenir même largeur que devant ma porte, avant de retrouver, après la rue Saint Sébastien, devant la boulangerie, l’étroitesse habituelle des trottoirs des petites rues de la ville, qui permettent difficilement de poser les deux pieds parallèlement, quand ils le permettent.
Faire face donc à la façade latérale de l’Hôtel d’Europe, immuable la bâtisse, historique (l’hôtel d’Europe et non de l’Europe, il s’agit de l’amante ravie par un taureau-dieu, a été ouvert en 1799 ), juste avant qu’immédiatement à ma droite, les trois niveaux de hautes fenêtres surmontées d’un toit presque plat, carré, quatre pentes presque imperceptibles de tuiles romanes - anciennes les tuiles bien entendu, et qui sont remplacées quand le besoin s’en fait sentir par des tuiles de récupération - les deux étages revêtus d’un enduit blanc tirant sur le beige, un peu fatigué, sur un rez-de-chaussée en pierres apparentes, se prolongent par un mur, de la hauteur du rez-de-chaussée, d’où dépassent les moignons du très vieux et grand platane de la cour élagué avec rigueur chaque hiver, mur percé, face au café qui occupe le bas de la deuxième maison après la mienne sur la droite, par un grand portail flanqué de piles surmontées de vases de fonte noire - accrochée à la première, la plaque-enseigne, ressemblant vaguement, mais pas de façon trop ostensible, à un parchemin, porte la mention Hôtel d’Europe surmontant cinq étoiles alors qu’à la plus éloignée est suspendue une lanterne de fiacre, au-dessus des macarons des guides touristiques – entrée latérale de l’hôtel, celle où les taxis déversent leurs clients, celle où dans une belle auto que le voiturier vient d’amener, sont chargées des sacs, valises, valisons etc... empilés soigneusement dans le coffre béant, en suivant les indications, ou ordres distraits (mais attentifs), mêlés de plaisanteries si j’en crois les voix, d’un couple d’âge indéterminé, le mur reprenant ensuite – la glycine n’est plus qu’un dessin sur les pierres, jusqu’aux pavillons de l’entrée sur la place, de façade desquels jaillissent des mats portant, comme sur la place, de grandes bannières blanches.
Les fenêtres du rez-de-chaussée, les moins hautes – une bande d’adolescent passe devant, qui vont au lycée professionnel privé, rue de la petite Fustrerie – sont protégées par des grilles aux barreaux assez serrés, droits, terminés par des piques, peints en gris très pâle, presque blanc nacré, comme les volets des hautes fenêtres du premier étage, l’étage noble, et ceux des fenêtres presque aussi hautes du deuxième, teinte, adoptée depuis deux ou trois ans, qui éteint la façade, malgré la très faible animation qu’apportent les bandeaux entre les niveaux, la ferme dans une réserve, une discrétion un peu méprisante, comme une barrière entre le monde qu’elle abrite et la vie du quartier, des manants, en désaccord avec la grâce aimable, sans excès, avec laquelle la vie de l’hôtel s’insère en fait dans la rue. Derrière les voilages, assez fournis pour bloquer la vue, des deux fenêtres du premier étage, à l’extrémité, à gauche, avant la rue Saint Etienne, on aperçoit les rangées, de plus en plus étroites, de petites lumières rondes qui, la nuit, évoquent avec discrétion un sapin stylisé.
A côté de moi, à droite, du lierre tombe dans un bac carré, reste de celui que les précédents occupants de la boutique du rez-de-chaussée, une agence immobilière dirigée par une femme avec laquelle j’avais des relations d’antipathie mutuelle, faisaient grimper le long de l’un des deux grands panneaux encadrant la vitrine. L’antiquaire vient d’ouvrir, il sort les deux grandes vasques coniques posées sur des trépieds en fer forgé, assez laides et sans doute assez chères, qui marquent sa place de trottoir. C’est un bon jour et il me salut, et puis s’en va vers le café qui doit être ouvert à cette heure ci, même si, à cause du froid qui s’est décidé à tomber sur la ville, les tables et chaises ne sont pas sorties.
Il rencontre devant la porte un homme, une des figures du quartier, qui débouche de la cour de l’hôtel – pour raccourcir son trajet entre la place, il habite au début de la rue Baroncelli qui y débouche, et le café, il a l’habitude, surtout en saison creuse, de traverser, avec assurance, cet espace en principe privé - en saluant d’un coup de chapeau – il est éternellement vêtu de bleu avec un grand feutre brun – la voiture, les clients, les garçons. La rue s’éveille petitement, comme en hiver...
août 2007
Une troupe disciplinée de touristes du troisième âge ou plus embouque la rue, en marche, à la suite d’un guide en bermuda kaki, vers le bout de la rue et la porte donnant sur le Rhône au niveau du pont ; ils regardent la porte de l’hôtel, regardés eux-mêmes par un garçon debout devant les salles de réception et de congrès qui occupent le premier bâtiment sur notre trottoir, par un client de l’hôtel, catogan, pantalon et chemise noires, et deux personnes attablées à la terrasse devant le bureau de tabac, terrasse qui dans le creux de l’été s’est réduite et n’occupe plus l’espace devant l’immeuble abandonné qui nous sépare de lui. La boutique, signalée par une enseigne peinte en noire, « tapis, kilims », et par un écriteau pliant posé sur le trottoir, est surmontée d’un bandeau métallique festonné, beige, et encadrée de deux cartouches de même teinte reprenant le nom de mon presque ami et l’indication « tapis, kilims » (bandeau, débarrassé alors des festons, et cartouches qui seront peints en noir par les successeurs).
Les grilles du rez-de-chaussée de l’hôtel, peintes en vert, les hauts volets rouge pompéien, rythment aimablement la façade et les mats des pavillons d’entrée portent, au risque d’entretenir la confusion entre la jeune fille raptée et le continent (Europe), des drapeaux colorés avec lesquels s’amuse la brise.
Le trottoir à ma gauche se rétrécit, laissant la place pour garer deux voitures, et, comme juillet est derrière nous, aucune moto n’est venue se garer devant ma porte, en passant entre les plots de pierre légèrement érodés qui nous séparent de la chaussée.
Presque à l’extrémité du long couloir segmenté de double-portes coupe-feu toujours closes, s’invisible un gros pot en plastique mauve. (Personne ne le voit vraiment, noyé qu’il est dans les pas qui passent.) La terre est recouverte de gros galets en désordre et en forme d’œufs, un peu blêmes, séparés par endroits de filaments et trous noirs irréguliers. De ce chaos surgit une tige épaisse et dégarnie vers le bas, la plante verte d’environ 70 cm de hauteur, aux très longues feuilles fines, pointues, lisses et brillantes, presque glacées, veinées en leur centre d’une double nervure blanche. (Après enquête personne n’en connaît le nom mais la question amuse. Incongrue). A cet endroit une porte rouge-brique entrebâillée sur les carreaux gris ouvre à droite sur le parallélépipède-rectangle du bureau infirmier, (16 pas en longueur, un peu moins de cinq en largeur) ainsi que sur le porte-manteau juste à côté de l’entrée. Il est toujours surchargé d’un mélange touffu de blouses, vestes d’hôpital ressurgies en hiver et vêtements de ville accrochés à la va-vite, manteaux encombrants, doudounes et écharpes, en plusieurs couches confuses mais cependant séparées (blouses blanches toujours sous la couche d’habits dits civils, tout aussi entremêlés mais en surface.) Le plumage du porte-manteau se modifie donc au fil des entrées et des sorties mais demeure obstinément baroque surabondant et peu hygiénique. On ne voit que son pied circulaire et noir et un tout petit bout de sa hampe. Le bureau est également pourvu de deux portes de couleur identique (souci d’harmonie ?) à chaque extrémité de la base d’un U qu’il souligne. Il est dans ses deux longueurs parcouru de grandes fenêtres. Donnant vers l’intérieur du U 12 baies vitrées dont – au centre 2 plus étroites – avec vue sur le couloir qui borde le patio, glacial en hiver, c’est le coin réservé aux fumeurs. De chaque côté du patio la distribution en U se ramifie ensuite en deux branches hérissées de 12 chambres de chaque côté. La numéro 12 est la plus froide. Deux sont condamnées pour humidité et moisissures, le bâtiment est de construction récente (environ 3 – 4 ans).
Sous ces mêmes baies vitrées sur toute la longueur un grand plateau gris. (Ce dernier repose sur un alignement de placards dévolus à ranger diverses ressources de papeterie - à aller chercher à genoux). Posés dessus trois ordinateurs, leurs trois écrans, découpent des brèches ou de drôles de loupes sur des tableaux et listes absurdes et impersonnelles, là deux personnes de dos, en blouses, courbées, occupées à taper cliquetis - cliquetis des observations dans les dossiers patients informatisés. Tout à droite une imprimante Laser volumineuse – puis juste à côté, 24 petits casiers en bois et leurs 24 noms - recèlent paquets de cigarettes, briquets, téléphones portables, flacons de parfum etc.) Entre les ordinateurs des rangées de classeurs accolés verticalement en bandes vertes (claires et foncées) rouges – noires - jaunes - bleues et de façon itératives les doubles ressorts blancs des cahiers à spirale. Parfois de grosses étiquettes rédigées à la main et au feutre (« Planning » en grasses lettres capitales et en noir délavé) Parfois de petites étiquettes, toujours verticales (obligeant à incliner la tête de façon douloureuse pour le cou et pour le coup), faites avec ces petites machines noires. Je lis : « ordonnances patients » – « cadres d’hospitalisation » – « prescription isolement » - « commande globale » - « urgences vitales » - « socle care » - « intérimaires » (Deux étiquettes cette fois, et sur fond jaune celles-là : une verticale surmontée d’une autre détachée au-dessus en barre horizontale. Intérimaires debout – couchés – vœu d’abondance ou aveu de misère ?) Enfin une étiquette pléonastique et hautaine celle-là, lettres noires sur rectangle blanc : « classeur dédié pour le suivi des injections retard ».
Au centre du bureau un assemblage de 5 tables dont aux extrémités deux semi-circulaires. Posés dessus d’autres classeurs et feuilles de « relèves », deux pots perforés de petits orifices décoratifs remplis de stylos bic, - surligneurs – ciseaux). Autour 14 chaises pliantes et tabourets, dépareillées les chaises, (certaines rembourrées confortables, d’autres en bois rappelant un mobilier scolaire) dont 5 sont repliées et appuyées à divers endroits, en particulier entre la table et le mur du côté extérieur du U – tranché de grandes vitres à mi-hauteur. Vue cette fois sur le couloir d’accès qui traverse l’ensemble du pavillon et donne accès aux lingeries – offices – salles à manger.
A sa rive droite donc plante verte et porte rouge entrebâillée.
Je me demande quand servent les 14 chaises.
Ce soir une infirmière – une collègue est assise presque à l’extrémité de la table. Elle attend que s’arrête le cliquetis-cliquetis pour me transmettre les informations utiles.
La lumière crue écrase tout et je me vois tout petit et de très haut dans une boîte jaune.
3 h 30
La porte rouge brique est toujours entrebâillée sur les carreaux gris. A droite le porte manteau a changé de plumage, mais il demeure surabondant. On dirait que les modifications ne peuvent l’affecter qu’en surface, ce qui est faux, évidemment. De toute façon dans la pénombre il n’est plus maintenant qu’une vaste masse informe et tâchée de blanc. Sur le plateau, devant les classeurs entre les ordinateurs mon thermos argenté et son Roïbos. Je suis de dos et je cliqueticlique – je relève la tête - regarde à nouveau et examine la boîte devenue obscure ; seules demeurent une petite lampe de bureau, les reflets de deux des écrans, les ampoules du couloir extérieur. Les baies vitrées ne donnent plus à voir le patio, les stores sont baissés. L’éclairage automatique à détection de mouvements a signalé à intervalles réguliers des mouvements dans le couloir et déclenché nos interventions, incessantes cette nuit.
Personne autour de la table ovale.
J’ai mal à la nuque et à l’épaule gauche.
Je me lève mesure la pièce, 16 pas en longueur, un peu moins de 5 en largeur,
E. me regarde étonnée.
— Tu sais ce que c’est la plante dehors ? C’est pas un ficus ?
— Non, je ne crois pas, je connais pas vraiment les plantes ! Elle rit.
Dans le couloir côté patio - qui vient de s’éclairer – en transparence derrière les stores beiges – elle repasse, massive, nue sous sa couverture bleue enfilée en capuche sur sa tête, elle va revenir tambouriner contre la porte à l’extrémité droite des 16 pas du parallélépipède rectangle.
Je pense aux charbonniers qui se protégeaient les épaules et le dos de leurs toiles de jute et déchargeaient dans un grand fracas de poussière âpre et gluante.
Je suis dans la boîte. Noire. Vu de dedans.
La rue commence à droite par une maison à angle biseauté, avec à ses pieds un trottoir recouvert d’une mosaïque grosse maille ; des dalles de comblanchien issues de blocs marbriers donnent l’allure d’une terrasse au trottoir ; il avance en V inversé vers la rue, une fenêtre le surplombant.
Sur le mur, une plaque bleue indique le nom de la rue, écrit en blanc, QUARTIER PRÉVÔTAL, on remarque les accents sur les majuscules ; un homme à casquette noire, qui est apparu sur le pas de la porte, située à droite de la fenêtre, indique que dans son enfance la rue avait un autre nom, il ne dit pas lequel, il ajoute qu’au fond de la ruelle, avant, c’était la poste du village, puis il disparaît. Relevant la tête, on s’aperçoit que la ruelle, dans sa première partie étroite, est plongée dans l’ombre, la maison côté gauche projette une ligne sombre à la verticale du panonceau. C’est à ce moment-là que résonnent des caquètements de poules, dont on ne sait d’où ils proviennent. Dans le fond, on aperçoit une Citroën grise, un modèle récent garé en face du numéro 8, une maison en tuffeau bordée d’un jardinet et d’une barrière blanche, large, percée de trois fenêtres et d’une porte au rez-de-chaussée doublées à l’étage supérieur de quatre fenêtres ; les volets en sont blancs ; apparence cossue renforcée par la porte d’entrée à trois ventaux de verre et peinte en blanc.
Le numéro 8 n’est pas le fond de l’impasse ; celle-ci se poursuit à gauche dans une sorte de boyau plus étroit, porte de garage sur la droite et murs chaulés en face ; il bute sur une maison grise, étroite, de deux étages, avec une porte en pvc bleu roi, ajourée d’une partie en verre formant une sorte de goutte d’eau ; on n’entre pas dans cette dernière partie de l’impasse, on tourne à droite ; la suite de la ruelle est bordée d’une maisonnettes d’un étage, à main droite ; ornée d’une porte à carreaux bois et verre de style rustique, comme on peut en voir dans un magasin Lapeyre, par exemple, et d’une verrière d’atelier à panneaux verticaux de verre dépoli ; la seconde latte en partant de la gauche est cassée ; devant le local, un barbecue de taille imposante, fermé d’un couvercle de plastique vert ; à l’arrière du toit en pente, sans doute de l’amiante-ciment, qui couvre la maisonnette, un mur plus ancien se dresse ; c’est en fait une autre maison en tuffeau dont les membrons et chéneaux du toit sont soulignés d’une corniche de tuffeau sculptée, avec motif régulier en modillons ; cette bâtisse est prolongée par un autre corps de bâtiment mitoyen, plus bas dans la rue, dont la façade est en moellons enduits, percée d’une grande porte de grange en bois peint en blanc et d’une fenêtre de grenier, de type stockage de grains. Sur la porte de grange, un panier de basket est accroché ; on ne sait pas si c’est à hauteur réglementaire. Dans le recoin après l’atelier, deux poubelles, une jaune, une brune, et une sorte de guérite suspendue, avec toit en ardoise, qui abrite deux énormes aérateurs, silencieux, le tout fixé à même le mur. On ne descend pas plus bas, on s’arrête pas discrétion, la fin de ruelle semblant se terminer en deux cul-de-sac entourés de bâtiments agricoles. Impression de désordre et de saleté, camaïeu gris et blanc délavé.
Le même Quartier Prévôtal, mais Google n’a conservé ni l’accent aigu, ni l’accent circonflexe dans le nom figurant sur la carte. L’entrée de rue est ensoleillée, mais pas d’homme sur le pas de la porte ; pas de voiture non plus devant le 8, on aperçoit la barrière et le portail repeints de frais, même la boîte aux lettres ; ce qui apparaît d’emblée, c’est l’allure pimpante, printanière de la ruelle ; les deux arbustes flamboyants du jardinet captent le regard ; on identifie un oranger du Mexique aux fleurs blanches ( et si Google pouvait donner l’odeur, on reconnaîtrait le parfum envoûtant de l’arbre) ; un autre arbuste, inconnu, aux fleurs fuchsias occupe la limite gauche du jardin. Si on poursuit côté droit, on aperçoit la même maisonnette-atelier, cette même porte rustique ; mais la deuxième latte de verre de la verrière n’est pas cassée ; il n’y a pas non plus de gros barbecue devant le bâtiment. Poussant plus loin le curseur, on retrouve les deux poubelles, la guérite et ses deux aérateurs muraux ; mais pas de panneaux de basket sur la porte de grange. Dans l’ensemble, la rue semble bien tenue ; comme si le laisser-aller avait gagné le quartier après 2013 ; ou plutôt une manière de vivre plus en extérieur, cuisine d’été et jeu de ballon semblant connoter une envie de vivre plus joyeuse, peut-être plus méditerranéenne, un peu moins à cheval sur le qu’en-dira-t-on. Sur Google, on doit s’arrêter, la Google car n’ayant pas poursuivi le trajet. On n’entend pas non plus les sons sur Google, pas de caquètement de poules donc, ni de cloches d’église carillonnant l’heure de midi ; on suppose qu’il est midi ; comment expliquer autrement la lumière de la ruelle, sinon par un soleil à l’à-pic du quartier.

La rue est advenue avenue. Le Général Michel Bizot, mort au siège de Sébastopol le 15 avril 1855, possède pour lui seul – et ça lui fait une belle jambe en pantalon garance – une voie élargie (un genre de stratégie) dans le douzième arrondissement de Paris.
J’ai vécu là, au numéro 108, de 1982 à 1990.
L’immeuble était alors accessible sans code. On pénétrait dans le hall, on ouvrait la porte et l’ascenseur vous emmenait jusqu’au troisième étage.
Mon petit appartement avait accueilli mon Raleigh mi-course, blanc et noir, une élégance folle (il fut volé plus tard dans la cave de mon appartement dans le dixième), j’aimais son nom, sa légèreté, je m’endormais les yeux sur lui.
« Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ? » (Georges Perec, Folio N°1413, novembre 1982).
Chaque week-end, ou presque, j’enfourchais ma bécane, direction le lac Daumesnil : j’étais doublé par des « pros » en tenues de coureurs cyclistes, j’avais l’impression qu’ils roulaient deux fois plus vite que moi.
Le soir, j’avais la télé et un magnétoscope : j’enregistrais les films du « Cinéma de Minuit » en VHS. Pour le cinéma, il fallait prendre le métro jusqu’à Bastille.
J’avais rapporté de New Delhi un sitar (très grand bagage accompagné dans l’avion) : un jour d’hiver sa coque se fendit à cause des changements de température. Je n’avais pas eu le temps d’apprendre la méthode pour jouer de cet instrument comme un émule de Ravi Shankar.
Quand j’y songe, l’avenue du général Michel Bizot m’a toujours semblé assez peu musicale.
Je n’étais pas passé depuis longtemps devant le N°108 de l’avenue Michel Bizot : mais j’y ai pensé souvent.
La porte en verre de l’immeuble, ce vendredi 6 janvier, n’a pas changé, mais elle est dotée maintenant d’un code d’entrée, je suis donc comme exclu, étranger. La frontière des quatre chiffres plus une lettre ressemble à un mur surmonté d’un rouleau de barbelé. Je regarde à l’intérieur, il fait sombre : les boîtes aux lettres sont bien rangées mais aucune ne porte sans doute plus mon nom : évanouissement postal.
Juste à côté, ils ont collé un Franprix, cela m’aurait évité à l’époque d’aller chez Picard, qui existe toujours de l’autre côté de l’avenue, et de me rassasier de surgelés (Findus, le poisson au carré).
Le restaurant « Le Petit Hugo » est aussi toujours présent, avec sa modestie affichée. L’école maternelle porte encore sa plaque noire et dorée sur les enfants Juifs déportés de 1941 à 1944, victimes innocentes de la barbarie nazie, « avec la complicité active du gouvernement de Vichy » (bien écrit sans prendre de gants).
En allant vers le café « La Royale », je constate que le marchand de journaux a survécu (en mettant des téléphones portables en vente dans sa vitrine) à la numérisation accélérée de la presse papier.
Mon immeuble est plus grand qu’un timbre-poste : j’ai pourtant gardé précieusement son adresse imprimée dans ma mémoire mais je ne lui ai pas envoyé une lettre nostalgique, j’ai fermé les yeux – la rue Braille protège la quincaillerie inoxydable pile à l’endroit du carrefour – et j’ai revu aussi la rue de Toul (je venais de Nancy) : étais-je finalement un simple courrier à acheminer ou un coursier déboussolé ?
Au retour de cette promenade, j’ai habitude de m’arrêter toujours au même endroit. L’hiver, il n’est pas loin de midi, le soleil est au plus haut et donne un semblant de chaleur. Je m’assois sur le talus et j’entre dans le paysage.
De l’autre côté du chemin forestier, court le canal Salva. Dire qu’il court est inexact. Son eau est prise dans les glaces en dentelles argentées. Une grosse pierre, une branche sont bloquées là pour quelques mois. La martelière en métal peinte en un vert agressif est abaissée, on devine derrière elle la rigole qui court à travers le champ en partie enneigé. Inutile, dans l’attente du printemps qui verra l’eau à nouveau bouillonner au travers du pertuis. A gauche se dresse un tremble au tronc noirci qui fut éventré par la foudre. En ce trou béant, l’été les enfants aiment s’y blottir, sans doute s’imaginent-ils trolls ou nymphes des bois, en sécurité dans les entrailles de l’arbre bienveillant. Éventré et cependant vivant, au repos durant la mauvaise saison. À droite, un églantier : squelette de lui-même, mais reconnaissable à ses baies. Les cynorrhodons rouges, quoique flétris par le gel, attirent les oiseaux qui n’ont pas migré vers le sud ; j’aperçois parfois une grive, un groupe de chardonnerets. Une pie solitaire festonne au-dessus de ma tête, son vol est maladroit, elle lance son tché-tché-tché-tché rauque et prolongé. Passe une famille qui chemine tranquillement. Le garçon lâche la main maternelle. Il saute dans le canal. La glace cède sous son poids. Il trébuche, tombe à genoux. Cris de la mère. Le père se précipite. L’enfant trempé rit aux éclats, fier de son exploit. Le père le gronde. Ils s’éloignent. Une brise douce joue dans les graminées qui bordent les berges du canal. Elle lancent des éclairs dorés dans la grisaille des feuilles mortes. Leur or, l’argent de la glace éclairent ce petit coin de terre, ma terre.
Au début de l’été, c’est le matin, à la fraîche, que je m’assois quelques mètres plus loin pour bénéficier de l’ombre légère d’un bouleau. Émerveillement du renouveau. L’eau court entre les berges du canal couvertes d’herbes folles et de menthes poivrées. Le sceau de Salomon – proche du muguet - a lancé ses pousses et ses fleurs blanches ourlées de vert pendent sous les tiges, suivant leur courbe. Les ombellifères aux minuscules fleurs groupées – sans doute des carottes sauvages – retiennent dans leurs couronnes des perles de rosée scintillante ; les nuits restent froides ici. Une nuée de petits papillons bleus se pose sur les fleurs mais bien vite les quitte pour s’installer sur le sol humide près de l’eau courante. Le tremble a retrouvé ses petites feuilles ovales qui s’agitent à la moindre brise et les rouge-queue, de retour de migration, leurs nids qu’ils reconstruisent sous l’écorce et dans les trous de l’arbre. Je les admire plongeant de leur poste de chasse, virevoltant pour capturer les insectes. J’aime écouter leur chant mélodieux, sonore, souvent mélancolique, coupé parfois de tittittit nerveux. Et le chant de l’eau qui se presse, qui traverse la martelière pour inonder les prés inférieurs en suivant le biauou, la rigole, qui continue son chemin dans le canal principal vers d’autres champs, d’autres cultures à irriguer. En moi, très forte, l’admiration devant le travail des anciens qui ont de leurs mains construit ce remarquable réseau d’irrigation en détournant l’eau d’un lointain torrent, le Cristillan ; dévastateur par ses crues, il est devenu secourable dans ce pays assoiffé par le soleil de l’été. Admiration encore devant le travail des hommes d’aujourd’hui qui assurent la corvée, l’entretien des canaux avant leur remise en eau, nettoyant, curant, élaguant, brûlant les buissons, fortifiant les berges. Et l’amusement devant, soudain, ce setter fou qui caracole dans le courant, lançant de hautes gerbes d’eau, quittant le flot pour s’ébrouer devant moi ; l’animal, il m’inonde. Je le connais, souvent il m’accompagne dans mes promenades ; il s’approche amicalement, guettant une caresse. Allons, Grandick, attends un peu, tu es bien humide. Et laisse passer tranquillement ce groupe de vététistes. Nous nous saluons, ils se dirigent à travers la forêt vers le sommet de Combe-Chauve. Bon courage, la montée est raide. Je préfère profiter de la paix de ce petit coin paisible, un timbre-poste, un presque rien, en un moment fugitif, un moment de paix dans notre monde en chaos. En ce pays que j’ai adopté, qui m’a adoptée.

Ils vont dans des lieux abandonnés. Ils écrivent, tiennent des blogs et des forums, font des vidéos de leurs explorations et parfois se mettent en scène dans ces lieux, y mettent en scène des objets ou en figent les graffiti. Ils en rapportent des photos ; de destruction, de désolation, d’abdication, de capitulation, de renoncement dont se dégage souvent une fascinante poésie.
Leurs livres s’appellent « Les ruines de Detroit », « Zones of exclusion : Pripyat and Tchernobyl », « France interdite et secrète », « 50 lieux abandonnés et secrets », « Patrimoines oubliés », « Forbidden Places-explorations insolites d’un patrimoine abandonné- », « Tempus irreparibile fugit », « Beauty in decay » « States of decay » « Explorations dans un monde oublié » « Passé décomposé » « Hors du temps » « Frozen » « Villes fantômes de l’ouest américain » « Spirit of Place » « l’inhabitable ». Ce sont de beaux livres, de photographes célèbres avec des préfaces d’auteurs parfois prestigieux (prévoir de 50 à 100 €) ; ou des œuvres plus modestes d’amateurs inconnus (prévoir de 15 à 30 €).
Des usines, des châteaux, des parcs de loisirs, des silos, des gares, des hôpitaux, des salles de spectacle, des bunkers, des centrales électriques, des hôtels, des asiles, des piscines, des aquariums, des maisons particulières, des cloîtres, des églises, des manoirs, des pensionnats, des orphelinats, des sanatoriums, des mines, des villes, des îles, des prisons, des forts, des garages, des locaux universitaires, des écoles, des abattoirs…parfois au coeur des villes, parfois en pleine campagne. Infinité des lieux qui ont été planifiés, budgétés, construits, utilisés puis délaissés parce qu’inadaptés, non rentables, dangereux, théâtres d’un drame, d’une faillite, d’un meurtre, victimes de l’absence de clientèle, d’une succession, d’un incendie, d’une explosion, d’un changement d’orientation, de politique, de gestionnaire. Inutiles et d’autant plus troublants qu’ils sont colossaux. Its splendid decaying monuments are, no less than the Pyramids of Egypt, the Coliseum of Rome, or the Acropolis in Athens, remnants of the passing of a great Empire.(MARCHAND MEFFRE The ruins of Detroit (2005-2010)
Ils se disent parfois lanceurs d’alertes patrimoniales mais l’histoire les intéresse assez peu et ils craignent par-dessus tout que ces lieux disparaissent, rasés ou réhabilités ; ce qui les passionnent c’est la recherche des adresses secrètes, le franchissement des barrières d’interdiction d’accès, le jeu de cache-cache avec les éventuels gardiens, les risques de l’exploration et l’ambiance particulière des lieux.
Beauté des lignes nues, reprise de pouvoir de la nature, vitres cassées, crépis décollés, infiltrations d’eau ; toits crevés, peintures écaillées, gravats et beaucoup d’objets abandonnés : machines, lits, fauteuils, livres, instruments de musique, jouets...comme si les départs avaient été précipités alors qu’ils ont souvent été lents et progressifs. Rebuts frappés d’obsolescence.
Ils sont nombreux et passionnés ; on parle d’eux ; ils ont créé une discipline (récente, 20 ans au plus) qui a ses codes, ses classifications, ses hiérarchies. Quelques chercheurs, architectes, anthropologues ou metteurs en scène s’intéressent à eux et décryptent dans leur pratique une recherche de l’émotion, celle de la transgression, du péril, de la distorsion du temps et de l’appartenance à une communauté.
Pour nous qui aimons parfois flâner dans les friches et ne dédaignons pas l’esthétique des espaces délaissés, quel est cet objet de fascination ?
Ma mère est morte il y a deux ans ; elle n’habitait plus sa maison depuis quelques années déjà, après des chutes et des chutes qui mettaient sa vie en péril.
Après l’inventaire exigé par le notaire (pour le calcul des droits de succession), nous n’avons rien bougé, rien vidé, tout laissé en attente. Sa maison est en vente mais personne n’en veut. Trop grande, trop d’impôts locaux, trop de frais de chauffage, plus au goût du jour, tout à rénover de l’électricité aux circuits d’évacuation, des plafonds à refaire aux murs à ravaler, tout à redistribuer de la cuisine trop petite au séjour trop grand.
Le toit fuit, l’indivision va faire les réparations.
Mais un lit et une moquette ont été endommagés…
…..Et j’imagine soudain la maison de ma mère qui devient un lieu abandonné :
Les tapisseries décollées, les fauteuils défoncées, les tables renversées, les appareils ménagers dépecés, les lustres vandalisés, les lits éventrés, les miroirs maculés, les livres dispersés, les vitres cassées, la cheminée servant de feu de camp, les placards vidés, la vaisselle et les vêtements éparpillés, les salles de bain rouillées, les carrelages décellés, les portes violées…
Le jardin devenu broussailles, les accès empêchés, les arbres et la pelouse dévastés…
Et tout ce que ma mère a conçu, voulu, aimé, habité qui serait détruit. Vertige, comme une chute à travers un plancher délabré.
Je n’ai jamais aimé cette maison où je n’ai jamais vécu mais il me vient une étrange tendresse pour ce lieu et pour ma mère qui ne mérite pas ce naufrage de ses rêves.

descendre vers la mer avec Papa et Maman ; des petits galets t’accueillent au bas des escaliers de pierre usée ; dès la dernière marche franchie ils crissent comme des grosses billes dans un sachet géant que l’on aurait déversé jusqu’à la mer qui t’attend à quelques mètres ; là ; en face ; meubles ils sont ces galets ; tu t’y enfonces un peu avec tes petites sandalettes en plastique blanc pour éviter de t’écorcher les pieds ; le mal aux pieds ce n’est pas bon pour apprendre à nager elle dit Maman ; tu as presque cinq ans ; en levant la tête vers le ciel tu t’arrêtes sur une voûte immense ; massif le pont blanc et gris ; avec des tâches noires qui ressemblent à des plaies cicatrisées ; Papa te raconte l’histoire de contrebandiers jetés de là-haut ; ils tombent côté galets ou côté mer pour échapper à la police ou à d’autres contrebandiers ; Papa ne sait pas bien ; toi tu cherches les traces de sang ; ne trouves que des algues par gros paquets ; sombres ; noirâtres ; peu de vertes ; c’est vers la mer où tu avances qu’il y en a le plus ; elles dégagent un fort parfum d’iode ; tu tiens ta bouée avec tes deux mains ; la mer est à peine agitée ; tu as très envie de te baigner mais tu prends ton temps ; à main droite le chemin monte vers les rochers en longeant un haut mur blanc ; pour l’instant tu n’y a pas droit puisque tu ne sais pas nager ; à gauche le pilier géant qui tombe de la voûte et la prolonge jusqu’à l’amas de galets ; dans ton dos des rangées de bateaux à voile et des garages à canoës ; tu les as aperçus en descendant tout à l’heure ; n’y as presque pas prêté attention ; te languissais de voir la mer ; et là tu les regardes en tournant la tête ; ils attendent la mer eux aussi ; beaucoup de blanc sur les coques des petits voiliers ; quelques bandes de bleu ciel aussi ; pour faire joli ; les canoës sont couleur miel ; il est tôt ; l’air est tiède ; la petite digue en face de toi ; c’est vers là que tu nageras ; tu marches dans la mer en serrant ta bouée d’abord puis en la lâchant au fur et à mesure que tu avances et que tu perds pied ; l’eau est bonne ; très salée ; elle pique un peu les yeux ; de tes lèvres tu frôles la surface ; couleur argent avec ce bleu clair du ciel qui se mélange : Maman te dit - c’est bien mon chéri, tu nages bien ; tu agites tes jambes et ne sens plus les galets sous tes pieds ; tu n’as pas peur ;
les galets se sont obscurcis ; tu t’y enfonces encore un peu avec tes chaussures de marche ; à chacune de tes promenades c’est pareil qu’avant ; ce bruit de billes qui se cognent ; une forte odeur de pisse mêlée au parfum d’iode ; la paroi qui chute de la voûte est parcourue de flaques d’humidité de haut en bas ; au coin du pilier de gauche les vestiges d’un feu ; du bois calciné et des cendres grises et foncées ; juste à côté un sac de couchage abandonné ; là où s’échouaient les contrebandiers s’installent les sans abri ; les voiliers et les canoës garés derrière un peu plus haut ont pris un coup de vieux ; le blanc est plus mat ; le bleu clair un peu craquelé ; ces bateaux n’ont pas touché la mer depuis combien d’années tu te demandes ; les paquets d’algues traînent toujours près de l’eau ; plus claires il te semble que les algues de l’enfance ; tu marches sur des sacs plastique et des canettes vides ; quelques unes mais c’est déjà beaucoup ; tu te demandes où est passée ta bouée depuis tout ce temps ; aucune trace de sang nulle part ; tu entends le bruit des voitures au-dessus du pont sur la Corniche ; la mer est calme ; trop froide pour se baigner ; et puis maintenant que tu sais nager tu préfères aller sur les rochers en prenant le chemin qui longe le haut mur blanc à main droite ; tu aperçois les graffitis qui le salissent ; l’air est froid ; le soleil est en train de s’en aller vers les îles ; en remontant le chemin tout à l’heure tu surplomberas la petite digue ; après le virage lorsque le chemin redescend vers les rochers tu les verras ces îles que tu rejoignais à la nage avec les copains ; il a fait très beau aujourd’hui et la lumière teinte de rose tout ce qui s’offre à elle ; Maman est partie ; tu n’as toujours pas peur car elle continue de te regarder et de te parler.

C’est un croisement, en réalité, qui s’est transformé en une entrée : attesté par les photographies d’époque, on sait que par exemple (mais elle n’est pas à l’image) la rotonde des vétérinaires existe depuis la fondation de cet espace – ceint ici par la rue, là par le quai (en contrebas passent les péniches, parfois, plus loin, au delà du pont, la navette va vers un improbable centre commercial à moitié en faillite). Le mieux c’est quand j’en sors (j’ai fini, j’en ai ma claque, je me tire le plus vite possible comme si le diable à mes trousses se tenait en riant, le sang, les os, les bêtes et les rats, toute cette ménagerie qui sied à ce lieu, les chiens, les écrevisses du canal qui se repaissaient d’un homme mort entre le flanc d’une péniche et le quai, dans les années quarante (le type qui m’a raconté cette affaire-là en avait d’autres, il pêchait là, au coin des deux canaux, un peu plus haut vers l’est – pour se retrouver à ce carrefour des canaux, il faut gravir une déclivité d’une bonne dizaine de mètres). Ce jour-là, il faisait encore quelque chose comme le jour, mais ça baissait, la lumière, il y avait au fond de l’air, dans son creux, quelque chose comme un froid dur et sec qui allait nous envahir, pas étonnant de voir les fumées monter des chauffages au fond de l’image, cet immeuble un peu nouveau, quelque chose de coloré – cette chose un peu ignoble préméditée par les architectes, ces temps-ci, des couleurs vives, éclatantes, parfois même allant jusqu’au fluorescent - on abrège en fluo, ça fait mieux – ça vous a un air de digitaline, ça se périme vite, suffisamment pour en inventer d’autres et faire passer ça dans les travaux d’embellissement, de renouvellement, des affaires faciles à monter dans le cadre de la politique de la ville, quelque chose qui exhale une odeur de pourri, cette odeur-là, même, qui devait prévaloir ici, il y a peut-être quatre vingts ans ; la charogne, le sang figé, les peaux qu’on tannera, les viscères et les tripes, le boudin probablement, toutes ces sortes de produits issus de ce cheptel, ça arrivait par camions, par trains entiers, et c’était entreposé de l’autre côté, avant d’être abattu, à coups de masse sur le crâne, quelque part je ne sais où). Au premier plan, ce sont des pavés réguliers qui se prêtent plus à la marche que les autres – sur la droite, devant l’entrée – qui eux prennent une sorte de plaisir lorsque sur eux se tordent les chevilles des bipèdes ou qu’ils passent là en vélo (il y en a deux ou trois à l’arrière-plan) ou à pied (deux types sécurité blouson orange fluo se tiennent sous l’auvent du bâtiment rouge intitulé folie par l’architecte du parc et se protègent sans doute du froid, mais sûrement pas de l’ennui) ; plein centre les superstructures du toit dit « en vague » et sur la gauche, une sorte de banc couvert de marbre dans les noirs, au milieu duquel on trouve des poubelles ferraille trouée et volume triangulaire, (signée d’un grand nom du design cette horreur de la famille de la publicité) fermées à cause des attentats, puis rouvertes depuis, depuis plus de vingt ans (c’était en quatre-vingt-quinze), puis une sorte de barre dont la forme imite la vague qui tient lieu de dossier sur lequel personne n’a l’idée de s’appuyer. Au deuxième (ou troisième) plan de l’image passe le tramway (c’est nouveau, ça vient de sortir, ça marche à l’électricité produite dans les cinquante-huit bientôt obsolètes réacteurs que compte cette jolie contrée, c’est dans les verts et les blancs, ça ne klaxonne pas mais un bruit de cloche s’épand devant l’objet lorsque sa voie est encombrée – cela se nomme un site propre, c’est recouvert de pelouse sauf aux intersections, verte comme l’écologie que se doit de suggérer ce mode de transport remis au goût du jour). Sur une affiche, la mention « Le rouge et le noir » une comédie musicale franc succès, et on se souvient de madame de Rénal caressant la tête de son Julien Sorel, c’est joli, ça doit être représenté au Palais des Sports (erreur d’appréciation, pardon). Quelques voitures, quelques lampadaires panneaux feux tricolores, arbres et piétons complètent le tableau.
La comédie musicale est un triomphe (c’est du moins ce qui est proclamé en haut de l’affiche, en blanc sur fond rouge), elle se poursuivra jusqu’à la fin du mois, dans un music-hall du centre (je crois bien, le Palace, vers la rue du faubourg Montmartre en face de chez Chartier – restaurant assez peu cher couru des touristes). On a écrit rouge en noir et noir en rouge histoire de ne pas se fier aux apparences. Dans le même état d’esprit (si on peut dire), on a inscrit « opéra rock » et à la main (façon de dire, une police du genre graphisme littéraire) inspiré du chef d’œuvre de Stendhal ( près de deux siècles plus tard, le vieil Henry doit sourire de la farce).
C’est de trop loin, je sais bien. C’est dans les années soixante-dix, je mets une photo : le croisement de la précédente se trouve en haut de l’image à droite, bord cadre on aperçoit vaguement cette rotonde des vétérinaire, la tour de l’horloge au milieu de la place, des arbres , nombreux. Ca n’est pas de jeu, mais on s’en fout : deux ou trois ans après cette photo, plus une bête ne mourra ici (dans ces bâtiments d’ailleurs jamais aucune n’a péri : un vrai scandale…). Puis on détruira la moitié du cube qu’on voit rive droite. Il ne restera qu’un bâtiment en préfabriqué qui, fin des années soixante-dix, abritera la bibliothèque de l’institut des hautes études cinématographiques – où j’irai de nombreuses fois me documenter pour je ne sais plus bien, peut-être cette maitrise dont l’objet était l’œuvre de Sam Fuller que je rencontrerai à Paris deux ou trois ans plus tard (« ce mémoire, ça flatte mon égo » me dira-t-il fumant son cigare sur le pont Neuf en riant aux éclats). C’est trop loin, l’un de mes oncles (le frère de mon père, lequel était l’aîné des trois) vendait de la viande en Chine (je ne sais plus bien, mais je l’ai vu réapparaître lorsque, pour mon diplôme de sociologie, j’ai rédigé un mémoire sur les études réalisées sur la Villette – il avait témoigné, je crois me souvenir, lors de la fermeture de ces abattoirs ultra-modernes qui n’avaient jamais vu passer une seule bête ni couler la moindre goutte de sang, qu’il fut bovin, ovin, porcin ou caprin ; je ne sais pas si on sacrifiait là des chèvres mais est-ce que ça a de l’importance ? je ne suis pas sûr) (les chevaux quant à eux étaient occis à l’exact autre bout de la ville, non loin d’un parc aujourd’hui dénommé – et donc sans doute dédié à - Georges Brassens) . Je sais bien, ce n’est pas du jeu, ça n’a rien à voir avec la discipline, on s’en fout, certes, l’important c’est que cette petite ville dédiée durant plus d’un siècle à l’abattage des bestioles pour nourrir cette métropole, ce bout de ville tout à l’est, une cinquantaine d’hectares, là, ces lieux, ce territoire, cette portion où en son milieu et lentement coulent deux canaux qui doublent la Seine, ce coin, bordé de boulevards puis bientôt du périphérique, du tram, des voies de la gare de l’Est qui mènent Dieu savait bien où, dans les débuts des années quarante, cet Aubervilliers juste en deçà, en bas du cadre, a vu l’arrestation de mon grand-père venu manger là un couscous. Et depuis plus de vingt-cinq ans, qui est-ce qui, près de cent fois l’an, s’y colle ?
Passage pavé sans nom.
De la rue il semble conduire aux tréfonds du monde, un très grand arbre visible de loin cache en partie le passage et la voie de chemin de fer en surplomb à cet endroit, on entend le train, certains jours plus que d’autres, quand le vent annonce la pluie.
La partie du passage à l’air libre est entourée du coté droit d’un groupe d’immeubles à cinq étages, le ravalement réalisé voici quelques années n’a pas résisté aux intempéries, la peinture a viré au gris sale, marbré, les balcons fermés à la même époque sont surmontés de linteaux qu’on devine roses à l’origine boursoufflent les façades.
Du coté gauche un mur de terre soutient le ballast des rails du chemin de fer.
Deux barrières métalliques de couleur verte s’entrecroisent, empêchent l’entrée du passage aux voitures.
Une mousse très vigoureuse en hiver se répand sans retenue sur les trottoirs très étroits, dessine des arabesques. C’est joli.
La partie souterraine sous le pont du chemin de fer bénéficie d’un éclairage succinct, beaucoup d’ombre et peu de lumière, est souvent jonchée de canettes, mégot et autres détritus, débouche rue Lamartine, zone pavillonnaire aux noms d’écrivains et poètes, un sol pleureur, des véhicules utilitaires en stationnement. Une maison longue à deux étages, au rez de chaussée ce qui ressemble à un magasin de matériel de salles de bain, à l’étage une véranda, côtoie la résidence Lamartine : barre d’immeuble longeant la voie ferrée d’un aspect pourtant HLM. Une grille installée depuis quelques années sensée éviter les intrusions clôt l’espace, suscite une sensation d’isolement et d’enfermement.
Je suis retournée voir à nouveau ce passage sans nom, si souvent emprunté, tenter d’en déceler l’invisible.
C’est un passage bien pratique (non pas pavé mais goudronné), en reliant deux quartiers de la ville il évite un long détour aux piétons. Je l’emprunte irrégulièrement depuis plus de trente ans en allant vers le petit lac ou pour voir un film au cinéma communal de la ville voisine.
Et toujours cette crainte m’étreint confuse diffuse à l’approche de tout ce qui ressemble à un passage souterrain.
Il prend à droite au bout d’une rue animée : mouvements de voitures, de piétons, de parents amenant leurs enfants à la crèche toute proche, des clients du seul commerce de la rue, un café « la petite vitesse ». On emprunte le passage juste au pied de la voie de chemin de fer en surplomb à cet endroit. De loin on ne le voit pas forcément, on distingue une masse de verdure, des conifères et arbustes.
La rue forme un coude et continue à gauche en longeant la voie de chemin de fer, prend le nom de chaussée Jules César. Le début du « passage sans nom » à droite à la pointe du coude longe quelques mètres la voie du chemin de fer dans l’autre direction, indice probable du tracé de l’ancienne voie romaine qui reliait Paris à Rouen. Reste à trouver le mobile de cette rupture.
J’ai compté mes pas à partir de cette bifurcation jusqu’à l’entrée du souterrain, en partant de la barrière croisée peinte en vert avec panneau interdit aux voitures, trente pas, une vingtaine de mètres,
D’un côté le mur de soutènement en terre (armée peut-être) des voies de chemin de fer, de l’autre des immeubles type HLM, le ravalement défraichi à mal vieilli, les murs grisâtres, des traces d’écoulement d’eau de pluie plus ou moins noires autour des huisseries métalliques des fenêtres.
Cette partie du passage ne laisse pas voir l’intérieur du souterrain.
Petit pincement au cœur.
Trottoirs étroits, malgré tout existants, celui de droite longe les haies des immeubles, reçoit la lumière du soleil quand il y en a, celui de gauche, longe le mur de soutènement, toujours à l’ombre et recouvert de mousse verte bien vaillante en hiver.
Les murs du tunnel repeints récemment d’une couleur gris clair, laisse apparaître la forme des moellons, des empreintes de semelles récentes.
Ce jour là un sac de détritus abandonné, éventré, des mégots de cigarettes, des canettes des bière, des crottes de chiens ou d’humain, je ne sais.
Je compte à nouveau trente pas dans le souterrain, à la sortie un plot assez haut en béton gris écaillé bloque le passage aux voitures de ce côté-ci aussi.
On débouche sur le quartier aux noms de rues d’écrivains ou poètes : Lamartine, Alexandre Dumas, Alfred de Musset, Victor Hugo… beaucoup de pavillons sont construit en pierre meulière, d’autres d’allure plus récente, peints, crépis ou les deux. A droite une barre d’immeuble longe la voie de chemin de fer. Depuis quelques années l’installation d’une barrière, digicodes, interphones empêche d’emprunter ce passage pour se rendre à la gare aux habitants des pavillons et autres.
A coté de cette entrée au n°4 de la rue un magasin de vente de pièces d’équipements indéterminés (et non pas de salle de bains), seul commerce du quartier rend sa présence insolite, des véhicules utilitaires stationnent devant l’entrée, personne à l’intérieur du magasin très peu éclairé par ailleurs. Au premier étage une véranda longe ce qui semble un appartement habité, plusieurs portes fenêtres, volets repliés de chaque côté.
Il n’y a rien à craindre finalement.
Une allée bordée d’arbres centenaires, celle d’un château du dix huitième siècle reconverti en maison de repos. Un petit pavillon au fond du parc où des logements de fonction ont été installés pour les employés de l’hôpital.
L’enfant quitte la chaleur de la maison au petit matin, ouvre la porte vitrée en hésitant. Les cimes des arbres griffent le ciel, on dirait qu’elles tentent de saisir les nuées noires qui courent dans le vent d’hiver. Elles sont autant d’ombres menaçantes qui se penchent au gré des rafales glaciales.
Elle franchit le seuil et s’élance dans l’allée. Plus vite, elle arrivera à la route, plus vite le danger se dissipera. À sa droite une maisonnette aux tuiles vernissées qui abritait les jeux des enfants du châtelain. Elle a été restaurée soigneusement, les murs sont couverts de carreaux aux teintes outre-mer et ocre. Elle les devine plus qu’elle ne les voie dans l’obscurité. En passant elle caresse des doigts les aspérités des pierres d’angle, se rassurant de leur forme familière. À l’intérieur il n’y a pas d’esprits négatifs mais seulement des souvenirs heureux de jeux et de pique-nique d’enfants insouciants.
Le chemin se fait plus pentu, elle laisse à sa gauche le grand chêne centenaire ou peut-être millénaire, où un sans-gêne a inséré une capsule de limonade dans un noeud de l’écorce. La capsule brille sous la lune comme l’œil unique d’un monstre tapi sous l’écorce.
Elle lève la tête, attirée par un hululement lugubre qui lui donne des frissons. Le grand duc aux plumes grisonnantes l’observe dans La fourche de l’arbre, elle s’arrête et lui fait un signe de la main par respect et pour tromper sa crainte. Il répond en déployant ses ailes, impressionnant et altier. Elle se demande si son envergure est plus large que la sienne.
Elle préfère ne pas attendre la réponse et court vers le portail. Il faut encore franchir une cinquantaine de mètres en évitant les racines des marronniers qui soulèvent le gorrhe du sentier comme autant de pièges à fillettes. À droite, la masse sombre de l’ancien lavoir luit sous la lune. L’hiver retient l’aube et les ombres de la nuit sont reines. Un chat noir ou peut-être gris l’observe, perché sur le coin de l’âtre où les femmes faisaient chauffer leurs bassines de lessive. Il se lèche la patte droite et son regard brille comme le souvenir de leurs braises.
Il miaule imperceptiblement, elle se demande si c’est une invitation amicale ou un signe de désapprobation. Elle passe son chemin, franchit les grilles monumentales où des lions debout sur leurs pattes postérieures la regardent passer, gueule ouverte.
Le réverbère de la rue lui procure un havre bienveillant. Il neige un peu. Elle se demande si le car de ramassage va pouvoir monter le col. Tant pis, s’il est bloqué, elle n’ira pas à l’école ce matin.
Promenade ou pèlerinage, elle ne sait.
Elle a eu envie de revenir sur les chemins de l’enfance.
Le parc du château est toujours là mais la maison de repos à été vendue à un promoteur qui l’a reconvertie en habitations vouées à la location. Les nouveaux occupants ne savent pas qu’ils dorment à l’endroit où d’autres corps ont souffert et sont morts il y a à peine cinquante ans.
Elle retrouve le petit pavillon au fond du parc, les fenêtres ont été changées satisfaisant aux normes internationales d’économies d’énergie. La porte vitrée n’existe plus, remplacée par une porte massive avec un digicode-robot qui la nargue.
Elle reprend le chemin qui serpente entre les arbres. La "maison de poupées" n’est pas en ruines même si quelques carreaux vernissés ont disparu probablement vandalisés par des inconscients. Elle se penche aux carreaux et tous les rires des amis de son enfance raisonnent à ses oreilles. Elle sourit.
Le chemin est plus ardu que dans ses souvenirs. Elle cherche le grand chêne et le reconnaît à sa capsule de limonade, qui est plus près du sol que dans son enfance. Elle réalise qu’on l’a mutilé d’une grande partie de sa ramure et qu’il fait triste mine. Elle cherche des yeux le grand duc mais il n’y a qu’un écureuil insolent qui sautille le long du tronc et disparaît à la cime plus vite que son ombre.
Elle suit le sentier qui mène au portail dont on a fait disparaître les grilles de fer ouvragé. Elle se demande où sont partis les lions et leur fierté princière. On a goudronné le chemin, contraignant les racines à rester confinées dans le sous sol. Les divinités maléfiques qu’elle imaginait la suivre jusqu’à son arrêt de bus, ont quitté cet endroit, dégoûtées par la modernisation du site. Le lavoir à été conservé comme une relique et une plaque y a été apposée pour expliquer aux touristes, la manière dont les lavandières venaient à bout de leur travail en ces temps anciens.
Le chat noir est absent mais un chaton blanc et noir la regarde en se lissant les moustaches.
Il n’y a plus d’arrêt de bus, la ligne a été supprimée devant la désaffection des usagers, il y a déjà une dizaine d’années.
Elle regrette de ne pas avoir gardé ses souvenirs intacts et remonte dans sa voiture. Elle quitte les lieux sans un regard en arrière, au moment où un chat noir traverse devant elle. Elle freine brusquement, le cœur au bord des lèvres, le chat lui jette un regard de braise, et saute d’un seul bond sur son capot. Il s’approche du pare-brise et la fixe pendant quelques secondes puis se détourne et saute dans le fossé. Elle reprend son souffle et redémarre, un peu mal à l’aise. Elle serait prête à jurer qu’il lui avait fait un clin d’œil avant de disparaître.
Rue peu fréquentée, les pas résonnent sur le trottoir... Ce jour assez irréel dont on ne se souvient pas vraiment et qui pourtant a fait date, puisque c’est ce jour-là qu’a débuté la longue marche loin d’un lieu de vie alors familier qui s’inscrivait dans l’espace comme une eau-forte gravée pour l’éternité... Sa représentation mentale sous la forme du souvenir en a gardé les contours nets, mais entre les bords coupants s’étale en coulées approximatives un ensemble de réminiscences assez floues qui dessinent un paysage tremblant difficile à reconnaître... Il faudrait pouvoir améliorer la visée, régler la focale, superposer les prises de vues, soupeser les strates de la mémoire, imprimer le palimpseste, le corriger, le retoucher... Travail sans fin d’une tentative de reconstitution d’un temps à jamais perdu que l’on voudrait avoir l’illusion de pouvoir faire revivre mais qui continue de glisser entre les doigts comme le sable... Les pas résonnent sur le trottoir... La rue est déserte, la maigre lumière des réverbères laisse entrevoir au loin une silhouette mystérieuse qui, à tant d’années de distance, m’obsède comme un appel indéfinissable... Le geste d’allumer une cigarette, le rougeoiement de la flamme sur fond d’obscurité profonde, la clarté tutélaire de la lune, le ciel froid très étoilé, les particularités de cette scène me reviennent souvent en mémoire comme les éléments récurrents d’un rêve ou d’un cauchemar... J’essaie tour à tour de noter, sans résultat probant, les souvenirs objectifs que je peux en avoir ou au contraire de m’en détacher pour tenter de retrouver sous des angles différents, à d’autres moments-clés, ce territoire arpenté jadis et qu’une sorte de glissement de terrain a fait disparaître de la surface de ma vie... Mais l’obscurité revient sans cesse obstruer les échappées possibles... une obscurité sonore, qui amplifie des bruits de pas heurtant la chaussée ou le trottoir... il est assez évident que ce sont mes propres pas qui résonnent, mais j’entends aussi comme en contrepoint un choc plus sourd qui semble provenir de l’endroit où marche devant moi la silhouette d’un homme que je ne reconnais pas... Mes efforts de mémoire me ramènent toujours à ce type de scène comme si la lumière du jour n’avait pas existé, je ne me souviens spontanément que des journées écourtées de l’hiver et de l’atmosphère assez inquiétante qui régnait dans cette partie de la ville... Je n’ai aucune raison de retourner là-bas. Le désir de retrouver des sensations premières n’est pas assez fort pour que j’entreprenne le voyage... Un début de curiosité me conduit à tenter avec Google Street une confrontation virtuelle entre mon passé imaginaire et une certaine réalité qui m’aidera peut-être à retrouver des points de repère... La mémoire du coeur reconnaît immédiatement les petites maisons de la rue où j’habitais... elles n’ont pas changé, il y a même encore les jardins ouvriers en face d’elles, la pression foncière de l’agglomération ne les a pas encore fait disparaître... des images fraîches et lumineuses ouvrent une brèche dans le mur de ma cécité... j’aperçois une petite fille brune qui se rend sans hâte de la maison à l’école, et de l’école à la maison, en suivant un mouvement de balancier aussi régulier que celui de la trajectoire des astres... elle marche le plus souvent aux heures sombres du matin et du soir, mais quand il neige, le monde est merveilleusement blanc, et le printemps coloré finit par revenir après l’hiver... Il me souvient que les rues du faubourg ressemblaient à celles d’un village... Plus grande, alors que je n’y habitais plus, je venais parfois me promener dans mon ancien quartier que je trouvais plus accueillant, où l’air semblait plus léger... je rejoignais ainsi la face claire de mon enfance qui s’éloignait déjà, de noirs tourbillons l’emportaient pour toujours loin de moi... La rue était déserte, des bruits de pas résonnaient sur les pavés... il y avait eu ce bruit crissant, ce choc, ce sang... le monde qui bascule, une silhouette qui s’écroule... la vie qui continue sans... plus loin...
Bas de colline, en étoile, elle dessert les quatre point cardinaux ; la rigole centrale des pavés reprend ce motif avec la bouche d'égout au centre. Combien de clés perdues dans ses fanons ? Il faut demander au service de la ville mandaté pour dépanner ce petit pourcentage malchanceux de la population. Le pavage déclinant toutes les nuances d'un échéancier de gris, a été refait récemment. On a déshabillé la rue, découvrant le sable, et les croisements emmêlées des canalisations. C'était donc comme ça ! On a tous oublié cette nouveauté comme la promesse faite le premier jour à une paire de chaussures d'un cirage quotidien ; dans les rainures, beaucoup de mégots, de vieux papiers, des bouts de verre, des végétations toniques.
Les immeubles de cette place à l'italienne sont de tailles inégales, mais obéissent aux lois de la perspectives. A leur seuil, toujours un commerce.
Comme tous les jours, avec une interruption au mois d'Aout, Madame Garçon a ouvert son Tabac- Presse- Loto à 6h et demi du matin jusqu'à 8h du soir. Sur un panneau adossé à la devanture, la famille de Monaco, en pièce montée, le père, la mère, les princes et le sapin, un peu crispée. La guirlande lumineuse de la vitrine est éteinte, et le père Noel en feutrine, occupant la place centrale parmi des figurines en pates de verre, n'en a plus pour longtemps. Son traineau en décalcomanie annonce encore la super cagnotte avec un gain de 25000 euros. Des affiches sur la porte d'entrée ; « 59 morts sur les routes en 2016, c'est mieux ».
La boite aux lettres jaune avec ses deux bouches, « Ain- Rhône » et « autres départements- étranger », levée à 14 heures.
Une gouttière sert de point de ralliement à un ensemble de fils disparates qui veinulent le mur et qui disparaîssent dans un boitier couleur frigo ; C'est un immeuble qui a la fibre ; rien n'est prévu à cet effet dans le cahier des charges des bâtiments de France pourtant bien sourcilleux.
Un gros 4x4 gris garé sur le trottoir. C'est celui de Patrice qui tient le théâtre de la Maison de Guignol ; fierté des yonnais avec les grattons et la cervelle de canut. Une manne ; une carte de visite pour la place où son effigie est reproduite sur presque tous les immeubles, en fer forgé, en bois, en murs peints ; c'est la grotte de Bernadette, version puppets.
La devanture de l’entrée avec fanfreluches en velours et passementeries, comptoir en bois, et coiffe de baldaquin a des allures de lupanar. Le lieu tourne à toute heure comme un cinéma X. Une guirlande en néon violette épouse les contours des vitrines, « Guignol est les lapins samouraîs » a balayé « Guignol et les briguandins de Noel » ; le soir café- théâtre avec « Chassez le naturiste, il revient au bungalow », « une merguez dans le couscous » et le retour de « la boulette » . Adrien fait les comptes, le patron souffle sur le palier, le regard vague.
Le café du soleil est aussi brumeux et abandonné comme un jardin l’hiver, les tables et chaises vides, pots de fleurs gelés, un palmier égaré. On ne sait pas trop à cette heure si le restaurant est ouvert ou fermé. Des branches de sapins avec des grappes de boules de Noel en boucle d’oreille habillent l'enseigne avec Guignol et Gnafron en symétrie. Le restaurant tient son nom du soleil joufflu qu’il porte sur le fronton de l’immeuble en part de gâteau. Aux angles, dans leur corniche, la Vierge et Joseph, les pieds mangés par les fientes de pigeons ; ils ont, même grignoté sa main.
La montée est déserte, elle débouche sur le blanc du ciel.
De couleur sang de bœuf, l’immeuble du Kamou, boite de nuit fermée à la suite à un règlement de compte, transformée pour la survie en bar à crêpes, et spécialités exotiques. Une Joconde noire est assise devant la porte, derrière sa crêpière et ses pots de confitures. Imperturbable. Dans le froid. Cette Vestale attire comme un aimant, on en oublie le toit aux tuiles arrondies comme des écailles de dorade . Elle éclipse aussi la devanture du Noctambule, alias la Crise, alias initials BB, alias boutiques de BMX. A cette heure, en début de semaine, il n’existe pas. Peinture grise, vitres noires. On a du mal à croire que c’est une pizzeria qui est ouverte toute la nuit. Pourtant la façade de l’immeuble est pimpante et orangée. elle a même eu droit, sur les fenêtres murés, à la sainte famille Guignol, Madelon, et Gendarrrme.
Place de la trinité. Vendredi 15 Mai 2015. 16h30. Température 30°.
Descente des collégiens ; par trois ou cinq, plutôt des numéros impairs, ils jettent leur jambes dans la descente, en faisant claquer leurs baskets, les épaules en arrière juste retenues par leurs sacs, enfin libérés d’être enfermé dans une salle surchauffée ; ils s’ébrouent.
Eclats de rire avec différentes tonalités ; un rire en basse, un autre essoufflé mais constant comme lorsqu’on reprend son souffle et puis l’alto. Les corps des demoiselles qui se plient d’un côté de l’autre pour venir se soutenir épuisées contre le mur ; le sac de cours qui ressemble à un sac à main, tombé au plus bas sur le bitume.
Dans une porte cochère un garçon embrasse une fille, sérieux, voluptueux, sous le regard des copines qui minutent le baiser.
Des enfants arrivent en courant devant le tabac. L’un deux rentre dans la boutique, les autres attendent la distribution qui s’en suivra. En devanture, sur fond noir, un visage avec le regard masqué, « Séquestrée par son beau- père, la martyre de Sussy en Brie raconte son cauchemar », Voici titre « Les plus belles montées de marches ».
Des prospectus de la Maison de Guignol sont éparpillés sur le pavé avec des Petits Bulletins piétinés. Allégrement.
On entend le rire du guide des traboules suivi d’un »salut gone » ; un connaisseur des indigènes qui fait sourire les grappes de touristes.
Marie apporte des bières sur la terrasse du café du soleil qui s’étend sur la chaussée. Les nappes aux tournesols ont été mises sur les tables, coincées par des pinces.
La dame de la galerie, déserte l’art brut, en plein soleil, pour venir se rafraichir au bistro d’en face et fumer sa clope. Elle porte une grande robe à crinoline noire et des cheveux corbeau ; elle a l’air de sortir d’une de ses installations.
La tenancière du bar à champagne initials BB plie sa correspondance. Bien potelée, perchée sur des mules à hauts talons, sanglée dans un legging en cuir, et une nuisette flottante, elle s’en va poster son courrier. La double contrainte des talons et des pavés, auquel il faut ajouter la chaleur épaisse comme un rideau, l’oblige à une démarche lente, chaloupée comme si elle attendait que sa croupe suive bien le reste avant d’entamer le pas suivant.
Passage des voitures régulier en contrebas, c’est l’heure des départs en week-end.
Les sifflements des martinets ont repris. Ils commencent leurs vols circulaires et le dessin de leurs cercles aux circonférences multiples autour du ciel de la place ; parfois, s’arrêtent à la verticale sur les murs, pour une brève pause.
Le vieux chat déborde d’un pot de fleur au rebord d’une fenêtre.
La rue Hugla, une ruelle étroite bordée de très hauts immeubles de pierre noircie, aux pavés irréguliers, un mince couloir de ciel au-dessus. Pas de place pour les trottoirs. Un vrai coupe-gorge Le numéro 8 est très proche du début de la voie. Difficile d’imaginer qu’il y ait trois portes d’entrée avant. Celle du 8 est épaisse et bleu vif. Quand on l’ouvrait, on tombait sur un long corridor au bout duquel on montait l’escalier jusqu’au troisième étage ; on entrait par la cuisine (à peine une cuisine) aux murs bleu roi, un lit de 90 com dans le coin à droite, la cheminée hors d’usage dont il restait le manteau, puis l’évier et la cuisinière à gaz, en face le bac à douche. A côté, la grande pièce, tendue de doublure satinée orange vif par le Grand Georges, un jour de grand speed. Dans la rue, toutes les fenêtres des rez-de-chaussée sont munies de barreaux.
Rêve
Toutes les ouvertures des immeubles ont été murées. On discerne cependant leurs traces. Leur surface est lisse et colorée comme un crépi de pays méditerranéen. Je suis ivre et titube sur les non-trottoirs de la rue Hugla. J’ai bien fait d’écrire qu’il n’y a pas de trottoir. Je cherche les numéros du côté pair. Ma curiosité me pousse jusqu’au bout de la rue qui fait un coude vers la droite et redevient alors un de ces boyaux de la vieille ville aux pavés luisants, un vrai coupe-gorge.
Pavés au sol très très irréguliers (vraiment de quoi se casser la figure pour qui s’aviserait de courir dans ce coupe-gorge) ; au centre, la trace du caniveau d’avant les égouts. II se confirme qu’ il n’y pas de trottoir. En cette froide après- midi ensoleillée de janvier, une camionnette, warnings allumés, occupe toute la largeur de la rue. Le conducteur ( ou présumé tel) debout à côté du véhicule, me regarde avec suspicion, d’autant plus que je m’assois sur un petit perron de trois marches pour prendre des notes. Son acolyte passe devant moi. Il ne me demande pas ce que je fais là.
Les façades ont été nettoyées. La pierre jaune envoie un peu de lumière. Toutes les fenêtres des rez-de-chaussée et entresols sont protégées par des barreaux. La porte du numéro 6 est ouvragée : un linteau de pierre sculpté, comme un reste d’architecture renaissance. Au numéro 8, la porte est toujours bleue. Il y a maintenant un visiophone. L’immeuble appartient à la partie droite d’une ancienne maison dont on voit le pignon en levant la tête vers le mince couloir du ciel au-dessus. Les fenêtres sont hautes et étroites comme des fenêtres à meneaux dont les meneaux auraient disparu ; au troisième étage, la fenêtre à un seul vantail de la cuisine bleue. L’espace de pierre qui la sépare de la fenêtre à deux vantaux de la grande pièce (plutôt chambre que séjour) est très étroit. On pouvait enjamber cet espace extérieur pour échapper à l’oppression de la chambre quand les murs et les objets se resserraient, et se réveiller au matin, une blessure au front, dans le petit lit de la cuisine.
16, rue des Dom’s est la phrase toujours entendue comme appartenant à la mythologie familiale de ce cercle dans lequel j’entrais jadis. Un lieu plein centre, très ancienne rue. Un été j’y descends. Depuis les portes dorées de la place Stan on lit l’enseigne, au premier étage de la vieille maison étroite touchant le ciel nancéien. Les rues se frôlent, s’emmêlent, c’est toujours un mouvement. Les Dominicains et l’Art Nouveau imposent leur passé partout jusque dans les devantures des magasins sur les pavés froids. Au 16, il y a cette avancée qui vous appelle, où se présente solennellement orfèvrerie et bijoux haut de gamme. Une vitrine où se reflète l’œil enfant à taille d’homme, des yeux de six ans qui prendraient en plein iris un boomerang de boîtes, bagues, timbales, croix, maquettes argentées et pâte de verre (peut-être Amalric Walter ?) comme un cadeau. Aucun éclat étincelant seulement la beauté mise à disposition de chaque cœur, une famille vous accueille même sous la forme brochée d’un chardon piquant. Un pas de côté, vous passez sous le porche où s’abriter de la pluie comme des regards, où admirer l’art en toute discrétion. On n’entend déjà plus la rue, on est entré ailleurs. L’on peut déambuler jusque devant le 16 sans vous y voir. Les sons hip-hop des lycéens ne vous atteignent plus. Vous êtes un peu reclus et gagnés par le satin duchesse de l’endroit. Et même si d’autres yeux observent presque à vous toucher ils n’y sont pas, vous êtes seul. Et vous voyez. Juste au fond du porche, très vite une porte costaude précède la boutique et vous impressionne toujours même si vous connaissez les derniers à y travailler (y entrer ? comment parler ? quels mots poser sur cet écrin ? seront-ils bien choisis ? simples ? mes vêtements ne sont pas chics, tant pis je fais un pas et mon sourire, ma joie de pénétrer seront mon mot d’accueil). Sur la porte, les initiales du fondateur, J.J. (le prénom étant celui qu’il se faisait donner) et le nom de la maison, simplement noirci sur le fond grisé de la porte vitrée. La poignée, grosse et carrée, est le premier contact charnel avec cette famille, comme une main empoignée, serrée, celle du bisaïeul démiurge que l’on salue gravement ainsi en entrant. C’est lui le doreur argenteur qui le premier a imaginé ce lieu d’échanges. C’était 1875. La nuit, des grilles noires géométriques pour protéger simplement la maison dont le nom seul noir et blanc du store est depuis passé dans les conversations. L’éclairage public soutient sa déjà longue existence. Porte poussée, surgit l’imposant mais discret comptoir en bois clair qu’illumine doucement une grosse lampe blanche comme un chevet sur une intimité rassurante, le bois lourd posé au-dessus de l’ancienne moquette rouge. Derrière le comptoir c’est Catherine, ses colliers, bagues, sourire authentique. Au fond, François à son atelier, le frère joaillier et sa femme aux comptes. On s’y trouve là comme deux siècles passés et l’on a l’idée d’imaginer que s’y cache un coffre-fort ; à l’ombre duquel sont conservés contrat et papiers de J.J. ; on sent l’odeur d’une vieille maison de famille baignée dans l’orfèvrerie religieuse (pour quelles croyances ? peu importe et la fabrique d’une porte de tabernacle nous dit juste que l’art sacré sort aussi de ces murs). Et toujours l’espièglerie enfantine nous étreint en observant François et Catherine, en les écoutant montrer, raconter. Et rien ne semble impossible, on se débrouille même pour réparer une crosse épiscopale en vermeil comme une canne de marche. Drôle d’impression cette entrée sur la rue, accessible à tous puis ce porche où celui qui ose avancer est conduit au sein même du nid d’or. Derrière le comptoir un escalier comme dérobé vous emporte sur cinq étages (absolument nécessaires pour loger tous les enfants et les ateliers). Gravi une ou deux fois, je me souviens des meubles non voulus, des jouets d’enfant, d’un évier où l’eau coule encore l’âme du lieu.
Aujourd’hui la longue façade vers le ciel est toujours coincée entre deux gros blocs d’une autre histoire, quatre fenêtres à persiennes contiennent encore (pour combien de temps ?) la vie des gens qui ont respiré ces murs. Un grand panneau blanc vient barrer l’entrée, l’échafaudage grimpe au faîte et referme la pierre sur son secret. Le porche est entravé mais je sens à 900 kilomètres que la maison J.J. vit en flocons d’argent, chacune des poussières étant façonnée par un orfèvre, là, qui vous sourit tendrement. Porte close 140 ans après sa création, le jour où l’un des jeunes enfants se mariait pour un an. Les liens et le mouvement sont encore là, tenaces, sacrés et si Catherine et François ont quitté les lieux l’escalier continue de conduire au sommet où, assurément les diamants de chacun prodiguent encore une chaleur vive. Les créations vendues, liquidées vivent ailleurs. Mais le 16, rue des Dom’s c’est toujours la vie même, les travaux aux deux extrémités du cycle humain, un atelier permanent ; tant que l’homme rénove c’est que le lieu appelle et renvoie des battements de cœur. Encore associé à la place Stan et à ces rues croisées du centre, son histoire est à présent écrite dans une même éternité mythologique que l’autre adresse au temps de Vittel 1923, R.J., ses diadèmes crées pour la reine du Cambodge, l’enfant Hassan II touchant à tout réprimandé vertement par sa nounou. Impossible pourtant de poser un pied dans cette maison. Le présent est une page blanche ; laissons-la naître d’un autre feu. Les murs sont devenus le coffre-fort où le nom existe pudiquement, serti de longues années où l’on offrait à la vue des badauds le beau, rien que ça mais aussi, un peu, l’odeur de l’âme. C’est précisément ce que j’allais chercher, descendant en ville, ce parfum qui vous ceignait comme des bras maternels. Aujourd’hui vous passez devant l’enseigne en travaux, contournez la camionnette de plomberie, longez les barres de ferraille superstitieuses mais savez maintenant qu’à l’arrière tout était verni du trésor familial.
Les maisons de chaque côté de la route constituent le Centre du Bourg. La route ce n’est pas une petite rue mais la « grand-route » Les portes d’entrées des maisons s’ouvrent sur elle. Il n’y a pas de trottoirs seulement une rangée d’arbres. Des pins. Leurs hautes branches donnent du recul aux maisons comme une protection. Dans cet espace, il y a parfois échouées à terre des charrettes remplies de bois. Les enfants peuvent traverser la « grand-route » sans danger. Il n’y a pas de voitures, seulement des bicyclettes. Un petit garçon, mon père, tient à la main un petit bateau en bois « Le Paris ». Au milieu de la « grand-route » un homme, une casquette sur la tête et des galoches aux pieds, avance d’un pas décidé. Devant une pancarte indiquant la direction « S-C » une petite fille tient un chien en laisse. C’est une chienne, elle s’appelle Peggy. Derrière la pancarte une murette s’allonge jusqu’au portail fermé sur un petit parc. Au fond du petit parc il y a une grosse maison à étage, avec un corps de bâtiments en forme de L qui lui donne un air important. C’est dans cette maison que mon père, l’enfant au bateau, est né. C’est là que je suis née, pas très loin de la « grand-route ». C’est là que nous sommes tous nés, ma sœur, mes frères. Notre père s’est marié avec la petite fille qui tient en laisse Peggy la chienne. De l’autre côté de la « grand-route » les maisons sont collées les unes aux autres. Dans une grange à côté des bottes de foin, sur le sol incliné, la terre battue bien balayée, on met des bancs et plus haut un écran de drap blanc. C’est là que j’ai vu mon premier film. Une histoire de Noël avec Tino Rossi. Dans un jardin plus loin, une Éolienne tourne avec le vent.
La « grand-route » je le sais assurément c’est la Nationale 10, celle au bord de laquelle nous regardions passer à deux heures du matin les cyclistes du Bordeaux-Paris. L’appellation « Le Bourg » n’est plus.« Le Bourg » ce sont les maisons vers l’Église. Mon lieu est débaptisé. Désormais je suis née au « Carrefour ». Un lieu où se croisent plusieurs routes. Il y a une épicerie, un bar, un routier. De nombreux véhicules remplissent le parking. Jour et nuit, sans discontinuer, des voitures, des camions roulent sur la Nationale 10. Le Carrefour, ses habitants, sombrent dans une symphonie assourdissante. Une symphonie qui gâche mes vacances d’été. Avec toute cette circulation les enfants ne peuvent plus traverser sans danger. Les adultes non plus d’ailleurs. Les pins ont été arrachés. Ils cachaient la visibilité. Le gris partout remplace le vert. Les portes, les volets des maisons sont fermés. Les bicyclettes ne circulent plus. La salle de cinéma n’existe plus. La grange est devenue une belle maison sans fenêtres ouvertes. Pour aller voir un film il faut prendre la voiture. Dans le jardin plus loin il y a toujours une Éolienne qui tourne avec le vent.
La Nationale 10 est déviée. De jolis prunus remplacent les arbres déracinés pour cause de visibilité. De beaux trottoirs ont été aménagés. Il y a même des bacs à fleurs, des gerbes de lavande. L’épicerie avec son bar-restaurant, est rajeunie, agrandie. Les routiers, les habitués choisissent de s’y arrêter. Un nouveau parking est ombré de pins parasols. La maison de mes parents est toujours là dans le petit parc. Une belle véranda protège la porte d’entrée. Devant la façade du corps de bâtiments, jaillissent les roses trémières. Les enfants courent, traversent la grand-route juste à côté. Les bicyclettes sont de retour. La belle maison, l’ancienne grange cinéma, ouvre ses fenêtres. C’est l’été. J’entends le silence. Dans le jardin plus loin il y a toujours une Éolienne. Elle tourne avec le vent.
28 décembre 2016 / Dès l’instant où mon corps arrive à l’angle de la rue Léon Nautin et de la rue Pointe-Cadet, mon regard s’élève sur le troisième et dernier étage de l’immeuble situé un plus loin sur le côté opposé, à mi-chemin de la rue. Cela ne peut être autrement. Les fenêtres, en cet après-midi de décembre, sont baignées de soleil et je sais ainsi le soleil qui réchauffe les murs intérieurs. Il y a bien longtemps que plus personne à la fenêtre ne me fait un signe de la main. Mon regard se déplace, redescend, ignore quelques façades et glisse jusqu’au premier étage de l’immeuble situé juste en face de moi : seule la porte fenêtre donnant sur un balcon minuscule a les volets ouverts ; peut-être la mère âgée de mon amie d’enfance vit-elle encore là ( j’ai vérifié son nom sur l’interphone) recluse dans une seule pièce qui, si je me souviens bien, servait d’atelier de tailleur à son mari.
Il n’y a plus de voitures en stationnement, c’est cela que je note en premier. La rue a toujours cette légère déclivité, le point le plus haut étant à l’opposé de ma venue. Je reste au bas de cette rue, du côté pair, au niveau du numéro 10 ; le trottoir en face a pris de l’embonpoint, grignotant quelques mètres sur la chaussée, mais aucun piéton en ce jour ne viendra animer l’asphalte. Je me sens un peu voyageur esseulé regardant avec hébétude la futilité d’un jour. Je sais depuis longtemps que les magasins d’enfance ne sont plus, hormis la fabrique de pâtes fraiches Cornand, renommée dans cette ville, qui aujourd’hui a le look d’une épicerie fine ; ce sont des restaurants qui se sont implantés et modifient l’aspect et la fréquentation de ce passage. Je suis pratiquement adossée, vue l’étroitesse du trottoir à cet endroit, à une boutique vide et apparemment en réfection qui reste pour moi la droguerie, un de ces magasins qui n’existent presque plus dans nos villes ; je me souviens d’un homme à blouse blanche, grand et chauve, qui officiait derrière sa banque allant chercher dans des rayons en hauteur ou dans sa cave ce qui lui était demandé ; je n’arrive plus à définir l’odeur particulière qui régnait là faite d’un mélange de produits dont des noms refont surface : thérebenthine, papier d’arménie, alcali, encaustique….Il me semble me souvenir que ce droguiste a été agressé dans sa boutique mais ce ne sont que bribes détricotées d’un passé peut-être erroné. Maintenant au travers de l’étroite vitrine je distingue un espace restreint avec dès l’entrée sur la gauche une trappe ouverte laissant voir l’escalier conduisant dans les profondeurs. Point de panthère, lion ou louve dans les parages, ni de Virgile pour apaiser mes craintes. La porte est bien fermée et je reste dehors. Mon alphabet de souvenirs se brouille, l’image se désintègre et tout se superpose en un court-circuit empli de doutes .
Si j’avance de deux pas à peine dans le sens de la montée de cette rue, c’est la boutique d’un encadreur qui a pris place avec ses deux vitrines où un Joyeuses fêtes écrit à l’encre blanche devrait inciter à venir faire l’achat de ces dessins à l’encre de chine encadrés d’une large marge couleur crème . Si je reviens sur mes pas, c’est la cordonnerie de l’angle « L’espace chausseur » qui m’offre à méditer sur deux hautes vitrines avec des semelles et des embauchoirs de tailles différentes : s’impose le geste de mon père les glissant dans ses chaussures afin d’élargir un peu leur forme.
Mon regard, dans sa hâte de tout noter, revient sur la rue, cherche à glaner pour la main quelque détail, un bruit, l’écume de l’instant, dans cet entre-deux de l’endroit pour seul guide. Les yeux s’abaissent, notent les pavés , peut-être les derniers dans cette ville, recouvrant la jointure des deux rues, et se fixent sur une toute petite plume blanche tachée de noir sur un côté, posée sur une pierre. Sourire sur mes lèvres, comme si un trésor brillait. Je photographie pour ne pas oublier. Je me revois, accoudée à la fenêtre de la chambre , là tout près au troisième étage : je regardais le vol des hirondelles, et m’enchantais de leurs petits cris rapides… brins de vie refaisant surface, ombres ensoleillées. Au retour, en regardant la photo , je verrai deux plumes, la plus grande ayant échappé à mon regard . Mon père était souvent auprès de moi pour regarder les hirondelles.

5 janvier 2017/ Quelques jours plus tard, je reviens au même point . Une camionnette blanche est garée je ne sais trop comment à cheval sur trottoir et rue, obligeant à décaler mon poste d’observation. Elle occulte la vitrine du cordonnier. Cela me contrarie. Mes fenêtres sont encore ensoleillées mais plus pour longtemps car il est un peu plus tard dans la course du jour. D’où je suis, j’essaie de faire l’inventaire des magasins de la rue côté impair, celui où je marchais le plus souvent :
– au numéro 1 : un magasin de vêtements pour hommes, de qualité/ c’était une épicerie Casino, mais nous n’y allions pas
– au 3 : une boulangerie qui semble fermée/ cela a toujours été une boulangerie
– au 5 et 7 : c’est le magasin de pâtes fraiches et épicerie fine/ ma mère y achetait les raviolis et les gnocchis ; ce furent les mêmes vendeuses pendant si longtemps...
– je ne sais pas où est le numéro 9 !
– le 11 est un restaurant/ je revois très nettement un pressing avec ses odeurs si fortes qui s’exhalaient lorsque nous discutions sans fin Astrid et moi au pied de chez elle
– le 13 est l’entrée de l’immeuble d’A. mon amie/ pas de changement si ce n’est l’installation d’un interphone et d’une porte bien fermée
– le 15 est cet immeuble qui avance et réduit de beaucoup le trottoir avec un magasin d’objets anglais ou une brocante, je ne sais pas vraiment/ c’était une patisserie et là dans les étages vivaient des amis de mes parents et leurs enfants avec qui j’échangeais des timbres
– le 17 un porche avec à côté une vitrine sale et vide/ le bouquiniste « Vers et prose » était là avec les « Sylvain et Sylvette » que je convoitais dans une des deux vitrines, la plus petite ; mon père regardait l’autre avec les livres de poésie de couleur bistre qu’il affectionnait
– le 19 un restaurant « les pieds sous la table » (il faudra que j’aille y manger)/ c’était la boulangerie, la mienne , celle où l’on me prénommait Chantal une fois sur deux et où on achetait le petit pain au lait le jour de la rentrée des classes. C’était aussi l’entrée de la traboule , désormais fermée à clef, que j’empruntais pour aller au petit lycée
– le 21 mon allée à laquelle s’est adjoint un grand porche pour laisser le passage aux voitures pouvant stationner dans la cour/ à la place du porche c’était un café sombre avec une tenancière acâriatre et criarde qui m’effrayait
– le 23 est le restaurant « Pachamacha » avec les trois mêmes marches qui montaient à L’étoile blanche, une toute petite épicerie où j’allais chercher le lait et où on rendait les bouteilles en verre consignées
Le reste de la rue reste plus obscur dans ma mémoire, mais je note la présence de trois restaurants côté impair et en compte aussi trois autres côté pair : changement de mode de vie, de population...Les épiceries et boulangeries ont fermé mais les boutiques sont ouvertes et laissent encore imaginer une vie qui fait défaut à beaucoup de rues de cette ville. Machinalement je recherche les plumes, qui ne sont plus, mais découvre au pied de la boutique en réfection (et que je nomme encore ma droguerie) quelques brins d’herbe raidis de froid et qui m’émeuvent, dont un petit bouquet dans le conduit éventré d’un cheneau qui descend du toit au trottoir. Il fait très froid alors je marche un peu dans la rue et constate avec intérêt l’offre de location pour trois appartements dans trois immeubles différents dont le mien et je me prends à rêver : je note le numéro de téléphone au cas où l’envie de visiter me dévorerait...Je ne m’éternise pas.
En repartant, je vois que la boulangerie toujours fermée, entre l’épicerie fine et le magasin de vêtements se nomme Boulangerie de l’aube… Au-dessus le ciel bleu ; je n’ai pas vu les gens. Je me prends par la main avec le poids du temps.
Je me connecte sur Google view et voit des incohérences manifestes alors que j’étais si sûre des souvenirs lointains et récents : il faudrait reprendre mot à mot, pierre à pierre ce qui serait encore une autre forme de réel. Une autre veine à creuser. Une échappée.
L’arrivée au feu est rapide, la station soudaine. C’est une sortie d’autoroute, courte, un virage dans lequel les voitures se départagent sans hésitation possible. Deux files peintes sur le bitume. En tournant à droite, on bifurque vers Romainville. En face, on s’engage dans un rond-point qui irrigue vers Montreuil. Il n’y a pas de panneaux de direction, on le sait seulement. Comme toujours, trois colonnes de voitures se forment en chevauchant les lignes peintes, une pour tourner à droite, deux pour la direction Montreuil, et s’arrêtent. On suit là le souvenir d’un marquage plus ancien, modifié il y a au moins cinq ans, invisible désormais. L’usage est resté, au mépris du nouveau code et de ces files dessinées trop larges pour n’être que deux.
Le regard, entre deux surveillances de feu ou de rétroviseur, ne parvient qu’à se poser sur les points habituels, vérifie. Devant, le passage piétons. Aucun piéton n’a traversé. Aucun piéton dans le champ. Au-delà, sur l’espace gazonné du rond-point, les arbres énormes, un cèdre, un saule pleureur, un autre qui a perdu ses feuilles. A droite de la route, végétation de bas côté, buisson bas indistinct, ni persistant ni complètement éteint par l’hiver. A gauche, une sorte de haie plus verte. Elle se creuse et devient plus fine sur un mètre ou deux : défaillance du végétal à cet endroit ? ou cicatrice laissée par une débroussailleuse ? Dans ce renfoncement transparaît un grillage vert. Deux panneaux accrochés au grillage (comment d’autres n’y ont-ils pas pensé ?) profitent de l’emplacement : Recherche viagers, un 0-6. Tout type
Traitement – le bas du panneau n’est plus là. Toujours à gauche, le poteau du feu, sur lequel les regards se posent.
Le feu passe au vert. Redémarrage obligatoire, en côte mais nul ne tarde. Pas de coup de klaxon, tout le monde a réussi la synchronisation pressée.
Ce que conditionne la durée du feu.
Coup d’œil au vide-poches dans la voiture, main fourrageant le sac pour trouver le porte monnaie, l’ouvrir, constater le contenu, calculer le restant nécessaire pour le parcmètre à l’arrivée, saisir les pièces disponibles, de l’autre main descendre la vitre, changer les pièces de main, simultanément appeler du regard ou bouger la tête pour qu’elle ait le temps de s’approcher...
Elle demande : « Bonjour Madame, ça va ? »
Et rien de plus.
Ce qui conduit le regard à parcourir l’insignifiant autour.
Eviter de croiser le sien, de s’attarder sur celle qui attend ici des centaines, des milliers de passages du feu au rouge ; suit l’arrivée de chaque voiture depuis l’autoroute ; voit les jets de papiers, cigarettes, par les vitres baissées ; se détourne des camions inaccessibles ; saisit, à travers les pare-brise des voitures, les mouvements, les signes, les velléités ; a vue sur chaque centimètre carré du carrefour, sec, mouillé, glissant, balayé par le vent, éclairé par le jour ou le lampadaire. Forcément seule à rester là, épuisant le rien que l’emplacement peut procurer. Saurait la statistique des regards qui se fixent ailleurs, qui stagnent, qui prennent en compte.
Elle marche sur le bas-côté gauche, longe les cinq premières voitures à l’arrêt, revient sur ses pas et se replace au niveau des deux panneaux accrochés au grillage. Recherche viager... Tout type de couverture Traitement de charpente…
Sa présence ou son absence que le coup d’œil du conducteur note en premier.
Depuis quelque temps, c’est moi qui ouvre la structure. Il n’est pas neuf heures. Pendant quelques minutes encore il n’y aura personne. Je referme, car on tient à profiter du temps restant pour investir, seul, le lieu vide. Et en particulier la salle du Lieu Ressource.
C’est quatre tables : deux rectangulaires, accolées ; deux trapézoïdales, disposées de part et d’autre du premier ensemble ; le tout formant, dans la diagonale de la salle, une rangée octogonale. Il y a cinq chaises : deux chaises d’un côté ; une chaise à chaque bout de la rangée ; une chaise de l’autre côté, pour le sac. Le fauteuil, c’est pour le manteau. Et devant, sur la table, vont se retrouver l’ordinateur portable (vite ouvert et déjà en plein « chargement de vos informations personnelles » – la machine est ancienne), la trousse à main droite (d’où s’échappent deux ou trois stylos et crayons) et quelques livres de poche entassés, un ou deux dossiers à main gauche (le rose, le bleu, le gris ?) et peut-être un DVD (ou un livre illustré, tiens, aujourd’hui).
Bref ! On s’installe, on se réveille. On ouvre une première page-écran avec, juste au-dessus, la porte de la salle info qu’il va falloir ouvrir, et dans les marges du champ visuel : d’un côté le mur de livres, de cahiers, de classeurs, de chemises cartonnées, de dossiers (des feuilles volantes, même), bien alignés ici, mais là en vrac, que forment deux bibliothèques ; de l’autre côté, contre le mur adjacent, un grand casier totalement vide, et les fenêtres nous signalant qu’il va falloir ouvrir – derrière les stores il y a du monde, les ombres vont et viennent. (Il y a aussi mon bureau, mais on le voit mal ; il se tient là, comme tapi derrière la bibliothèque, dans l’extrême frange du champ visuel, monoculaire).
On referme la messagerie et on va ouvrir la salle info (et la salle de cours, au fond). On revient pour ouvrir à tout le monde. Mais Momo, vêtu de sa doudoune aussi orangée qu’un soleil levant (alors qu’il fait bien gris dehors) – « Salut ! ça va ? » –, vient de le faire. Se dispersent alors les stagiaires dans l’Atelier de Pédagogie Personnalisée, comme une poignée de boules de flipper. « Bonjour. – Bonjour. – Bonjour. – Bonjour. – Bonjour ! – Bonjour », etc. – sauf la voix ; les voix, les timbres et les modulations d’un même énoncé : quelle place ça prend, ça, dans un lieu ?
On se rassoit. On ouvre un livre, éventre un dossier. On examine rapidement telle page, tel extrait. Les stagiaires arrivent maintenant au compte-gouttes. « Dessiner. Dessiner qui je suis sous forme d’un arbre : se poser, trouver ses racines, ses fragilités… » « Eh bonjour m’sieur ! » Il va falloir y aller. « …le garder à l’esprit, en évitant toute identification et toute condamnation, mais en parlant à la première personne… » Et il faut y aller. Et le nouveau, son scoot aussi discret qu’une meule – comme le vieux Ciao de ME ? –, déchire – « …tout en s’observant “en train de…” » – le passage qu’on a en main, renverse le Lieu Ressource qu’on doit quitter pour la salle de cours. Et Momo :
« Ah… c’est lui que j’entendais tourner en ville comme un moustique ? »
Je ne retrouve vraiment le Lieu Ressource qu’en fin de journée, peu après seize heures trente lorsque tous les stagiaires sont partis. Rien n’a fondamentalement changé. Sur la table, le dossier s’est un peu plus disloqué, la trousse est presque vide, le DVD n’a pas bougé et le tas de livres a disparu. Tout le reste est identique à lui-même. Il n’y a guère que la lumière assez vive (par réflecteurs) pour permettre de voir le Lieu Ressource d’un autre œil. Et le bruit d’aspirateur, étouffé depuis la salle de cours mais de plus en plus clair (et assourdissant), tandis que je taperai les passages lus dans la journée.
Le mardi 27 décembre à 18h02, sur la plage, le vent souffle doucement sur le sable blanc. La mer haute redescend à peine la recouvre. Sur le quai en surplomb, arrivant depuis la rue de la bibliothèque, des maisons d’ethnographes et grands voyageurs, marins de commerce ouvrent, volets ouverts, leurs salons aux passants. De grands bahuts de chêne pour bibliothèques, des marines et de grands miroirs, des masques de bois ornent leurs murs, et quelquefois, comme mis là, à l’avant-scène, un échiquier où deux joueurs s’affrontent. Cette grande lumière sur les murs rouges de leurs salons, cette flambée, c’est comme les murs couverts d’icônes des églises orthodoxes, dans les brumes de l’encens, le murmure des prières, ce brouhaha des femmes qui chuchotent dans leurs mains, ce serait le fracas des vagues, dehors. Elles battent, là, avec constances, gagnent du terrain, ferment la plage, rabattent le passage le long des villas. Longeant les alignements de salons sur la digue, c’est un peu comme d’y pénétrer, y être avalé, tel Jonas, à son corps défendant, voir chez les autres, et ne pouvoir détourner son regard, sinon pour l’ombre des flots qui s’agitent, sombres et confus, aux brumes du crépuscule, comme si, déjà, ils se muraient dans cette grande solitude de la nuit. Les pièces, elles, semblent s’ouvrir comme de grands coquillages, des corps de statues de cire éclairées à la bougie des autels. En contrebas les bâtons de bois plantés dans le sable, pour arrêter les lames, des milliers de fûts de chêne de talus pour brise-lames.
Elles luisent en contrebas des digues dans le ciel bleu de brume, parfois elles écument sur les murs, aux grandes marées, sautent les barricades, tambourinent aux portes malgré les sacs de sable et les planches de bois, toujours, le friselis crémeux de l’écume des vagues, masse noire, soyeuses des grosses algues échouées sur le rivage par la dernière marée, depuis redescendue, elle les récupère, de jour en jour, les avale et les recrache, une fille en fourrure grise trempe ses cuisses dans l’eau, la minuscule silhouette d’un enfant en rouge, son cri qui retentit sur la plage déserte, la réponse de sa mère, invisible derrière la digue, une fugue à l’horizon, derrière les silhouettes des dériveurs, 25 mâts en alignement, comme des dards d’insectes, passage de Rochebonne au Minihic, un symbole proscrit la pêche à pied, ou un cheval saisonnier, avant la plage du pont, et la toute petite plage de la Vade, après le chemin vers Rothéneuf, qui bifurque sur la lande, des vagues qui dansent, une s’échoue et toutes les vingt secondes, pour qui compte, une autre lui succède, dans l’air, une odeur de cendre et de feu de bois se mêle à la marée, comme des champs en cendre, l’hiver, la nuit avançant noircit en bleu noir le ciel. Il y a un petit passage, comme de douanier, au pied du café, un immeuble en forme de phare qui se nomme la Conchée, et qui est à présent mis en vente, le terre-plein descend en pente douce, ses galets, gris, rouge luisent doucement, ils seront entièrement recouverts par la mer d’ici vingt minutes, quand, à 18h40, la pleine mer montera à 10 mètres 71, nous sommes le 27 décembre, le jour de la fête de saint Jean l’Evangéliste, et la prochaine grande marée aura lieu dans quinze jours environ.
Le mercredi 28 décembre la pleine mer est à 6h25, le matin, le coefficient de la marée est faible (72) et la pleine mer revient à 18h44 le soir, le coefficient monte à peine, à 75. La basse mer est à 3mètres 35 et identique en tout point le soir, ce qui est rare. C’est le jour des Saints Innocents. Il fait un temps splendide, la veille ayant été plutôt grise et humide, sans être réellement maussade, sur la plage, l’air sent, de manière inexplicable, les gousses de vanille, les goélands semblent crier de jouer, s’égaillant dans le ciel à tire-d’aile, j’admire l’empan de leurs ailes empennées, leur puissance quand elles fendent le ciel d’un coup d’aile, à 11 heures 25 ce matin-là, j’avance vers le Minihic en parcourant toute la plage de Rochebonne depuis les remparts de la vieille ville, sortant par le château Quic en Grogne, et je traverse d’humides amas de goémons rouges sombre, comme de grosses grappes de raisins rouges proposant l’ivresse d’océaniques vendanges, d’où émerge une petite botte en caoutchouc bleu. L’air sec chante le roulis minuscule du jour, chaque jour a son chant, la mer est plate, lisse, sans vague presque ce jour-là (le vent de la veille est tombé au cours de la nuit), il fait un froid sec, le lendemain, s’échouant contre les rivages du fort Vauban, les vagues créeront de la buée au contact de l’air gelé, le sable sera recouvert d’une fine couche de givre, une surface épaisse et grenue comme du sucre glace sur du sucre de canne. Le soleil, à l’est, à cette heure, ne se lève pas encore assez au firmament pour éclairer la plage avant la digue, les cheminées des villas fument, au bout du quai, un petit avion vrombit, au large, vers Rothéneuf. J’arrive au passage vers la plage du Minihic, il est ouvert, même si les bassins d’eau, qui ne veulent pas se résorber, rendent le petit chemin de béton brut impraticable, il faut passer plus bas, entre les rochers, sur la plage, ou plus haut, en escaladant un peu, sous le mur qui surmonte la roche de petites pierres granitiques, comme celles dont elle est faite. Tout est ici, de ces pierres dures et brillantes, qui luisent sous l’assaut de la mer, comme les galets et comme les vagues, d’un même éclat de lune.
Seul demeure cet éclat, le soir-même, à l’heure de la marée haute, à titre de comparaison avec la veille au soir. Les maisons le long de ce passage entre Rochebonne et le Minihic ne sont plus visibles que comme une masse indistincte qui lui, une muraille. L’on imagine seulement ce que l’on aperçoit à la lumière du jour, à l’œil nu : d’abord, le petit passage de béton brut est d’une largeur de trois pieds, et d’une longueur de 20 mètres, au-dessus de lui, des rochers de granit pointus montent vers des murailles crénelées d’une hauteur de 10 mètres en amont, la première maison est carrée, crénelée, à toit plat, avec des balustrades, dans un style un peu byzantin, sa terrasse et ses grandes fenêtres à balcons profitent de leur vue sur le large, l’horizon de deux plages. Elle débouche, sur la plage du Minhic, sur des murs protégeant des jardins. En enfilade, sur Rochebonne, elle s’appuie presque à deux maisons de granit gris, dont les balcons refaits en verre transparent ne masquent pas le style un peu banal et aujourd’hui désuet, les deux maisons disposent d’un petit escalier descendant à pic sur la plage, par le biais d’une petite porte fermée de barreaux de fer qui rouillent et dont les trainées de rouille colorent chaque marche de l’escalier comme des attaches de rideaux. Une maison à tourelle échoue à évoquer le style angevin des villas des îles grecques ou italiennes, il y a ici un côté austère, atlantique, que confirme la petite maison blanche au toit pointu, qui rappellerait lui Deauville aux volets blancs de bois peint, une villa à deux étages propose, elle, un style fonctionnaliste, insistant sur la vue par le biais d’une très grande baie vitrée. Toutes ces maisons se présentent derrière de grands murs, assez hauts. Puis, rompant la ligne, une suite de grands immeubles des années 80, avec leurs grands balcons de verre, en partie sous échafaudages, maximisent le potentiel de l’emplacement au détriment de l’harmonie de l’ensemble, qui exigerait une suite de villas ne dépassant pas les trois étages. A l’angle, suivant la plage cette fois, remontant vers la ville sur quelques mètres, jusqu’à l’avenue de Rochebonne qui remonte vers le centre de Paramée, de belles maisons anciennes, un peu en retrait de la digue, présentent d’austères façades, de trois étages, plus ou moins larges, crépies de beige ou de gris, dont les fenêtres sont étroites et petites. De l’autre côté, surmontant le café, un immeuble des années 70, qui rappelle un peu l’Algérie, avec son décor de granit comme du stuc et ses balcons de béton beige où pend du linge, devant les stores marrons, s’échelonnent jusqu’au toit, surplombé d’une sorte de ponton surélevé, à la manière d’un navire citerne. Peu avant l’avenue des Portes Cartier, le grand café triste, aujourd’hui rebaptisé « La caravelle » a déjà connu de nombreux naufrages (sous d’autres noms) et comme victimes d’un armateur sans scrupule qui la lance sur des mers hostiles, ou comme, en montagne, ces chalets à l’abandon, l’ombre de l’ubac tombant, fatal, sur ce versant où semble planer un vent froid sur une terre avare. Ici, caravelle ou caraque, le nom et le décor varient, mais le coin n’y gagne pas de charme, du fait de l’immeuble et de la baie vitrée du rez-de-chaussée qui, construites trop en hauteur, dérobent l’essentiel de la vue même depuis l’installation (récente) de petites estrades de bois, dans l’esprit des alcôves où s’accumulent d’inutiles coussins. Au plafond, par un caprice malheureux de décorateur, sont collés des portraits encadrés d’ancêtres, le prince Florizel de Bohême, le colonel Géraldine, et une ou deux dames en coiffe, entre des miroirs sans tain où se distinguent les calottes des crânes, comme dans les anciens trains où l’on comptait, pour se distraire, les calvities. Comme en symétrie, sur le trottoir opposé, le petit café de pêcheur, son comptoir ouvert sur la digue, à la terrasse ensoleillée, présente une vision de carte postale de bord de mer, ses grands volets peints du bleu d’Ouessant et de blancs évoquent le bois vernis de ces petits canots qui sortent du hangar voisin, dès avril, pour apprendre la navigation. C’est l’époque aussi, où les enfants y trainent leurs parents pour les glaces italiennes roses et jaunes qu’on y trouve.
La boussole indique plein Ouest vers le Grand Bé, vers le soleil couchant, la plage du Minihic dans mon dos, dans le droit prolongement de Rochebonne, la mer venant du nord. La ligne de vent aussi, pousse d’est en ouest depuis la veille. Avec cette main dans le dos, l’espace fond comme le sable coule entre les doigts, pour qui longe le flot dans la nuit. Une fois passée la digue et les lumières aux fenêtres des villas, les brisants du fort Vauban au loin, dans la distance, forment avec les murailles de la vieille ville, le seul repère en plus des étoiles. S’y ajoute le rythme de la montée des eaux, qui fait de ce retour une petite épopée. Il faut jauger à l’œil si le passage est encore ouvert jusqu’au prochain escalier, aucun n’étant visible à distance, disparait dans l’ombre des rangs de troncs de chêne, se fond dans les murs de granit. Bien que plus périlleuse, la promenade, au retour, n’en est que meilleure : il y a dans le flux quelque chose de plus grisant que le jusant, une force montante qui agrémente la promenade, quelque chose à attendre, comme une éclosion, en quelque sorte. C’est ce moment de presque pleine mer qui, bien qu’il dérobe le passage et escamote des pans entiers de la plage, s’avère le plus grisant de tous.
Rue du Cherche-Midi ? Rue de Vaugirard ? Boulevard du Montparnasse la Tour les magasins leurs galeries (un toit, où ? Nous nous y allongeons et je te raconte ma vie courte et bousculée déjà. Il y avait un ciel semé d’étoiles blanches, j’avais posé ma tête sur ton torse, je n’avais pas dix-huit ans). Chez Bébert dans un angle de la place des voitures des piétons de la vie en masse. (J’arrivais de ma campagne. Je voyais ici autant de monde qu’en six mois là-bas.) Le boulevard du Montparnasse le long duquel tu avais garé ta voiture à la parisienne, une Fiat immatriculée 3516RA91. Quelque part sur le boulevard, une pizzeria, (je me souviens de la pizza Pino mais ce n’était pas celle que l’on trouve aujourd’hui sur ce même boulevard si près de la place Montparnasse, en tout cas celle-ci ne m’évoque rien). Le bar de La Marine à l’enseigne rouge (des fauteuils et des banquettes de Skaï rouge dans mon souvenir) avec une ancre bleue et blanche (l’ai-je rêvée ?). Un mois de septembre clément.
Boulevard du Montparnasse au départ de l’angle qu’il fait avec la rue de Vaugirard, de ce côté qui mène vers le Port Royal, le café restaurant La Marquise et sa terrasse ouverte avec ses deux palmiers. Service continu 7 h – 20 h en lettres blanches sur une bâche rouge vermillon. Ninasushi, blanc sur noir. Fermé. La Parizienne Hôtel, à l’entrée noire et grise. La coiffure à petits prix, 22 à 52 €, shampoing brushing à 10 € inscrit dans un macaron rose collé sur la vitrine. Au n° 35 un homme s’apprête à poignarder un lion, le bras droit dressé au-dessus de la tête, gravure dans la pierre qui surmonte le porche et le portail en fer forgé orné de rosaces, noir tout entier, mais aux poignées dorées. Une boutique d’antiquités, bijoux-brocante, à la devanture rouge, solde ses prix en rouge dans un immense placard jaune vif qui couvre le tiers de la vitrine. Au théâtre du Palais Royal, on joue Edmond, la nouvelle création d’Alexis Michalik. L’affiche collée sur la porte d’entrée représente un homme de profil sur fond bleu, un nez de caoutchouc attaché par une ficelle autour du crâne. Dans la vitrine, un lévrier de bronze sur un socle de marbre se solde 350 €. Au Stock Montparnasse, mercerie, on vend des boutons pression, des boucles de ceinture, du fil à broder, des aiguilles à tricoter, des bonnets et des pulls marins. À côté, l’hôtel trois étoiles Best western Le Montparnasse a son accueil sur le boulevard et l’homme en vitrine derrière le comptoir ouvre et referme le cahier des réservations. La maison du croque-monsieur est à céder 06 26 26 21 67. Derrière la vitrine désertée, sur une table haute, une branche de conifère remplit un petit pot de métal blanc. Un caoutchouc orne l’angle du resto et celui du n°39, séparé par une paroi de verre et de métal. Au 39, deux cornes d’abondance taillées dans la pierre encadrent un blason vierge. On monte trois escaliers jusqu’au portail de fer forgé. Un homme sac au dos, une boîte d’œufs dans une main, un paquet de mouchoirs dans l’autre tape le code et franchit la porte après l’avoir poussée du pied. Trois grands bacs de bois supportent des sapins et séparent le 39 du Bistrot du sud-ouest, à céder. Sur les marches en tôle galvanisée, une bouteille de champagne côtoie la Cuvée du Patron. Les deux sont vides. En ce samedi le Grand Optical solde à 50 % dans un espace quasi vide où les vitrines de lunettes se font face de part et d’autre d’une grande allée centrale. Casden banque populaire. Un Vespa recouvert d’une bâche noire stationne devant la vitrine. Au 43-45, la porte vitrée d’un jaune pisseux ouvre sur quarante-quatre appartements et deux cabinets d’avocats. Un petit resto miteux propose des pizzas à emporter. Au 47, une double porte à battants bleu canard et aux vitres grillagées épaule un pas de porte à vendre. Restaurant japonais Tokugawa, à la porte peinte en gris. Passe devant la vitrine noire un homme aux cheveux blancs. Un tricycle stationne sur le trottoir. Au 51... Le 51 au store écru sali, et devant, l’arrêt de bus « Place du 14 juin 1945 ». Tête à tête, un restaurant asiatique au 53. Sur la façade de l’immeuble de cinq étages, aux balcons de fer forgé, le nombre s’affiche en blanc dans un rectangle d’émail bleu au-dessus d’une entrée notariale au fronton orné d’un cordon de pierre. A droite, le Bistro Burger tout de gris souris, assorti au temps et à la pluie, puis une crêperie aux lettres dorées sur un fond bleu roi. Au 55 un porche s’élève jusqu’au premier étage. Ici il est interdit de stationner mais une voiture blanche stationne. A droite, Djerba, un café aux tables dressées dehors sous la pluie, aux chaises en plastique tressé, marron, sales. G 20, un petit supermarché. La Pizza Pino. Une agence de Caisse d’épargne, vieillotte, un portique bleu anglais. Le café 1900. Un hôtel trois étoiles, Terminus Montparnasse coincé entre le café et le bar de La Marine.
La rue de Saint-Pétersbourg commence place de Clichy. Florence, Turin, Bucarest, Moscou, on voyage aussi à travers les rues adjacentes. Un peu de la Mitteleuropa, un peu de l’Orient-Express. 490 mètres plus bas, le périple se termine place de l’Europe. Le restaurant Hippopotamus qui, tout en haut sur le trottoir de droite, fait l’angle du boulevard des Batignolles et de la rue de Saint-Pétersbourg, est ouvert non-stop de 10 h 45 à 5 h le matin. Sitôt dépassé le restaurant, la rue côté droit est en travaux — prolongement de la ligne 14 du métro, jusqu’à Mairie de Saint Ouen ; vos commerces restent ouverts pendant les travaux —, des palissades sont dressées du 43 au numéro 37 : tout du long, des blocs de béton gris, rouges ou blancs, encombrés d’affiches en partie arrachées, alternent avec des barrières en métal ondulé, vertes et grises, surmontés de grilles. — 39 rue de Saint-Pétersbourg, Création de vêtements Amalia reste ouvert pendant les travaux. Le chantier reprend à partir de la rue de Florence, enveloppant l’angle des deux rues, pour descendre jusqu’au n° 17 — 33 rue de Saint-Pétersbourg, Hôtel Régence Paris reste ouvert pendant les travaux. Des bâches fixées aux grilles cachent partiellement le chantier. Port des protections obligatoire ; 31 rue de Saint-Pétersbourg,
Retouches/Repassage Pax Moon reste ouvert pendant les travaux. On distingue cependant des tuyaux rouges et jaunes, par endroit des sacs, sables ou ciment, entassés, des machines : pompes à béton, groupes électrogènes SDMO, bennes à déchets, bureau de chantier, sanitaires, godets à terre, tapis roulants, extracteurs, plaques vibrantes, pilonneuses, bidons oranges, fils électriques, câbles. 27 rue de Saint-Pétersbourg, votre restaurant Boob Mara reste ouvert pendant les travaux ; en dessous, en plus petit, il est précisé : du lundi au vendredi de 12 h à 15 h — sur place ou à emporter. Ensuite, la rue descend sans heurt jusqu’au feu, au croisement de la rue de Turin. Saint Petersbourg, Turin, Florence se coupent et forment un triangle.
Les rues de Turin et de Florence se sont toujours appelées Turin et Florence. De 1914 à 1945, la rue de Saint Petersbourg s’appelait rue de Petrograd. Jusqu’en 1991, elle s’est appelée rue de Leningrad. À l’angle du boulevard des Batignolles et de la rue de Leningrad, je venais le soir acheter du beurre ou toute autre chose qui venait à manquer, quand c’était un Monoprix, ouvert en nocturne jusqu’à 20 h. J’avais 10 ans, parfois on me laissait garder la monnaie des courses. Mon frère avait eu un flirt avec l’une des caissières. Nous habitions au 31, un immeuble à l’angle de la rue de Florence, au-dessus d’un café. Le café toujours fermé dans mon souvenir, peut-être parce que je ne le remarquais que le dimanche matin lorsque je sortais acheter le pain ? La grille baissée, les chaises posées à l’envers sur les tables près des vitres, plus une, près du comptoir, où étaient empilés des assiettes et les cendriers jaunes portant, dans les encoches prévues à cet effet, la marque brune des brûlures de cigarettes oubliées.
Ma sœur n’avait pas loin à aller pour rejoindre son école, au 4, rue de Florence. La porte de l’école, en bois, est surmontée de l’inscription « école de garçons » gravée dans la pierre. Le drapeau européen ne flottait alors pas encore à côté du drapeau français, au-dessus du portail. Sur le trottoir d’en face, un peu plus bas, au numéro 9, la porte cochère à double battant est toujours du même bois clair, le bas des deux battants protégés par deux plaques de laitons devant l’entrée carrossable pavée de losanges devant laquelle un soir de 1978 le concierge passa le jet d’eau depuis la cour au moment où passait ma chienne Douchka, qu’on promenait sans laisse. L’animal prit peur, fit un écart, la voiture qui arrivait depuis la rue de Turin ne le vit pas. Ma mère me fit croire qu’on avait enterré Douchka dans le jardin de la maison de campagne de mes grands-parents. Elle m’avoua plus tard qu’il n’y avait rien sous l’autel que j’avais édifié près du puits, devant lequel j’allais chaque fois me recueillir en retenant mes larmes. Rue de Turin, une porte cochère. Lumière bleue d’un soir d’automne derrière la porte vitrée au fond de la cour. Marcel Proust, dans un texte étudié en classe de français, évoquait la même lumière. Dans l’escalier, au 31, rue de Leningrad, un mercredi en fin d’après-midi — j’avais oublié mes clés —, j’ai lu des comics de Batman et de Tarzan que je venais d’acheter. Quelque part entre la place de Clichy et la place de l’Europe, Marcel Proust, Bruce Wayne et Lord John Greystoke sont enfermés ensemble dans une bulle temporelle, enveloppés d’une belle et douce lumière bleue. La mémoire elle aussi est en chantier ; le commerce avec les souvenirs reste ouvert pendant les travaux.
Regard posé et reste. Sur le portail délabré. Silence, longueur de temps. Pas de date au verso de la photo. Retour arrière si possible. (Il n’y aura pas de deuxième chance. Il leur faudra repartir). On s’approche pour détailler la place : le parking délimité pour dix voitures de biais. (Autocad affichait que ce choix était une erreur). La voie devant a été goudronnée. Mais ça depuis le début (c’était quand déjà le début ?). Là-haut, une lampe allumé. Pourtant l’immobilité est complète. Le regard sur la vieille photo a accès à dix lattes de bois. Pas de poignée côté visiteur ; on jette un œil par-dessus les lattes, on la découvre tombée par terre. Entre deux poubelles ; une noire sans couvercle, toute amochée. Une jaune conforme avec l’étiquette résumant son utilisation par autant de pictogrammes usés. Frotter et respirer, frotter la pierre, tourner, souffler, c’est fini. (Ca va finir). De l’autre côté la dalle de béton. Jusqu’au bout de l’ouverture sur le garage. Le portail de bois sous les pieds la dalle de béton et entre les dalles, la nature pousse sans que personne n’intervienne. Monde entre deux. A droite de l’allée, un parterre surélevé piqueté de branchus, arbres en plein essor, prunier, noisetier. On découvre, posée sur le bord du parterre, une pierre taillée en forme de pyramide. Toute recouverte de mousse. Corps de plantes serrées les unes contre les autres, emmitouflées de ronces, terrassées par la menace muette d’un lierre accumulé, sporadique. Comme un violon dans un charnier, comme une violette dans un pré, menace et tentation. L’œil circule. Un pas en arrière pour mieux envelopper l’ensemble. Derrière le portail et sur la gauche, une plate-bande étroite large d’un mètre, et, cachée dans le coin d’un renfoncement (il faut se pencher légèrement derrière le portail pour la voir), une fosse, recouverte de deux battants en aluminium ; la mauvaise herbe l’entoure en abondance. Voyons la haie. Séparant ce côté de celui du voisin. Ce sont ses églantiers qui retombent en pluie, emmêlant leurs branches dans celles de piquants signalés par des floraisons de boules rouges et sans interruption jusqu’à la porte de garage ; haie touffue, foutraque, bloc de silence de solitude. On tourne la tête et de l’autre côté, on distingue trois marches d’un escalier menant à droite vers l’entrée principale. On fait quelques pas en arrière pour élargir le champ et sous les pieds, l’emplacement devant, entre le portillon qu’on ne voit pas sur la photo et le portail qui l’occupe entièrement, de tout son bois délavé, gratté par l’eau et le temps, pris sous les flots et le flux, déposé une fois, récupéré reconstitué et , peut-être, peut-être que le soleil a parfois trop donné également dessus, mais on voit bien que jamais il n’a été remplacé, tout ce temps ; et là, juste devant, le véhicule perpétuellement garé comme n’ayant pas sa place sur le parking délimité par les lignes blanches de biais. (C’est là que c’était. C’est là). Et si on recule encore, d’un pas ou deux, en pivotant d’un quart de tour dans le sens des aiguilles du temps, dans l’allée de la C., goudronnée depuis le rond-point avec la bande d’arrêt pour les enfants constamment là, jouant dans l’allée et circulant à vélo, jouant à la balle et se cachant dans les buissons abritant les boîtes des compteurs électriques. Fini, c’est fini.
Et maintenant devant pour de vrai. Soleil froid, bleu blanc en direct des lattes de bois, micro monde bercé de micro coupures. Prise de notes dans le mémo du téléphone. Lattes du portail au nombre de quinze. Serrure toujours pas réparée. Du jardinage d’effectué. Sur la droite de la partie rehaussée, l’arbre fruitier a giclé. On distingue une souche sous un amas de lierre, au beau milieu d’un petit espace insultant, mal rasé ; grosse herbe blanchie et trouée de partout. Dépenaillé, terrain défiguré. Comme un pauvre hère grimaçant au soleil de toute la force des ses dents ravagées. Un de ces vagabonds pisté par les voisins vigilants. Mais eux, où sont-ils ? Derrière leurs portails, leurs lattes de bois vernies, entretenues, micro monde de société invisible, figée ? Lattes de bois au nombre de quinze. Et les feuilles grossièrement gelées même pas ramassées. Ceux-là de derrière leur portail détérioré, qui sont-ils ? Furtifs isolés et mal intégrés ? Côté portillon d’entrée, barré par un arbre penché. S’offrant de tout son long à la force des éléments et à l’incongruité d’un art abstrait et naturel, jamais contrarié (on voudrait se coucher par dessus et attendre la fin du temps).

De 8h25 à 8h30
C’est un peu avant la sonnerie, le pic de fréquentation quotidien du lieu. Du monde circule dans les deux sens, allant vers ou repartant de la rue Bretonneau où se trouvent face à face, de chaque côté de la chaussée, les deux écoles, maternelle et élémentaire. Beaucoup viennent des autres rues, en étoile, et y retournent ; autant que je sache, pour repasser chez eux, filer ailleurs, au métro, à l’arrêt de bus, à leur boulot. J’en connais aussi qui vont prendre un café pas loin. Ceux qui arrivent du fond de la rue Bretonneau, lorsqu’on est posté au croisement, on ne les voit pas ; masqués qu’ils sont par les attroupements devant les portes des établissements. Effectivement, quelques parents restent toujours agglutinés un moment, généralement ceux des CP : la peur de les abandonner à l’ogre scolaire, sans doute.
Concernant les flux de personnes, dans la direction des deux écoles il y a bien sûr parents et enfants tandis que, dans le sens inverse, seulement les parents. Visages fatigués, tristes ou au contraire, radieux, contents d’être débarrassés, c’est selon. Généralement il y a un parent avec un ou deux enfants, voire trois ; mais dans ce cas, on perçoit dans leur allure une plus grande urgence : les enfants se répartissant dans différentes écoles, le parent doit effectuer plusieurs déposes en un temps bref. Plus rarement les deux parents accompagnent. Il y en a qui prennent leur chien avec eux. Quelques enfants sont seuls, en majorité des filles à ce qu’il me semble. Les plus jeunes ont des cartables, les CM1-CM2 des sacs à dos. Ces derniers, s’ils sont accompagnés, quittent leurs parents au tout début de la rue Bretonneau, juste après le croisement, au niveau du panneau sens interdit. Ce matin un vélo est cadenassé à la barrière juste à côté. Pourquoi ? Beaucoup d’au revoir se disent là. Un bisou et un mot dans l’oreille, le tout rapide. Parents pressés, enfants émancipés. Quand ils ont atteint cet âge, on s’est fait une raison. Chacun va vers sa vie. Ma petite voisine passe en courant. Son père l’a peut-être quittée plus haut dans la rue. Mon fils part lui aussi en courant, comme tous les matins, je ne sais pas pourquoi, car nous sommes dans les temps. Me vient cette idée : c’est fou ce qu’on revit les différents âges de sa propre enfance à travers ses enfants. Bientôt mes années d’école élémentaire seront définitivement terminées. Deux ou trois enfants arrivent encore. Puis retentit le couperet, annonce de la fermeture des portes. Il est précisément 8h30.
De 8h30 à 8h44
L’instant fait ressortir deux types de psychologie parentale. Les zens et les paniqués. Je constate : alors qu’ils croisent une ou deux tribus nonchalantes, dont le pas lent suggère que cinq minutes de classe en moins dans la journée ne va pas changer la face du monde, des parents adoptent subitement un comportement dément, traversant en diagonale avec leur progéniture la rue du Surmelin (très fréquentée par les voitures arrivant de l’A3, porte de Bagnolet) en enchainant au beau milieu du carrefour sans plus rien regarder d’autre devant eux que la porte de l’école encore désespérément éloignée. D’où probablement ce calcul insensé dans leur esprit : mieux vaut tous passer sous les roues d’une bagnole plutôt que d’arriver trop en retard (puisqu’ils le sont déjà).
La fréquentation se raréfie. Cela me laisse le temps d’observer les rues en elles-mêmes. Le graffiti en bleu sur l’immeuble à l’angle. « FSKRS » ? On dirait un captcha. Au loin l’enseigne « Kronenbourg » du café « Chez Aïssa » puis, côté rue Le Bua, un drapeau français qui pend à une fenêtre, accroché depuis les attentats, à moins que ce ne soit pour l’Euro de foot, je ne sais plus. Les pistes cyclables au sol tracent des itinéraires. Assorties aux passages piétons, c’est graphiquement harmonieux. Mais aucun vélo ne passe. La propriétaire de celui cadenassé est bien venue le récupérer mais elle a remonté la rue du Surmelin sur le trottoir en le tenant à la main.
A 8h39, j’aperçois de loin un ami qui arrive avec ses trois enfants, un sur les épaules, les deux autres derrière au pas de course. Catégorie des paniqués, bien qu’ils soient en retard depuis qu’on se connait, la maternelle de nos aînés, ça fait un bail. Trop préoccupé de regagner quelques secondes en se dépêchant, il ne me voit pas. Ne restent maintenant plus que quelques groupes d’adultes, par deux ou trois, qui discutent, soit au carrefour, soit un peu plus loin. Un homme et deux femmes rebroussent chemin, ayant déjà leur caddie de courses. Quelle organisation. Deux dames se séparent en se parlant puis se rapprochent de nouveau ; un détail a vraisemblablement relancé leur conversation. Elles échangent maintenant de chaque côté de la barrière de sécurité, une sur le trottoir, l’autre sur la route. A 8h44, elles se quittent pour de bon, je décide de m’en aller aussi. Il n’y a plus que des voitures.
Lieux de légendes et d’Histoire ; histoires de lieux sans histoire mais qui diraient les ratées de la lumière et le lieu vide ; le point d’attache invisible percé par la parole ; le silence en défaut dans la course d’un messager de poussière ; la déchirure de l’écriture dans le songe glaiseux d’un golem, un facteur étrange condamné à parcourir la part d’éternité allouée au temps. Tour à tour lecteur, crieur, conteur, écrivain public, romancier, scribouillard, artisan, copiste, artiste, maître, baladin, trouvère, rimailleur, liseur, frangin du souffle et des fragiles enfants du sens, tous vêtus de verbe et de bohème, tous venus de mille ailleurs, tous en tous lieux, chacun pourtant passant par un seul point fictif sans quoi rien ne serait. L’être étouffe le néant.
A la lecture du lieu ( lequel ?), je m’aperçois qu’il échappe à mes tentatives de l’étaler, tout en le comprimant, par paragraphes dans la dimension plane, faussement double, d’une feuille quadrillée. Lieu en bouteille aux deux bouts bouclé. Une espèce de conte qui n’y trouverait pas son compte mais entre ses portes on se procurait de tout. On aurait pu y vivre sans en sortir ; la rue était magique où j’ai grandi et là, quand je revenais de chez mon pote par le petit kiosque (alors de l’autre coté du pont entre l’usine de godasses Minerva et le troquet des Allées), je ne la remarquais pas ; elle passait au-dessus et si, distraits, mes yeux les effleuraient, ils sont restés longtemps sans s’arrêter au latin des caractères gothiques peints sous le cadran. Un mécanisme vieux de trois siècles et qui fonctionne à ce jour pour dire à peu près son âge, du reste sans importance comme les contes des mille et une rues de nos mille et une vies ou ce tableau reproduit sur la boite oblongue d’un calendrier chinois acheté au Cap-Vert ; une image à bord de laquelle je suis monté pour y rejoindre les personnages d’un autre temps ; d’un autre lieu où j’écrivais sur un fleuve jaune dont j’ai perdu le nom cependant pas la vision de la barque lentement ridant à peine la surface ambrée, ni celle de l’homme à la gaffe, à l’avant debout, ni l’autre assis au gouvernail, ni ces trois passagers dont deux femmes, droites, immobiles sous leurs ombrelles.
D’un appontement secondaire, à l’ombre épaisse des toisons tombantes de trois saules babyloniens, des badauds, des familles saluaient le départ de parents, d’amis tandis qu’effilée, la proue de la pirogue pointait en direction de la jonque amarrée au pied du palais blanc. Je revois les traverses, les piles, l’arc cintré reliant le ponton aux dalles du quai désert, l’escalier déroulé dans le marbre et menant à l’Esplanade des Roses, à l’épaule océanique du palais des huit immortels, aux mille aiguilles dressées des toits rouges aux angles relevés, aux soixante-quatre cours orthogonales, soixante-quatre hexagrammes à ciel ouvert orientées vers l’oeil gauche de la constellation du Dragon, or ce symbole encore, inscrit vivant dans l’âme des bâtiments et ordonnant la ronde muette des pénitents lents, tout ça, plus et davantage et pourtant le lieu que je porte, que je cherche n’est pas dans le roman de cette image que je reprendrai, possible un jour, cependant sur le champ voici venir les eaux de la mer d’Arabie et l’horizon bronzé d’une plage indienne ; la plage, celle que j’arpente quotidiennement depuis une semaine guettant dans le reflux de l’eau, dans le ruissellement doré du sable fin, les lettres éparses des enfants d’Abraham et qui me souffleraient à l’esprit les noms de la descendance et ce lieu que je me devrais de décortiquer pour le boulot quand je marche au nord, l’ayant perdu, parmi ces visages étrangers, chacun chargés d’un récit inscrit dans la chair invisible du temps, colporteurs de fantômes hantant leurs mémoires de verres, tant d’évènements vécus, tant auxquels ils ont assisté mais s’il fallait, pour chaque crabe filant à marée basse se réfugier dans un trou, pour chaque étoile de mer tombée du ciel, pour chaque rognure d’ananas, chaque éclat de noix de coco roulé dans les vagues, chaque mégot tété, jeté, chaque bouteille abandonnée, chaque morceau de plastic délavé, durci, cassant, s’il fallait pour chaque transat, chaque siège, chaque table de chaque établissement et dans chaque établissement tout connaître : méduses échouées, sirènes aphones, ermites planqués, zonards, routards retraités, cours de massage, de yoga, de méditation, de reiki, marchands de sagesse, de sérénité, d’encens, de gri-gri, de statuettes, marbre, ivoire, argent, bois précieux, marionnettes démembrées, tissus fatigués, tous ces saxo plaintifs, toutes ces musiques flambées au son des light-show, verres, mugs, assiettes, menus, clients, serveurs et s’il fallait tout décrire, feuilles à la dérive, chiens errants, vaches, épis de maïs rongés, braseros ambulants, vendeuses de saris, photos volées à la pourpre du couchant et pour chaque ballon, frisbee, raquette, volant de badminton, sardine, dessin sur le sable entrer dans ses détails et de chaque objet, de chaque personne qui n’est personne retrouver quelque chose, quelqu’un pour ensuite remonter le fil de chaque histoire alors oui, je me condamne à l’éternité et fatalement, après que la jonque indolente, libérée de ses attaches, s’éloignerait du port et qu’à bord de l’image, debout à la poupe du vaisseau, je verrais disparaitre cet homme attablé au clavier et la tranche, devinable encore, d’une petite boite oblongue qu’il observe, fatalement en quittant l’Orient d’or et de nattes pour les terres glacées de Thulé alors oui, le temps comme d’habitude s’incurvera et, comme tant de fois autrefois, je repasserai sous l’horloge aux chiffres romains. Sous l’aiguille du soleil et de la lune je reverrai, sans la lire, la sentence idiote : « Vitae nostra brevis est », toujours en lettrage gothique mais aussi, coté trottoir, sous la voûte, la plaque scellée rappelant en quelques lignes de pierre que l’édifice, rénové dans la première moitié du XX siècle de l’ère chrétienne, est placé sous la protection de la confédération. La porte aux deux tours aussitôt franchie, je reconnaitrai, pris dans la façade de la première maison du faubourg, le haut-relief modeste, usé, saillant au-dessus du linteau de la deuxième fenêtre basse ; un écu parti en deux tranches égales ; à la première revient la crosse des Princes-evêques de Bâle, à la seconde un coq ; sur ce, je continuerai à longer les ouvertures basses, dont une double, toutes trois à ras du sol et garnies chacune de sept barreaux ; quatre en hauteur, trois en largeur ; derrière le fer des grilles, des croix blanches, formées par le meneau principal et deux croisillons horizontaux ; derrière les croix, la grande salle du Moulin ; le Moulin, un établissement à deux casquettes ; bistro et cinéma.
Curieux comme de revisiter certains lieux, le fait de marcher, de stationner, d’être sur place remue l’oubli, or ce que l’on ne croyait pas même enfoui, cette part des choses à laquelle incidemment nous prîmes part, avait disparu sans que personne n’enquête ni ne s’inquiète et vraiment rien ne manque parfois plus cruellement que ce dont nous ne ressentons pas l’absence. Le long des murs de la grande salle du Moulin, à l’arrière dans le prolongement du comptoir, deux ou trois marches à descendre et il était là. Géant, noir, veiné d’acier, lisse, luisant, l’anaconda fabuleux déroulait ses anneaux circuit quatre pistes tout autour de la salle ; quatre bolides ; un jaune, un noir, un rouge un blanc et sur les flancs des flammes, la foudre, les éclairs des stickers. On actionnait les bagnoles à l’aide d’une manette manuelle moulée pour les phalanges ; de la pression du pouce dépendait la vitesse des machines ; on appuyait légèrement et les caisses ronronnaient, démarraient en douceur ; on pressait à fond le piston du régulateur et les Formules 1 fonçaient, s’affrontaient, se dépassaient, rugissaient, miaulaient, décollaient dans les tournants, dégageaient en tête à queue, en tonneaux dans les courbes mortelles ; souvent avec l’hiver aux carreaux, la tête près des barreaux quand dans mon dos la nuit blanche s’enfonçait dans le froid de décembre, je m’arrêtais. La salle tournait. Elle a tourné quelques années et vu que le temps passe sur les objets comme il infiltre tout, le circuit a disparu. Sans doute existe-t-il encore, dormant dans le sous-sol de rares mémoires comme existe à jamais ce qui fut. Question d’accès. Le faubourg m’enchantait et la rue savoureuse, terrain des jeux, phantasmes et craintes comme un berceau, un canyon vivant. A l’opposite des trois fenêtres basses, collée à la tour droite de la Porte de France, la section d’un mur de rempart à l’intérieur du faubourg. Épais, massif, il se prolonge de quelque soixante pas à l’extérieur serrant ainsi la tour entre ses deux tronçons ; sept à huit mètres jusqu’à son sommet recouvert d’une triple rangée de tuiles d’argiles avec, à moitié déchaussés, quelques piquets rouillés autour desquels s’enroulaient les corolles pâles du liseron. A l’abri du gros mur, presque à même hauteur, entre rue et château, l’ancien cimetière des capucins reconverti en jardins potagers. On pouvait y accéder par la montée à droite, à l’angle de l’Aigle, le café face au pont reliant la rue à la ville, après la boulangerie et le cordonnier, mais une fois la courte côte grimpée, cent mètres après, l’impasse. L’impasse ! L’impasse sauf à savoir qu’au fond de la cour en U, à gauche des marches en bois qui grimpaient à l’atelier de menuiserie d’oncle Émile, derrière des gonds grinçants se faufilait un boyau sombre ; grossièrement taillé, poussière et gravas au sol, les semelles s’enfonçaient légèrement dans la peuf ; l’odeur humide de cave, de salpêtre, fraîche et proche de la mort m’enveloppait le temps bref de franchir l’obstacle pour arriver dans le jardin, où mon grand-père près de la remise, là où le sapin qu’il a planté existe toujours, sur son banc se reposait ; serf sans seigneur et libre enfin de goûter le printemps comme on goûterait une liqueur, une ambroisie, un nectar en l’âme. Toutefois, pour monter au jardin rarement je passais par l’Aigle. Je passais par la maison à l’enseigne au cheval blanc ; en face du 26 où nous habitions. Ainsi, au troisième étage je prenais le couloir à droite ; au bout se trouvait une porte simple, en sa partie supérieure divisée par un montant vertical en deux rectangles égaux garnis de vitres dépolies. Toujours ouverte, je la refermais derrière moi. Restaient six, huit marches à monter et j’arrivais dans la cour des capucins ; à dix mètres du percement, du trou de vers menant au vieux cimetière des moines. Je me rappelle les potagers, quatre lopins pareils, quatre rectangles enneigés, retournés, bruns, amendés, ensemencés, fleuris en mai et qu’une petite bordure cimentée encadrait ; l’odeur sous l’imposante tour du Coq des mottes effritées, le soleil, le temps filant vers l’après-midi, la piscine pendant que je bêchais, que dormaient dans une niche de la tour les perches à haricots, que les deux frangines aux bonnets pointus, à bout de bras tenant le temps à jour, veillaient le maigre trafic tout en rappelant aux latinistes la brièveté du séjour quand le clocheton d’égrener les quarts et les heures, mesurant la course des astres comme la carriole du laitier, réglée pareil qu’un chrono sur le pas traînant du cheval la tirant et qui s’arrêtait, le museau dans la mangeoire en jute accrochée à son cou, ne voyant rien, à hauteur de l’enseigne de la boucherie chevaline ; ce cheval ponctuel qui n’existe plus nous donnait l’heure quand le laitier agitait sa cloche. A l’arrière de la charrette des bouilles de quarante litres. De l’une d’elle, le manche recourbé de la mesure calibrée dépassait. On tendait les sous puis le bidon de deux litres en alu. Du 26 où nous habitâmes une très longue décennie, (au second puis au premier ensuite), de la cuisine d’en haut je pouvais voir, dans le jardin des capucins, la toiture de la cabane du jeu de quille et trois poutres la soutenant.
Je suis revenu de l’image en bateau, de la plage en avion et je pensais prendre la bagnole puis pedibus repasser sous la porte ; en détailler les tours, les ouvertures, nombre, grandeurs, formes, oculi, encadrements, signaler la meurtrière, disserter sous le cadran or et azur, prendre ses mesures, décrire sa flèche unique, l’étoile au centre, les chiffres romains, l’ornementation baroque, les cinq petite oves, les deux baies prises dans les rinceaux de la fresque, les tons des couleurs, le cône évasé des toitures, la terrasse du Moulin mais ça la semaine prochaine ou celle des quatre jeudi, on ne sait jamais toujours est-il, j’y retourne occasionnellement et j’en connais les changements récents ; pas les immeubles, intouchables, caste protégée mais la vie, les mouvements, ce qui reste d’avant, d’avant que ne s’écoule sous les ponts tant d’eau et d’existences comme autant de vagues en mer. J’y retourne parfois. C’est une musique qui s’empare soudainement du temps et le tord dans un refrain immortel, dans le rythme joyeux d’une farandole en goguette au gré des courants capricieux, flottant, dansant dans l’air d’une mélodie reconstituant, restituant, délivrant tout, absolument tout car le temps transpercé par la vision, les odeurs, les sons, le goût de l’ail, la rugosité du crépit sous la pulpe des doigts mais plus encore comme une transposition, un voyage à contretemps où toutes les dimensions n’en forment plus qu’une ; ouverte et fermée simultanément. Nos tricycles sur nôtre trottoir, le nôtre. Petits, on jouait toujours du même côté de la rue ; on traçait jusque Chez la Juliette, l’épicerie tout en longueur qui ne terminait pas la rue (interrompue perpendiculairement par celle débouchant du pont), cependant marquait comme un terme. Au-delà de nos cent cinquante mètres de piste s’étendait un autre territoire. Le magasin, vente- réparation de vélos en bornait le terrain ; juste avant de traverser, juste avant la descente vers la rivière. Il n’existe plus. Aujourd’hui plus de petite reine mais un journaliste, auteur de plusieurs ouvrages dont un récent sur le pape François pour l’avoir rencontré à diverses reprises, avant et après le Vatican. L’épicerie out ; à sa place une extension des pompes funèbres, déjà présentes depuis plus d’un demi-siècle en face et jouxtant la boulangerie également envolée mais l’Aigle lui est resté. A l’ouest, la porte de Bure ; une simple trouée dans les remparts, sans horloge ni tour à l’autre bout du Faubourg où, dans le prolongement des murs du château, toujours dans leurs meubles, s’affairent les héritiers d’un commerce de chaises, tables, cuisines, divans, bibliothèques, literie, commodes, fauteuils, salons, miroirs, lampadaires, tout pour le confort, à votre service depuis des lustres et des lustres ; du bazar pour les un peu riches mais pas trop. En remontant des meubles vers la Porte de France, à l’est, plus de cordonnier, plus de boulangerie toutefois les pompes funèbres prospèrent ; les morts en croquent. Vis-à-vis donc plus de Juliette ; plus de légumes en vrac dans le cabas, de soupes en sachet, de boites de mélasse, de moutarde insipide, de pâté Le Parfait en tube, de corned beef, de lessive Sida ; plus de timbres escompte Toura, plus de carnets dans lesquels on les collait pour toucher dix balles quand ils étaient pleins, plus de ristourne, plus de crédit. Plus de bourrelier aussi. Il avait sa boutique à deux pas du 26 et devant sa porte, une selle posée sur un tréteau remplacée en hiver par un tas de grosses bûches. Aujourd’hui plus de selle, mors, courroies, rennes, lanières, fouets mais du pinard. Du bio ; des vignes cultivées avec passion par un pote de lycée. La boutique semble close cependant un numéro de téléphone, bien lisible parmi les crûs, trône en vitrine ; autour gravitent à divers niveaux des modèles réduits des années 60, petites bagnoles en bon état de conservation. Les cours terminés, vers 16h 30 on se retrouvait chez ce pote. Pas dans le bar à café (ouvert dans un autre quartier par ses parents) mais au-dessus du bar ; dans les combles encombrés de meubles on écoutait « la Vache », le dernier Pink Floyd sorti et on en sortait pas de le mettre et le remettre, de jours en jours, comme si « Atom Earth Mother » nous embarquait à bord d’un dernier hommage à la terre, que la vache, le pré, par la voix de Démocrite réincarné, nous priaient d’arrêter de jongler avec l’atome. Avant d’être rasée pour un hyper hyper-moche, la maison a connu diverses fortunes dont une des dernières l’aura transformée en œnothèque. Boutique encore tenue par un pote ; un baroudeur rangé des assurances avec en lui l’infinie nostalgie des vivants pour le voyage et l’aventure, or et encore, pour revenir au Faubourg, s’est évaporé aussi notre voisin immédiat ; le nettoyage chimique. Un pressing débarqué vers la fin des années cinquante. Le vent en poussait parfois les vapeurs jusqu’aux fenêtres de derrière ouvrant toujours sur la Minerva vide (depuis de nombreux hier à vendre ou à louer) et les produits aux odeurs piquantes, désagréable, irritantes essences industrielles que je me surprenais, par curiosité, à respirer. L’été la porte de la blanchisserie restait grande ouverte laissant fuir, mêlés aux pssssssssssiiiiiiiiiit des machines, des nuages puants de molécules complexes obligeant à bloquer le souffle au passage tant leurs signatures olfactives répugnantes agressaient. Finie la chimie au faubourg. J’aimais bien le couple qui s’en occupait. Tous deux gentils et je me disais que bosser là dedans, dans le bruit, la vapeur, la chaleur ça devait pas être coton. Plus bas, un nouveau commerce ; du matériel informatique avoisinant une boutique dépôt-vente de fringues et à vingt mètres de chez la Juliette, là où à dix ans j’avais perdu les derniers vingt balles de la quinzaine, une association d’aide à l’enfance a pris racine. Sur le trottoir d’en face, entre les fleurs de marbre, les regrets éternels et l’ancienne laverie automatique (changée en troupeaux de pelotes laineuses de toutes teintes et nuances), en place du marchand de tapis une galerie vient d’ouvrir. Un ami s’en occupe. Il compte se spécialiser dans l’art africain et dans l’art africain quelle branche, il me le dirait mais bon une galerie et dans cette galerie, inaugurée à l’automne précédent a exposé, pour le lever de rideau, un autre ami persuadé que la révolution passe par l’art. L’expo fut un succès et vraiment j’aime sa technique qui consiste à appliquer, sur divers supports, des éclats, de fines écailles de craies grasses où la lumière coule des ombres géométriques colorées, urbaines, champêtres, ondulantes comme tavelées, étalées par plaques et voilà une galerie, l’art en vitrine dans cette rue où presque tout les commerces, mirages d’un temps, se sont évanoui mais pas la boucherie chevaline, établissement que j’ai toujours connu ainsi que le père qui la tenait ; un homme droit et sa fille et ses trois fils dont deux ont repris l’affaire ; la sœur réside en Espagne, la maman vit toujours à l’étage. D’une fenêtre à l’autre, le matin on se saluait, on se causait. Les gens, les maisons communiquaient et les rumeurs, les ragots relayaient l’info. Aujourd’hui on n’accède plus au jardin des moines en passant par l’immeuble et le couloir du troisième. La porte a été condamnée. On n’y accède plus non plus, en remontant derrière l’Aigle, par la cour des capucins. Le trou de vers est bouché comme est muré l’escalier de bois qui conduisait à la menuiserie. Voyage interdit, privatif. Le monde rétrécit, se rétracte. Qui le verrouille et pourquoi ? Au 26 rien n’a changé, ou si peu. Au rez-de chaussée, les grilles en fer forgé, autrefois du même gris-clair que les volets, ont été repeintes en noir et je mesurais le risque à me barrer de nuit par la fenêtre en essayant, prudemment, de poser un pied sur la pointe pas du tout arrondie et d’où partait, faisant comme une cage aux carreaux, le faisceau des barreaux proéminents mais moi, l’oiseau en peine d’envol, mes pattes n’atteignaient pas la pointe et je risquais de me casser la gueule alors je me vengeais la journée quand, ma mère au turbin, sur l’électrophone que je m’étais payé je plaçais « get off my cloud » « wild thing » ou « eight days a week », ces disques anglais - avec mon blé- interdits en présence des autorités maternelles mais elle pas là, le volume à fond, j’ouvrais la fenêtre, m’asseyais sur la tablette ou plantais, rebelle et boudeur, les coudes sur le rebord extérieur puis laissais, du premier, s’envoler la musique, la révolte et les tempêtes vers le cheval blanc, le cimetière des capucins, la blanchisserie chimique, la sellerie déjà plus là, la laverie pas encore, les tapis oui, les cercueils oui, la boulangerie oui, la Juliette, l’Aigle et bien sûr la porte, les tours, le bistro du Moulin logé dans celle de gauche (toujours en venant de Belfort)mais surtout cet ami au comptoir parlant de Léo Ferré venu passer un mois chez lui, ce baiser fraternel sur le seuil du 26 où il logeait ces temps, ce baiser que nous ne savions pas dernier, cette accolade juste avant que la nuit ne l’emporte, avant qu’il ne parte sans regret comme nous en avions parlé, une poignée d’heures plus tôt, au Moulin, son dernier quartier général. Au Casino du Moulin plus les bagnoles et plus de cinéma. La salle de projection est devenue le siège permanent d’une association chrétienne. Le cadran de l’horloge a été rénové. Le temps ne vieillit pas.
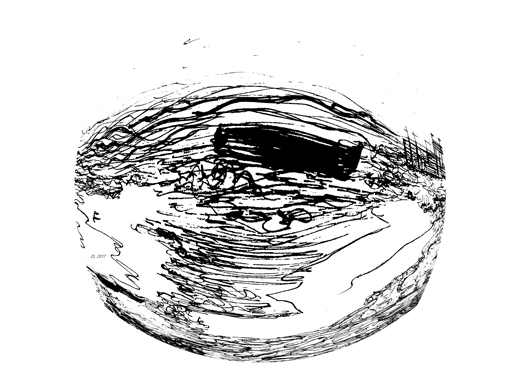
Août 2017, sud de l’Italie, côte adriatique, Bari – Plage ’’Pane e Pomodoro’’. Onze heures du matin. Chaleur écrasante, humide. À l’entrée de la plage, sous un parasol Coca-Cola, il y a un vendeur illégal de bières Peroni, entouré de deux ou trois habitués, des hommes en chemise. 1 euro la Peroni glacée qui sent la friture ! Le sable est brûlant. Ça fait des paquets parce que tout le monde y marche. On découvre des mégots de cigarettes, des papiers de bonbons, des gobelets en pastique, des étiquettes de bière, des serviettes en papier, en boule. L’eau est transparente, mais il paraît qu’il ne faut pas s’y baigner ; trop de pollution ; la bouche d’égout est à quelque pas. On s’y baigne quand même. Plage de ville bondée, bruyante. Un parasol rayé ; un homme seul, sans parasol, peau noire, lunettes de soleil qui reflètent le décor ; parasol à fleurs, fille qui bronze avec sa copine, elles discutent ; parasol à rayures blanches et bleues, femme et homme roses, peut-être des allemands ou des russes rougis par le soleil ; parasol rouge, bébé tout nu dans le sable, déjà bronzé ; parasol vert, famille et glacière ; groupe d’adolescents sans parasol qui parlent fort ; second parasol vert, mais avec des franges, couple avec un chien qui porte une casquette ; parasol blanc ; parasol vert et bleu ; parasol jaune ; parasol jaune et orange. On entend des brides de conversations en italien, des rires, des cris d’enfants. Un brouhaha. Ça sent la crème solaire, le sel, les algues. Le bruit des vagues arrive par intermittence. On a de l’eau jusqu’à la taille. De jeunes garçons, riant, surveillent les baigneurs depuis leur bateau de sauvetage, devant la bande de rochers où certains se logent pour bronzer, d’autres pour pêcher. Un migrant africain ouvre une valise qui déborde de bijoux. On l’envoie sur les roses. Il laisse un bracelet tomber dans le sable, qui sera ramassé. Ça porte chance.
Hiver. Tempête de neige. Un samedi matin – Je suis revenue. La plage était plus lisse, compacte, parce que le sable avait coagulé, comme gelé par le vent qui venait de la mer. Grondement de l’eau, sourd, constant. Les déchets de la plage avaient laissé la place à d’autres reflux venant du large, plus anciens, plus lourds, rongés par le sel, dégradés par les vagues. Des bouteilles en plastique devenues opaques, des bouchons de toutes les couleurs, des algues marron, des branches, des rochers, quelques galets égarés, des chaussures, du verre poli ; rencontre entre le végétal, le minéral et les résidus humains – seul l’Homme peut effacer ses traces, s’il est attentif. Deux degrés au-dessous de zéro. Dans la lutte contre l’humanité, les mouettes (ou les sternes) avaient gagné le terrain. Plus un chat. Elles se confondaient habilement au paysage beige et gris, brumeux, à la neige qui recouvrait dès lors la plage, là où les vagues ne peuvent pas aller. Par centaines, les mouettes partageaient un repas invisible parmi les rejets de la mer. Certaines étaient sur la terre, d’autres dans le ciel, mais aucune dans l’eau, évidemment. La mer n’avait plus rien de transparent, blanchie par l’écume qui se confondait avec l’horizon, avec le sol enneigé qui formait de grandes craquelures. L’horizon était devenu informe, ravagé par les vagues blanches qui montaient plus haut que lui. Au centre de tout cela, il y avait une barque abandonnée sur le rivage, comme au milieu d’une tempête en mer.
Après : De vieilles affiches de films, qu’on dirait plus vieilles même que le film, comme passées elles aussi à la machine, toutes délavées du même bleu fadasse. Une publicité pour un Noël chrétien. Des "Elles" de la saison passée. Un tabouret avec accroché dessus un bac, pour rendre plus fluides les allers retours de lave à sèche linge. Des instructions qui ne correspondent plus aux nouvelles machines, et chacun, alors, doit adapter. Tout concourt à faire ressembler le lieu à ça, une laverie donc, sans que rien, en dehors des machines, ne tienne uniquement de ça, et tout pourrait effectivement se trouver ailleurs, dans le même ordre. Une salle d’attente d’un cabinet médical en zone péri-urbaine, un salon de coiffure le mercredi, un vieux ciné d’art et d’essais qui tient sur le temps libre de deux trois bénévoles gentils, on vient laver son cancer, sècher sa journée, le film insipide de c’est sale à c’est propre, ou un peu moins sale. Une table de pliage sur laquelle on est instamment prié de ne pas s’asseoir. Les machines en enfilade, batterie de portes ouvertes ou fermées. En face, montés les uns sur les autres par deux, les séchoirs, réservés en priorité aux clients ayant utilisé nos machines à laver, comme les toilettes des restaurants. Derrière le tambour de l’un, un crustacé tout plié, l’édredon. Des reproductions de tableaux ayant pour thème la lessive, Ernest Meissonier Les Blanchisseuses à Antibes, Marcel Gromaire La Lessive, Giovanni Boldini La Lavandière. Trois photo de Marylin, certains l’aiment chaud, et une de Jennifer Lopez, cuissardes et cheveux au vent. On se dit, si on regarde, si on est de ceux qui restent, de cette moitié-là du monde qui s’attarde dans le lieu pendant que le temps fait son oeuvre, blanchit et sèche, on finit par se dire que des affiches il y en a trop. Dehors, ceux qui fument, et c’est un autre temps, la rue, la soirée qui pousse contre le flanc du jour, il faudra rentrer, plier et ranger, mais rêvasser encore, devant les vélos Déliveroo turquoises. On lave autre part que chez soi son linge sale, on mange chez soi la nourriture faite par d’autres mains que les siennes, est-ce-que ce soir on parviendra à habiter sa propre nuit, ou devra-t-on loger une fois encore celle d’un autre, on se réveillera en pagaille, rapatriant en vitesse ses menues affaires, le doggy bag avec dedans encore la nuit toute froissée, un cauchemar à repasser sur la table de pliage. Les machines n’appartiennent qu’à ici, de marque Miele, on identifie immédiatement la fonction, et on connaît par coeur le parcours, de mettre le linge aux machines à sous, de la lessive qui tombe en poudre dans le gobelet à start, sortir le linge, payer, sécher et puis revenir chez soi, moins propre que son linge, la journée encore qui colle, et on n’a pas pris de détachant, ça on l’a encore oublié, on fera sans. Au sol, un carrelage de petite école, jaunasse rouge ou blanc. Un tableau de liège, pour punaiser le local, la ville toute proche, quand le quartier fait tout Paris. Parlez anglais cours totalement adaptés et sur mesure chez vous ou tout près de chez vous, Professeur de piano pédagogie expérimentée donne cours tous niveaux, un numéro en 07, Je recherche une aide informatique pour apprendre à copier des fichiers des dossiers pour envoyer des pièces jointes surfer sur internet réserver des billets, Mendy Travaux peinture papier peint parquet carrelage moquette rénovation plaquiste pour travaux professionnels à prix imbattables, Garde d’enfants soutien scolaire ménage repassage courses, Les caprices de Marianne d’Alfred de Musset. Si ceux-là se connaissaient, détachaient le petit numéro coupé exprès pour qu’on puisse, d’un coup d’index, l’arracher, alors Alfred de Musset serait tout propre, Internet bien repassé et carrelé, les enfants d’internet bien gardés et le piano saurait parler anglais. A quoi tient la mélancolie propre à ici, au tout ordinaire d’ici, l’été et on dirait mélange d’herbe coupée et de lessive, l’hiver et il fait bon se coller près des séchoirs, et un lieu hors maison où il n’est pas suspect de rester, de s’installer, même d’ouvrir un livre. On est arrivé, un peu honteux, ses soirées en boule dans le sac, on repart un peu plus fier, on dit au-revoir, des résolutions à bout de bras, on ira bien, on n’attendra pas qu’arrivent les taches pour venir ici, on fera toutes les choses un peu mieux.
Au croisement en bas de la pente, de longues lettres blanches annoncent le panneau octogonal rouge encadré de blanc du stop, monté sur une tige métallique ajourée. Il oscille légèrement sous le vent. Il n’y a pas de trottoir de ce côté de la rue, la limite entre la route et le bas-côté est marquée par un caniveau où de l’eau s’est accumulée autour d’une grille d’égout. Elle coule, suggérant le bruit d’un petit ruisseau. De longues racines accrochées à la pente du terrain butent contre le ciment et plongent sous la route (il en faut plus pour dérouter de telles racines). Un chien - un labrador au poil doré – vient renifler le lierre autour du panneau, se ressaisit et repart. Juste derrière le stop, une bouche à incendie blanche- gros tuyau coiffé d’un embout pointu avec des sortes de moignons vissés sur le côté. A cette intersection en T, il est possible, comme l’indiquent deux panneaux marron, en croix, plantés sur un piquet métallique, d’aller vers Muir Way (déjà vu ce nom dans d’autres lieux, là où la ville renvoie à la nature ou la nature à elle-même) ou vers Park Hills. Un jeune homme surgit à pas rapide, bonnet noir, jeans, les bras en balancier, barbu. Derrière lui, deux femmes - en collants de sport- dont la conversation se perd « the critique of.. ». Au même moment, sur la droite, deux petits vieux marchant au pas- lui, vouté, casquette beige, doudoune noire, une canne en bois - elle, tennis, pantalons noirs très lâches. En face du stop, un numéro de maison, 1103, peint en noir sur une petite planche rectangulaire grise clouée à deux poteaux à hauteur d’homme. Seul le toit d’une maison construite en contre bas est visible. Sur les tuiles grises, des panneaux solaires. Le garage situé au niveau de la rue est grand ouvert. Une voiture grise, avec un autocollant rouge (« Vote Hillary » sans doute) y est garée. Il y a aussi des étagères et un vélo appuyé au mur. A droite du garage, trois poubelles, une bleu clair (ecology center),une noire (city of Berkeley), une verte (plant debris only), les roues tournées vers la route, alignées- la verte collée à la noire, la bleue plus loin, le couvercle soulevé par des cartons aplatis-. Dans les branches du cèdre rouge adossé au garage, le frisson du vent interrompu par le sifflet lointain, long et sourd d’un train (« un Santa Fé ! » s’écrirait l’enfant dans la poussette arrêtée devant le stop, s’il ne dormait pas).
Dans la voiture, arrêt obligatoire devant le stop. L’enfant dort dans le siège arrière. Crépitement des gouttes de pluie sur le toit métallique. Au croisement en T, un panneau de forme octogonale rouge encadré de blanc se découpe dans la brume. Quatre lettres majuscules blanches, STOP. Garé en face, un pick-up- blanc- devant un panneau jaune avec deux grosses flèches noires confirmant le tracé de la route, ou l’annonçant pour qui serait distrait : la circulation peut continuer soit vers la droite soit vers la gauche. En face, c’est un garage. Au coin en haut gauche une petite lumière qui s’éteint. Il est fermé par une large porte beige quadrillée de vert clair. Y-a-t- il une ou deux voitures à l’intérieur ? Une boîte à lettre rectangulaire noire, accrochée au portail en planches verticales vert clair, suggère la présence d’une habitation (lien entre la maison non visible et un ailleurs indiqué par les routes). Trois poubelles sont disposées perpendiculairement à la route, toutes fermées- la verte accolée à la noire, elle-même à la bleue quelque peu inclinée vers l’arrière. Devant la bande blanche du stop, de grosses flaques d’eau et une bouche d’égout ronde au milieu du carrefour. Les branches dénudées au dessus du stop se balancent légèrement. Le bruit d’un avion résonne. Un cèdre rouge crève le plafond du ciel alors que le panneau marron indique Park Hills suivi d’une flèche vers la droite. Bruit de plaques métalliques qui claquent juste après le stop sous le poids des roues de la voiture. D’autres plaques d’égouts ? Le monde souterrain n’est pas fléché.
La rue César Franck forme un angle droit. L’axe des ordonnées est composée des numéros 2, 4, 6. L’axe des abscisses est composée des numéros 8, 10, 12. La rue César Franck n’a pas d’impair. Entre l’abscisse et l’ordonné la route fait le tour d’un parking. Chacun de chez lui peut garder un œil sur sa voiture et pour une seconde 10 minutes ou toute la journée être spectateur de la circulation des biens et des personnes de la rue César Franck, de la rue Camille Flammarion et du boulevard Marie Stuart. Une fois un samedi, le parking a servi à une fête de quartier. Il n’y avait plus aucune voiture et dans ce vide résonne l’écho d’une adolescence à l’eau écarlate.
Juste avant le 2 de la rue, il y a un carré de pelouse sur lequel pousse des buissons courts piquants et marrons dans lesquels on aura un temps l’idée de pousser par surprise l’interlocuteur avec lequel on est en train de faire un bout de route et qui se trouve du côté buisson court piquant marron qui borde les plates-bandes entre 2 porches. Entre le 6 et le 8 il y a un passage pour descendre aux caves du 8, 10, 12, surmonté d’une rambarde qui sert de poste d’observation. 22 !
Au 2 il y a Joachim et Fernando, au 4 Cathy, au 6 Corinne, au 8 Etienne, au 10 ma mère deviendra veuve puis perdra son fils, au 12 on l’appelait Kalaï on disait ta mère t’as fait de la morue. Après viendront les Turcs, après les vietnamiens, après les somaliens. Les immeubles font 4 étages. Il y a 2 appartements par palier tous des F4. Nous on avait chacun notre chambre.
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne 26 décembre 2016 et dernière modification le 27 mai 2019
merci aux 7638 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page





