
avec Francis Ponge, la littérature retournée comme un gant
Francis Ponge, 14 fois le même objet
Toujours même principe : ne pas considérer la proposition comme exercice, mais chercher à quelle pointe de risque elle va à la fois révéler sur soi-même et sur la friction au monde. Sinon, autant s’en tenir à décrire les objets qu’on a dans son sac (remarque, je n’ai rien contre).
Alors, d’abord – et c’est la tâche de l’animateur de l’atelier, quel que soit le public, classe de 5ème ou CE2 ou Ulm c’est tout comme –- de recontextualiser : l’histoire des objets dans la littérature c’est une horloge précise. Ainsi, si Etienne Binet n’est pas mis au premier plan des écrivains du XVIIe siècle, c’est pour la résistivité de la littérature comme symbole et institution à accepter que l’interrogation sur les choses lui soit consubstantielle.
Retournez voir chez Balzac, n’importe quelle description d’ouverture, juste pour examiner le statut respectif de l’objet par rapport aux lieux. L’objet n’advient à la narration qu’en fonction de son importance symbolique : une horloge ou une marqueterie, seulement si due à Boulle. La grande rupture, je la vois dans Madame Bovary : quand la description de la casquette de Charbovary remplace le personnage.
Dans Proust, l’objet accède à une fonction susceptible de faire bifurquer ou d’induire la narration par sa rupture technique : l’ascenseur, le téléphone, le pianola d’Albertine ou le Kodak de Saint-Loup. Nouveauté radicale : c’est l’espace de notre relation à l’objet qui devient premier et moteur.
Et c’est là qu’advient Ponge. Désolé de la longueur de la vidéo, on est dans un champ qui me préoccupe depuis pas mal d’années. Résumé :
– que dans la conception du Parti pris des choses, les textes qui déterminent l’oeuvre ultérieure de Ponge (disons : la cigarette, le cageot, le pain, le galet...) sont comme pris dans la gangue de textes relevant plus conventionnellement du poème en prose ;
– ce qui reste radicalement mystère, c’est l’obstination de Ponge : de ses 28 ans (1927) à ses 38 ans (1937), il propose obstinément à la publication ce recueil composite, et les nouvelles strates d’écritures (aujourd’hui dites Proëmes), sont des extensions, des justifications, des commentaires. Ponge s’écarte malgré lui, par le mur des refus de publication, d’une conception poétique de la prose. Son Introduction au galet, décrivant le travail de composition du Galet, lui ouvre l’espace définitif de son écriture ;
– définitivement, entrer dans l’espace vide et muet qui sépare toujours le mot – ce qui nomme et désigne – de l’objet, ne suppose pas de remplir ce vide par un accroissement d’analyse ou description, mais de multiplier, comme en arrière de soi, ces processus de désignation, accepter leur hétérogénéité, leur récurrence, leur obstination dans l’obstacle, et les constituer comme ensemble : le texte neuf sera l’ensemble de ces désignations plurielles, lancées vers l’objet et toujours n’en manifestant qu’un écart. La totalité de ces écarts deviendra cet au-delà de la langue, où la chose muette, mais sociale, construite, historicisée, résiste au langage.
Dès Rage de l’expression, puis dans les « classiques » que sont Le savon, La fabrique du pré, Le carnet du bois de pin, c’est ce processus qu’il mettra systématiquement en oeuvre.
Un des plus hauts exemples (mais Comment une figue de parole et pourquoi ou bien sont Pour un Malherbe en sont aussi des démonstrations) reste, dans Méthodes son « Journal d’un verre d’eau ». Pendant plus de 4 mois, une suite de notes obstinément consacrées au verre d’eau que, censément, celui qui proposera à son public tunisien une conférence sur la poésie aura devant lui sur la table. Objet matériel, concret, mais rassemblant mille vocabulaires (la transparence, le vocabulaire du diamantaire, l’organicité de l’eau, le goût).
Quand j’ai abordé ce qui est pour moi principe essentiel : que, dans les paramètres rassemblés dans toute prise d’écriture, doit être pris en compte cet irrésoluble écart entre le mot et ce qu’il nomme, où la révolution Ponge est incontournable, je suis simplement parti du Parti pris des choses, d’une contrainte d’objets pauvres (belles pages d’Hélion, ami de Ponge, qui peignait aussi les cageots, son Estafette garée au coin du marché), et la proposition d’écrire en 2 colonnes : sur une des feuilles d’extraits disponibles, j’ai ainsi mis le Galet en vis-à-vis de l’Introduction au galet. Savoir qu’on écrit à 2 voix, 2 strates, est une possible proposition.
Je continue régulièrement de travailler à partir du Journal du verre d’eau – voir aussi la fiche d’extraits. Pour 2 raisons : 1, la banalité même de l’objet, et sa transparence, font que la proposition de Ponge n’interfèrera pas dans la relation entre celui qui écrit et l’objet qu’il a choisi ; 2, l’incrément temporel (toutes les notes sont datées, Ponge ne récrit pas une note déjà rédigée, il en conçoit une autre) oblige à quitter l’idée d’un texte bloc, ou descriptif, mais prendre conscience de cette multiplicité d’incises venant d’univers et de questions bien distinctes.
C’est très récemment que j’ai commencé à travailler avec le texte proposé pour aujourd’hui (3ème fiche d’extrait) ; L’oeillet.
Rappelons le contexte :
– Ponge, sous la couverture d’un agent d’assurances, dispose d’une voiture et d’un laisser-passer pour franchir la ligne de démarcation, il transmet oralement des messages aux réseaux de résistance, parachutages d’armes, actions ou évasions, exfiltration d’agents. C’est dans ce cadre qu’il est régulièrement hébergé à Roanne, sous fausse identité et clandestinement. Dans le couvre-feu de rigueur, et l’obligation de tout contrôler de ses gestes, sa relation à ce jardin où il sort un moment la nuit devient essentielle ;
– le texte de 18 pages est daté Roanne 1941 – Paris 1944 (l’année de Paris libérée). Il est grossièrement constitué d’un triptyque : prologue presque programmatique sur la poésie, postface où il n’y aurait plus rien qu’un texte continu sur l’oeillet, tous échafaudages enlevés, et pour corps de texte une série numérotée de 14 fragments ;
Le début :
Est-ce là poésie ? Je n’en sais rien, et peu importe. Pour moi c’est un besoin, un engagement, une colère, une affaire d’amour-propre et puis c’est tout.
Je voudrais que ce passage serve de guide à votre choix d’un objet, de la chose qui sera l’objet de votre texte. Rien d’illustratif, rien de neutre. De toute façon il y aura mystère. L’ombre de la guerre n’est pas évoquée dans le texte de Ponge : pourtant, c’est bien ce qui le contraint à sa visite du jardin, nuit tombée, dans la ville où il est clandestin, qui détermine l’intensité du texte.
Attention : pas de fleurs (encore moins d’animaux, ça m’est arrivé !). Où, quand et comment l’objet choisi devient-il risque ? C’est ce qui m’a guidé dans les objets pris pour exemple dans la vidéo. Une chaussure suffit, mais sachez ce qui vous y motive.
Je ne voudrais pas que ma consigne soit prise à la lettre : vous n’irez peut-être pas à 14 fragments. Mais l’important serait de faire comme si. Pas en écrire 5 ou 6 et m’envoyer le texte par retour. Mais expérimenter cette durée qu’inscrit Ponge. Revenir le lendemain et le surlendemain, pousser le texte là où vous n’aviez pas prévu qu’il irait. Récrire un fragment existant, et c’est un autre fragment. Faire l’effort du saut mental dans cette hétérogénéité : les fragments partent d’univers, de questions, de scènes différentes. La description analytique de l’objet en est un élément parmi les autres. Le temps, la matière, la relation en sont d’autres.
Je reviens pour finir à la démarche : avec Ponge, la littérature s’est dotée d’une pièce supplémentaire. Presque une lettre de plus à l’alphabet des formes. Comme toute invention de littérature, c’est la relation au réel qui est transformée. Un grand atout de notre démarche d’atelier, c’est de revenir au moment de cette invention, l’examiner depuis sa transition. Dans la vidéo, je parle de Jean-Loup Trassard, de Régine Detambel : cette nouvelle relation du mot à ce qu’il nomme est certainement invisible dans notre usage aujourd’hui de la narration.
Le moulage dentaire en plâtre qui a servi à la réalisation du dentier, posé sur le téléviseur dans telle nouvelle de Raymond Carver, n’aurait pas été concevable même au temps de Flaubert.
À revenir à l’instant et au mécanisme de la transition, on permet à ce qui est un des paramètres parmi d’autres de notre écriture de prendre artificiellement toute sa place.
Je ne peux pas vous aider quant au choix de l’objet. De mon côté, quand j’ai écrit Autobiographie des objets, il s’agissait certainement plus des premiers signes de la perte de mémoire aujourd’hui totale de ma propre mère, qui ont servi de déclencheur. Au mot-clé Francis Ponge sur le site vous trouverez traces de précédents ateliers.
Astuce si vous avez du mal à vous décider : et si vous relisiez votre propre texte de l’atelier Perec « table de travail », rien qui pourrait servir ? Ensuite, les 2 ou 3 premiers fragments viendront vite, et serviront d’embryon : c’est eux-mêmes qu’on questionnera. Il y a des extraits de Detambel et Trassard dans les fiches aussi, qui peuvent vous mettre quelque démangeaison dans le bout des doigts.
Mais soyez strict pour vous appliquer à vous-même cette technique proposée par Ponge dans son Oeillet : 14 fragments désignant tous le même hiatus. Arrêtez-vous à 7 ou 11 (préférez l’impair, sussurerait Verlaine), mais encore mieux si la fatigue même de l’exercice vous contraint de monter aux 14.
Soyez gentils, ne m’envoyez pas 3 ou 4 versions successives parce que vous auriez manqué un ajout. On a le temps, laissez mariner.
vos contributions
– Atelier lancé le 25 juin 2016, ouvert jusque 31 août 2016, rejoignez-nous !
– Vous pouvez bien sûr accompagner votre envoi d’une photo : format jpg, dimension max 520 px merci.
– Les publications se font dans l’ordre chronologique de réception.
– Bien repréciser dans chaque envoi la signature souhaitée et s’il vous plaît toujours inclure le lien éventuel vers blog ou site, même si vous pensez que je m’en souviens par coeur (c’est quand même un processus laborieux, les mises en ligne !).

Quelques grammes d’argile dans la main du potier valsent dans son esprit au rythme du tour. La main façonne la terre humide, faisant naître la forme souhaitée d’une sphère boueuse. Il caresse la pâte qui se ramollit au contact de sa chaleur. Il étire le corps de l’objet, en resserre le col étranglant légèrement le boyau de terre. Ses doigts fins lui dessinent un bec. La forme désirée sort peu à peu du néant en suivant la volonté de l’homme. Il la trouve sensuelle mais ce n’est pas son but. Il corrige et la fera plier à sa volonté jusqu’à ce qu’elle devienne simplement fonctionnelle. Il est là pour ça, créer l’utile puis le rendre indispensable afin que chacun ait besoin de son travail et qu’il se sente utile à son tour.
Un pot d’argile blanc vernissé presque nu s’il n’y avait ce dessin de cœurs vendéens entrelacés sur la panse, dort dans la boutique du potier. Elle rentre de la plage, remarque la boutique sous l’ombrage des pins. En vitrine, quelques assiettes étalent leur élégance mais elle remarque ce pot si simple à l’arrière un peu dissimulé derrière un ficus. Elle aime la discrétion, cet objet d’une utilité banale lui plaît. L’alliance du blanc et du bleu l’attire, on a toujours besoin d’un pichet gardant l’eau bien fraîche en été. Mais son utilité primaire n’est-elle pas de parer son quotidien d’un peu élégance ? Elle l’achètera en se demandant bien pourquoi. Peut-être tout simplement parce qu’il lui a demandé, songera-t-elle.
Sous la tonnelle les enfants jouent à colin-maillard. Leurs cris joyeux éclatent dans le bosquet, les rires fusent. L’été s’étire dans la touffeur aoutienne. On entend au loin le grondement sourd de la marée montante. Un mouette plane au-dessus du jardin, puis d’éloigne vers l’ouest en lâchant un ricanement strident. Elle sursaute sur son transat, brusquement réveillée par le cri de l’oiseau. Elle cherche des yeux le groupe d’enfants puis les appelle pour qu’ils viennent goûter. Dans le petit pot blanc strié de buée, les glaçons fondent doucement. La citronnelle embaume l’après-midi d’un parfum méditerranéen. Elle pose la main sur le ventre rebondi du petit pot d’argile, puis en caresse sa nuque. Elle aime la chaleur de l’été, mais cette année est vraiment étouffante. Heureusement qu’elle a fait des réserves de citronnade.
Un mariage à la campagne réunit tous les cousins réunis dans la joie du partage. L’occasion de ces grandes retrouvailles n’est pas si fréquente. Le plaisir des souvenirs d’enfance dessine un sourire sur toutes les lèvres. Sur une console à l’écart, les cadeaux s’exposent. Au milieu des pièces d’étain et des ménagères d’argent, trône un petit pot d’argile tout simple. Devant lui, une lettre à l’écriture surannée finement déliée d’une grand-tante qui n’a pas pu venir puisqu’elle ne quitte plus son lit. Dans les feuillets de la lettre, tout l’amour d’une marraine pour sa jeune filleule et l’espoir qu’elle se servira du petit pot de terre en se souvenant des après-midis d’été et du goût inimitable de sa citronnade.
Une discussion un peu vive, des portes qui claquent. Un jour d’orage où l’atmosphère est si lourde que les cœurs s’écorchent et que les mains se repoussent. Peut-être un courant d’air dans la tempête ou alors un geste de trop. Le petit pot s’écrase sur le sol, son étagère de prédilection ayant été arrachée du mur. Les chevilles d’encrage devaient être trop fatiguées, ou l’étagère trop chargée.
Un pot au fond fendu par les ans, tellement recollé que son ventre ressemble à une carte routière, jaunit peu à peu abandonné sur le dernier plateau d’une étagère. Le rayon est devenu trop haut pour la propriétaire. Le petit pot a été oublié. Il s’est peu à peu recouvert de la poussière grasse de sa cuisine à l’ancienne. Il est devenu l’image de la vie qui s’en va à petits pas, ceux que la vieille dame enchaîne lentement sans oser sortir seule désormais, de peur de la chute.
Un pot retrouvé à la cave quelques années après. Il fallait bien venir faire l’inventaire. La maison sera vendue et les objets d’une vie dispersés aux quatre vents. Bien sûr les cousins récupéreront ce qui leur sera utile. Et que pourrait-on faire d’un pot brisé tant de fois qu’on peut voir le jour à travers ?
Un pot d’argile vernissé, à la couleur incertaine, décoré de cœurs vendéens tirant sur le bleu, sur un plateau de bois dans ce vide-grenier. Des passants dubitatifs, quelques questions mais peu d’achat. C’est fou ce que les gens arrivent à vendre comme vieilleries. Mais ce petit pot lui plaît, elle sait comment le rafistoler, et bientôt les blessures du temps ne se verront presque plus. Elle négocie le prix par tradition puis rentre chez elle avec sa trouvaille sous le bras. Elle est sûre qu’il est heureux d’avoir retrouvé un endroit où sentir la vie continuer autour de lui.
Une boutique de décoration dans un petit port de Vendée. Sur le plateau d’une commode peinte, au soleil de l’après-midi, un petit pot d’argile raconte à son nouveau compagnon, une soupière « d’époque » qu’il a vu le jour non loin d’ici, sous les mains expertes d’un potier disparu depuis un siècle.
Elle a décidé que sa nouvelle maison ultra-moderne avec cuisine américaine ouverte, aux baies immenses pensées pour un style de vie « dedans-dehors », n’aurait pas d’âme si elle ne la remplissait pas d’objets chargés d’histoire. Elle chine sa vie dans les brocantes et les boutiques « vintage » où elle a trouvé un petit pot d’argile qui conviendra très bien à son plan de travail en alu-brossé. Il sera parfait pour recevoir son bouquet de cuillère en bois. Elle préfère avoir tous ses ustensiles à portée de main lorsqu’elle cuisine pour ses amis.
Un petit pot d’argile au bec tourné vers l’ouest se chauffe au soleil couchant. Une main attrape une des cuillères qu’il contient un peu brutalement et le renverse. Il va encore perdre un morceau de son anse si ça continue. Ils pourraient faire attention, il n’est pas de la première jeunesse, tout de même. La main le relève en tremblant. Des yeux bleus comme l’océan le contemplent, braqués sur ses deux cœurs entrelacés et se remplissent de larmes. C’est le jeune locataire, il est aussi maladroit que sentimental. Elle lui demande pourquoi il s’inquiète autant pour un pot. Il lui explique qu’il a passé toute les vacances de son enfance chez sa grand-mère vendéenne qui est désormais enfermée dans une maison spécialisée pour les gens dont la mémoire est partie avant eux.
Un petit pot d’argile dort sur un plan de travail en alu-brossé. La petite dernière a bien grandi, elle rentre du lycée et se fait des pancakes. Il adore l’odeur du rhum qu’elle met dans sa pâte, ça lui rappelle ce que son créateur buvait dans la pénombre de son atelier quand l’été devenait trop lourd.
Un petit pot d’argile, c’est juste un amas de terre, friable et fragile. Pourtant celui-ci a dû en voir passer des heures de joie ou des jours de chagrin. Elle y est attachée, bêtement, sans raison, peut-être à force de l’avoir toujours vu dans cette cuisine. Elle demandera à sa mère si elle peut l’emporter quand elle partira s’installer dans sa chambre d’étudiante. Ça sera un point d’ancrage, un souvenir de sa vie d’avant.
Elle a décidé d’apprendre la poterie. Elle a toujours aimé le contact de la terre humide. Elle espère avoir un jour la dextérité de ce potier qu’elle a vu à l’œuvre dans son stage de vacances. Idéalement, elle espère bien y arriver. Elle gardera le pot de sa grand-mère devant les yeux, et en reproduira la rondeur autant de fois qu’il lui faudra, jusqu’à ce qu’elle y arrive. Elle a toujours aimé son ventre rond et ses cœurs vendéens aussi bleus que l’océan en été. Elle est sûre qu’il lui portera chance.
J’ai devant les yeux un objet absent imaginaire de forme rectangulaire… comme si la mémoire, comme si la ré-présentation était impossible… et pourtant, dans ce cadre rectangulaire inexistant ou abstrait ou virtuel, scintillent comme des appels d’air, des appels à l’écriture…
L’objet absent, ce rectangle… rectangle blanc de la tablette où s’inscrit le noir de l’écriture… mes velléités d’écriture s’inscrivent en négatif dans le cadre rectangulaire d’un objet réel, une tablette numérique, qui me renvoie le souvenir des ardoises disparues de mon enfance, dont le fond noir recevait les signes blancs que je traçais à la craie…
Le printemps qui revient n’est jamais le même, l’enfance révolue a disparu, les jours anciens ne reviendront pas… mon temps, le temps humain, n’est pas cyclique… sur mon ardoise imaginaire, je vois une flèche blanche… curseur du temps… comme au cinéma, j’aperçois déjà le clap de FIN…
Les lignes de l’écriture s’enroulent et se déroulent, s’effacent ou se gravent à l’encre virtuelle sur l’écran blanc de la tablette… tentent de se faufiler entre les fils emmêlés des lourds écheveaux de souvenirs… fragments de mémoire agglutinés dans l’épaisseur du temps… où l’étoupe étouffe les mots avant qu’ils ne parviennent à se former à la surface…
De tous les objets anciens que j’ai tenus entre les mains, il ne me reste donc que cette matrice… la forme idéale d’un rectangle, mère des réminiscences venues du plus lointain de mon passé… forme de mes cahiers d’écolière et de mon premier livre de lecture, des premières cartes à jouer, des premières images… forme de la toile cirée qui recouvrait la table familiale… je savais qu’elle était superposée aux plus anciennes et que leur épaisseur retenait dans ses strates la mémoire de notre histoire… plus tard, sous l’effet d’un élargissement sidérant du monde qui s’ouvrait à moi mais que je ne pouvais plus contenir dans l’espace restreint de mes mains écartées, forme de l’écran des trois cinémas de la ville où mes parents m’emmenaient parfois voir des films qui n’étaient pas de mon âge…
Comme au cinéma, ma tablette, cette ardoise magique, laisse apparaître ou disparaître les mots, les sons et les images… sur l’écran scintillant, je vois ou j’imagine le présent absent et le passé présent… le temps recomposé… ma vie décomposée…
Le monde se recréait à la pointe des plumes Sergent-Major crissant sur le papier mat des cahiers de brouillon, ou glissant sur le papier brillant des beaux cahiers du jour qui recevaient nos chefs-d’œuvre… le monde continue de s’écrire à la pointe extrême de l’instant, sous la pression de nos doigts qui tapotent désormais les touches virtuelles de claviers représentés par une image…
Imaginer chaque impact de nos stylos sur le papier, chaque point de contact de nos doigts sur les claviers, impulsant un rayonnement électrique qui serait à l’origine d’une formation étoilée, très loin, par-delà les galaxies visibles… penser aux pans de vie engloutis dans les trous noirs de la mémoire… entre les espaces blancs de l’écriture tournoient des univers perdus…
Plages, pages d’écriture… le cadre reste rectangulaire, mais, aujourd’hui, il n’existe plus de limite au bas de la page… le bord n’est qu’apparent… l’écriture s’enfonce à l’infini vers les abysses… si le fond de la piscine n’est jamais atteint, il est toutefois possible, en cliquant sur la barre qui balise l’espace vertical illimité de la page, de remonter vers les hauteurs…
Penchée sur la page toujours neuve, je passe le plus clair de mon temps à en scruter la surface, guettant les surgissements imprévisibles des lettres… la page est comme le lac dans lequel, enfant, j’ai failli me noyer… sa substance est trompeuse, l’appui n’est pas solide…
La page est un étrange objet… l’étrangeté de la page est démultipliée par la tablette numérique… légère, elle ne pèse pas dans le creux de mon corps qui l’accueille… et il est rassurant d’appuyer les doigts au repos sur les bords de son cadre… aussi plate que les ardoises de mon enfance, son format l’apparente aux fins cahiers qui ont reçu mes premiers essais d’écriture…
Pouvoir de l’encre sur la page blanche, quand je voyais mes premières phrases avancer sur la page comme des vagues, avec le sentiment quasi religieux d’assister à la création du monde… pouvoir démultiplié de la tablette qui ajoute à l’écriture les couleurs et les formes des images, leurs mouvements, la musique des sons et des voix…
La page promettait déjà l’universel et l’éternel… elle attirait vers elle en les transformant en lignes d’écriture les ficelles des marionnettes ligotées à l’intérieur de nous, et propulsait nos véritables personnes à la lumière…
Les lignes d’écriture se continuent aujourd’hui du même geste, augmenté des pouvoirs de la tablette… les pages virtuelles se déroulent comme un papyrus ou de vieux parchemins dans le cadre rectangulaire de l’écran numérique… le haut et le bas qui autrefois se touchaient dans le rouleau refermé se rejoignent aujourd’hui d’un seul clic sur une commande de permutation qui permet le retour instantané vers le premier ou le dernier mot, l’alpha ou l’oméga… la page virtuelle est un esquif dans l’océan du web… elle est portée par des vagues de liens connectés à l’immense du monde… sa surface est agitée par la houle de ces mêmes liens qu’elle porte autant qu’ils la portent… ma tablette interconnectée fait de moi un être de réseau… dans l’eau glissante que ses bords encadrent…
La vapoteuse. Au début, on a un peu honte. Que l’objet soit « joli », c’est précisément ce qui le disqualifie.
L’élégance de la cigarette tenait dans la consommation, la manière. La certitude de sa nocivité donnait quelque assurance publique, on s’en fichait des communiqués, le sanitaire c’était pas la vie. Avec la vapoteuse, la mienne noire au cul large à l’embout métallique, on ne fume plus. On vapote, on fumote, on lance des nuages de douceurs, on ne défie plus la mort. Reste l’addiction.
Elle est lourde, la machine, elle pèse ses 75 boules : pleine de boutons, des ronds des ovales et des triangles adoucis, elle manifeste la technologie et réduit la main à simple préhension, les doigts au pauvre pouce. Avant, c’était l’index alerte, la clope roulée c’était savoir-faire : chacun son style.
Les premières vapoteuses étaient longilignes. Elles prolongeaient l’esprit clope, elles y jouaient. Fallait nous prendre au sentiment, à l’habitude. On y préfère maintenant les grosses batteries, la dissymétrie pratique, avec le réservoir fin, et l’embout plus encore. Du gros calibre à l’arrière, profilé devant. Y a la prise en main et la prise en bouche. Ça vous organise un corps.
Socialement, c’est sûr, y a gain. On peut vapoter (vaper ?) dans la gueule d’en face. Parfois même, il aime le parfum. Souvent, il se renseigne sur le modèle. Ça a quel goût ?, qu’il demande. On ne sait jamais répondre.
La préciosité dans le liquide. Belle couleur toujours, cognac or fondu, ça glisse aux parois, et c’est la part animée. Du truc. Et c’est ce que j’émets par moutons discrets, toujours satisfait.
Vapoter (« vaper » ?, merde !) ça reste un mystère. C’est pas inscrit, encore. La vapoteuse, elle machine toute seule, avec ses boutons et le liquide magique dedans. On est pas bien fier de l’arborer, mais on l’arbore. Dans le fond, la mode est presque passée et ceux qui continuent ont leur objet bien à eux, après plusieurs essais des modèles trop ou pas assez. On en use façon résigné, certain que ça fait comme métaphore. Mais de quoi ? Pourquoi on fume plus, en vrai ? Où est-ce que ça l’fait, la vapote ?
Bouton majeur pour tirer. Il est rond, il vient sous le pouce, naturel, évident. Il sert aussi à éteindre, faut presser cinq fois. Boutons secondaires qui servent pour régler des trucs qui finissent par « Ω », « v » ou « w ». Avec du nombre devant. On tâtonne, on trouve, on touche plus.
Atomiseur, clearomiseur, e-liquide... Tout un vocabulaire que la vapoteuse charrie et qui lui donne des airs de futur. Y a de la Nasa dans le creux de ma main.
C’est pourtant le truc perso. La cigarette, on la faisait tourner, le pote qui voulait une simple taf, on lui passait. Mais la vapoteuse, on aime pas bien la tendre vers d’autres lèvres. Comme si le tabac de la terre supposait ce partage que le composant électronique refuse.
Parce que la vapoteuse traîne avec soi, au bureau ou en pogne, sur la table en terrasse : elle est fidèle. On peut tirer à intervalles réguliers. On peut aussi laisser de longues minutes entre chaque bouffée. Mais on la garde en main, et elle rythme les conversations. Si j’aspire, là tout de suite, c’est que je chercher à formuler un argument. C’est la bonne excuse.
Toujours le spectre de la maladie. Parce qu’au fond c’est pas anodin. L’objet devait faire transition vers l’arrêt total. Limiter à la nicotine, et plus rien après, plus rien enfin. Pourtant on s’est habitué, on a installé un vrai rapport de consommation, d’entretien, des rythmes de recharge, et la petite collection de fioles. Difficile de se projeter sans. Mais l’objet est trop propre. Ça rutile suspect.
Avant de se coucher, on la laisse charger sur le port USB de l’ordinateur. Dans le matin bleu, après le yaourt, pendant le café, on y tête sauvagement, presque passionnément devant la presse en ligne qui énerve, et c’est la mise en route du jour, juste avant d’enfiler le froc propre. Alors à nouveau, elle est amie, la vapoteuse. Elle fait partie de l’orchestration matinale.
Au boulot, on se cache aux toilettes. Un peu honteux, mais soulagé de l’avoir gardée en poche. Elle est amie, décidément. Surtout rayée, ou avec les petits pètes aux coins qui la font vraiment nôtre.

Semi-remorque : remorque de semis ?
J’aime que ce mot ait un trait d’union, il représente mon camion préféré.
Au diable, les réformateurs de l’orthographe !
Dominer la route en tenant le volant.
Les voitures, vues de la cabine, sont de pauvres moustiques.
Le moteur chante, pas besoin d’allumer l’autoradio.
Sur l’autoroute (et jamais d’autocamion ?), le ruban noir avec ses pointillés blancs.
La ceinture de sécurité, les barrières de sécurité, les bandes d’arrêt d’urgence.
En plus de l’airbag, il manque peut-être une bouée de sauvetage.
Le pare-brise, piste d’atterrissage mortel pour moucherons, mais papillons si rares.
Le lave-glace nettoiera ce cimetière glacé.
Le semi-remorque : l’un (puissant) tire l’autre (fatiguée).
On mange, on fait la sieste, on dort dans la cabine.
C’est un appartement mobile.
Pourvu que personne ne fasse démarrer le camion pendant qu’on rêve sur le parking de la station-service.
Les pneus sont énormes, increvables : l’air y est vissé.
Des fils jaunes et rouges relient le tracteur à ce qui est tracté.
Il y a de l’électricité en route.
La vitesse est limitée mais le GPS veille aux « zones dangereuses ».
Un rond blanc affiche « 90 » sur le dos de la remorque : les suiveurs peuvent contrôler.
Les arbres défilent à une cadence uniforme.
Partout, maintenant, des éoliennes : un château en forêt.
J’imagine l’une d’elles sur le toit du camion, l’écologie au-dessus de la tête du conducteur.
On pense à un Don Quichotte moderne.
RTL nous bassine (à part ses émissions nocturnes de rock).
Le semi-remorque aime s’arrêter tous les 300 km, le chauffeur aussi.
Les restaurants « Routiers » ont quasiment disparu : dommage, on se retrouvait entre travailleurs pour discuter de nos centres d’intérêt.
Il s’est quand même trouvé un ingénieur pour penser à placer en hauteur les distributeurs de tickets d’autoroute pour nos engins surdimensionnés.
Hélas, plus de jolies filles pour délivrer le droit de franchir le péage : robotisation, Vinci a vaincu.
Elles nous souriaient, cela encourageait à continuer de rouler.
La nuit, mon semi-remorque est garé parallèlement à une trentaine d’autres.
Ce sont comme des navires venant d’accoster.
On entend alors parfois des bruits dans les couchettes des cabines.
Il ne m’a pas coûté cher et je n’ai pas de traites à payer.
Il m’obéit au doigt et à l’œil, il m’accompagne tous les soirs, sur une étagère de la chambre, dans la nuit tourmentée.
C’est un semi-remorque « Dinky Toys » jaune, avec l’inscription « Kodak » en rouge sur le toit amovible.

C’est une coupelle assez profonde, au bord supérieur festonné, au marli ondulant comme une corolle de petites vagues, en faïence émaillée, d’un blanc sans violence - la terre invisible, même en transparence, s’affirme cependant et son existence adoucit la perception que l’on a de l’émail - le bord est orné d’une guirlande dans l’esprit des grotesques, vert amande, et un oiseau, jaune et bleu, classiquement, selon la convention majoritairement respectée, ailes déployées, se penche au centre vers le petit monticule herbu sur lequel il s’est posé.
L’ondulation sage qui gagne la courbe large montant du fond vers le bord festonné, comme les plis non repassés d’une jupe se mouvant doucement en accompagnant un pas retenu.
L’épaisseur modérée de la matière, comme le souvenir de la coulée épaisse de terre humide.
Sous la coupelle, une signature, une graphie nerveuse, comme le dessin des ailes, ou des herbes qui semblent bouger dans le vent, ce vent qui a emporté un petit signe bleu sombre jusque sur le marli, signe qui est, je le suppose, ou je le sais d’instinct, un insecte.. Jallier, ou Dallier peut-être, je lis mal ces lettres tracées en noir mat, pinceau moyen, par contre, parce que je le sais ou parce qu’il n’y a pas cette majuscule initiale qui sollicite la fantaisie de la main du scripteur, c’est sans effort que je lis ensuite : à Moustiers.
L’oiseau est jaune et bleu, et je me demande - aurais dû, au lieu d’en rester à mon constat empirique, faire une recherche ou tout bonnement lire un texte quelconque sur les faïences, à la fin du 17ème siècle, au début du 18ème, quand les bleus et blancs, avec parfois un peu de pourpre, comme les belles faïences de Rouen, de Nevers ou les premières de Marseille, ont été relayés par des décors polychromes, une polychromie d’ailleurs limitée, quatre couleurs au maximum sur chaque objet – ce qui fait que d’une fabrique à l’autre, et cela vaut aussi pour les porcelaines, à part les plus raffinées auxquelles ont contribué des peintres animaliers – il est presque toujours fait appel à ces deux couleurs pour représenter les oiseaux.
Une coupelle, un vide-poche, un grand cendrier à l’origine, un souvenir rescapé, il y en eu quatre, des dix ou quinze jours de vacances dans un studio loué, début septembre – l’ai fait quatre ans de suite, avec invitation rituelle des toulonnais à une bouillabaisse préparée par mon poissonnier – au bout du port de Bandol, et de la visite, le premier jour, à une boutique de souvenirs, un peu en retrait, un peu hors du courant touristique, pour l’achat d’un cendrier de faïence, Moustiers dans trois des cas... personnaliser un peu les lieux, agréables et neutres,.. et un petit lien que je ravive parfois, quand j’en ai besoin, avec les petits matins sur le port, les longs crépuscules, les bruits d’accastillage, et de merveilleuses heures d’un vide parfait.
Le plaisir aigu du trait, la nervosité heureuse de la main, donnent à l’oiseau, pourtant occupé calmement à chercher au sol un ver, une nourriture quelconque, la légèreté, le dynamisme joyeux d’une entrée de violons.
Il n’y a aucune lourdeur dans le corps de l’oiseau, qui n’est qu’une courbe élancée, contrebalancée par celles des ailes, une toute petite tête aigüe au bout du léger renflement d’un cou allongé.
Aucun des autres oiseaux peints sur des assiettes, tasses, coupes, petits brocs de faïence, restes d’une collection constituée peu à peu, longtemps il y a, sur une suggestion que j’avais faite à ceux qui se sentaient, se voulaient obligés à un cadeau aux dates consacrées, n’a cet aspect aigu.
Tout dans le dessin est ramené au plaisir du tracé, à la finesse, les pattes sont des brindilles comme le bec, et la branche qui ancre, borne, l’ensemble et vient se balancer au dessus de l’oiseau n’est qu’un long rameau aux feuilles fines et mouvantes, la seule fleur n’est qu’un contour ébauché, une évocation rapide, comme une obligation bâclée.
Un oiseau, sur un dôme d’herbes mouvantes, se courbe violemment vers le sol, bec dardé, sous la danse d’équilibre des ailes, et tout autour de lui est mouvement vif comme un allegro.
Le motif occupe presque toute la surface, déborde de la partie creuse, et pourtant laisse toute son importance aux ondulations d’un blanc amati qui rejoint la guirlande du bord supérieur.
Un petit objet qui est là, peut se faire oublier, pose juste une petite touche plaisante à la limite de l’oeil, un petit objet utile qui se fait compagnon, qui peut, si on le désire, teinter de plaisir le regard qui se pose sur lui, entre méditation et absence.
Un dessin, l’harmonie de trois couleurs sans violence et du blanc, le plaisir du trait, la rapidité nerveuse de la main, un motif familier et toujours différent, une énergie joyeuse, qui ne s’attarde pas, des pizzicati, des reprises, réponses dans la petite musique muette de cet oiseau, et au verso la même danse dans les quatre mots tracés du même élan, avec un pinceau un peu plus épais.

L’usage de se moucher dans un carré d’étoffe est venu d’Italie, parait-il et on distingue le mouchoir de poche du mouchoir de cou - distinction encore usuelle chez les ruraux.
(Mon arrière-grand-mère l’employait pour désigner un foulard)
Blanc, il doit être blanc - dans les dictionnaires on peut lire aussi que, en anglais « white » a la même racine que « wheat » - céréale - en référence à la blancheur de la farine. Blanc, comme neige et nu, immaculé, comme une virginité renouvelée chaque jour, propre, repassé, et puis plié replié avec une goutte de lavande que tu déposais toi, de patchouli, moi aujourd’hui, une larme que j’emporte partout, toute bue, toute tue, se déplaçant avec moi toujours au fond d’une poche de jupe, robe, pantalon ou short, tablier, manteau, imperméable, sac, valise, sac à dos et jusque sous l’oreiller, le coin du piano, ici, là, à droite après le dernier do, vers l’aigu, sur la petite bordure de bois verni. Jamais vraiment repassé, tant pis. C’est toi quand même, ce nuage léger qui me suit.
Il est propre. La propreté-même. La simplicité.
A l’égal d’un dessous, d’une intimité du dessus. Il affiche à lui seul l’assurance d’une maison bien tenue.
Tu y tenais tant à ce détail. Le mouchoir de fil était ton luxe à toi qui n’a jamais rien eu à toi, jamais eu besoin d’autre chose. Il couvrait ta bouche les jours de ces forts étés quand la chaleur tombait sur tes épaules, à couper le souffle, ta chaise plantée de travers sous les arbres
Souvent lavé, bouillu dans la lourde lessiveuse avec l’odeur molle et salée, vertueuse, des copeaux de savon et le risque de voir les couleurs – tapage - dégueuler sur lui. Et puis, pendu, étendu, petite sculpture roide dans nos hivers, équilibre sur la corde à linge.
Le blanc devenu gris, ou d’un bleu passé, d’un rose qu’on n’ose afficher, comme une aristocratie perdue. Moins beau, il passe à d’autres fonctions, dégringole vers les jours ordinaires – le blanc reste la couleur du Dimanche, avec le noir aussi – en boule, dans la poche du tablier plutôt que dans celle du manteau, plié pour le cimetière ou la robe pour chez le docteur, par-dessus la combinaison synthétique.
Buvards de nos pleurs, de toutes les larmes de nos corps, il boira aussi bien l’encre de la plume, du stylo qui fuit, la peinture et le sang de nos blessures, la morve de nos rhumes, la sueur de nos courses, et nos mains de saletés vite torchées, mouchées puis cachées, tassées au fond de la poche, oubli.
Ange déchu.
Qui a un mouchoir ?
Et à combien de jeux aura-t-il servi ? Combien de fois à le trainer, à faire le tour des enfants assis en rond à le laisser tomber derrière un dos pour s’enfuir avant d’être rattrapée ?
Combien de masques d’enfants cow-boys, de mouchoirs drapeaux blancs toujours blanc pour dire pouce, noués à une baguette ?
Combien de pansements autour d’un genou écorché, de garrots approximatifs pour ensuite claudiquer, incertain héros blessé qui dure encore un peu, et dont la mort, la fin du jeu, ainsi reportées, retardées ?
Et combien de chapeaux, avec des nœuds aux quatre coins pour tenir sur la tête les jours de lumière trop blanche ?
Combien de secrets contenus dans ses nœuds ? Combien de petits sous ?
Mon arrière-arrière–grand-mère se servait de son mouchoir comme d’un porte-monnaie menu, d’un coin noué sur trois sous.
Plié en 3, puis encore en 2 ou en 3, carré parfait, avec le feston des 4 ourlets – passés à la machine, les bords s’effilochent toujours un peu, l’un d’eux parfois, pas les trois autres, repliés bords à bords, écrasés au fer bien chaud. C’est doux. Ca sent bon le tissu de coton propre qui a séché à l’air libre, au soleil mais pas trop, sous les arbres, plutôt, que leurs lentes feuilles mobiles s’y dessinent en ombres légères, sinon ça le tacherait. Mouchoir de fil, de lin, de soie, piqué à la machine, brodé, chiffré d’initiales enlacées, roulotté à la main en un travail difficile de fourmi invisible.
De fil en aiguille, trame et chaine, qu’est-ce qui se trame ? Coton damassé, à bords brodés, de couleur mais pas trop. Comment se fait-il qu’il soit à moi, celui-là ? Retrouvé en fouillant un tiroir : mouchoir de dame, de ceux qu’on allait choisir au bazar de Mme F pour quelques pauvres francs les veilles de fête des mères.
Il est toujours resté plié, personne ne l’a. Ma mère ne l’a. Non, pas gardé. Pourtant, avec une fleur, de jolis pétales en dégradés de Oooh ! rose, la bouche toute aussi pareille, brodés, à la machine certainement. L’envers est aussi presque plus que parfait que l’endroit. Je n’y peux plus pleurer dedans, m’y moucher encore moins. Pourquoi le garder ? Nécessaire de peu guère d’espace, ni d’encombrement. Alors, il est. Mais c’est comme s’il n’existait pas. Rien qu’un poids de plume sur le monde.
Le ciel parfois rassemble ses mouchoirs, troupeaux mouvants de blanches nappes, sur qui pleurent-ils de là-haut ?
Trainées de condensation des avions, évaporées en larmes perdues dispersées, suiveuses de lignes qui s’en vont aux quatre coins des antipodes, l’avion poursuivi par ces petits mouchoirs d’adieux d’au revoir, linge oiseau dispersé, lange resté à l’arrière, sur le tarmac, le quai, le trottoir, loin derrière une vitre, loin de plus en plus petite silhouette, point blanc sur un banc, qui hésite, se rassemble et, d’un coin soulevé, léger, s’en va s’envoler.
Puis plus rien que le vide
Joli tas de pliures, plissures comme des rides, en boule avec de beaux coins d’ombres, des nœuds, des secrets, des cris qu’on étouffe, morsures, soupirs ravalés de maladies tues.
Bâillonnées, verrouillées.
Chiffons jetés au rebus, rébus.
Les grands bleus de mon arrière-grand-père. Fond blanc et lignes bleues formant carreaux. Plus ou moins grands, plus ou moins bleus, sauf aux croisements de plusieurs lignes, de petits carrés se forment par accumulation d’une couleur plus soutenue.
Après sa mort, j’ai tenté de les coudre tous ensemble. Mais trop vieux, sans doute, trop usés, la maille trop lâche. Troués. Je n’ai jamais remarqué qu’il en ait eu des neufs. Mais peut-être que si, finalement … Restés au fond d’une armoire, d’un tiroir de la mémoire. De qui ?
Les mouchoirs de ciel des photographies de Peter Stewart montrent les hauts immeubles de Hong-Kong en contreplongée, et la photo est prise de telle sorte que les habitations ont l’air de converger vers le haut de l’image et découpent des formes dans le ciel, toutes différentes
Saignements de nez épistaxis étanchés épongés des midis d’été, fleurs rouges virant au soleil en taches dures. Surtout de l’eau froide et puis le rendre si on me l’avait prêté, ce qui arrivait rarement parce qu’un mouchoir ça ne se prêtait pas !
Et si, si, cette blancheur révolte, contre toutes nos noirceurs intérieures. Nos biles, nos crachats, absorbés. Cachés. Au dehors, c’est la lumière qui irradie, fleur à peine légèrement flétrie, dans le creux d’une main, contre un front blanc et sans rides. Il passe, essuie, éponge, boit. On ne voit rien. Il garde tout. La tache, le trouble, c’est pour l’intérieur. Récoltes. Révoltes.
Au réveil, ma joue marquée, cicatrices de la pelote du mouchoir couché tout en boule sous ma joue
En papier, quelle horreur ! Contact rêche. Blessure des frottements sur les ailes du nez mouché, jeté, déchiré, froissé dans son étui rectangulaire
Feuilles mortes de nos rhumes

Mon Arrosoir. Il est vert, un peu sale, il transporte, je le regarde, je le cherche, je le trouve. Il se penche, je me penche. Il est lourd à l’aller, léger au retour. Je le pose. Nous collaborons et nous nous contrarions. Quelquefois il renverse l’eau sur mon pantalon, je l’ai mal posé et il dégouline. Il redonne toute l’eau du ciel. Ce soir sur le bord de son ouverture il y avait un escargot un peu marron.
L’hiver est fini. Au printemps je le pousse, il me gêne, je n’ai pas encore besoin de lui. Tout sec à l’intérieur, des feuilles de chênes se sont collées sur son ventre dodu.
Il vient de loin, de Chine peut-être. Il a pris l’avion ou bien un cargo, enfermé dans un container. Il n’était pas seul. Ils étaient des centaines. Il a volé ou bien tangué.
Il est indispensable. Je l’ai choisi, retourné, regardé, caressé. Je le voulais lui, sans défaut au milieu de tant d’autres. Les soirs d’orage je le remplis pour qu’il résiste au vent, qu’il ne virevolte pas, qu’il ne se cabosse pas.
Il y en a eu d’autres, mais le présent c’est lui. C’est lui dont j’ai besoin dans mon jardin. Il accueille la mélodie de l’eau qui coule du robinet. Nous partageons les soirées d’été. Ses jours de repos ce sont les jours de pluie.
Il préside à la naissance d’une nouvelle plante, s’inquiète des feuilles jaunies du jasmin étoilé. Il n’est pas ordinaire. Je le tiens fermement dans ma main droite. Les lignes courbes de son anse sont voluptueuses et son joli petit tuyau jusqu’à son bec est très élégant. L’équilibre il le tient.
Il est un peu macho, masculin. Il aime les vacances, les nouvelles rencontres. Il y en a un autre tout petit, un peu rose, pour les petits-enfants. Il n’est pas jaloux, il sait bien qu’un arrosoir c’est l’enfance, le tendre, l’envie de grandir et en prendre un petit pour aider mamie.
Il est très fier. Il se vante de s’enorgueillir d’une pomme au bout de son long col. Cette petite plaque percée de petits trous s’appelle une pomme, et elle est verte. Une pomme verte.
Je pourrais lui acheter un jumeau pour équilibrer notre avancée dans les allées. Je ne veux pas le vexer. Il est là depuis tant d’années. Nous avons tant arrosé. Nous habitons le temps sec de nos gestes précis. Délicatement sans trop de bruit, juste un léger gazouillis. L’eau du ciel est précieuse.
Il est en plastique. Ce n’est pas très honorable, mais très léger. Il aurait pu être transparent. Je n’en ai jamais vu. Son intérieur il ne veut pas le partager. Au premier regard on ne le voit pas. On pourrait voir son ventre dedans, l’eau croupie sur ses parois, mais il faut se pencher vraiment, et jamais, jamais, on ne pourrait voir tout de sa vie intérieure. Il est assez pudique finalement.
Il arrose, il donne vie à la terre. Il conserve la vie. Conserve ce n’est pas à priori un mot pour un arrosoir. Et pourtant les conserves sont au bout de son travail d’arrosoir. Avec lui je voyage. Il se penche sur le dahlia de Bruxelles, le phlox du Jura, les pervenches de Poitiers, les cactus d’Italie, le lilas d’Espagne et le lilas des Indes. Avec lui je pense aux donateurs, aux vendeurs, aux circonstances de ces entrées fleuries dans mon jardin. C’est le conservateur de mon jardin. Un compagnon bien tenu dans la main avec qui on espère en entendant l’eau couler.
Et avant lui qui est vert en plastique, ses ancêtres ils étaient comment ? En tôle grise galvanisée. Il y en avait en cuivre aussi. Maintenant les tuyaux jaunes sont ses voisins. Il ne les laisse pas arroser le coin des poètes, peintres, musiciens, les rosiers Pierre de Ronsard, Léonard de Vinci, Alphonse Daudet, Mozart et celui de la fête des mères et des fiançailles. C’est lui le gardien de leurs couleurs et de leurs senteurs. Il se glisse délicatement sous leurs branches pour ne pas les casser.
Une douce mélancolie s’installe les soirs de canicule. On se repose tous les deux de tant d’efforts. On traîne, on s’arrête, on arrose le souvenir des autres jardins au milieu de tous les parfums.
Oui bien sûr c’est un outil pour arroser. C’est mon arrosoir. Il a déjà bien vécu. Les fleurs sont en lui, les légumes, les fruits. Il a tout entendu, les oiseaux, la chatte impatiente, les vaches et leurs veaux, les orages, les glands qui tombent des chênes, les coups de fusils des chasseurs, le facteur et sa voiture, les joies et les peines, les cris, les murmures. Il a tout respiré, tout vu. Il sait l’hiver au repos, le froid qui transperce, l’espérance du printemps, le travail de l’été et l’automne du temps.

Le corail n’est pas un minéral, le corail est un animal « pluricellulaire primitif (coelentérés, antozoaires) à orifice unique entouré de tentacules urticants, vivant le plus souvent en colonie arborescente » (petit robert). Le corail est un polype, le corail est un squelette.
Le corail peut être blanc ou rouge ou même rose. Le corail est un squelette (de polype branchu) utilisé en bijouterie.
Le corail forme une barrière. Une barrière de squelettes.
Le corail forme un récif. Un récif se définit comme un groupe de rochers. Le corail forme un récif-barrière. Le récif est minéral. La barrière, elle, par essence, peut être en bois ou en métal. Le corail est un animal… à orifice unique etc. C’est à n’y rien comprendre.
Le corail comme les nuages. Polymorphe. De forme changeante : branchu, compact, alvéolé, cornu, tripède, bipède, quadrupède, en forme de phase, de fronde, de cactus, de reptile, de crocodile, de carabine, de vénus préhistorique, d’étoile, de massue, d’éponge, de menhir, d’arche, de tête de chien, de moignon, d’arbre, de pieuvre, de prière, de béquille.
Mon corail est un homme qui court, chaussé de bottes de sept lieux. Il court à pas de géant. En dix enjambées, il aura fait le tour de la terre. Il court les bras en avant, éperdument.
Mon corail court dans le vent. Vers le vent. Mon corail court vers là-bas où c’est plus beau, plus poli, plus gentil, plus intelligent, plus sensible. Mon corail court dans le vent.
Mon corail regarde droit devant lui.
Mon corail vient de loin. Il a volé à travers les nuages, les merveilleux nuages, les cumulus, les alto cumulus, les cirrus, les stratus. Mon corail vient de Phuket. Mon corail est thaï et il court
Mon corail est rugueux et dur – à base de carbonate de calcium. Il est constructeur de récifs. Il est dur comme plâtre. Mon corail a des grosses grandes jambes boudinées plâtrées. Mon corail s’est peut-être cassé les jambes en courant autour de la terre. Après quoi court mon corail ?
Le corail est barrière et squelette. Le corail est un animal qui forme des barrières de récif de squelettes. Mon corail court comme un fou, un insensé. Mon corail est insane.
Il n’y a pas d’autre mouvement en (lui) que l’expansion (cf : Ponge, la faune et la flore). Le corail construit son environnement qui devient l’habitat de nombreuses autres espèces. Il couvre 0,1 % de la surface des océans et abrite 30 % d’espèces marines. Le corail est un superorganisme, un superhéros.
Le corail est du même embranchement que les méduses. Le corail vit plus longtemps que les palourdes quahog qui peuvent vivre plus de 400 ans.
On peut adopter un corail. Adoptez en un avec une bonne tête de corail à vous tenir compagnie les nuits d’insomnie.

FORMARE - Colline en simple fil – de fer
Vole au vent des remises – bête de dressing bête de pressing – voûtée
Epaulettes – bec et col – poigne et manche – et taille même, affiner
Point d’interrogation – colvert endormi flottant
Base et sommet - Des coraux même, en forme de C. !
Flexible suspension
Trois coudes avec rêve inatteignable : être anguleux
Porte- nippes : Eviter les veuves et les orphelines, elles n’ont souvent, rien à se mettre.
Fringues, nippes, guenilles, sapes, fripes, dèches et pelures…, bien volontiers, je vous accueille.
Lieu de probable rencontre : dépôts- vente, boutiques, pressings et autres lieux de vapeurs ; Cambuses, arrière-boutiques, grange ou zone pavillonnaire, mais encore…, marchés soutes stands et dressings, pentes de toits.
Déconseillés car improbables : épiceries même fines, officines, étals.
Se lie facilement d’amitié avec chaussures et autres boites de nœuds – pap’, foulards, ceintures ou dessous plus ou moins chics, chaussettes et bas-nylon, guêpières.
Filiforme, de la famille des trombones, fourchettes, anneaux de classeurs, il ramasse poussière, et garde-robes.
Dompter la matière : crocheter, déboucher, suspension, sculpture – déformer-tordre- couper la tête – chauffer à blanc – façonner. – Tu fais quoi demande l’enfant ? - Une pieuvre mais sans yeux !
Combien mesurerait- il une fois totalement désaxé et mis en ligne ? Longueur d’une corde, d’un bras, d’une élingue à peu près ?
Elle aurait grande et belle, gueule : la ligne fuselée d’un 747 !, … sa courbe et sa démarche, si on le tordait, le déformait, le sectionnait. Chiche, on le remodèle ?
A mon réveil, je ne reconnais rien mais le galbe de tes trapèzes, tes petites clés, tes clavicules, une accueillante épaule… pour mes chemises.
On le dit fou, gentiment fou, un peu, pas toute sa tête, à enfermer, zinzin, à suspendre avant que de le pendre, par les pieds, décapiter ? On dit « pis que pendre » de lui.
J’aimais les jours de brise // Vêtements de coton, de gros coton, tee - shirts, toujours quelques guenilles à l’air libre, chez le voisin, au fil à linge dans sa cour. Et un ou deux vieux cintres en fil de fer pendus à une vieille chaine, qui se télescopant, venaient rompre l’ennui de mes après-midi, faisant un son de fin métal, une sorte de musique de sphères.
PLEXUS : Partir du sommet , sommet lisse de ton crâne , ramper le long assez court puis , courir , arriver dans ta nuque , ton cou torsadé, à petits pas de loup croquer, ta pomme d’Adam , réveiller la zone muette puis lentement descendre, au cœur des choses.
A l’heure du petit déjeuner il traine à ses pieds. Allez savoir pourquoi ? Le désordre de la pièce ou le chaos du monde, le sien ? C’est une forme aboutie : le triangle. Une forme d’aplomb qui lui dicte de suivre, surtout de ne pas perdre… plutôt que les systèmes ( « l’au fil de l’eau » : risée à l’adresse des pédagogues), le « fil de la Merveille », et de son existence.

Une lecture hâtive leur prête des ailes d’oiseaux. Est- ce le même glissement qui conduit le fabriquant a les métamorphoser en grue ? Petit échassier sécant dans une boite de couture.
Sage, au repos c’est un poignard pour dame, un moustique aux grands yeux qui attend la blessure.
Danse singulière que celle de ces soeurs siamoises collées aux reins qui se joignent, qui s’écartent, se touchent, se repoussent, à grands battement, ni avec, ni sans, pour un pas de deux tranchant et métallique.
C’est la mère qui les a donnés, elle les avait reçus de sa mère." Jamais au grand jamais ne couper du papier avec, ça les émousserait définitivement". Interdit insinuant. D’or ou d’argent, il brille sur la table, objet magique. Ils suffisent. Ils coupent les murs, les serrures, les barreaux, ils ouvrent des tranchées dans la mer, ils déchirent la nuit.
Ciseaux impatients. Il faut retenir l’impatience enfantine de couper, de tailler rapidement pour déjà porter le modèle. Il faut se contenir car il n’y a pas de repentir, au tissu mal coupé, pas de deuxième session.
La toile est tendue, et conscient de tailler, la lame remonte le droit fil comme le nageur de crawl dans ses lignes d’eau, alors que l’autre bras en profondeur trace le sillon.

Mon objet est le ticket. Pas celui des transports en commun courte ou moyenne distance. Pour les longues, c’est le billet, plus large, plus classieux. Mon ticket ne passe pas dans les mains du poinçonneur, ni entre les hachoirs du composteur. Mon ticket ne sort pas d’un coffre de banque, juste d’une caisse enregistreuse. Parfois accompagné d’une facturette carte bleue. SBAM.
Sésame remis au consommateur à la fin de sa course. Preuve ! Échange impossible sans lui. Sert de garantie pour le droit à l’erreur. L’encre s’effacera rapidement surtout si plié ou oublié au fond d’une poche ou pire encore, si passé en machine. « Pensez à le photocopier ! ». SBAM.
Les encres douteuses et néfastes de mon ticket pour les femmes enceintes : base phénol/ bisphénol. Maintenant son verso nous garantit fièrement en être exempt : « Phénol free ». Rassuré aussi le consommateur à lire « Papier issu de sources responsables ». Argent sale mais ticket sain. Moins coupable le client. SBAM.
Parfois, extension du marché, le verso couvert de publicités ou de coupons de réduction pour autres achats et autres tickets. SBAM.
Mon ticket a largeur normalisée mais longueur variable fonction des achats. Parfois, un seul, donc petit mon ticket, mais avec somme faramineuse. Cette course pour un ami. Impression de transporter nitroglycérine et surtout ne pas perdre la preuve de papier. Sinon soi, au pain sec et à l’eau ! 2x château Yquem pour 1500 F. SBAM.
Projet plastique pour artiste en résidence/(résistance ?) : sur un mur blanchi du musée du cru, coller, en ligne et à hauteur de regardeur, dans un ordre scrupuleusement chronologique, les tickets qu’on aura collectionnés, maniaquement, pendant le séjour. Proposition titre compte-rendu article journal local : « L’art et l’économie ». Titre installation possible : « SBAM ! »
Projet romanesque : écrire le roman du modeste réveillon de cette femme -son nom inscrit sous le montant cagnotte fidélité- à partir de ce ticket trouvé dans le caddie, veille de Noël, et longtemps conservé près de la table de travail. SBAM.
Ces petits tickets arrachés à un bout de journal et griffonnés par le vieux maraîcher ou alors ceux, petits aussi, des grosses calculettes à encre violette. SBAM ?
Et toujours les suspicieux, les torves à vérifier si la réduction prise en compte ou juste pour voir si pas grugé. SBAM.
Projet poétique : lire son ticket de caisse en du 26/05/2016 émis à 9H36mn45s
– 4 TOMATE REBELLION 5 2,90
– 4 CORNICH PTIT CROQ 3,30
– 4 CIGARES ORIENT.X4 2,90
– 5 INVISIBLE PP 4,90
– SBAM
Projet socio-éco-historique : demande de crédits d’État en vue création laboratoire de recherche et centre de conservation de tickets de caisse pour étudier l’évolution des habitudes de consommation et des prix à partir d’ échantillons significatifs et représentatifs. Retenir le seuil de 10 000 pour chaque étude ? Voir liens possibles avec départements de rudologie et d’analyse marketing. SBAM.
Quand le rouleau va bientôt finir, la caissière prévenue par la bande de couleur violette ou rose. Derrière ça va râler. Re-SBAM.
En haut : marque du distributeur, en bas formule de politesse parfois slogan :
– « X vous remercie de votre confiance »
– « Merci de votre visite A bientôt »
– « Pour vous faciliter la vie votre supermarché X est ouvert le dimanche matin ! »
– « J’optimisme »
– SBAM
Toujours, toujours ta caissière à te tendre ton ticket avec son SBAM aux lèvres :
– Sourire Bonjour Au revoir Merci.
– SBAM les Mulliez pour le moyen mnémotechnique !
– SBAM, SBAM, SBAM, SBAM à t’en taper la cervelle dans la boîte crânienne.
Ceux à qui le vigile signale l’absence de certains articles sur le ticket ou pire encore, l’absence même de ticket. Ta preuve ! SBANG !
F
in du ticket de métro à Paris mais déjà des distributeurs de littérature format ticket de caisse dans les lieux de passage. SBAM ?
Un rêve : un ticket éthique. SBAM ?
Un autre rêve : un ticket avec ma caissière ! sbAMOUR !
Par le hublot la vie était claire et abstraite. Absente, dit un marin défait.
C’est un hublot en métal peint. En métal peint en fer blanc. Quatre marins vivent à l’intérieur. Chaque matin, ils se disent bonjour avec des sourires trop grands plein de poussière. De poussière de nuit. C’est la poussière des rêves, disent-ils en époussetant leurs yeux tous bleus.
Trop grand ? Mais un hublot n’est jamais trop grand. On y ferait même pas passer la mer à travers. Ma mère, je veux dire. Enfin qui sait, faudrait-il juste, la poussée un peu.
Quand on le regarde sur le côté, le hublot a l’air plus épais. Plus distant. Comme les verres de myope d’une institutrice aux yeux jaunes. Par le hublot, à travers les marins, quand on regarde plus près, si ont les poussent un peu, on voit la mer. Oui. Toujours, ou presque. Bleue elle aussi. Puis plus loin, la mer encore, verte cette fois, puis l’horizon toujours, aussi. Le soleil s’est couché. Le ciel est jaune griffé d’orange. Enfin, on se demande, car les marins, droit devant, ont pris leurs quartiers, et ont virés à bâbord.
Hublot, écrit le dictionnaire, nom masculin. Fichtre ! Petite fenêtre étanche…Etanche, qui donne des idées…Généralement ronde pour donner du jour et de l’air à l’intérieur d’un navire, d’un avion de transport ou d’un four, d’une machine à laver. Surveillance. Lunette. Yeux. Encore, toujours.
Mon dieu ! Crient les quatre marins épouvantés, on n’en espérait pas autant ! Il faudra ouvrir l’œil. Veiller jusqu’au le matin. Prier pour la relève.
Mais pourtant…Jamais connu de nuit si courte. Un marin baille. Regagne la dunette. La mer se cache, quelqu’un a fermé le hublot.
Si le hublot est rond. Il s’oppose donc au carré. A la terre en somme. Rien de fou, ni de violent en apparence. Un rond épais. Distant. Elégant même. Et étanche ! Crie le marin. Cela vous fige soudain d’horreur. Diantre, on ne sait où cela pourrait nous entrainer.
Respirons. Là. Ça y ait. On sent de nouveau les embruns, la peinture, le carburant, le zinc, la sueur, et l’ennui. La pâleur des sardines sur le ventre, le merlan et les frites, et le melon aussi.
Ouvrons. Une vague nous claque la figure. Offensés, dissidents soudain, on en appelle à la liberté.
Fermé. On se ravise. Alité. Dans le lit, je veux dire. On suffoque. On manque d’air. La gorge se dessèche, et nous voilà tout retourné encore.
Alors par le hublot à peine ouvert, là, on s’apaise. La mer, le ciel, le nuages, et le couché de soleil. Tout est de nouveau dans notre histoire. Et l’horizon toujours. L’infini. La lorgnette. Il n’y a plus de fond. On s’engloutit. Pas même un bastingage, un parapet, ou une crinoline. Rien ne nous retient diantre ! Mais tout est pardonnable.
La charnière grince. Les gons se grippent. La rouille sous les boulons. Le fer sent le varech, la buée, les ripailles. Toute une vie Madame. Au juste un prix ! Chaque sa liberté.
Par le hublot on en fait fi. Il en va d’elle comme des lucarnes. Ici on fend la mer, monsieur ! Pas de flambeau, de faitière, de grenier, ni de mansarde. Seulement l’horizon et lames. Ici en fend la mer et tout crie droit devant.
De l’extérieur, évidemment, tout est calme. Aucun accès. Aucun amant. Seuls les rivets montés comme des agents. La vitre paraît sombre. Même glacée, comme miroir l’encre d’un encrier. Rarement seul, il s’aligne sur le suivant. Le bateau est à quai. Les marins au charbon. On grimpe les tonneaux. Les couleurs sont hissées. Un peintre, sur le quai, dessine les haubans.
Sur le pont, les quatre marins ont repris la barre. Sur leurs visages, par le hublot, on imagine leurs sourires trop grands. Leurs sourires trop grands qui en disent long, et s’effondrent parfois comme les amants.

De l’ouverture utile à la forme du monde, écrit donc F. Ponge : « … ( les particularités de couleurs, de parfums) comme par exemple une branche de lilas, une crevette dans l’aquarium naturel des roches au bout du môle du Grau-du Roi, une serviette éponge dans ma salle de bain, un trou de serrure avec une clé dedans. »
La clé j’en brûlerai des éclats mais très courts me dis-je parce que quand même 14 c’est s’embarquer pour un sacré drôle de truc. Alors pas en boucler le double tour complet. (d’autant plus que j’arpente régulièrement de longs couloirs nocturnes ; dans leurs chambres attenantes des gens perdus s’enferment s’enferment s’enferment et parfois poussent leurs cris.) Alors plutôt des pointes de ballerine comme pour mordiller par précis sursauts cette affaire là.
Posée sur l’étagère mélaminée blanche, toujours encombrée ; en sa grisaillante rectitude les ondes frissonnantes d’un fouillis innombrable : étreintes de mains en mains répétées, assujetties au fruit froid du fer forgé, le martèlement confondu du métal accouplé à celui pulsatile des doigts resserrés drus sur la tige, enfin son odeur incisive amère et insidieuse, tentaculaire et précise, sa dense pesanteur, l’impudeur offerte de l’accueillage imposant ses ratiches droites et les courbures insolentes du panneton, occupé à dupliquer des sortes de 5 inversés et comme accroupis. Ramassés.
257 grammes
Indissociables : la clé - au mur la photo couleur (disparue) du haut-fourneau dégueulant sa langue incandescente de lave métallique en fusion, soleil immaîtrisé des nains et des géants. L’usine. L’usine. L’usine et le bar sombre « Au petit métallo ». Le cadencement absolument lourd et éclatant du marteau – pilon, la matrice absolue des réveils d’adolescence après les mains encagées aux grilles de l’école.. Pas loin les girafes à tête de roue des puits de mine. Le delta pulvérulent des crassiers comme une encoche dans du bleu - l’été immobile et torpide, posé dessus comme un couvercle de chaudron noir, sale et repu.
La passe-porte, je dis ça dans l’attente, la passe – porte sur l’étagère mélaminée blanc produit des îvresses et des ouvertures de chiennes de vie, des entrebaillements sournois grinçants au pied de la tourelle, de l’obscur et des chiffons de brouillard, et surtout pas de vérité. Elle est là par errances et fulgurances multiples et multiformes, présentes et oubliées puis retrouvées, tenue alors dans ces mains inépuisables que je vois paysannes solides et charnues ou frêles grêles et bientôt tremblantes, et ces gens ont tous été chacun à leur tour de noir vêtus oui tout de noir revêtus. Maintenant pour beaucoup d’entre-eux ils dispersent à peine perdue leurs escarbilles d’os et de poussière. Et puis à leurs côtés persistent en songe les obscures pleureuses, toutes ces vieilles barbelées et courbées qui se signaient à chaque croix hissée des saignées de sentiers, en récitant les je vous salue Marie et les Notre Père avec leur genou qui cognait terre. Quand ça se relèvait à la ferme, autour de la table grossière poinçonnée de mouches, ça balafrait une grande croix sur la miche de pain farineuse avant de lui ouvrir le ventre. Le ciel dehors et dessus dégoisait quelques fois un foutre noir et emmêlé. C’est pas si vieux et pourtant c’est de si long temps et même d’avant, la clé.
Indissociables : la clé – la serrure – la porte – le sommeil – l’hébétude – le hurlement en creux, sombre et continu, des nuits où s’enroulent les rêves au front des dormeurs – les étreintes moîtes – la sueur – le jour qui cogne aux volets – les tombes – la terre flétrie aux mains de ceux qui la jettent par poignées par dessus les cercueils, le petit crépitement sec qui s’en produit, orage de grêle en miniature – dedans le père - ses mains froides aux doigts enchevêtrés en continu (tu parles !) sur le ventre immobile – la clé – la claie des planches après disjointes et vermoulues - les mots entremetteurs qui tout en laissant filer le temps l’entretiennent – la puissante carcasse des mots SDF, sans définition fixe, secoués et abrutis d’absence. La clé des mots qui passent la corde à la clé…
… mais la clé cousue d’histoires comme de fil blanc. L’image de la clé l’envahit et la rature. Alors, dure et insensible, engoncée en son fourreau de serrure, la clé discontinue et fractionnée affûte son pur poids rassemblé de fer sans désir. Deux gouttes refroidies de métal oxydé, étroitement embrassées dans leur jaillissement saisi, lui portent couronne rugueuse.
On se la passe de main en main comme un témoin de coureur de relai. Elle compose le lâcher – le passage et la reprise – elle condense des éclats de famille comme le mot poursuit et déborde la phrase. Parfois muette - elle en tient verrouillées les impasses.
Indissociables : la clé - les vitres perlées de gouttelettes fraîches et translucides - la pluie glacée aux bosses des pavés – rue de la Loire, entrée grouillante du lycée A. Camus. (42700) Années grises du milk bar.
Et la morsure donc. La clé montre ses dents à désosser le réel. Elle le brise et l’ordonne à coups d’histoires et autres échancrures de territoire. Ce faisant bien sûr elle renonce à tout. Je le déplore comme on regrette une peau de bête morte pour éloigner le froid : sans aucun procès. Mais faire autrement ?
Les clés plates filiformes ont perdu ampleur et ambition, elles s’insèrent étroitement dans une épousaille sèche et secrète qui ne cède place à rien et laisse interdit d’espace. Elles bafouent et réduisent l’interstice, elles obstruent le regard, elles méconnaissent l’horizon et son jeu de fuite. Clé et serrure se vassalisent et se prostituent l’une l’autre en complète jouissance de leur absence totale d’imagination. Faites l’une pour l’autre et en dépit de tout elles s’accordent sur mesure et se rabougrissent méticuleusement.
Question insensée, de l’orifice béant de la serrure à la poussée obtuse de la tige, qui l’emporte ?
Petit lexique de la clé.
Anneau : monocle, ce que la clé, ajustée à l’œil, descelle. Ce que l’œil ainsi cerné décèle.
Tige : sans concession aucune elle épanouit en corolle bifide l’onde métallique poussée fort depuis les racines gigoteuses du panneton.
Museau : à l’évidence la clé renifle et farfouille du groin – c’est une fouineuse et pas une empêcheuse même si on lui en donne des airs.
Pertuis : peignes du temps passé. A ouvrir et refermer et rouvrir encore comme une plaie. Autrement : Pertuiset, là où la Loire circonvolutionne et s’étrécit et se traverserait à la nage au milieu des cris apeurés des enfants après avoir gonflé le canot pneumatique jaune vif bon marché.
Rouet : ruse de la clé – place de l’encoche – éloge de l’attente.
Accueillage : force contenue de la clé – exultation de l’attente.
Embase : rides annelées de la clé. 4 cercles et 3 gorges du temps évidemment indifférent à l’épreuve.
Au goût elle mord, imprime la forge au bord des dents et répand l’âcre du sang dès la pointe de la langue.
Exhibition obscène des clés délaissées. Dans les cartons souillés tâchés troués déchirés des brocanteurs replâtreurs du temps elles piquent leurs fards désuets de rouille à la concupiscence désenchantée des regards passants déshabilleurs. Feront peut – être l’affaire : comme ces objets désuets pendus aux murs des résidences secondaires, outils désarmés et décoratifs, fontaines en cuivre assignées à faire comme si et battre le factice rappel. Règne des faux-semblants et des objets déportés sans âme.
Indissociables : la clé enfouie dans la poche des tabliers profonds noués à la taille, portée sur le ventre in memoriam de coïtus pas tous interruptus.
On dit l’histoire de ces enfants qui partaient à l’école avec la clé au cordon, passé autour de leurs cous de pendus, parce que s’en revenaient sans personne.
Embryon, apatride sans espaces sans images et sans mots – quelle clé ?
Au bout la dissolution, apatride sans espace sans image et sans mot .
Rien pour s’y tenir, à son fond sans bords le trou avide du temps.

En réalité, 1, il est à peu près certain qu’il se trouvait au cent quarante et un, quelque part, mais où ( pour ce qu’on en a à foutre de savoir où, c’était certainement quelque part, et après ? dans la chambre des parents, quelque part, deuxième étage fond du couloir droite, elle donne sur la rue, une fenêtre, les deux autres ce sont celles de la chambre qu’on occupait, mon frère et moi, dans les débuts – les filles vivaient au troisième ; donc là, ou ailleurs, dans les tiroirs de la table ovale du petit salon vert qui faisait l’entrée de l’appartement du premier, peut-être quelque part) c’est certain, il était là.
Et donc aussi, évidemment, 2. dans la villa, J2, de l’avenue du théâtre romain, en face des termes d’Antonin, laquelle était voisine de celle de l’une de mes (grands-) tantes (paternelles, il en était deux ; maternelles, il en était aussi deux) (pour les oncles, j’en dirais plus un jour) (il y a aussi les alliances, donc deux tantes encore) (plus encore une troisième vu que le frère de mon père divorçât dans les années cinquante) (ou soixante) (et d’ailleurs si tu vas par là, il est une autre tante, D. laquelle mourût avec et comme ses deux petits enfants dans un accident de voiture - la jaguar – bleu nuit - en sept sept) (la smalah d’Abdelkader tatoué sur la fesse gauche, voilà, c’est pour Francis Blanche et Pierre Dac, la voix de la France, enfin tout le toutim), mais alors là, pour dire où, je ne pourrais pas (je ne me souviens de pas grand-chose là-bas)
J’ai fait une liste mais pas d’objets, quarante quatre points, suture ou pas, blessures ou n’importe quoi, en tout cas 3. c’est un cadeau, probablement de mariage (ils s’épousent en quarante huit), les cadeaux, il en est des caisses (ça se faisait sans doute plus que de nos jours ? wtf j’en sais rien, ça s’administre aussi, je me souviens du mariage de la fille de E. au bois de Boulogne, comment s’appelait-elle déjà ? A. oui, c’était en sept de ce siècle (ou en six ? enfin par là) et il avait été question d’une liste aux galeries printemps dlamerde) (on a décidé, pour cette déclinaison des quatorze nuances de cet objet, de faire dans le grossier) (cette décision, unilatérale, n’a aucunement l’obligation d’être tenue)
4. Ca se présente sous la forme d’un rectangle de douze sur sept (pratiquement) ; c’est en argent, je ne pense pas que ce soit du massif bien que ça doive peser dans les cent grammes - lorsque c’est vide, d’ailleurs plein, c’est de l’ordre de vingt-huit grammes de plus : combien pèse une cigarette ? deux grammes… - , mais peut-être, je n’ai pas le sentiment qu’il soit plaqué parce que ça ne s’écaille pas, mais c’est possible, je ne crois pas (j’ai dans l’esprit le briquet reçu en cadeau, je ne sais plus (forme alambiquée à l’ancienne à la con) comme les bouteilles de champagne ou les stylos à encre, ce genre d’attention luxueuse et onéreuse qu’on peut avoir pour ceux qui, par exemple, participent à une communion, quelque chose de cet ordre) (ce sont des centimètres)
5. Je pourrais aller m’enquérir du prix de cent grammes d’argent massif, histoire de voir ce que ça vaut (ça me fait penser aux démarches entreprises dans les officines de la rue Lafayette – rendez-vous nominatif préalable, en étage, caméra rez-de-chaussée, portes blindées, œilleton électronique, barres vitres six centimètres d’épaisseur – lors de la cession de la pierre de ma grand-mère) (elle était un peu jaune, dommage) (la pierre, pas ma grand-mère paternelle – ni maternelle) (un cadeau de mariage aussi, sans doute) : sur le dessus, un décor en obsidienne noire laquée, très art nouveau géométrie de losanges dans le pauvre souvenir
Ce qui ne fait aucun doute non plus c’est que 6. ça se trouve quelque part chez ma tante centenaire, est-ce chez ma tante ? ou l’ont-elles déjà déposé là-bas (chez ma tante, je veux dire) ? pas facile à savoir, d’autant que les invectives vont bon train, ces jours-ci (en revenant tout à l’heure de bosser, je pensais à l’objet, je me disais que je n’en savais rien, finalement, mais qu’il découlait de cette culture de ma jeunesse, cette aventure de la fin des années cinquante, et puisqu’il faut bien tenir une ligne)
6 bis. Au rang des invectives, je ne résiste pas et je cite dans le texto : « (finalement non)
7. Sur l’un des petits côtés, on n’aperçoit rien que le mince filet de la jointure (lequel court tout autour de l’objet), sur l’autre un petit onglet qui permet l’ouverture, probablement facilitée d’un ressort minuscule, il s’ouvre donc en deux parties égales, réunis par une sorte de gond faite de plusieurs petits cylindres (six, ou huit) imbriqués les uns dans les autres, à l’intérieur de chacune de ces deux parties symétriques et presque exactement semblables, une sorte d’élastique beige, réalisé en fines bandes – peut-être cinq, ou six – tissées et réunies en une seule, beige couleur peau large d’un petit centimètre, marquant le tiers inférieur de chacune des deux parties dans la plus grande dimension (on peut y introduire sinon l’entièreté d’un paquet de tiges de huit, du moins quatorze ou seize, très probablement)
8. Il s’agit d’un paquet rouge, à la bordure blanche comme un cadre – une vingtaine de craven A - je ne crois pas qu’il existe encore mais c’est fort possible (pas en France, semble-t-il) (tout à l’heure en allant au tabac, je regarde, et s’il se peut j’en achète un paquet, j’en fait la photo et je la pose en exergue de l’exercice, mais il me semble plutôt que ces clopos-là n’avaient pas la dimension d’aujourd’hui) (le souvenir intime, c’est que le paquet reposait dans la boite à gants – non mais eh, la boite à gants… - le vide-poche (le vide-poche…) de la décapotable blanche, deux banquettes, sublime intérieur sellier cuir rouge, américaine en diable, appartenant à l’un de mes oncles (du coté de ma mère, il en était deux, du côté de mon père itou) (du côté de ma mère, un troisième, par alliance comme on dit) (d’ailleurs, c’est par alliance aussi que l’objet existe) (un porte-cigarettes, ça n’existe plus) (c’est sans doute que je n’exerce plus mon observation sur les bons milieux, j’imagine) (en voit-on au cinéma, dans les films contemporains ? je n’en garde pas souvenir)
9. Quel abîme imperceptible existe-t-il dans ces souvenirs ? il y a là une petite table basse, de celle où on pose négligemment le catalogue de l’exposition en vue, ces temps-ci, lorsqu’on reçoit à dîner le N+1 (fuck off cette vulgarité de nos jours, le supérieur, les dîners en ville, toute cette boue, cette saloperie pour laquelle on s’habille, on choisit couleurs parfums assortis, je me souviens de cet article d’Oublier Paris qui traitait du cercle interalliés, du triangle d’or, de cette invariable géométrie, faite pour et de ce luxe sublime et frelaté), sur laquelle repose, aussi, juste mitoyenne de l’objet, une soupière (est-elle d’un même métal ?) (en tout cas d’une même teinte et poids) posée sur une assiette hexagonale, manufacturée identiquement (le couvercle de la soupière est, lui aussi, hexagonal, surmonté, un peu comme sur la bourse du commerce, d’une petite tourelle ronde), et aussi très probablement issue de la même cause (de la même manière, au coin sud de la salle à manger du cent quarante et un, premier étage, avait été posé un genre d’armoire – le nom de ce meuble m’échappe – bonbonnière confiturier je ne sais quoi n’importe – en chêne - une seule porte, largeur quatre vingt peut-être, haute de près mais de moins de deux mètres, deux ou trois étagères, sur lesquelles on posait la vaisselle de prix – les douzaines de verres à pied, cristal ou quelque chose, l’argenterie qu’il fallait parfois faire briller à coup de ce produit qui puait grâve, et d’autres choses encore qui faisaient souvenir de ce temps où, avant d’avoir tout abandonné en quelque sorte, on jouissait peut-être d’une espèce de sensation de bien être confortablement bourgeois et installé et d’appartenance aux heureux du monde)
10. On ne fumait certes pas, on avait une consigne, ne pas fumer avant dix huit, ou plutôt non, vingt et un ans, ou je ne crois plus savoir, mais j’ai tenu (la qualité de ma respiration y est pour pas mal) (le cabinet du médecin, je ne suis pas complètement certain qu’il s’agisse d’une ordure, mais qu’il repose en paix, au huitième étage d’un des immeubles de la fin de la rue de la Pépinière, presque à l’église, qui, lorsque je vins le voir – il s’était agi d’un ami de la famille, si je comprends bien – pour lui demander de certifier mon état d’asthmatique invétéré – il m’avait prodigué ses soins début soixante et un quand cette maladie s’était attachée au nacre de mes poumons - , afin que je présente ledit certificat aux autorités militaires pour qu’elles aient l’occasion, la possibilité de consentir à m’exempter de mon devoir pour cause de maladie grave, m’avait regardé, visage un peu souriant, avait sorti de son tiroir un bloc d’ordonnance, y avait griffonné les mots demandés, puis avait indiqué « c’est cinq cents francs » j’avais un chèque, je le remplis) (l’ordonnance n’a été de rien)
11. Il est passé par le 4 des Invalides, tout aussi fatalement, obligatoirement, nécessairement (elle y vécut vingt ans à partir de soixante quatorze, elle n’avait pas cinquante ans, il devait se trouver dans le secrétaire, ou sur la table basse du salon – une grande pièce salon-salle à manger moquette bleu ciel ou gris-bleu, jouxtant une chambre – parquet - (les trois fenêtres du petit pavillon de deux étages, au dessus vivait la propriétaire, patronyme à particule, en haut de l’immeuble du 4 vivait une star de la mode et du luxe particule aussi) au bout du couloir la cuisine toute en longueur, on distingue la fenêtre qui était au dessus de l’évier dans les photos prises par cette saleté de robot, au dessus de laquelle un petit toit de zinc sur lequel s’aventurant un jour, dans les années quatre vingt, le concierge, glissât, chût, mourût)
12. Sa mère y vécut ses derniers jours (elle était allongée sur le lit, dans la chambre, ses yeux un peu mouillés, j’avais dans mes mains la sienne droite, ya amri qu’est-ce que je fais encore là ? elle partit en août, j’étais en vacances, elle repose sous une pierre noire où sont gravés son nom son prénom cette année-là, probablement rehaussées d’or ces gravures – on n’a pas porté le nom de ma mère ni son prénom si le deux mille huit, il s’agit pourtant de sa sépulture aussi, aussi bien que celle de TNPPI - une pierre noire un rectangle tout con, de la même forme que cet objet-là, à Montmartre, du côté de Berlioz – il s’agit aussi de celle de L.)
13. En bas de l’avenue, qui à présent est coupée en deux, ce n’est plus qu’une impasse au fond qui monte de la mer, en bas de cette voie alors vers midi trente quarante cinq arrivait l’un des oncles de mon père (le frère de sa mère, il tenait le garage nommé de son prénom) (à lui, pas à mon père), il klaxonnait pour prévenir pour qu’on lui ouvre la porte, je crois qu’il gare sa caisse sans se donner la peine de (rapport ténu à l’objet, mais le lieu où il devait se trouver aussi est là, plus haut remonter, passer sous la voie du TGM, laisser à sa gauche la pile du pont où a été flanquée une quatre chevaux beige foncée, un jour de mai cinquante huit ou neuf, était-ce en mai ? monter encore, croiser un chemin de terre –c’est une rue d’asphalte de nos jours – continuer un peu, quelques mètres, et là, sur la gauche, dans les blancs dans les bleus derrière les jasmins)
14. j’ai confondu, entre mes tantes et mes grands-tantes (les tantes de mon père surtout, encore que ma grand-mère maternelle ait eu un frère – il portait le même prénom que son beau-frère, que le père de mon père et que mon frère - qui vivait non loin du Belvédère, au rez-de-chaussée de sa maison on trouvait dans une grande pièce un bar, on devait y danser, quelqu’un demande une clope, une femme disons, un homme (c’est Richard Widmark, tu penses bien) sort son porte-cigarettes, l’ouvre d’une main, le lui présente, elle se saisit d’une, briquet, les yeux dans les yeux (Ida Lupino dans « la Femme aux cigarettes ») ( Jean Negulesco, 1948) peut-être, il me semble que l’année du clou sur lequel j’avais allègrement marché – six à huit centimètres fichés dans une planche de bois, vaccin immédiat à Cavalaire, je portais alors des tongues, ça se passait à la Croix-Valmer dans le Var sur la colline à quelques kilomètres de la mer, une des plages du débarquement auquel participa mon père – cette année-là, je me souviens de ce grand oncle-là, de sa (quantième ?) femme blonde robe à fleurs, et aussi de mon oncle qui était son neveu et qu’on appelait Joujou – il disait « tu me comprends, tu me comprends » légèrement bègue, fumait des blondes aussi ( des « coups de chance », peut-être), jouait non pas au casino mais dans un cercle, payait ses impôts le jour dit à l’heure dite, sans relation pourtant avec l’objet, mais le voilà, il disposait d’une chambre où il m’est arrivé de faire la sieste – je détestais la sieste - dans la maison du Belvédère, loin, là-bas, les sacs de sable sur la route de l’Aouina, fin cinquante neuf

1 - C’est une mémoire usée à trente-deux soufflets – et presque autant d’années – pour distribuer le travail du mois. Comme un parapheur en plus volumineux, un genre d’accordéon en carton au dos large qui se déplie, se déploie.
2 - Il y a des onglets numérotés de 1 à 32. On pense d’abord qu’il n’y a que 31 jours maximum dans un mois, oui, mais le jour en plus est utilisé pour conserver ce qui devra être réparti, ce qu’on n’a pas encore eu le temps de faire, bien que programmé…
3 - C’était l’objet destiné à faciliter l’organisation du travail, distribué au cours d’un stage Templus chez Apple Computer France. En 1987… La chose a donc près de 30 ans ! Trente ans que je trimballe cet objet parmi mes cartons pour le retrouver sur un bureau ! Un objet qui me parle du temps qui passe, en plus du temps à organiser. Organiser le temps… S’organiser dans le temps. Déployer le temps en accordéon, en remplir les interstices, peut-être soulever certains onglets et découvrir que rien n’est prévu ce jour-là.
4 - J’ai voulu le jeter bien des fois après l’avoir rafistolé encore et encore. Avec du scotch épais, transparent, ou marron. Une photo à l’intérieur. Quelques phrases issues de lectures du moment. Des post-it collés ici et là.
5 - Je le regarde comme un objet que je découvre pour la première fois. Il s’appelle Tri-Classeur. Il est bleu à la couverture granuleuse. Sur ses trente-deux onglets, le n° 10 a perdu son numéro, et le 32 est arraché. J’ouvre le 32 : là sont rassemblées des lettres anciennes, des enveloppes bleu blanc rouge « Par avion », d’autres enveloppes kraft avec de vieilles photos noir et blanc, dentelées. Un monde d’avant. Un travail oublié.
6 - « Le bœuf est lent mais la terre est patiente. »
« Il ne faut jamais retourner sur les lieux qui nous ont envoûtés. »
« Le plus court chemin de soi à soi passe par l’autre. »
« Le bonheur des hommes se situe dans les petites vallées. »
« Ce n’est qu’en risquant heure par heure notre personne que nous sommes vraiment en vie. »
« Il faut se prêter à autrui et ne se donner qu’à soi-même. »
« Vous arriverez le jour où vous cesserez de voyager. »
Entre les proverbes chinois et japonais, Gide, Ricœur, Giono, William James et Montaigne me mettent en garde à chaque ouverture.
7 - Je m’amuse à le déployer, entièrement, la couverture cartonnée bleue face au dos, cartonné bleu. Un accordéon couleur jean délavé… Une tenue usagée avec des dessous roses comme autrefois les gaines des grands-mères. De ce déploiement ne sort que du vent, et seulement dans un son très sourd. Comme un instrument de musique qui serait devenu muet.
8 - Un classeur à 32 onglets où ranger – temporairement, le temps d’une journée, normalement – sous chacun des onglets, les papiers correspondant aux activités du jour… Trente-deux jours soit un mois de trente et un jours, plus un, qui contiendrait tout ce que l’on refoule, repousse, re-programme, et qu’il faudra trier dans cet espace de temps entre la fin du 31e jour et le début du 1er du mois suivant. Souvent, je me décide à jeter ce que je sais que je ne ferai jamais.
9 - Je pense que je n’ai plus rien à dire de ce Tri-Classeur, plus rien à penser de lui, plus rien à en tirer. Il ne me raconte plus rien.
10 - A trente ans, la vie nous appartient. Pourtant, pas de place au rêve dans ma vie à trente ans. Le travail et rien que cela.
11 - Parallélépipède rectangle destiné aux bipèdes qui s’imaginent tout maîtriser.
Accordéon comme le temps qui se déploie.
Trente-deux comme trente-et un plus un. Comme s’il fallait penser si loin…
12 - A l’intérieur, les pages cartonnées sont trouées à deux endroits, deux gros trous où l’on passe le doigt. Et où l’on tombe directement sur la page qui vient nous rappeler qu’il reste encore quelque chose à faire.
13 - Ce trente-deuxième volet me tarabuste. Dans l’idéal, il aura recelé tous les contenus des autres onglets, on y aura placé tout ce qui tombe sous la main et qu’il faudra trier. Il aura en plus conservé l’excédent, tout ce qui déborde, que l’on ne trouve jamais le temps de réaliser et qui se retrouve coincé sous cette 32e page. Je devrais écrire la rhétorique du 32e onglet…
14 – C’est un accordéon bleu qui chante le temps de la vie, des maladies et des ordonnances, des achats et des factures, des voyages et des billets d’avion, des excès de vitesse et des contraventions, des lectures recommandées, des fleurs à rempoter, des anniversaires à souhaiter, des morts à honorer…
Extraire le moindre dans cette mise à l’épreuve d’une réalité sans principe. Occuper peu à peu les poches d’espace par des segments hétéroclites qui bordent notre vie. Prétexte à nous accompagner vers le présent dehors
Misérable mirabilia dans son corps de tortue. Sédiments d’identités variées pour usage administratif, financier, hygiénique ; attestations à toutes fins utiles. Clefs pour entrer, sortir, ouvrir, démarrer, cadenasser. Tout ce qui alourdit le quotidien et pèse.
L’appel du cuir, sa peau violine et noire, souple, odorante, qui appelle la caresse. Désir érotique de glisser la main dans la fente qui s’entrouvre.
Parfois l’objet baille, parfois il se ratatine au pied d’une chaise, abandonné. Fidèle et infidèle à la fois, selon les saisons, les tenues ou les voyages. Il se fait admirer ou oublier mais jamais simple accessoire.
Qui a jamais parlé du viol de son intimité ; le regard qui fouille dans ses profondeurs pour y déceler les trahisons imaginées ou dérober ses précieuses possessions ? L’amputation, l’abandon, le désespoir ressentis à sa disparition ; le deuil de soi.
Aucun grigri, aucune photo, parfois une liste ou un message. Mais l’Iphone glissé dans sa poche contient déjà tout ça jusqu’à ce que la batterie se vide.
Au fond, s’amassent des reliefs : miettes de biscuits, de tabac ou des cachets cassés. On le dit aussi plein de bactéries. Preuve s’il en est qu’il vit.
Itinérance : il se balance et va de-ci de-là. Agrippé dans des lieux d’affluence ou juste compagnon de promenade.
On se souvient de la première rencontre, de son origine. Celui-ci vient de Romans et en matière de cuir, c’est déjà tout dire.
Anse ou bretelle, ça dépend d’elle. A bout de bras ou sur le flanc, son balancement rythme ses pas, légers ou lourds, à sa convenance.
Les mains rageuses fouillent ses entrailles : plus de briquet, où sont les clefs ? Il avale les objets mal rangés. Il les digère jusqu’à ce que le calme revienne puis il les régurgite.
Vider son sac : ça le soulage mais annonce de séparation. Un autre prend la place ; changement de saison.
Il paraît qu’on ne trouve pas de mouchoirs dans les sacs des hommes. Ont-ils d’autres poches que leurs yeux dans leur doublure ou leur pantalon ? Bourrelets disgracieux ou bien larmes refoulées. Excroissances du corps musclé.
Sachez enfin que n’est ni baise-en-ville, ni réticule, ni escarcelle et encore moins barda ; ni polochon, un peu fourre-tout, ni vil sacotin : juste son sac à main.
C’est au sol que le marron se manifeste à l’homme. C’est la seule certitude que l’on peut avoir à son sujet car pour le reste, au-delà des apparences bonhommes qu’il tient de son aspect joufflu et brillant, le marron cumule les confusions et contre les évidences.
nier
glacé (pas lui)
couleur
d’Inde
en anglais
Ambivalence permanente du lisse et du rugueux, du brillant et de l’opaque, de la rondeur et du creux.
Pas le poids de son enveloppe mais le sens profond de la couleur.
Echappe à toute logique identitaire. D’autres se font passer pour lui quand on le prend pour un autre.
Origine non identifiée, en bon élément métisse. Boule d’écorce polie laissant à penser qu’il descend du végétal vivace, ligneux et rameux. Il convient pourtant de préciser que c’est le vent qui l’a porté. Un tel raisonnement emprunte tout au questionnement du « qui de la poule ou de l’oeuf ? » et étouffe par sa linéarité des racines plus profondes. Le marron l’est, marron, comme la terre qu’il embrasse parfois de son humidité boueuse, s’y mêlant à l’en pénétrer et se fondre. N’en est pas moins minéral comme l’indique son radical dérivant du préroman mar, « pierre, rocher ». A ce stade comment ne pas douter de son milieu. L’opercule qu’il partage avec d’autres mollusques témoigne de son adhésion certaine aux choses de la mer alors même que ses fréquentations essentiellement urbaines et routières le lient aux plis de la ville.
De notre regard dépend son devenir objet : il y a une vie après la rue.
Manuel d’utilisation du marron ?
Fonctions d’usage : travail de la mobilité et de l’adresse (doigts et membres supérieurs),
développement des facultés tactiles, boule anti-stress, presse-papiers ?
Fonctions avancées : sculpture, objet philosophique temporel.
Principaux gestes tactiles : préhension, toucher, double-toucher, toucher maintenu, toucher rotatif (2 à 5 doigts), glisser avec le pouce, glisser peau contre peau.
Autonomie : illimitée.
Durée de vie : longue en milieu domestique ; variable selon le taux d’humidité et l’exposition à la lumière.
Recommandations : placer dans une poche, un sac ou sur le bureau.
Rouler, glisser, tourner, voler, sauter.
Scrupule gravitaire.
Rester, (re)poser.
Tu regardes toujours de haut. Pourquoi ?
Dans sa prononciation, le mot MARRON engage le tout et son contraire dans une pleine bouche résonnante.
Mmmm, point d’articulation bilabiale, un mystère qui éclate en Aaaaa sur une grande ouverture où la langue se cambre, la mâchoire se relâche et le souffle se porte hors du corps.
Rroonn, soudaine obstruction buccale en suite d’un voile du palais rapidement raclé, lèvres pointées en petit trou, résonateurs nasaux à l’oeuvre, fourmillement dans le museau, vibration des cavernes du corps.
MARRON ou les contrastes délicats d’une puissance sonore.
Le dessous des choses, à la discrétion des feuilles, un certain regard sur ce qui affleure.
Placé hors de son milieu soi-disant naturel, le marron consacre sa parfaite inutilité et repose l’homme de son pragmatisme radical. Il n’est plus un objet dans l’espace mais un objet dans sa durée : temps déspatialisé, sans événements comptables, pas d’avant ni d’après, continuité indivise. Le marron change sans esprit de succession dans l’intensité de ses qualités : réalité temporelle de la matière sans distinction du dehors et du dedans. Mouvement ininterrompu, la vie bourdonnante.
Ne peut être vendu. Surtout séparément.
Ce matin au réveil, je me suis adressé à mon fer à repasser...
« Cesse de me narguer. Tu ne me feras pas baisser les yeux. Ne cherche pas à m’embrouiller. Je ne dirai pas comme Lautréamont que tu es beau comme la rencontre fortuite d’un parapluie et d’une machine à coudre sur une table de dissection. Je suis trop avisé pour savoir combien ton pouvoir de nuisance est incommensurable. Tu ressembles à un poulpe en plastique. Tu es ridicule. Les plus grands génies se sont moqués de toi, ad nauseam. Ne fais pas l’arrogant. J’ai très bien percé ton manège et tes petits jeux sournois. »
Notice n°1 : La semelle de fer à repasser monobloc pour fer à vapeur présente sur sa face extérieure une couche d’émail et comporte une première partie, réalisée en alliage d’aluminium moulé par injection sous pression, dans laquelle est noyée une résistance tubulaire de chauffage, caractérisée en ce qu’elle comporte en outre une seconde partie, constituée d’une tôle d’aluminium laminée, fixée directement à la surface de la première partie voisine de ladite tôle, la face extérieure de la tôle laminée étant recouverte d’un revêtement d’émail réalisé à partir d’une composition de fritte d’émail frittable à une température comprise entre 500 et 600° C.
Pourquoi confiez-vous votre repassage à des femmes de ménage, vous qui n’avez jamais médité ?
Pourquoi ne cherchez-vous pas à vous réapproprier les gestes simples ? Déplier la table. Remplir le réservoir. Brancher et attendre que le fer exhale sa vapeur chaude et odoriférante. Il chante au moment où il entre en ébullition. C’est le moment de cajoler votre linge avec cet instrument lourd qui émet des borborygmes hilarants. Si vous écoutez de la musique, je vous conseille le concerto pour piano n°23 k.488. Pleurez toutes les larmes de votre corps, toutes celles que vous avez retenues jusqu’à cet instant indicible. Retrouvez votre primum mobile. Ecoutez votre âme agitée qui ne demande qu’à s’apaiser. En Occident, la meilleure méditation, c’est le repassage.
Notice n°2 : Certains alliages d’aluminium présentent une dureté relativement faible, de sorte que la surface des semelles de fer à repasser est facilement rayée lors du repassage d’articles textiles comportant des objets durs tels que boutons, fermetures éclair, agrafes, etc.
L’usage du fer à repasser me plonge dans un état d’ivresse spirituelle proche de la sainteté. Aucune mauvaise pensée ne vient troubler ma transe. Je lave mon linge dans un seau. Je n’ai qu’une casserole pour cuire ma viande et mes légumes, et aussi bien, pour faire bouillir mon eau. J’ignorais qu’à force de sanctifier les objets, l’un d’eux prendrait l’initiative de se retourner contre moi. Je ne savais pas que dans toute chose se cachait une âme, mon âme.
Notice n°3 : Les rayures peuvent provoquer une usure de la semelle qui a pour effet d’augmenter le coefficient de glissement de celle-ci par rapport aux articles textiles à repasser en rendant ainsi le repassage de plus en plus pénible pour l’utilisateur.
« Crois-moi, je viendrai à bout de ta scélératesse. Tu t’es piégé toi-même avec ton fil à la patte. Tu n’imagines pas ce dont je suis capable. Je me suis inspiré de certaines techniques ayant cours au pays du Soleil-Levant qui n’a pas son pareil pour faire de l’humiliation le plus jubilatoire des divertissements. Le bondage est une pratique sadomasochiste qui consiste à ficeler sa partenaire sexuelle nue ou presque nue avec une corde. Voilà le sort que je te réserve, une fois que je serai arrivé à bout de tes manigances : hojojutsu !
Notice n°4 : Les semelles en alliage d’aluminium deviennent, en fonction de l’usage, de plus en plus sensibles au tachage dû à l’oxydation provoquée notamment par la vapeur d’eau et aux matières organiques carbonisées provenant des articles textiles.
J’ai appris qu’au Ier siècle av J.C., les Chinois repassaient leur linge avec des casseroles en métal remplies de charbon de bois enflammé. Cette information m’a plongé dans une extase érotogène. Comme par magie, la senteur acide des aisselles d’une paysanne du Yunnan (car je n’imaginais ni un homme ni une bourgeoise) est venue chatouiller mes narines.
Le fer à repasser électrique a été inventé en 1882 et ne provoque aucun émoi chez mes contemporains.
Notice n°5. La fixation d’une résistance électrique tubulaire à une tôle laminée en alliage d’aluminium présente des difficultés. En effet, la demanderesse a constaté que si l’on fixe, par exemple par soudage, une résistance tubulaire de chauffage sur une tôle métallique en aluminium, cette dernière se déforme sous l’effet du gradient thermique qui lui est imposé.
« Cette nuit, tu t’es élevé dans les airs, tel une âme innocente. Tu es resté en suspens au-dessus de la table trapézoïdale comme si tu hésitais à t’en détacher. Deux lumières stroboscopiques sortaient de tes yeux phosphorescents. Tu es devenu un phare à repasser. Tu t’es mis à ondoyer comme un reptile ailé et soudain, tu as filé à la vitesse de la lumière, laissant derrière toi un sillage de vapeur livide. Alors tu t’es enfoncé dans la nuit, animé par une force impérieuse et maléfique. Par l’effet de la transsubstantation de ton corps en ange du démon, tu t’es arrogé les pouvoirs du passe-murailles et tu t’es introduit dans les conduites des immeubles, tu as traversé les cloisons et pénétré dans les chambres où tu venais surprendre les couples dans leurs ébats, les vieillards dans leurs respiration asthmatique, les fous dans leurs cauchemars et les invertis à la poitrine creuse, jusqu’à ce que tu jettes ton dévolu sur la plus innocente des créatures, un enfant. Et de tout ton poids tu t’es abattu puissamment sur son crâne. Le métal de la semelle est resté collé à la peau du bambin et il fallait que tu l’arraches pour t’en défaire, emportant le scalp furfuracé sans t’en rendre compte. Puis tu as repris ta folle escapade nocturne. »
Notice n°6. Une tôle métallique est compatible avec une résistance plane mince de chauffage, mais pas avec une résistance tubulaire.
« J’ai fait la paix avec toi lorsque j’ai surpris Clémence en train de repasser. Je n’aurais jamais du emprunter le chemin de la buanderie, mais je l’ai fait pourtant. Clémence, dans le plus simple appareil, tenait l’appareil. Son corps était coupé en deux, la table de repassage lui arrivait un peu en-dessous du nombril. Jambes nues, bras nus. La petite penchait la tête, toute affairée à sa tâche. Elle ne me voyait pas. Ses longs cheveux lui couvrait le visage. Je fus immédiatement frappé par le contraste existant entre ses petits poignets fragiles et la masse du fer à repasser. Elle manipulait le manche avec ses mains délicates, le faisait ramper. Assis, debout couché. J’éprouvai immédiatement un frémissement de plaisir et je ressentis le désir vertigineux d’attacher ma cousine avec ton appendice, le fil électrique, veuillé-je dire, qui traînait à ses pieds. »
Notice n°7. Quant aux taches provoquées par le calcaire engendrées par l’évaporation de l’eau ou par la carbonisation des matières organiques provenant des articles repassés, elles n’offrent aucune prise sur le revêtement d’émail, de sorte que la semelle sera toujours aisément nettoyable.
Clémence ne m’a pas calculé. Tant mieux ou tant pis. Vingt minutes plus tard, le fer à repasser avait repris sa place dans le placard avec les autres ustensiles. Perdu au milieu des bouteilles d’ammoniac, sac-poubelles, éponges, tampons verts grattants, serpillères, et toi, posé entre la balayette et le mini aspirateur, tu as perdu de ta superbe et retrouvé ta fonction d’objet. Je t’imaginais pourtant une dernière fois, ahanant et fumant comme une locomotive, sur la table. Accrochée aux deux extrémités, une hétaïre au corps galbé, ligotée des pieds jusqu’à la tête, et qui n’était pas ma cousine car son visage semblait métissé. Ses cheveux noirs pendaient comme des algues marines et sa bouche carminée était légèrement entr’ouverte. Soudain, le fer à repasser a bougé, glissé sur la toile molletonée comme s’il était poussé par une main invisible. Esprit es-tu là ? La fille, évaporée, semblait indifférente au scénario abracadabrantesque qui se produisait quelques centimètres au-dessus de sa tête. J’ai poussé un cri de frayeur. Puis, plus rien.
« Ne la ramène pas », me disent-elles en chœur.
Pourtant, vous êtes le sujet de l’exercice donc je suis bien obligée d’en passer par là.
Je dois la ramener pour essayer de parler de vous qui embellissez mon jardin, faites le délice de bestioles pas trop recommandables.
Ne rougissez pas, vous n’êtes pas la tomate, autre invitée du jardin.
Vous êtes la…
« Ne la ramène pas ! Entends-tu ce qu’on te dit ! Tu es sourde ou quoi ? »
Elles croient être seules à s’appeler ainsi, mais elles sont un peu ignares, il faut leur pardonner. Ce ne sont que des fruits.
« Certainement pas ! Nous ne sommes pas des fruits ! Idiote toi-même ! »
C’est vrai qu’elle peut être aussi un mets raffiné quand on aime les abats.
Beurk ! pour ma part. Rien que d’imaginer dans mon assiette cette membrane qui enveloppe les intestins de l’agneau, j’en ai l’estomac retourné.
Je sors de table en courant et me précipite dans la première pâtisserie venue et veux me gaver d’une charlotte.
« Certainement pas ! Nous, on nous savoure. On ne nous engloutit pas comme cela. Du balai ! Et d’ailleurs qui vous a permis de sortir de table ! »
Continuons notre inventaire, mais à voix basse car je crois qu’elles écoutent aux portes. Elles ne se sucrent pas elles-mêmes encore et sont bien vaillantes.
Petit retour en arrière.
Jetons un coup d’œil vers le XVIe siècle. Elles pouvaient être grandes, faites de fine dentelle et orner le cou d’hommes et de femmes. Les gentilshommes espagnols les appréciaient beaucoup en ces temps éloignés.
Au XVIIIe siècle, elles étaient beaucoup plus belliqueuses. Comment aurais-je pu l’imaginer ? Mais si, le grand Hugo les cite dans « L’homme qui rit », très exactement à la page 135 du tome 3 (ne jamais oublier de citer ses références). Au moment de notre lecture, elles sont des collerettes de pieux pointus.
Mais revenons bien vite à aujourd’hui avant qu’elles nous traitent d’assassin.
Ces divagations et inventaires autour du mot objet de ce texte ne vont-ils pas rebuter le lecteur.
« Quel lecteur ? car tu crois que quelqu’un peut s’intéresser à ta prose. À nous, oui ! Pour nous déguster ! »
Revenons à nos moutons ! pardon au fruit en question.
« Tu es bouchée ou quoi ! on te dit, te le répète. Nous ne nous sommes pas des fruits ! et toc ! ce sont les akènes, en fait, comme disent si volontiers les enfants, ce sont les petites graines jaunes qui constituent le fruit de notre support.
Heureusement qu’Elisabeth est là, pour rétablir la vérité.
Cela t’en bouche un coin.
Non ! non ! ne m’avale pas tout rond ! »
Je continue mon exploration.
Heureusement que je peux compter sur Google pour m’aider. Je vais continuer mon enquête auprès d’une de mes lectures favorites : ORTOLANG du CNRTL.
Moi aussi, je sais user et abuser des sigles.
Un nombre impair, je pourrais m’arrêter là.
Mais impossible, j’ai déjà écrit le numéro 14 et je ne vais pas noter Fragment 8 à 13 – néant.
Ce serait ridicule et non respectueux de vous, le lecteur, qui voulez bien me prêter attention.
Je veux que vous les connaissiez sur toutes les coutures et tous les sens.
Vous allez devoir me subir pendant six fragments plus le fameux quatorzième, déjà écrit.
Hihihi !! ce pourrait être mon cri de guerre.
Hihihi !!
Oui, je suis le champignon parasite, la terreur de Michel, le jardinier-chef du Château de Versailles. Je m’égare. Je ne le connais ni d’Adam, ni d’Eve et ne suis-je pas en train de me mélanger dans les prénoms.
On verra bien. Qui n’ose pas…
Ne me dites pas que je suis en train de me sucrer. Je sais, je me répète (voir fragment 3), mais il me faut bien me justifier de toutes ces phrases.
Je vous soule. Cela ne m’étonne pas.
Il parait qu’au Moyen Âge, il était recommandé de les savourer après les avoir trempées dans du vin, afin d’éviter qu’elles donnent des maladies. En effet, à cette époque, elles prospéraient sur les tas de fumier.
Normal ! Elles fréquentaient déjà le coq gaulois.
Allez la France ! Pardonnez-moi Vikings si vaillants qui vont peut-être tailler une croupière en cette soirée du 3 juillet 2017 à onze joueurs aux pantalons trop courts.
Attendez, je suis persuadée que je vais vous coller.
Vous me connaissez sous le nom d’arbousier et ignorer que je suis un arbre à…. Chut ! ne le dites pas trop fort. C’est top secret et avec cela, vous allez en épater du monde.
Imaginez, une promenade en forêt et tout d’un coup : « Regarder un arbre à… » . Tout le monde se tient coi et vous prend pour un doux rêveur.
Mais non, vous êtes l’intellectuel, le lettré de la promenade.
Tout cela grâce à moi.
« Et l’écrivaillon, je suis sûre que je vais t’en apprendre encore une bonne.
Viens voir dans le poulailler. Oui, ici, tout le monde habite dans le poulailler à cause du renard qui rode de trop près.
Regarde le dindon et sa chair plissée qui pend sous son bec… Eh oui cela porte le même nom que moi.
Ferme ta bouche ! Tu vas gober une mouche !
Et dans la forêt, j’entoure la base des bois du cerf, du daim et du chevreuil.
Je suis trop forte !!! »
Encore un nombre impair.
Nouvelle possibilité d’interrompre mon écrit.
Cela plairait certainement à Verlaine, dixit François Bon, mais voir l’excuse donnée plus haut — fragment 7.
Impossible de m’arrêter.
Aïe ! viens-je d’entendre.
« Mais desserrer les dents. Ne soyez pas si crispée. Ce n’est plus un supplice.
Il paraît maintenant que l’on ne souffre plus quand on va chez le dentiste.
Mais je vous comprends : subir cet instrument qui porte le même nom que moi, il faut en avoir du courage.
Moi, qui ne suis que douceur et plaisir.
Et là, me sentir tourner à grande vitesse… Dans un mouvement de rotation digne d’une danseuse étoile. Je m’égare.
Aïe ! Arrêtez ! J’ai mal pour vous.
Mais vous n’auriez pas dû engloutir le paquet de Tagada.
Que dis-je, votre paquet journalier et ce depuis maintenant, combien ? 32 mois…
Pas raisonnable du tout. Vous le payez maintenant.
Je vous laisse, car entendre ce bruit me fait claquer des dents, façon de parler et frissonner.
Je suis aussi un outil utilisé pour faire des forages…
Combien de pièces ai-je pu évaser… je ne les compte plus. »
Le fragment 14 n’est plus très loin.
Je pourrais me taire, poser mon stylo, éviter de poser mes doigts sur le clavier et aller au dénouement illico presto.
Mais non. J’ai envie de prolonger le plaisir.
J’ai envie d’étaler ma science, oui comme la confiture. J’adore celle aux cerises, aux griottes plus particulièrement.
Mais arrêtons notre bavardage et continuons de nous instruire de concert.
« Vous avez deviné de qui le scribouillard vient de vous entretenir.
Non ! vous êtes de mauvaise foi, car pourtant, le temps a été pris et mes différents sens ont été employés pour vous mettre sur la voie.
Allez ! ne faites pas les timides : je suis la… la…
Strawberry ou erdbeere ou fresa ou fragola ou morango.
Toujours pas alors que je vous ai donné différents vocables que vous auriez pu connaitre.
Non ! Vous ne parlez pas les langues les plus courantes.
Il vous faut la traduction en Suédois : jordgubbe ou en néerlandais : aardbei.
Pas encore, alors franchissons d’autres frontières et allons voir du côté des langues Russe, klubnika ou Arabe, fraoula ou Coréenne, dial kee.
Bon, vous vous moquez de moi, la dernière façon de me nommer que je connaisse, c’est en Japonais : ichigo.
Là, vous m’avez reconnue oui… je suis la F R A I S E.
À bientôt, car je ne doute pas que vous allez me croquer moi ou une de mes congénères. »

* Premier fragment de lunettes :
Un achat dans un magasin un jour de une paire de lunettes plus un pantalon pour un priix total de 12€ ; plus épaté par le prix que par le contenu, puisque ni l’un ni l’autre ne me servait beaucoup, à l’époque... c’était un pantalon d’été et nous étions en hiver, et, voyant très bien, je n’avais pas besoin de lunettes.
* Premier fragment de lunettes : voyant très bien / De la belle vue
Grande richesse de ma vie : une belle vue. Alors, ces lunettes ?? Être vieux ? Et mon cerveau ? baisse-t-il aussi pareillement ? Et moi ?
* De la belle vue : Être vieux ? / Option fumeur
Mais non : c’est parce que je fume.
Mais quand même : une ou deux cigarettes par jour, est-ce fumer ?
* Du direct
Hé mais ça brille.
Hé mais ça a une carapace comme une tortue.
Hé mais son étui pourrait être un sac à main femminin.
Hé mais c’est immobile.
Hé mais son étui est transparent sans doute une conjoncture significative car il n’y a pas de hasard.
Hé mais ça pourrait presque me regarder.
Il dort.
* Du direct : Hé mais / Hé mais Hé mais Hé mais
Essayer aussi avec Ho mais ou Mais tout court ou peut être simplement Et.
* De les porter
Ouvrir leur étui, saisir ses lunettes, les déplier - attention : les branches sont rigides et pourraient se casser ou blesser - et les porter à la tête - mais les branches pourraient blesser les yeux sur un faux mouvement.
Sur la tête c’est comme si on vous lisait le règlement militaire, mais les yeux voit mieux.
* De les porter : Sur la tête / De la tête
Il parait que les lunettes de lecture achetées à bas prix abîment les yeux.
Aussi je ne les utilise que pour de courtes périodes et, si je dois alternativement lire de près et voir de loin, je les fais pivoter sur ma tête ; devant mes yeux pour lire de près, en haut dans les cheveux lorsque je dois voir autour de moi.
Mais je ne dispose d’aucun nez dans mes cheveux susceptible de porter mes lunettes dans la position haute. Aussi, de là, mes lunettes glissent, arrivent sur le front et rampent devant mes yeux dans une attitude absolument non collaborative.
* Du nettoyage
C’est vraiment pénible dans le regard lorsqu’elles sont salles. Il y a une transparence du regard, c’est un acquis comme dirait la CGT. C’est un truc qui existe, qu’on ne remet pas en cause.
Quand les lunettes sont salles elles négligent 4 millénaires d’évolution terrestre. C’est une immoralité. Et puis, chercher quelque chose pour les nettoyer... un bout de chemise ? Trop court ; avec le manteau ? Trop gros ; un mouchoir en papier ? Trop troué. Je crache dessus, je me débraille et sors ma chemise du pantalon, et j’attrape un bout pour tout essuyer et laver... j’obtiens des lunettes propres, mais je ne suis plus présentable.
* De leur disparition
Quand on les a sur le nez on ne les voit plus.
Et même ceux qui sont complètement miros ne les voient ni quand ils ne les portent pas, ni quand ils les portent ; ils ne les voient qu’au toucher.
Oh ! profondeur insondable de l’objet paradoxal !
Mais il y a une pesanteur sur le nez et des menottes sur les oreilles. Un caillou ? un carcan ? Je tourne les yeux à droite... je ne vois rien ; à gauche... rien non plus. Je les enlève je les rejette je les expulse... et je n’y vois plus rien du tout, si j’étais gravement atteint de la vue.
Oh ! ça suffit. Ne dramatisons pas. Même sans lunettes, je vois encore bien.
* De leur disparition : on ne les voit plus / Du miroir
Solution : se regarder dans une glace, un miroir.
C’est un objet de la même parenté que les lunettes : avez-vous déjà vu un miroir ? Non, puisque le miroir renvoie ce que il réfléchit.
Une glace renvoie une lunette et l’on voit un monsieur avec des hublots à la place des yeux.
* De l’écrivain à lunettes
L’écrivain à lunettes... sans entrer encore dans un abîme sans fond de paradoxalité, est bien forcé de considérer avec distance l’écriture descriptive ; est-ce sa description ? Mais alors pourquoi a-t-il besoin de lunettes ?
Donc, un peu de distance.
Ou peut être pourrait-il décrire d’autres lunettes que les siennes ?
* De l’écrivain à lunettes : Ou peut être pourrait-il décrire d’autres lunettes que les siennes / De l’écrivain qui s’écoute parler
Être extrêmement prudent dans cette direction, de l’écrivain qui s’écoute parler. La distance, c’est entre soi et l’objet, mais c’est également entre soi et soi. Imaginer que je parte de derrière moi, par des stratagèmes divers : laisser le temps faire son oeuvre (c’est à dire oublier), générer du désordre dans son texte...
* De l’écrivain qui s’écoute parler : l’écrivain qui s’écoute parler / De l’écrivain qui s’écoute parler
* De la littérature de conférence
Incluses dans un étui (à lunettes) les lunettes se composent d’une facade de deux verres encadrés, tenus sur une ligne, prolongés par des branches recourbées. Cadre et branche s’appellent la monture. Les verres sont transparents, la monture d’une matière la plus légère et la plus lisse possible, de couleur variée.
L’étui est un petit sac rigide qui s’ouvre sur toute sa longueur, d’une taille juste suffisante pour contenir et protéger les lunettes.
* De la prise de décision
Vous prenez la décision de mettre vos lunettes ?
1) les chercher, considérant que il faut découvrir l’étui ou les lunettes.
2) faire la liste des lieux de situation possibles : le bureau, le(s) sac(s), ou bien essayer de se souvenir de la dernière fois.
3) à sa découverte, se saisir de l’étui
4) l’ouvrir
5) tirer les lunettes
6) et les poser sur le nez.
* De les porter
Ouvrir leur étui, saisir ses lunettes, les déplier - attention : les branches sont rigides et pourraient se casser ou blesser - et les porter à la tête - mais les branches pourraient blesser les yeux sur un faux mouvement.
Sur la tête c’est comme si on vous lisait le règlement militaire, mais les yeux voit mieux.
* De les porter : Sur la tête / De la tête
Il parait que les lunettes de lecture achetées à bas prix abîment les yeux.
Aussi je ne les utilise que pour de courtes périodes et, si je dois alternativement lire de près et voir de loin, je les fais pivoter sur ma tête ; devant mes yeux pour lire de près, en haut dans les cheveux lorsque je dois voir autour de moi.
Mais je ne dispose d’aucun nez dans mes cheveux susceptible de porter mes lunettes dans la position haute. Aussi, de là, mes lunettes glissent, arrivent sur le front et rampent devant mes yeux dans une attitude absolument non collaborative.
le papier est la frontière des fous dit le proverbe
le papier porte - vingt grammes de papier blanc vingt grammes de papier blanc vingt grammes de trois phrases vingt grammes de trois cent cinquante neuf caractères noir police times 12 écrits entre neuf heures trente et quatorze heures cinquante vingt grammes cinq lignes vingt grammes d’assemblages de mots dans la norme de la grammaire normative - je porte vingt grammes de tristesse à la main
le papier porte l’écriture de mon père
le papier se liécrit - une enciclopedia ilustrada sapena la fuente, Liberté à Brême Rainer Werner Fassbinder, Comédies et actes divers Samuel Beckett - une pochette verte avec des trucs administratifs - douze carnets avec des notes prises dans des salles de cinéma des débuts de textes - le vent prolonge l’art des anciens - le vent la langue vernaculaire du ciel - le livre posé ce matin Photographies Abbas Kiarostami édition Hazan
le papier porte la guerre
le papier dit - ROCKHAL 4361 ESCH SUR ALZETTE ROCKHAL CENTRE DE MUSIQUES AMPLIFIEES PRESENTE PATTI SMITH SAMEDI 2 JUILLET 2016 21H00 DEBOUT PLACEMENT LIBRE PRIX TTC EUR 44,00 CATEGORIE UNIQUE NORMAL 99970307035121201160502/S02/B1697039705 FRAIS DE LOC. INCLUS et plus tard le papier se couvre- elle ne chante pas elle dit dans sa voix de Patricia Lee Smith PATTI SMITH elle dit chevaux chevaux chevaux chevaux
le papier porte toutes les langues
le papier remplace - la pierre la pierre remplace le bois le bois remplace le métal l’argile remplace le papyrus le papyrus remplace la peau - sur la peau la voix - et rien de plus - une petite musique - petite musique dans un carré de lumière - elle regard fixe dans la peau dans le souffle de la guerrière - colère elle creuse par le bout des doigts la colère - et le silence - elle jette en arrière la tête - elle incline son visage sur l’écran
le papier porte le nom du passé
le papier joue – la feuille couvre le puits les ciseaux tombent dans le puits la pierre tombe dans le puits la pierre brise les ciseaux les ciseaux divisent la feuille la feuille couvre la pierre la pierre brise les ciseaux tombent dans le puits
le papier porte la musique de Moondog
le papier brûle - chevals chevals chevals chevals chevals - chevals chevals chevals chevals chevals - l’eau endormie sous le pont la pluie éclaire le - chevals chevals chevals chevals chevals - le copiste dos courbé main encre croix - à ce feu à cet arc de feu à ce chant dehors ce vent ce long chemin cet avant sa tête tournée vers ce mouvement arrêté - cette lettre ce visage chevals chevals chevals chevals chevals ou - la main retirée du jour la tête désordonnée - le papier le feu la lettre
le papier se transforme - de fibres de fibres entières de fibres coupées de rayons ligneux de cellules de parenchyme de vaisseaux - arrivée au bout du couloir une porte s’ouvre sur l’ atelier du peintre - au sol une immense feuille de papier vivante format très grand monde
le papier porte la vision du paradis
le papier se peint - je pose quelques pointes de bleu sombre puis de bleu moyen trempe le crayon dans l’eau et trace et efface avec la peau de l’index l’eau et les bleus - surface de ciel - ensuite je pose des pointes de verts sombre et moyen - surface d’herbe - je prends un crayon noir je trace deux traits pour le tronc ensuite des traits plus nerveux pour les branches - l’eau attaque la surface de l’arbre je creuse la surface la surface - une matière - le papier n’est plus lisse - je pose des pointes de vert - avec la pointe d’un crayon neutre je trace des cercles - je pose des traits de jaune et d’orange - je pose des pointes de rouge - je trace six traits rouges - avec un crayon neutre je griffe la surface et les griffes deviennent herbes - je pose au - dessus six pointes de violet - chaque point violet devient - cercle - je fais descendre le rouge j’estompe le rouge du cadre avec un peu de jaune du vert - ciel d’ arbre
Immobile mais tournant autour de son axe lorsqu’on lui impulse un léger
mouvement de la main, la mappemonde conteste toute platitude à son égard. Elle s’est dissociée de la nappe lorsqu’elle a changé son n en m. Sa rondeur s’impose à l’œil oisif qui pâture sur ses territoires.
Nord : étoile de feu
Sud : dansent les femmes et leur panier de grain
Est : aigle doré dans son envol
Ouest : et le feuillage s’embrase
Le globe propose une pensée sphérique autour de son axe.
Pour déjouer la rigidité de la ligne qui encercle et sépare les deux moitiés du globe en hémisphères, l’esprit humain a tracé une autre ligne qui serpente et se joue des points cardinaux malgré son appellation nord sud.
Le bleu laisse émerger des surfaces marron dont l’opiniâtreté s’inscrit en une teinte plus foncée. Les zones vertes se font discrètes.
Tissu d’Arlequin confectionné par le temps, cousu et décousu, souvent rapiécé.
Comme une feuille jaunie par le soleil, l’Amérique du Sud est irriguée de nervures qui se divisent et se démultiplient en vaisseaux.
Et la navigation côtière du regard se perd sur le pointillé des îlots figés dans leur dérive. Cependant, la calotte blanche, comme une méduse, cherche à s’étendre dans la masse bleue.
Partir d’un point, suivre l’échancrure d’une ligne
Partir d’un point encore, dans le bleu.
Partir d’un point toujours, fouler, fréquenter la finitude.
Le globe est tenu par un arceau en deux points qui lui confèrent un axe, le tout reposant sur un socle, indispensable pour son équilibre. Une poussée trop brutale de la main pour initier un mouvement de rotation peut facilement déstabiliser cette fragile structure.
Alors que sous un choc, le verre éclate en cataracte, un globe, plastique, se fendille et se craquelle.
Statique, la mappemonde pose.
Elle ne prend vie que lorsque cet autre globe, oculaire, vient se nourrir de ses vaisseaux, couleurs ou toponymes pour rêver.
Sur la mappe, le regard cherche l’axe indispensable à sa respiration.

Objet transitionnel qu’on prête qu’on oublie — combien ai-je perdu de parapluies dans ma vie ? — qu’on achète parce qu’il pleut et pas parce qu’on en a envie.
Que reste-il de l’objet hormis la fonction de para/pluie, à part la pluie ?
Qu’y a-t-il à dire d’un parapluie ?
Voilà son problème, il pare. Il est un rempart, un entre-deux, un arc entre le corps et l’eau. Contaminé par l’humidité accumulée dessous et la morosité grise du dessus, le parapluie est triste. Oui, tandis que le parasol est joyeux, le parapluie est triste.
And what about the umbrella ? L’anglais, accent londonien, californien ou de la Barbade, n’y change rien, quand il pleut, il pleut.
Au mieux, il est une parade, publicité pour compagnie d’assurances ou revendication d’un weekend en Normandie.
Seule issue vraiment positive, l’histoire d’amour naissante à chanter dans sa tête : « … elle avait quelque chose d’un ange, un p’ti coin de paradis, contre un coin de parapluie… » (Brassens), « vous désirez ? Un parapluie ! Un parapluie ? » (Jacques Demy /Michel Legrand) ou « you can stand under my umbrella, ella ella eh eh eh » (Rihanna).
Bref, le parapluie est une protection ou un prétexte à chansons, d’accord.
Mais son en-soi, c’est quoi ?
Finies les lamentations météo, l’ontologie du parapluie est ailleurs. Alors où ? Bien y réfléchir.
Il est une parité entre métal coupant et tissu soyeux. Mais encore ? Chercher du côté des apparences.
Est-il beau, est-il laid ? Formuler un critère.
Enfin, ce objet existe bel et bien, à un moment où un autre ! Plutôt fermé, plutôt ouvert, en se balançant à l’extrémité d’un bras ou oublié dans le vestibule d’un restaurant ? Trouver quand.
Surtout, ne pas oublier de « relever le défi des choses au langage ».
Commencer par un inventaire : combien ai-je eu de parapluies ?
J’ai certainement dû avoir un petit parapluie rose.
Le pire, c’est celui dans lequel je me suis pincé le doigt en jouant, vers 7 ou 8 ans, véritable raison pour laquelle je crains les parapluies.
Je me souviens d’un parapluie vert transparent, on voyait les gouttes s’écraser.
Il y a celui trouvé dans la cave de ma grand-mère, noir brodé rouge, perdu dès le lendemain.
J’ai eu un parapluie turquoise, comme la Mer des Caraïbes, choisi plutôt qu’un autre pour cette couleur, un matin d’été orageux en Suisse. Il a fini cassé dans une poubelle en bas de mon immeuble.
Pendant quelque temps, j’en ai eu un argenté, comme une soucoupe volante. Mais d’où venait-il au fait ?
Les noirs pliants, je ne peux pas les compter.
A Banff, Canada, j’ai acheté un grand parapluie avec un castor dessus.
Celui que j’utilise en ce moment est petit, vieux et kaki. Il me convient et je m’y suis habituée.
Un ami m’a donné ce parapluie alors que je m’apprêtais à quitter son domicile. Etant donné que c’est un garçon plutôt capuche, je suppose qu’un ou une autre avait oublié l’objet là-bas. J’étais arrivée sous le soleil et repartie avec la pluie : lui ou elle devait avoir vécu une aventure météorologique inverse.
Les parapluies sont des témoins qui passent de mains en mains.
Plié, il mesure exactement 24 cm. Il a une poignée en plastique qui fait semblant d’être ergonomique, à laquelle se rattache une lanière en tissu finement tressée que je n’ai jamais utilisée pour le suspendre. A l’examen, elle se révèle être douce, voire d’une qualité surprenante par rapport au reste.
La partie principale, toujours lorsqu’il est plié, ressemble à un bourgeon pressé d’éclore.
Et il a bien raison, car c’est lorsqu’il s’ouvre que ce parapluie est formellement le plus intéressant.
Une fois le système coulissant parvenu à mi-chemin du manche, il se transforme en un mini-manège, de ceux avec des bras articulés, au bout desquels des hélicoptères ou des fusées montent et descendent pendant que le plateau tourne. Ce système de pliage me fascine car il participe, à son niveau, certes, mais quand même, à la famille ces objets, poussettes ou trains d’atterrissage d’avion, auxquels on demande d’exécuter sans faille un mouvement réversible.
Totalement ouvert et bloqué par le cran en haut du manche qui me donne une légère sueur froide à chaque fois (je me suis pincé le doigt en jouant, vers 7 ou 8 ans), on peut admirer la structure de ses baleines, terme bien étrange pour évoquer huit tiges de métal graciles, bien plus similaires aux pattes d’une araignée qu’à la silhouette d’un cétacé. Etant pour moitié plus désarticulées qu’articulées, elles semblent moins endommagées que aptes à quelques contorsions inattendues. Le tissu en revanche n’est pas favorable à leurs velléités frénétiques et, en maints endroits, il s’est désolidarisé de l’armature.
Messenger : Slt, j’espere ke tu va bien ! ça va te paraitre chelou, je t’expliquerai c pour ecrire un truc, je voulais just savoir, le parapluie ke tu m’a file, le vieux kaki, avant il etait a ki ? biz
Quand je suis sous mon parapluie, souvent je pense à Maman, la sculpture de Louise Bourgeois. En forme d’araignée géante — 9 mètres de hauteur, elle est installée à l’extérieur du Musée Guggenheim de Bilbao et plus précisément en bas d’une rampe, qui conduit inexorablement à devoir passer au-dessous, malgré des réticentes augmentant au fur et à mesure qu’on se rapproche. C’est une expérience. Ses grandes pattes forment une architecture élancée, protectrice et, en même temps, une cage effrayante dont on espère qu’elle ne va pas se refermer. Comme les baleines de mon parapluie, elles sont distordues, mais plutôt que de la fragilité il en émane une puissance surprenante. Grâce à elles, l’araignée tient le coup. De même pour le parapluie.
Messenger (1) : ben chai plus ! fo ke j reflechisse a+ xxx
Mais d’autres fois, je me prends pour Mary Poppins, surtout quand il y a du vent. Dès la première bourrasque, le parapluie se retourne. De concave, il devient convexe, de cloche il passe en mode tulipe et je le poursuis plus qu’il m’accompagne. Alors j’ai l’impression que je vais m’envoler dans le ciel de Paris.
En anglais, on dit « fontain pen », stylo fontaine. La source inépuisable de l’écriture, les mots qui se déversent, qui coulent sur la page, s’accrochent parfois aux rugosités, les mots rageusement rayés jusqu’à trouer le papier (effet conjugué de la pointe et de l’encre humide).
Outil de jardin, râteau à main, cisaille et élagueur tout-en-un ? L’écriture comme du jardinage, d’abord on déblaie, on élague, on arrache les mauvaises herbes et les ronces.
Fountain pen. Corne d’abondance, fontaine de Jouvence. Ratures plus souvent que littérature.
je me souviens d’avoir lu une interview de Laurent Génefort dans la revue Bifrost, il y a 5 ou 6 ans. On l’interrogeait sur la raison pour laquelle il écrivait des romans de plusieurs centaines de pages. Selon lui, la littérature de science-fiction avait suivi l’évolution des techniques : d’abord de courts récits, écrits à la main ou tapés à la machine, publiés en revues. Puis des romans standard, machines électriques et diffusion de masse. Enfin, le traitement de texte, le roman-fleuve. On peut imaginer, suggérait-il, avec la publication en ligne, des romans sans fin, des livres univers qui s’étendraient à l’infini.
“The surrealists believed that objects in the world possess a certain but unspecifiable intensity that had been dulled by everyday use and utility. They meant to reanimate this dormant intensity, to bring their minds once again into close contact with the matter that made up their world.” Jonathan Lethem—The ecstasy of influence. Quelle est l’influence qui sommeille dans mon stylo ?
Oh, et puis, de toute façon, je n’écris presque plus jamais au stylo, encore moins à la plume.
« La main est constituée d’une partie proximale, élargie, à laquelle sont appendues cinq structures cylindriques, les doigts. On lui décrit une face palmaire (ou antérieure) et une face dorsale (ou postérieure), une extrémité proximale (ou supérieure) et une extrémité distale (ou inférieure), et un bord latéral et un bord médial. La partie proximale peut être divisée en trois parties : l’éminence thénar, latérale, le creux de la main, central, et l’éminence hypothénar, médiale. Elle comporte sur sa face palmaire (la paume) trois plis de flexion, les lignes de la main. » (Wikipedia) C’est l’éminence hypothénar qui pose problème, quand on est gaucher et qu’on écrit au stylo plume : l’éminence hypothénar frotte l’encre encore humide et l’étale sur la feuille. On s’en met plein les doigts aussi. (L’encre sur la peau ne part pas facilement au savon et à l’eau).
En chiromancie, cette éminence, on l’appelle le Mont de la Lune. C’est assez plaisant de se dire qu’on barbouille son texte à l’aide du Mont de la Lune.
L’odeur de l’encre : l’encre, substance liquide mise en solution de colorants d’origine végétale, minérale ou chimique, dans un solvant » (Wikipedia, encore). L’écriture, mise en solution de substances chimiques présentes dans un cerveau.
C’est un Parker sonnet vermeil (argent recouvert d’or). Bel objet. Trop ?
La vraie question : pas le stylo, la marque, le modèle, le type d’encre ou la couleur. La vraie question : pourquoi écrire ?
Motifs en léger relief sur le corps du stylo. Surface rugueuse sous les doigts. Métal froid, reflets dorés à la lumière. Oxydation légère. Négligence peut-être, charme certain. Acheté non pas d’occasion, mais en solde, retrouvé par le vendeur au fond d’un tiroir. Coup de foudre immédiat. Objet qui, sans avoir jamais servi, a paradoxalement déjà une histoire — comme en témoignent la patine et la vieille étiquette, minuscule carré blanc accroché à un mince fil rouge sur lequel quelqu’un a écrit au crayon le modèle et le prix (en euros : pas si vieux, finalement ce stylo).
Plutôt qu’une cartouche d’encre, j’utilise la pompe à encre. J’ai le goût des rituels. Comme l’artisan affute ses outils avant d’attaquer son travail, je prépare mon instrument avant de me lancer dans les corrections à la main.
L’écriture, le gros œuvre, je le fais avec le traitement de texte ; les corrections, au stylo. Comme Apple inscrit sur ses produits : « Designed in California. Assembled in China », je pourrais dire de mes livres : conçu dans un cerveau humain, fabriqué sur ordinateur, finitions main.
Dans l’une des deux vitrines de la bijouterie familiale, sont exposées des montres de toutes formes, de toutes sortes, en argent, en or, rondes, ovales, rectangulaires et leurs bracelets de cuir, d’inox. Les LIP tiennent la vedette et la fillette les admire, fascinée par le temps qui s’écoule d’elles. Il diffère de l’une à l’autre. Elle s’interroge : quelle montre détient la vraie heure, la vraie ?
Dans l’atelier, son grand-père a coincé un gros lorgnon sur son œil droit de cyclope. Il se penche sur l’établi où gisent des montres fatiguées, à bout de course. Elles espèrent un nouveau remontoir ou, plus délicat, que les ressorts, dans leurs entrailles, soient remplacés. La fillette aime regarder les mains aux gestes précis de l’homme qui leur redonne vie, remplaçant leurs verres, jouant avec les pivots, les aiguilles, les poussoirs, les cadrans.
Une montre ronde et fine, au bracelet de cuir blanc, lui a été offert pour sa communion solennelle. Un cadeau inouï, merveilleux, comme une entrée dans le monde des adultes, cette montre à son poignet qui tic-taque doucement.
Cette montre fidèle l’accompagne dans l’épreuve de français du bac. Son bracelet a été remplacé ; usé, il serrait méchamment son poignet. Le nouveau, vert tendre, elle lui trouve du charme. Pour lui, elle a retenu ses longs cheveux par un ruban de sa couleur. Fébrile, elle lorgne en permanence l’avancée des aiguilles, la trotteuse la fascine. S’accorder à son rythme pour écrire.
Même montre fidèle : le cadran présente deux fines rayures – il faut dire, elle ne la quitte jamais. Fébrile, elle déplore l’avancée rapide des aiguilles. Elle supplie : arrête-toi, petite... Elle le sait, son amoureux ne viendra plus.
Une Rolex, voilà la montre qu’il convient d’avoir. C’est ce que lui a dit l’homme de sa vie en la lui offrant. Faut dire, elle rutile de mille feux, s’orne de multiples cadrans, elle éclaire la nuit. « Si à cinquante ans t’as pas une Rolex, t’as raté ta vie. » C’est ce qu’il a certifié Ségala en 2009 ! ce connard ! Elle a quitté à regret sa petite montre timide pour celle-là, signe extérieur de réussite.
Dans sa main, comme dans un nid, la montre à gousset de son grand-père l’horloger, la chaîne d’or qui barrait sa poitrine. Un trésor est caché sous le couvercle arrière. Une photo de sa grand-mère, si jeune, sourire éclatant sous sa chevelure moussue. Et une date gravée, celle de leur mariage.
Dans sa main, celle-ci se cache sous son couvercle orné de fines roses et de perles, cette autre est chronomètre, avec au bout de sa chaîne une petite médaille patinée par le temps, sans doute un saint Christophe. Celle-là, sur son cadran émaillé, donne l’heure : gros chiffres bleu en italique à l’intérieur de une heure à douze heures, petits chiffres rouges et gras à l’extérieur de treize heures à vingt quatre heures. Elles font toutes partie de son héritage : les voici exposées sur les rayons de sa bibliothèque, le début d’une collection qu’elle poursuivra avec ténacité ; en l’honneur de Louis.
Branle-bas de combat : la Rolex a disparu. Comment le dire à l’autre qui sera furieux ? Vraiment, aller à la plage avec cette merveille précieuse, la laisser dans ton sac pour te baigner, quelle stupidité ! Non, mais tu perds la tête ! Rolex, tu es annonciatrice de jours difficiles. Bientôt le divorce.
Montres en révolte. Les ouvrières de LIP occupent l’usine, elles refusent sa fermeture, elles vendent les montres qu’elles se sont mises à fabriquer en auto-gestion. LIP , un nom qui sonne dans sa mémoire de militante, ces pétitions qu’elle a signées et fait signer, les réunions auxquelles elle a participé, la LIP qu’elle exhibait fièrement à son poignet. Surgissement du passé à partir d’un mot qui sonne haut et clair. N’était-il pas logique qu’une petite fille d’horloger participe, au moins par pétitions et réunions, à la lutte des petites LIP ?
Dans sa boite aux lettres, ce matin-là, un paquet, vite l’ouvrir : un écrin très simple contient une montre, ronde, chiffres bien dessinés, aiguilles fines, bracelet de cuir noir. Elle vérifie, pas un mot, aucune trace d’un quelconque expéditeur. Juste Elle, souveraine, aimée dans l’instant, qui ne la quittera plus, c’est juré. Et s’entrouvrent pour elle des pans entiers d’une mémoire qu’elle croyait perdue.. « Une montre LIP, c’est une montre LIP ! »
Quelques années plus tard, elle rend l’âme, elle s’arrête, refuse de scander le temps. A bout de souffle, irréparable, lui dit-on. Elle aura une place d’honneur dans sa bibliothèque.
Coïncidence, elle s’est arrêtée quelques jours avant sa retraite à elle. C’est fini, plus de montre à son poignet. Adieu aux horaires rigides, rendez-vous contraignants, plannings stressants, nuits blanches quand ça débloque au boulot, réveil qui sonne trop tôt, toujours trop tôt, au beau milieu d’un rêve bleu. Devant elle, s’ouvre une nouvelle vie au rythme du soleil et de ses envies.
Dans les rayons de Décathlon, est présentée une montre carrossée de plastique vert et violet, pas vraiment belle, mais drôle ; pour les jeunes, c’est certain. Quinze euros ! Sacré coup de cœur, elle flashe sur elle, l’emporte. Géonaute - c’est son nom – se prélasse sur son poignet, prête à chaque seconde à donner l’heure exacte. Là, maintenant, tout de suite, il est 16 h 38 minutes 15 secondes.
1 - séparé, il est déchu
Atout de beauté et de féminité, le cheveu tombe en disgrâce quand il tombe. Dégoût. Répulsion. Sur le champ.
Un cheveu. Le même pourtant, mais hors contexte. Hors de propos.
Condamné à faire partie.
Prisonnier à vie de sa terre d’enracinement. S’il la quitte, il sera traqué jusqu’à l’élimination.
Séparé, le cheveu déchoit. Rebut.
N’est plus, dès qu’il cesse d’être relié. Seul, il est sans intérêt.
Sa perte n’est pas un drame, l’ensemble survit. Mais dans l’espoir de retarder l’inéluctable chute.
2 - partout ! présent !
Commence à les voir et tu les verras partout.
Stries noires sur le savon blanc de la salle de bains.
Frontières fragiles qui lézardent le drap blanc du lit partagé.
Motifs incongrus sur l’épaule d’une femme en tailleur beige, une dame élégante.
Fils d’une autre texture (laquelle ? tout sauf du coton) sur la nappe fraîchement dressée.
Envahissement discret par une armée ainsi disséminée, sans intention belliqueuse.
3 - intrusion
Le cheveu s’immisce. Atteinte à la pudeur.
Le cheveu s’incruste. Inattendu toujours. Indésirable.
Isolé, il devient l’intrus.
Incongruité au quotidien. L’accident minime.
S’installe. Réflexe ? Le cheveu se réenracine sur des terres stériles. Résiste au balayage distrait d’un revers de main qui minimise.
Le cheveu ne cherche pas de place, souvent s’accroche au hasard de sa chute qui n’est nulle part appropriée.
Et lui, jamais à la bonne place.
4 - sale, forcément
Repéré, suscite la répugnance. Aussitôt.
Partout, indésirable.
Un simple cheveu pourtant. De soi ou d’un autre tombé.
Si, si c’est ton cheveu, regarde ! Les miens sont plus clairs… les tiens plus longs, etc.
Séparé de la chevelure, il devient parasite. Qui aurait envie de le reconnaître sien ?
Est-ce encore du soi, ce cheveu ?
Il tombe ; déchet. Propre ? Toujours sale.
Jadis complimenté, valorisé, choyé… quand il choit, il chute aussi dans la considération des hommes.
5 - pluriel
Ils n’opèrent pas toujours en soldats solitaires. Il suffit de penser à la touffe qui bouche la canalisation.
Tenter d’extraire les cheveux qui dépassent. Ils glissent entre les doigts.
Échappent à la prise, aspirés par des profondeurs invisibles.
Reprendre les bouts qui débordent. Tirer. Doucement, avec fermeté pour ne pas rompre la chaîne.
Les premiers cheveux émergent, les autres suivent, gluants, par paquets.
L’odeur s’ensuit. La nausée aussi.
Le cheveu n’y est pour rien, il est simple véhicule.
Ce que les doigts peinent à retirer, l’esprit se jure de le détruire par la chimie.
Éternel combat.
6 - envahissement des mots
Le cheveu occupe la langue aussi.
Singulière table de conjugaison en zigzag : s’arracher… tomber dans la soupe… couper en quatre… faire dresser sur la tête… jouer… se faire… se prendre… saisir l’occasion… ne pas toucher…
Ou images qui se prennent au corps de l’homme, pour mieux l’exprimer : tiré par… à un près… mal… sur la langue…
Le cheveu serait-il dans nos cerveaux enraciné ?
7 - balayage de mains
Ils sont deux ou trois à s’accrocher aux doigts de la jeune fille, qui passe sa main de bas en haut, et doucement étire les mèches attrapées.
Dégager sa chevelure de ces parias déjà morts, surplus planqués, comme par mimétisme, dans ce tout, qui ne les reconnaît plus comme partie.
Ils se laissent faire, ne résistent pas ; comment résister quand plus rien ne nous relie à l’ensemble ?
La main gauche à présent. Même mouvement, pour des résultats équivalents, à quelques cheveux près.
La jeune fille regarde ses doigts, les retourne puis les agite. Après le constat de la perte, se débarrasser de la chose et de l’idée.
Secouer à plusieurs reprises avant que les cheveux se retirent, congédiés.
Le crâne, la tête, la main, les doigts, le sol, l’aspirateur, la benne... Triste trajet.
Déchéance, après le faste d’hygiène et de soins.
8 - brosse
Tristesse de la perte.
Derrière chaque cheveu qui cède et rejoint les dents voraces de la brosse, des heures et des journées de vie ressenties comme révolues.
Après chaque brossage, elle évalue la récolte entre les pics de la brosse.
Récupère entre ses doigts la masse qui cède.
Elle regarde ses cheveux perdus, mais elle se regarde surtout. Dépouillée. Elle se regarde vieillir, dépérir peu à peu.
Elle sait pourtant que les chutes ont commencé tôt ; pas une question d’âge, mais de vitalité.
Elle voit ses cheveux se défaire, s’accrocher à nouveau aux balises de la brosse, céder ensuite… comme autant d’illusions qu’elle doit abandonner.
9 - ce n’est plus un cheveu qui tombe
Sur le sol, ce n’est plus un cheveu, mais des centaines qui s’amoncellent, sous la cadence métallique du chant des ciseaux.
Le coiffeur les piétine, absorbé par la traque des prochaines victimes. Il ne se laisse pas distraire par leur chute, les ignore : ne seront-ils pas balayés sans merci à la fin de la séance ?
Il poursuit, avec ou sans idée du résultat escompté. Dans la répétition de ses coups qui plongent dans la masse. En rythme.
Coupés, ce ne sont plus des cheveux qui tombent, mais des bouts qui éclatent, se séparent, s’éparpillent.
Ils se raccrochent au visage, à la nuque, aux bras ou aux vêtements… on dirait des poils raidis.
Et ils s’agrippent, se collent à la peau, comme jamais auparavant.
10 - trait tiré
Le cheveu se dresse, entre des espaces par sa seule présence déterminés.
Trait tracé, sur quelle attente ? L’avant et l’après ? Le pareil et le différent ?
Frontière ? Partie ? Limite ?
Ou la simple indifférence au sens. Le cheveu traîne, c’est tout.
11 - l’impossible mélange
Beurk un cheveu ! s’exclame le mangeur.
Ce n’est pas un poil pourtant. Mais beurk ! Beurk !
Filandreux sur la langue ou contre le palais, beurk ! Le sent-on s’enrouler autour de la glotte ? Beurk !
Craint-on qu’il s’accroche aux parois de l’œsophage ? Impossible à détacher une fois assimilé à nos entrailles, bien malgré nous.
Sa texture longtemps hantera le goût qui persiste. Difficile de s’en défaire : sa saveur est matière et la matière est tenace.
Même arrière-goût d’impuissance face à l’infime.
Comme un cheveu dans la soupe ! Déconcertant. Inapproprié.
Un cheveu ne se fondera jamais dans le liquide, ne s’y mélange pas sans laisser poindre son irréductible différence.
12 - pointe de vie
Au bout du cheveu noir, le bulbe. Blanc !
Minuscule point d’accroche, décoché. Plus rien à relier.
Pointe de vie dévitalisée.
De part et d’autre, extrémités sans prise.
Quel flux circulerait à présent entre les deux pointes ?
Point de transmission désormais !
13 - survie
Sur le bureau, au pied de l’ordinateur, près du clavier, contre la souris : un cheveu. Il n’y était pas hier ; Thérèse le jurerait, s’il fallait témoigner. Cheveu animé, ondoie sous ses yeux, dans une improbable pantomime de séduction. Elle se surprend à le fixer, absorbée par son mouvement absurde.
Bouclé, il désigne Layla. Sa fille Layla. Sans ambiguïté. Layla a toujours refusé de se lisser les cheveux. Silencieuse résistance aux modes de son pays natal.
Elle les laissait friser, mi-longs.
Layla morte, son cheveu aujourd’hui animé. D’où sort-il tant de mois plus tard ? Mis en branle par un souffle extérieur ? Ou Layla qui fait signe à sa mère ?
Pour Thérèse, l’âme de sa fille s’y meut. Elle se perd dans sa contemplation. Sa fille morte. Sa fille, par la grâce d’un cheveu, éternelle.
Mollusque marin dont le corps est enveloppé d’un squelette externe, le coquillage est à l’inverse de l’homme qui possède son squelette à l’intérieur de lui-même. Le coquillage est entendu aussi comme la coquille vidée de son mollusque. Gastéropodes pour les uns, bivalves pour les autres, certains coquillages sécrètent leurs propres coquilles. De coquillage en coquille, l’homme en perçoit d’abord la coque externe. Elle peut prendre une allure artistique que nul n’ignore, spécialement les dentelées si prisées que l’on appelle murex. D’autres dites céphalopodes le sécrètent parfois en os ou en plume, ainsi les seiches ou les calamars. Bien d’autres choses encore en sont écrites mais en une telle diversité que je ne saurais nullement la détailler.
Le coquillage vit contre la paroi rocheuse ou enfoui dans le sable. Sa double résidence ne le fait pourtant pas échapper aux menaces de l’existence car le pêcheur à pied le guette à tout instant. Ce dernier ne se déplace que lors des grandes marées. Armé de son couteau, de son seau et de sa réglette, il mesure les spécimens qu’il prélève aux bords de mer.
L’homme entretient ainsi un rapport certain aux coquillages. Il se plaît à y retrouver les saveurs de la mer. Ail, persil ou saumure ne sont là que pour les exalter car le coquillage se déguste ainsi sur les bords de tous les océans du monde. Parfumé d’odeurs de l’enfance, c’est le parcours habituel du bivalve. Du sable où il se contracte encore vivant, à l’estomac du pêcheur, cadavre devenu, il est bouillie méritant alors véritablement son nom de mollusque. Peut-être est-ce pour cela même qu’on les nomme mollusques. Mais cela n’est écrit nulle part, mais il est sûr aussi que je n’ai pas tout lu.
Mais parfois échappant aux rafles maritimes, le coquillage parfois se déplace de façon insensible, forçant l’observateur à quelques minutes d’attention voire plus. Il faut alors se poser. Et attendre...
L’homme entretient avec le coquillage, un rapport de silence. D’ailleurs ne dit-on pas se fermer comme une huître ? C’est dire la tacite posture d’une vie souvent ignorée entre l’homme et le coquillage. De ce fond marin, l’homme garde ce creuset de mystère, exilé des mots et du sens qu’ils supportent. Etre de coquillage, féminité en germe, mollusque à coquille, quel est donc ton secret ? Penché sur lui comme sur un habitant de l’autre hémisphère, l’homme le sonde de ses pauvres questions. Car il veut en extirper la donne qui illuminerait sa vie. L’illuminé n’est-il pas en effet celui qui porte la lumière ? Mais pauvre pêcheur de coquillages, misérable promeneur des sables, aveuglé par le soleil, il ne se trouve qu’ébloui.
Dénudé de son corps de mollusque, réduit à sa seule coquille, coquillage en sa flottaison printemps, qui ne se souvient d’Aphrodite le surmontant ? Botticelli l’a immortalisé aux yeux du monde. Aphrodite fait corps à sa coque salée. Elle est céleste, terrestre mais aussi maritime et lacustre. Elle est " écume" du sperme d’Ouranos, le Ciel, dit la Théogonie. Et dans cette poussière d’étoiles que sont Rhodes, Cythère, Chypre et Salamine, elle reste à jamais présente dans son dire d’amour. Aphrodite ou l’autre nom du coquillage. Aphrodite ou l’autre nom de femme, en son odyssée océanique. Coquillage, désormais conjugué au féminin. Si souvent. Etre à la perle rare. Voilà l’image qu’ont laissé les mythes à son égard.
Coquillage, il s’est imposé à mon esprit. C’était au réveil. A ce point où s’émeut la lumière. Je ne sais pourquoi, gardant bien malgré moi, sa raison obscure. Mais une fois posé, coquillage toujours ici au masculin, dans la langue des bords de mer, il a vu venir les huîtres et les palourdes, toutes revenues, hermaphrodites devenues, le temps d’un été. Lovés dans sa rondeur blanche calcite, ils se sont endormis.
Repos.
Suspens.
Mais là où s’espéraient vacances et vide fomenteur de tous les possibles, s’est faite entendre cette phrase étrange : " Plus de liberté !" Car se sont déchaînées des vagues de mots, seulement à partir de l’évocation de ce seul nom : coquillage. Elles sont venus l’habiller de leurs congénères et de leurs prédateurs, de leur manière de faire, de parler et de cuisiner. Doux plaisirs de bouche. Elles sont venues le polir. Frottant les mots et leurs sons contre le roc des choses, elles ont mimé les vagues du large, érodant la pierre, la faisant galets puis sable de rivage. Coulures entre les doigts, fables, mots ou choses devenues.
J’ai voulu leur échapper en cassant l’écran de leur nacre. Traverser les frontières et croire qu’une autre langue en extirperait l’étrangeté. Je n’ai pas sondé de profondeurs occultes. J’ai seulement glissé à la surface des langues. Dans leurs mélodies inconnues, équations vibrations, lallations. J’ai fait résonner dans la courbure de mon crâne : Co-quille-age. Et voilà venu je ne sais d’où cet écho : ốc, ốc, dans sa rondeur picoreuse, toute en bouche qui s’ouvre et se referme, occlusive gonflée d’air avec son coup de glotte final qui élève le ton mélodique. Alors que résonnait le son et que m’apparaissaient ses éclats calcaire, fragments scintillants, hallucinés sous le soleil, insidieusement sont arrivées des onomatopées : lóc cóc. Ils sont venus tinter comme les gouttes d’eau d’un robinet mal réparé, réveillant la sieste de l’été : toc toc à la porte, le temps d’un souffle de mer. Tu croyais en traversant les langues trouver ta vérité. C’est la fable que tu t’étais racontée. Mais tu ne t’es trouvée bercée que dans la jouissance sonore qui a construit le monde lorsque tu y étais arrivée.
Derrière coquillage, mot surgi je ne sais d’où, ont retenti des sons pianotant sur l’orbe du langage. Et soudain dans la blancheur coquille, dans les nervures ciselées par le sel maritime, coquillage, voilà que tu n’as plus d’histoires à raconter. Tu es là seulement en tes éclats arc-en-ciel, acte de confiance, présence nacrée au monde.
C’était sous le soleil. Tu as tué hier. Tu as vécu seulement aujourd’hui, réduit à ce brouhaha qui résonne dans la rondeur de ma tempe. J’ai apposé alors ta conque sur les paupières, je l’ai glissée ensuite vers les oreilles fenêtres sur mer. Là où tu te reposes, se couche le soleil. C’était à l’occident d’un horizon éternel. Nulle mort n’y existe. Car il y résonne seulement l’éternité faite langage. Et à travers les langues devenues toutes inconnues, j’ai entendu tambouriner la pluie en ses onomatopées du monde. Babel tourbillons. Ils ont résonné dans ta rondeur nacrée.
Coquillage.
Matin du monde à nouveau.
Une matière sombre granuleuse prédomine
elle recouvre toute une face et sur les autres côtés
elle enserre des surfaces rouges très lisses.
Trois faces de taille équivalente et une quatrième plus étroite
en contrebas d’une crête. Quatre centimètres sur le plus long côté.
Par endroits, le rouge a débordé sur l’anthracite granuleux et l’a en partie teinté.
Quelques éclats blancs disséminés sur les bords grenus.
De quelle déflagration monstrueuse as-tu jailli ? Magma bouillonnant
projeté dans la mer, fulgurante solidification en un crissant refroidissement.
Sur les bords, le rouge s’éclaircit, vire à l’ocre, à l’orangé.
Basalte ou rhyolithe, comment savoir de quels cristaux,
de quels minéraux tu es la concrétion ?
La main sur toi s’est posée mais ne t’a pas façonné. Pourquoi t’avoir choisi plutôt qu’un objet manufacturé ? Chercher les mots qui diraient ta présence, des phrases qui auraient ta densité.
En frottant la surface rouge, le doigt légèrement se colorie.
L’éruption transperce la montagne et tu dévales ses flancs
et son cratère s’effondre et les eaux l’engloutissent.
Soleil vertical, rivage de fragments noirs, trois millénaires plus tard une main t’a ramassé.
Parmi les livres, les carnets, les crayons, les stylos, près de la lampe,
près d’autres pierres, sur le bois du bureau tu attires le regard.
La main sur toi s’est enroulée, elle t’emporte dans les lieux
où sa confiance vacille, tu es son talisman.
La datation K-Ar dirait peut-être ton âge.
C’était bien avant nous, ce sera bien après.
Que ce soit arrivé un jour sans qu’on y ait vraiment réfléchi qu’il était dans le passage vers le lit et qu’en le voyant ce jour là mais on ne sait plus lequel mais ce doit être pourtant un jour bien précis qu’en le voyant peut-être on ait eu peur de marcher dessus glisser ou je ne sais parce que sur le plancher sombre il faisait soudain comme une tâche désagréable parce que je ne sais pas on avait vu le plancher les lattes l’édredon qui coulait du sommier la fenêtre et la matière inquiétante du monde dehors je veux dire qu’on voyait tout ça pour la première fois et dans une lumière pâle et lucide que le passage vers le lit n’était plus la surface de jeu mais morceau minuscule d’une chambre minuscule que ce soit arrivé ce jour là mais on ne sait plus dire quand mais tellement important puisque d’un coup c’est le regard qui changeait d’axe et se posait sur la tâche rouge et immédiatement s’en décollait comme d’avoir réalisé l’extériorité des choses que ce jour là et sans vraiment y réfléchir on l’ait ramassé dans le passage vers le lit et déposé derrière la vitrine coulissante avec le reste des souvenirs d’enfance.
Et comme dans la fabrication du modèle réduit les proportions générales de l’objet sont respectées, non seulement extérieurement, mais jusque dans ses détails les plus inaccessibles, on peut en approchant l’oeil près des ouvertures latérales, du hublot arrière, se sentir aspiré à l’intérieur dans la travée des sièges poussiéreux dans un léger tremblement du sol qu’on oublie quelques secondes durant d’imputer aux inévitables mouvements oculaires et je ne dirais pas qu’on ait l’impression d’être réellement à l’intérieur mais le regard rétréci ne rencontre dans les choses rien qui heurte la notion qu’il a de leur proportions, du rapport par exemple entre la hauteur des dossiers et la longueur de l’assise, entre le plancher et l’élévation des sièges, ou la largeur des fenêtres, qu’en le promenant devant soi on a de la pièce morcelée et sur elle une vision et un point de vue radicalement différents du fait d’abord que les barres verticales des fenêtres en divisent la continuité en images discrètes, et parce que le bus est arrêté peut-être pour de bon au sommet d’une de ces montagnes de carcasses limitrophes à la ville, en images immobiles, ou chaque objet est une architecture étrange, et qui habiterait ce bloc dont la façade vitrée s’ouvre, une horloge numérique incrustée dans la paroi ? et à quoi pouvaient bien servir ces puits transparents qui dépassaient du sol si étroits à leur sommet ?
Que l’homme qui les fabriquait, du moins au début, avait conservé en dépit de la guerre, de la vieillesse cette faculté qui consistait à réduire son corps à la taille d’un œil puis de le maintenir devant soi aux commandes des objets minuscules. Il pouvait faire cela des heures durant avant que ne s’altère la capacité que le corps réduit avait de sentir contre sa peau la vitesse, le métal froid des portières, et que, faute de concentration, épuisé, avec sans doute des douleurs traversantes dans les jambes et le cou, il retrouvait la table de travail, les outils, le visible étroit.
Le tenant bras replié à cinquante centimètre des yeux, distance qu’en augmentant ou réduisant on perd cette station où l’objet est d’un bloc forme-détails, il y a comme un point fixe dans le langage, je veux dire qu’il doit y avoir dans cette station neutre de l’objet une fixité, une tenue, qui n’impose pas de parler, ou plutôt, parce qu’on a senti que les choses les mieux harnachées au réel sont aussi les plus mystérieuses, qui décourage la parole. Et cette station naturelle de l’objet qui traduit en réalité sa participation au réseau des signes fonctionnels qui passent de lèvres en lèvres comme s’ils étaient fait de gaz instable, de gaz hautement explosif, cette station de l’objet qui traduit le plus petit écart consenti avec sa nomination, c’est à dire la zone où l’on est encore à peu près sûr qu’en parlant on mettra la main sur quelque chose de dur de solide, que pour la même raison on ait plus à le faire, à parler, cette station naturelle de l’objet qui est sa forme totémique il semble qu’elle ne puisse traverser la surface de la langue que pauvre, désuète, fade, à moins de la crever.
Et sur les sièges, de combien de corps peau et ongles en une moitié de siècle la poussière accumulée, et du corps de son possesseur défait refait sans cesse, comme une farine grise avec par endroits des grains plus gros non encore broyés qui font penser à des os désensevelis, qui si on pouvait les en extraire à l’aide d’une pince assez fine, les étaler devant soi, les ausculter raconteraient quoi venu se taire moitié de siècle dans un jouet. Et ce ne sont pas les morts à proprement parler mais leurs mues, mais l’effritement des vivants dont s’est déposée la poudre maigre, rare, semblable à du pollen.
Que l’homme qui les fabriquait avait mis longtemps à trouver dans quel objet recueillir cette poudre maigre, rare, semblable à du pollen. Qu’il n’avait jamais songé auparavant à faire des jouets, étant botaniste de métier. Qu’un jour en visite à Londres, dit-on, il s’était soudain figé devant un de ces bus rouges à double-étage qu’on réserve aujourd’hui aux touristes, qu’il s’était figé près d’une heure là, debout, dans le courant de la foule qu’il séparait en deux, car c’était l’heure des longs-cours à la gare Victoria, qu’il s’était figé près d’une heure là, debout, quels soulèvements de formes de plans de signes lui traversant le crâne en même temps que les sifflets soupapes des locomotives et toute la ville aigüe à l’heure de pointe, qu’il s’était figé, dit-on, soudain, devant les bus rouges qui embarquaient et s’éloignaient, embarquaient et rapetissaient, embarquaient et disparaissaient.
Il y a peu on trouvait encore au bord des villes cette large construction cylindrique, anonyme parmi les excroissances industrielles, silos, réacteurs, cheminées d’usines ; et pour qui n’était pas renseigné on traversait sans la remarquer le paysage morne, le paysage plaqué contre l’autoroute. Puis les nouvelles techniques d’archivage que l’on sait furent mises au point, des camions équipés de sonars, d’appareils photographiques de précision parcouraient la ville et la mémorisaient ; on dispersa les collections. Mais alors, quelle impression lorsqu’on entrait, voir ces immenses plateaux des villes minuscules qui s’étalonnaient sur vingt étages, dix au moins s’enfonçant sous le sol, à l’éclairage artificiel des soleils de verre et de tungstène, et c’était la même ville, celle qu’on venait de traverser, multipliée, réduite, stratifiée, dont on avait empilé les différentes transformations, jusqu’à ses limites géographiques mouvantes que la forme cylindre du bâtiment modulait par comblements. Exigües et géométriques tout en bas, les pièces s’étalaient en montant, rongeaient dangereusement la paroi. Personne ne pouvait prévoir alors que les villes se propageraient si vite, si loin, si haut, que du dedans même le degré d’entropie ne reviendrait plus au niveau des états stables, des formes coalescentes de l’ancienne géographie. J’ignore ce que sont devenues ces constructions cylindriques. Nombre d’entre elles sans doute se seront écroulées. Il m’arrive encore de jeter un œil aux silos et cheminées d’usines, par delà les panneaux anti-bruits, mais comment faire la différence.
Au contraire de ce que j’ai d’abord pensé l’odeur d’eau de Cologne n’est pas localisé au seul ruban autocollant, et certes elle y est plus dense le papier s’étant gorgé plus vite mais aussi moins subtile, non elle s’est infiltrée sous la couche de vernis, dans la peinture, et peut-être même, ce que je n’aurais pas cru possible, à l’intérieur des fibres du métal, en tous cas assez profond qu’à le manipuler depuis des jours la contagion des mains n’a pas suffit à l’en faire partir, et même tiens si je frotte un peu longtemps du doigt un coin de la carlingue toujours pas, c’est dedans, de l’eau de Cologne pourtant bon marché, et par ailleurs aucune trace de lutte avec le métal, rouille ou brûlure, rien qui dise que c’est dedans, que c’est entré ; qu’il ait eu ou non au sortir de l’atelier une odeur qui lui soit propre, étain fondu, solvant, air chargé du box de stockage, celle-ci l’a remplacée pour de bon, on ne pourra plus remonter son origine par cette voie là qui aboutit sans faute à une chambre confinée avec salle d’eau attenante.

Étant donné l’objet, le décrire tant son existence est primordiale. Sa longue tige coupée par une corole se ponctue d’un bouton-poussoir, il faut bien actionner les trois crochets de la pince à l’autre bout. La corole surprend par son inutilité, la pince n’en a peut-être pas besoin, mais elle y gagne en élégance. Cette même élégance orne les crochets de vaguelettes. Invitation à la finesse, au raffinement. C’était l’objet des dimanches, de quand il y avait de la compagnie. Plongée dans le sucrier, elle ne ménageait pas ses effets, la pince à sucre, relevant d’un imaginaire hors classe. Il ne s’agissait pas de faire comme les bourgeois, dont les habitudes étaient certes autres et hors de portée, mais d’imaginer un faire autrement, sortir du tous les jours.
Sortie du tous les jours, objet des grandes occasions, la pince illumine les regards des petits-enfants. « Mamie, tu me la donneras, un jour ? » « Non, à moi ! » Alors comment la promettre à l’un, ou à l’autre, tant l’envie se répand. Surtout chez les garçons, les plus jeunes des petits-enfants. Le mécanisme les fascine, vous poussez, vous attrapez un morceau de sucre, vous le laissez retomber dans la tasse, puis un autre, ils entraineraient vers le diabète tous les adultes qui les entourent en sucrant à l’infini leurs tasses de café ou de thé. Benjamins de la tribu, ils osent revendiquer une propriété qu’aucun de leurs parents n’aurait osé s’attribuer. C’est l’objet de la famille, intouchable, non déplaçable, il n’a pas de sens hors du buffet de la salle à manger de la grand-mère. Objet transitionnel, il dit l’attachement et les places dans la famille. Objet bon marché, que l’on pourrait remplacer si l’on voulait, sa valeur ne se tire que de l’imaginaire familial.
La construction du mythe familial suppose l’objet. Sa tige est coupée par une fleur à huit pétales qui retient les doigts quand vous actionnez le poussoir. La fleur aurait pu terminer la tige. Et au premier abord, elle ne vous parait pas essentielle, vous avez vu les deux extrémités, le bouton-poussoir et la pince. Mais essayez de la prendre en main, sans la fleur judicieusement posée à deux centimètres du bord, essayez toujours de pousser, le bouton vous reste en main, ça bloque, vous avez besoin d’une prise, d’un frein pour que ça ne vous échappe pas. La pince coince les morceaux de sucre, un normalement, mais vous pouvez aller jusqu’à deux, les enfants l’ont tous fait, essayé de faire tenir le deuxième morceau. Tenter, non pas l’impossible, on y arrive bien, mais l’inattendu, l’imprévu. Et s’inscrire dans le mythe familial, la réunion de tous, les premiers nés, les derniers, qui rassemble dans ses crochets les grands écarts respectés par les générations de familles nombreuses, selon les critères en vigueur.
Mais ce n’est pas une pince à sucre, c’est une pince à glace ! Qui a le premier prononcé cette phrase sacrilège ? Et quand ? Nul ne le sait, l’épisode a été vite balayé, bien sûr que c’est une pince à sucre, une pince crabe, attestée par tous les spécialistes en arts de la table et orfèvres de tous bords. Parfois présentée dans son double usage, pince à sucre ou à glaçons, elle est devenue l’objet vintage par excellence ; si elle se vend encore neuve, la tendance veut qu’on l’achète d’occasion, chargée du poids de l’histoire. Car, qui voudrait aujourd’hui une pince à sucre pour un usage immédiat, qui aurait encore l’idée de l’utiliser ? La fascination exercée sur les plus jeunes de la famille a forcément à voir avec la conscience d’un geste suranné relégué par la mode au niveau du port de la canne pour les hommes et du chapeau pour les femmes. Ne nous y trompons pas, la pince à sucre n’était ni plus, ni moins utile qu’elle ne pourrait l’être de nos jours. Sa motivation ne pouvait être purement pragmatique, il est plus facile de prendre un morceau de sucre avec les doigts qu’avec une pince ; était-elle hygiénique, ne pas toucher le contenu du sucrier avec des doigts éventuellement pas très nets ? Il n’est pourtant pas évident que nous ayons les mains plus propres aujourd’hui qu’alors. Prenons-nous moins de sucre avec le café ou le thé ? Certainement. Entre ceux qui se sont habitués aux breuvages sans sucre, pour conserver leur gout original, et ceux qui se sont convertis aux sucrettes, se donnant ainsi bonne conscience pour ne pas se priver du dessert dix fois plus sucré que le morceau de sucre lâchement délaissé, l’usage du sucrier périclite.
Le sucrier français est une rareté. Du sucre, vous en trouvez partout. Mais qui a adopté, et conservé, cette habitude du sucre en pierre, ces petits parallélépipèdes d’une blancheur immaculée qui ne cessent de surprendre les étrangers ? Évidemment, les modes grignotent, les cafés branchés proposent du sucre en poudre dans ces longues buchettes en papier, les écolobobos ne jurent que par le sucre brun en carrés irréguliers ; mais qu’est-ce qui marque mieux la France que la pierre de sucre ? Quand vous aurez vu un Espagnol tourner autour d’un buffet pendant cinq minutes alors que le sucre est sous son nez, vous comprendrez que, s’il connait peu la France, il ait du mal à se résoudre à plonger dans son café ces morceaux blancs difficilement identifiables. Et quand vous lui aurez dit, voire expliqué, que c’est du sucre, il n’en restera pas moins perplexe, comment du sucre peut-il prendre cette forme solide quand vous ne l’avez connu, jusque-là, que comme une poudre plus ou moins fine ou grossière, mais une poudre, pas des pierres ! De grâce, alors qu’il tente d’attraper son sucre avec une cuillère, n’allez pas jusqu’à lui parler de la pince, il frôlerait l’attaque ! Gageons que, même s’ils sucrent de moins en moins, les Français ne sont pas près de renoncer à ces petits morceaux, partie prenante de la liste de leurs péchés mignons.
Duchamp aurait pu en faire un ready made, non un objet d’art mais un regard, un objet qui devient de l’art par le regard de l’artiste, qu’il fait porter sur un objet au demeurant très commun. La pince à sucre, notre pince à sucre, aurait-elle pu être le porte-bouteille ou l’urinoir ? Pour Duchamp peut-être, pour nous non. La relation que la famille entretenait avec elle, et qu’elle entretient probablement toujours par la pensée, n’a rien à voir avec l’art, il ne s’est jamais agi pour nous de lui donner plus de valeur que celle qu’elle avait intrinsèquement, la valeur qui nous intéressait était celle de son usage, attraper les morceaux de sucre un à un, ou au plus deux par deux, et celle de sa fonction, nous rassembler, tous. Ce qu’elle continue à faire. Du fond de son tiroir, elle observe, se cache, guette le moment propice pour se rappeler à notre souvenir. Trans et intergénérationnelle, elle n’a rien de ces objets du quotidien qui vous encombrent, que vous essayez de recaser. Elle sait se faire oublier. Longtemps. Mais essayez d’évoquer le sujet, disons plutôt l’objet, et vous verrez les yeux briller, les langues se délier, les questions surgir : « Mais au fait, elle est où, maintenant, la pince à sucre ? »
Poli d’origine, le corps inoxydable brille. Il brille de tous ses feux, il brille par sa présence, par son absence… Poli par tant de doigts habiles ou malhabiles, il se voit danseuse en tutu manœuvrée avec grâce, il se rêve carlingue effilée traçant l’air, il se sent pilier du récit familial. Que jamais l’oubli ne vienne ! Un tel corps ne peut se flétrir, le temps n’a pas prise sur lui, c’est de là qu’il tire sa supériorité sur ses propriétaires, disons plutôt ses possesseurs puisque aucun acte de propriété n’a pu être établi. Oh, il ne joue pas de sa superbe, il accepte de somnoler, de disparaitre, de se faire oublier, momentanément, faisant le modeste. Il lui suffit d’attendre. Attendre la question qui ne manque jamais : « Mais au fait, elle est où, maintenant, la pince à sucre ? »
1) C’est un fin bâtonnet rectiligne, plus ou moins modulé selon les marques, dont l’extrémité soudain s’affine et se replie sur elle-même. La flexion elle-même possède quelque chose de contrit et de menaçant. De profil, on dirait un cheval de parade, de face, une lance africaine.
2) L’outil est beau, poli sous tout les angles, il épouse la main sans a coup. La tige est légèrement rabotée sur deux faces. Sur la face avant, fronton majuscule, on lit le mot PHILDAR (boutiques de province désertes, laines trop chères). Face arrière, l’industrieuse lira l’indispensable nombre décimal garantissant le bien fondé de son choix technique (ici : 6,0).
3) Contrairement aux aiguilles à tricoter qui se promènent en double, sont impossibles à ranger, difficiles à manier, qui à l’usage fatiguent les bras et crispent le dos, le crochet n’engage que la main. Les seuls mouvements requis sont une douce rotation du poignet et une oscillation, verticale et régulière. Le geste est lié, souple, menu (loin des hoquets cathartiques du tricot). C’est reposant, une berceuse, ça ronronne. Et inexorablement le fil se dévide, les mailles s’accumulent et s’entr’accrochent, alternant la raideur des nœuds et des brèches franches (bride, double bride, maille serrée). L’ouvrage monte comme un régiment d’infanterie. Efficacité de cette petite chose si vite rangée.
4) « Grosse aiguille, tige de métal, de bois, d’ivoire dont une extrémité est recourbée pour accrocher la laine, le fil, en vue de permettre l’exécution d’ouvrages de couture. » Trésor de la langue française informatisé.
5) En bois, en plastique, en métal. Artisanal, industriel, unique, de série. Colorés, bariolés, neutres. De 0,5 à 20 millimètres. De moins d’un euros à plus de quatre-vingt pour les étuis de luxe. Le tout est de trouver le sien. La chose est d’importance, rien de plus pénible qu’un crochet qu’on ne sente pas (il est des crochets comme des crayons et des tournevis).
6) Neutre. Gris argent métal. Outil chirurgical, mécanique, ciseau du sculpteur. Rigueur et industrie. Pas de frivolités (en matière de fils et de points, tout est permis : textures, couleurs, palanquées de nœuds, mailles en pagaille, excès des brides, outrances des jours).
7) Le temps. Le fil. Le crochet. Et tirer d’un objet si petit une couverture. Outil d’ampleur et de précision.
8) J’aime le poids du métal qui lestant la main, amplifie le geste. Nulle aspérité ou la laine s’accroche agaçant l’ouvrière, musique des mailles, souple et sans à coup.
9) Dans la pochette du sac à main, il s’aligne avec deux ou trois de ses semblables. Sourire intérieur. Le crochet comme farce sagement rangé près du smartphone. Il fait briller les yeux des aïeules dans les salles d’attente. Tout l’or du monde.
10) Les crochets se reconnaissent et se classent avec des nombres, comme les clefs Allen et les joueurs de foot. Sauf que le vice est poussé jusqu’à l’emploi de la décimale, achevant de perdre dans la mercerie la néophyte en quête d’instrument. Au début, le plus souvent, il suffit de se laisser guider par les instructions inscrites sur la bande de papier ceinturant la pelote. Le temps passe et c’est plus compliqué : le calibre choisit variera sensiblement selon le fil donc, mais aussi l’ouvrage à venir, les habitudes et l’habileté de l’acheteuse.
11) A la gare, chez le médecin, dans le train, en attendant la fin d’une averse, sur le canapé, chez l’étiopathe, la sage-femme ou le dentiste, en écoutant la radio, sur Instagram, à la banque, dans mon lit, au soleil, sous un porche de cathédrale, pendant le journal télévisé, en surfant sur le net, la nuit, au bord d’une rivière, pendant qu’un plat cuit au four, en téléphonant. Partout, tout le temps (un peu comme les livres)
12) Crochet en métal PHILDAR, taille 6,0, valeur 1,5€ (non négociée). Acheté à la Brocante du Fil d’Onet-Le-Château (12000, Aveyron), le dimanche de la Pentecôte, sur le stand (situé près de la porte du gymnase) de Madame Z... , 57 ans environ, charmante mais dure en affaire, au sein d’un lot comprenant neuf pelotes de mohair, un autre crochet taille 3,5, deux passe-laines et plusieurs modèles de napperons un peu ringards que j’ai pris pour lui faire plaisir.
13) La laine : n°4 ou 6 et nombres supérieurs.
Fil de coton : du n°4 au n°3, selon le fil, l’ouvrière, et l’effet désiré.
Dentelle, fil fin : petits calibres (pas mon domaine car pas la patience et myope de surcroît)
14) « Ah le point de pensée ! Et j’en ai fait des napperons... Ma pauvre maintenant avec mon arthrite. Une jeune comme vous, c’est drôle. Une paire de chaussons, c’est une bonne idée (et c’est pour quand au fait ?) Montrez un peu voir... Moi, je serai vous, j’aurai tout recommencé. »

On dirait une petite tour Eiffel sur du sable avec un soleil bleu de 630 lumens à sa gauche. Six cent trente c’est beaucoup, autant de triangles solides et de candelas.
En haut à droite une égalité approximative 42 serait près de 60.
Ça fait de la lumière et on lui demande beaucoup à la lumière, guider notre esprit, éclairer nos origines, nous régénérer, s’identifier au verbe, vrai lumière… En plus elle est vieille la lumière, c’est le premier truc qu’a créé Dieu. On lui demande beaucoup de choses, c’est pour ça qu’elle va vite, t’as intérêt à bien prévoir ta question avant qu’elle passe.
L’aire du verso
Beaucoup de texte et quelques logos intéressants. D’abord les fondamentaux : 42 sont presque égaux à 60, comme au recto, nous voilà rassurés. La lumière brillante (les ternes ne sont pas encore en vente) va durer 2000H soit 83 à 84 jours. Ce n’est pas énorme. Quand une ampoule meurt, souvent lorsque l’on l’allume, on a tendance à penser que l’on s’est mal servi de l’interrupteur (trop vite trop fort ou au contraire après une hésitation). Finalement elle meurt parce que c’est son heure. Arrêtons de culpabiliser.
RoHS compliant : En Européen veut dire « contient des cochonneries en quantité conforme aux normes des cochonneries »
Il ne faut pas mettre l’ampoule usagée à la poubelle (cf point 6). Qu’en faire ? L’incinération est possible.
La lumière est dimmable, c’est-à-dire sujette à des variations, rien n’est immuable.
2700 Kelvin. Avant Kelvin, au paradis, l’eau gelait à 0° et bouillait à 100°, juste et parfait. Mais voilà où amène la soif de connaissance, sous l’influence de Kelvin, ce zéro absolu, tout est décalé vers le bas de 273,15 unités sous prétexte qu’à moins 273,15° rien ne bouge.
Un vrai serpent ce Kelvin !
Le logo suivant nous indique qu’il ne faut pas toucher l’ampoule avec les doigts et le suivant que l’on doit utiliser un chiffon. En effet, sous l’influence de la chaleur, les impuretés des doigts peuvent infiltrer la silice constituant l’enveloppe de l’ampoule et la rendre moins résistante à la flamme de la lumière. Voici le monde où nous vivons : les impuretés du corps s’opposent à la divine lumière, mais nous avons des torchons.
Mention UV block : tu peux pas bronzer sous une ampoule halogène
Le dernier logo, le symbole Hg barré nous rappelle qu’aujourd’hui la mythologie romaine n’a plus court, le messager des Dieux, Dieu des voleurs, du commerce n’existe plus. Il est remplacé par la 17e colonne.
Sous les logos, la mention « made in PRC », ce n’est pas un matériau mais la Popular Republic of China.
Quant au logo représentant une lumière dans un triangle, il est là pour nous rappeler que ce sont bien les Illuminati qui dirigent le monde.
Dans l’une des deux vitrines de la bijouterie familiale, sont exposées des montres de toutes formes, de toutes sortes, en argent, en or, rondes, ovales, rectangulaires et leurs bracelets de cuir, d’inox. Les LIP tiennent la vedette et la fillette les admire, fascinée par le temps qui s’écoule d’elles. Il diffère de l’une à l’autre. Elle s’interroge : quelle montre détient la vraie heure, la vraie ?
Dans l’atelier, son grand-père a coincé un gros lorgnon sur son œil droit de cyclope. Il se penche sur l’établi où gisent des montres fatiguées, à bout de course. Elles espèrent un nouveau remontoir ou, plus délicat, que les ressorts, dans leurs entrailles, soient remplacés. La fillette aime regarder les mains aux gestes précis de l’homme qui leur redonne vie, remplaçant leurs verres, jouant avec les pivots, les aiguilles, les poussoirs, les cadrans.
Une montre ronde et fine, au bracelet de cuir blanc, lui a été offert pour sa communion solennelle. Un cadeau inouï, merveilleux, comme une entrée dans le monde des adultes, cette montre à son poignet qui tic-taque doucement.
Cette montre fidèle l’accompagne dans l’épreuve de français du bac. Son bracelet a été remplacé ; usé, il serrait méchamment son poignet. Le nouveau, vert tendre, elle lui trouve du charme. Pour lui, elle a retenu ses longs cheveux par un ruban de sa couleur. Fébrile, elle lorgne en permanence l’avancée des aiguilles, la trotteuse la fascine. S’accorder à son rythme pour écrire.
Même montre fidèle : le cadran présente deux fines rayures – il faut dire, elle ne la quitte jamais. Fébrile, elle déplore l’avancée rapide des aiguilles. Elle supplie : arrête-toi, petite... Elle le sait, son amoureux ne viendra plus.
Une Rolex, voilà la montre qu’il convient d’avoir. C’est ce que lui a dit l’homme de sa vie en la lui offrant. Faut dire, elle rutile de mille feux, s’orne de multiples cadrans, elle éclaire la nuit. « Si à cinquante ans t’as pas une Rolex, t’as raté ta vie. » C’est ce qu’il a certifié Ségala en 2009 ! ce connard ! Elle a quitté à regret sa petite montre timide pour celle-là, signe extérieur de réussite.
Dans sa main, comme dans un nid, la montre à gousset de son grand-père l’horloger, la chaîne d’or qui barrait sa poitrine. Un trésor est caché sous le couvercle arrière. Une photo de sa grand-mère, si jeune, sourire éclatant sous sa chevelure moussue. Et une date gravée, celle de leur mariage.
Dans sa main, celle-ci se cache sous son couvercle orné de fines roses et de perles, cette autre est chronomètre, avec au bout de sa chaîne une petite médaille patinée par le temps, sans doute un saint Christophe. Celle-là, sur son cadran émaillé, donne l’heure : gros chiffres bleu en italique à l’intérieur de une heure à douze heures, petits chiffres rouges et gras à l’extérieur de treize heures à vingt quatre heures. Elles font toutes partie de son héritage : les voici exposées sur les rayons de sa bibliothèque, le début d’une collection qu’elle poursuivra avec ténacité ; en l’honneur de Louis.
Branle-bas de combat : la Rolex a disparu. Comment le dire à l’autre qui sera furieux ? Vraiment, aller à la plage avec cette merveille précieuse, la laisser dans ton sac pour te baigner, quelle stupidité ! Non, mais tu perds la tête ! Rolex, tu es annonciatrice de jours difficiles. Bientôt le divorce.
Montres en révolte. Les ouvrières de LIP occupent l’usine, elles refusent sa fermeture, elles vendent les montres qu’elles se sont mises à fabriquer en auto-gestion. LIP , un nom qui sonne dans sa mémoire de militante, ces pétitions qu’elle a signées et fait signer, les réunions auxquelles elle a participé, la LIP qu’elle exhibait fièrement à son poignet. Surgissement du passé à partir d’un mot qui sonne haut et clair. N’était-il pas logique qu’une petite fille d’horloger participe, au moins par pétitions et réunions, à la lutte des petites LIP ?
Dans sa boite aux lettres, ce matin-là, un paquet, vite l’ouvrir : un écrin très simple contient une montre, ronde, chiffres bien dessinés, aiguilles fines, bracelet de cuir noir. Elle vérifie, pas un mot, aucune trace d’un quelconque expéditeur. Juste Elle, souveraine, aimée dans l’instant, qui ne la quittera plus, c’est juré. Et s’entrouvrent pour elle des pans entiers d’une mémoire qu’elle croyait perdue.. « Une montre LIP, c’est une montre LIP ! »
Quelques années plus tard, elle rend l’âme, elle s’arrête, refuse de scander le temps. A bout de souffle, irréparable, lui dit-on. Elle aura une place d’honneur dans sa bibliothèque.
Coïncidence, elle s’est arrêtée quelques jours avant sa retraite à elle. C’est fini, plus de montre à son poignet. Adieu aux horaires rigides, rendez-vous contraignants, plannings stressants, nuits blanches quand ça débloque au boulot, réveil qui sonne trop tôt, toujours trop tôt, au beau milieu d’un rêve bleu. Devant elle, s’ouvre une nouvelle vie au rythme du soleil et de ses envies.
Dans les rayons de Décathlon, est présentée une montre carrossée de plastique vert et violet, pas vraiment belle, mais drôle ; pour les jeunes, c’est certain. Quinze euros ! Sacré coup de cœur, elle flashe sur elle, l’emporte. Géonaute - c’est son nom – se prélasse sur son poignet, prête à chaque seconde à donner l’heure exacte. Là, maintenant, tout de suite, il est 16 h 38 minutes 15 secondes.
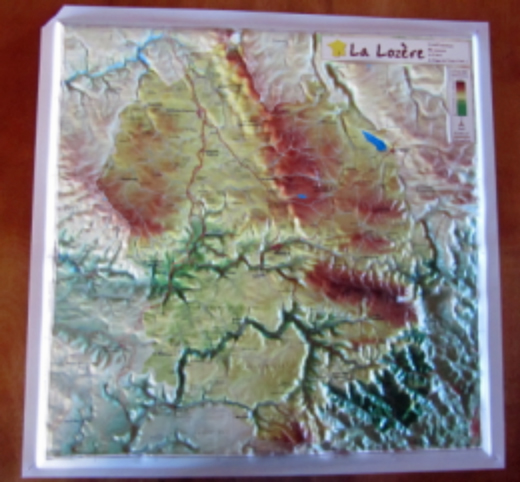
1/ C’est un carré de plastique coloré de 32 cm de côté à la bordure légèrement jaunie. De minuscules trous situés aux quatre coins rappellent qu’il a été punaisé sur le mur du couloir pendant de longues années, un angle est désormais cassé sans doute lorsqu’il a été ôté du mur lors des réparations il y a quelques mois. De la poussière s’est insinuée sur toute sa surface qui nécessiterait un nettoyage humide. Placé à hauteur du visage dans un lieu de passage, entre rêve et réalité, cela pourrait être une sorte de miroir.
2/ Je n’ai jamais porté d’attention aux inscriptions situées en haut à droite du carré. Soit dit en passant, cela me plaît que ce soit un carré et non un rectangle comme d’autres objets de ce type sont coutumiers. Je n’avais jamais noté avant ce jour le nombre d’habitants ( 73 609 ), celui des communes ( 186 ) sa surface ( 5171 km²) et son sommet ( Signal de Finiels 1701 m ), ni l’échelle indiquée 1 cm pour 5 km. Seul le nom, d’une police plus grosse et plus grasse, inscrit près d’une carte de France jaune ( avec une croix à l’intérieur pour symboliser sa position sur l’hexagone) saute bien évidemment aux yeux.
3/ Ce que j’aime par dessus tout, c’est caresser la peau des reliefs , sentir sous mes doigts les dénivelés , les creux, les boursouflures : rien d’aigu ou de piquant , juste une douceur d’ombre. Les rides de sa surface comme le visage de ces grands oncles ou tantes que je voyais l’été pour une courte visite et dont je retrouve un peu de cette mélancolie dans le toucher de ces formes. Le petit aplat, que je sais bleu, et que mentalement je nomme plage, se laisse dénicher les yeux fermés.
4/ Quatre couleurs essentiellement, emplies de nuances ou de dégradés : vert, jaune, marron et bleu correspondant aux altitudes traversées de 116 à 1702 m selon la légende. C’est un jaune irisé de vert qui semble dominant mais c’est le promontoire marron foncé qui attire l’œil, le mien du moins car je sais là des chemins arpentés, balayés de vent, et de visions à 360 degrés où soudain l’on se sait tout petit et même reconnaissant devant tant de beauté. A ses pieds je sais la pierre et la bruyère.
5/ Revenir à la carte en relief, aux dessins qui se profilent et l’on hésite entre une théière ou une cafetière au long cou pointé vers le Nord, et une cornemuse , j’avoue un peu incongrue dans la région car ici c’est plutôt l’accordéon qui a rythmé les jours. Une sorte d’épine dorsale, non pour interdire l’accès, mais plutôt pour afficher une certaine fierté. Plus au Sud, la forme d’un sanglier peut-être ou tout au moins d’un animal bossu, le museau pointé sur Le Rozier. En creux le point rouge de la préfecture, comme un cœur, un tout petit cœur en amande. Même en cherchant bien, on ne voit pas de visage exceptée cette boursouflure de bouche, ce promontoire sombre, d’où pourraient se délivrer des prophéties anciennes.
6/ On a eu beau retarder de nommer, il faut bien y arriver à la litanie des noms que l’on aime, et passer du Nord au Sud en psalmodiant les noms des villages et des villes que nos pas ont traversés : Paulhac-en-Margeride, Le Malzieu, Saint-Chély d’Apcher, Rimeize, Serverette, Javols, Nasbinals, Marvejols, Chanac, Mende, Le Bleymard, Les Bondons, Le Pont de Montvert, Florac, Barre des Cévennes, Meyrueis…. Et écrivant, se rendre compte qu’il en manque bien sûr, et en rajouter encore et encore à la liste il faudrait….
7/ Se souvenir du comment cette carte m’a été offerte, car c’est le cadeau d’une amie. C’était au mois de novembre, le temps semble plié car je ne sais pas l’année, plusieurs est tout ce qu’il me reste, elle m’avait donné un petit papier dans une enveloppe où il était écrit : « bon pour une carte » sans autre commentaire et je devais me rendre dans la librairie presse de Florac, pour l’échanger contre l’objet que j’ai aujourd’hui sous les yeux ! Sourire à cette pensée, à ce partage d’amitié. La libraire aussi avait souri au procédé et se souvenait de mon amie venue la semaine précédant mon séjour élaborer sa surprise !
8/ Comment s’appelaient ces jeux pour les enfants où il fallait découper avec un poinçon des formes pré-dessinées ? C’est à cela que je pense lorsque je fixe cette sorte d’animal cernée d’un creux profond où l’on sait des gorges, délimitant ce Causse, le Méjan, aimé et arpenté à de nombreuses reprises. On poinçonnerait ainsi le pourtour et la partie détachée s’élèverait, s’envolerait : de toute évidence lorsque l’on est dessus, on se sent sur un nuage et se retrouvent les mots de Julien Gracq évoquant ce lieu : images d’un dépouillement presque spiritualisé du paysage, qui mêlent indissolublement, à l’usage du promeneur, sentiment d’altitude et sentiment d’élévation.
9/ Tourner la carte à l’envers, c’est ainsi qu’est la Lozère pour moi ; elle n’a longtemps été que ce petit hameau de Margeride - le plus au Nord - d’où mon regard s’étendait vers les lointains. Puis les années s’accumulant, j’ai parcouru ses territoires si différents, exploré l’Aubrac, le mont Lozère, les Causses et les Cévennes, sans oublier l’œil bleu de Naussac. Et chaque année encore , je roule sur ces routes à la recherche d’esquilles de souvenirs, le regard écorchant les talus et se faufilant dans les strates de pierre pour dénicher la gangrène du temps.
10/ J’ai toujours aimé les cartes routières que l’on déplie sur une table et sur lesquelles on trace mentalement le voyage qui va être. Je ne suis pas Nicolas Bouvier, mais la contemplation silencieuse d’une carte a toujours été le début du dépaysement. Sur cette carte en relief les nervures vertes, les aplats bruns, les liserés bleus, conjuguent la grammaire de ces paysages de dentellières. Je déambule dans le dessin, ramasse des fragments rescapés de mes anciennes escapades, m’installe dans la douceur de cette parenthèse, suture (ou tout au moins essaie) le passé au présent, emplit les creux de souvenirs argentés. J’entendrais presque les clochers de tourmente appeler le voyageur égaré dans le brouillard.
11/ Affiner la vision et prendre langue dans la sinuosité de ces fins traits bleus qui sillonnent en silence, murmurer leurs noms – la Truyère, la Colagne, le Chapeauroux, la Rimeize, le Bès - ces veines d’eau qui creusent, explorent en pleine jouissance, traversent, révèlent l’image des ombres, coulent et font leur chemin dans le recel des jours, s’épaississent , se séparent, mélangent leurs voix dans un halo, abandonnent des sédiments par-dessus le passé et s’approprient le temps. Les souvenirs s’interpellent, ricochent puis se cachent dans les méandres des mémoires : tout ce qui s’égare cherche un abri.
12/ Entre les strates, oublieux de ce qui nous fait tenir devant, on sait que quelque chose se passe, on sait les langues qui bruissent au coin des mots, on sait les nappes d’ombre encore. Les souvenirs accumulés se délivrent à la simple lecture des noms et ce serait un livre qu’il faudrait écrire où s’emmêleraient la grande et les petites histoires… J’ai de la bruyère plein la tête et le granit griffe mes doigts mais je continue à suivre le chemin du bleu, tentant de ne pas perdre sa trace.
13/ Navigant sur internet comme je rêve sur cette carte, je vois ce qui vient et là ce sont des photos du pic Cassini mises en forme sur le site de désordre.net, et je refais la randonnée , si souvent accomplie. Et même si mes yeux se ferment, je vois. Je vois ces paysages où il est question de disparition puisque ici se perdent des fragments de soi. Ces photos, cette carte, ces mots font rejaillir ce que le temps a effacé, ce quelque chose de l’invisible, ces lointains sursauts de vie.
14/ C’est un musée des souvenirs entravé d’ombres où chaque nom, chaque creux, chaque bosse, chaque veine, gardent les vibrations d’instants, ces suites de ricochets à la surface de la mémoire qui font éclore de petits copeaux de langue où soi-même et un autre se partagent l’espace. Et n’en finirai-je donc jamais de tendre des fils entre temps et espace ?
1– Le galet a roulé sur mon pied, la plage était déserte, il avait plu toute cette nuit, l’air était mouillé, le brouillard cachait la mer, les maisons, tout. Je me penchai, le pris, le regardai, ovale doux, il prenait sa place dans la main, rose et vert sur gris. Je le glissai dans ma poche.
2– Explosions, feu, encore, encore, nous sommes les seuls témoins de cette fusion, dispersion. Après le voyage est long, nous explosons encore, tous ensemble puis séparés, les millions plus loin, plus tard, un choc, rouler en bas, dans l’eau, au fond, noir, rester, rouler, cogner les uns aux autres.
3– L’eau se retire, nous devenons montagnes, roulons encore les uns sur les autres, cassons, nos tranchants naissent, s’estompent dans le vent le temps.
4– Des vies autour, des bêtes, des arbres, nous basculons, roulons en bas, l’eau, une rivière, restons, moitié dans l’eau moitié air.
5– Des pas se font entendre, les bêtes sont nombreuses, elles courent sur leurs quatre pattes, passent sur nous en criant pour aller de l’autre côté de l’eau, d’une terre à l’autre.
6– Soulèvement, rouler encore au bout du monde, basculer ailleurs, stoppé par l’eau, au fond, salée. Rouler, cogner, casser.
7– Les bêtes nagent autour de nous. Certaines sont attrapées par des mains, des filets, des piques qui se plantent parfois en nous, se brisent.
8– Des pieds, un corps debout sur nous, des pas dans l’eau en silence, puis l’eau s’efface, retrouver la lumière, le soleil, le sec.
9– Tant rouler, devenir moins gros à force de casser, rouler les uns aux autres, nous diminuons.
10– L’eau est revenue au-dessus de nous, des gens nagent là-haut, à plat, ils bougent les membres et avancent, plongent vers nous, remontent toujours.
11– L’un s’est posé au fond, sur nous, en silence, il ne bouge plus, les poissons nagent autour de lui, par petits bouts le défont de lui-même.
12– De grandes tempêtes nous ont mélangés encore, le jour au-dessus est parti, le noir occupe tout, dans l’eau, pas le noir de temps d’avant.
13– Tout petit, tout lisse, sortir à nouveau jusqu’au jour et rester à l’entre-deux, mer qui monte nous recouvre, descend nous découvre, soleil, eau, pluie, mer, rouler un peu, s’enfoncer, remonter.
14– Un pied est proche, immobilité dans le brouillard d’un matin froid, l’eau le recouvre presque, il recule un peu. Une petite vague me soulève, me pose sur le pied, on se penche, on me prend dans la main, chaude, rouler là, et dans le sombre de la poche. Plus tard, une planche de bois, oublié là, parfois la main me prend, rouler un peu au creux, reposer sur la planche de bois.
Les objets se succèdent, se rassemblent, utilitaires s’associent ; tables chaises, lits draps, couverts nappes, fringues armoires, voitures papiers ; d’occases, neufs, cassés, usés, abîmés, incongrus, perdus, erratiques par milliers, ils se sont attachés à mes pas ; les survivants m’observent, harassé souvent au retour du taf, poser ma mallette sur la chaise cannée du bureau, aller et venir dans le bureau, ranger un des leurs, le déplacer.
Ils toussotent, chuchotent et même les récents commentent mon allure ; barbe d’une semaine, visage froissé, nouvelles pompes achetées Rue de Rivoli ; ça les scotche les pompes, habitués qu’ils sont à ne jamais voir qu’un type de chaussure ; du costaud pour le boulot.
Personnages de plomb, plastic, gypse, résine, tissu, tableaux aux murs, sous-verres en vrac au sol, lithographies, sérigraphies, digigraphies, esquisses ; coupes gagnées lors de compétitions de pétanque par et héritées de ma mère, cadre en allumette, pots peints, couteau au manche coloré, dessins, poèmes, lettres d’enfants, de femmes, d’amis, boites en carton, en métal, en bois, en os, petits coffrets fourre-tout, Ogoth sur son piédestal qui tire la gueule, cette chechia qu’il m’arrivait de porter, un collier de fleurs séchées, des plumes ramassées, un bois flotté tordu suspendu au lustre, le fantôme d’un passeport perdu conservé plus de trente ans, (j’y tenais, dedans le tampon de la frontière, la date de mon passage en Iran en 72) une vieille lanterne, des taille-crayons, stylos, porte-mines, plumes, cartouches en pagaille, des dizaines de mètres de CD, de vinyles plus des milliers de livres lus, à lire, oubliés et dans ce temple de papier, trois bouquins particulièrement mais plus que des livres, des évènements.
J’ai appris tôt le détachement et bien que toutes ces formes alignées, posées, abandonnées à la poussière sur des étagères, ces meubles agençant mon espace représentent des situations, des instants, (je connais pour la plupart des livres l’origine, le moment, les circonstances de leur rencontre ainsi que celles de nombreux objets) je maintiens une distance avec l’avoir même si certains articles, à l’instar de ces trois livres, du petit jouet Gorgytoys, (les Beatles in a Yellow Submarine,) s’accompagnent d’anecdotes piquantes, curieuses, ils ne m’appartiennent pas ; sont là, pourraient résider autre part, s’en iront et c’était il y a longtemps, en abandonnant un mouchoir rougi de sang, depuis un an bientôt noué à mon poignet droit, en le balançant au cours de circonstances très particulières dans la cuvette d’un WC, en en tirant la chasse que je me suis libéré de l’attachement aux objets ce qui ne m’empêche nullement de les apprécier, ; souvent davantage pour leur apport affectif, insolite dans mon existence que pour eux même strictement : d’où le peu de valeur monnayable de la plupart et notamment de ceux qui comptent.
Parmi ceux qui comptent, il en est un avec lequel je m’amuse depuis je ne sais plus combien, je dirais toujours bien qu’ici toujours ne semble pas dépasser pas une quarantaine de lunes noires.
Cette objet ne possède aucune valeur marchande, impossible d’acheter fût-ce un carambar avec ; je ne me rappelle plus ni quand, ni où ni comment nous fîmes connaissance mais en plus de ses multiples fonctions, voilà qu’il apparaît au fil des lignes. Ça, je ne l’avais pas remarqué ; tout en pensant à lui, ou elle c’est selon, je n’avais pas pressenti la place qu’il, qu’elle prendrait et lorsque je décidai d’en faire l’objet d’un texte dont l’objet serait un objet, je n’imaginais pas sa métamorphose.
Plutôt que de revenir à ce presque rien dont la description tient en deux, trois mots (d’autres en auraient fait des pages), je devrais raconter sa force étrange, sa puissance, sa banalité et comment je me marre en jouant avec ; finalement c’est un jouet extraordinaire, un jouet d’enfant ; attention à ne pas l’avaler.
Alerte, où donc est passé mon fut ? « Au sale » répond ma femme et je n’ai pas le temps de lui poser la question qu’elle me rassure : « oui, elle, il est là, sur le bureau avec le contenu de tes poches que j’ai vidées ».
Sa couleur noire ? Peut-être mais pas que ; la couleur ne serait pas un élément déterminant dans la curieuse relation que nous entretenons et dans la liste hétéroclite du bazar logeant sous les mêmes tuiles, plusieurs prétendants de choix furent évincés, sans effort, bien que constituant des éléments clés ; des clés, voilà ! ce sont les clés de portes s’étant ouvertes ou dont j’aurais poussé les battants, je l’ignore, mais des clés oui, des souvenirs et que je les égare ou non les portes demeurent larges béantes et ça, c’est l’essentiel et puis des clés, de quoi s’amuser, ouvrir et fermer, se suspendre à la poignée et du pied contre le chambranle donner le départ, c’est cool.
Son logis vient de riper de la poche gauche à la droite et parfois, je me dis que je devrais lui trouver une sœur, un frère blanc cependant, le penser me suffit et qui sait le, la trouverai-je.
Pour l’heure, après avoir séjourné(e) sur la table de travail en compagnie des fiches de frais, après avoir, médité(e) sur un paquet de tabac bleu, elle a rejoint la poche droite du pantalon beige que je porte. Ainsi me suit-elle, de grimpants en grimpants, de poche en poche et parfois je lui fait prendre l’air.
Une clé, c’est une clé toutefois ce n’est pas une clé ordinaire mais une clé, par exemple, comme ce livre « les frontaliers du néant » ou une clé comme une poubelle en fer larguée de six mètres par des noceurs et encaissée, après rebondissement sur une gourde en plastic à quelques centimètres de ma tête, sur le front en haut à droite, une clé comme une caroube qu’un chauffeur de taxi vous offre avant que vous ne preniez le bateau, un clé comme une source, une clé comme une rencontre et là oui, certes une rencontre mais avec quoi ?
Se pose la question de savoir où la placer ; d’évidence dans une poche de pantalon, rarement de veste, de blouson, d’anorak ou d’imperméable ; jamais près du coeur dans celle d’une chemise.
Une poche de devant (en aucun cas de derrière), droite ou gauche ? et combien longtemps dans l’une, combien dans l’autre ? Sa réalité change selon son emplacement, la position de la terre sur l’écliptique, la violence et la fréquence des éruptions solaires ; pendant les orages aussi ; toutes les manifestations climatiques hors normes cependant, j’ignore dans quelle mesure et en quoi ; je sais qu’elle change, c’est tout.
Sa taille idéale permet de l’emmener partout, de l’oublier des jours pour la retrouver juste après avoir remis le jean délaissé lundi dernier ; de l’oublier en marchant, en conduisant, en mangeant, lisant, réfléchissant, de l’oublier très souvent quand, parti à la recherche d’un briquet, d’une clef, de monnaie, d’un papier au fond d’une profonde, soudainement éprouver des doigts sa présence.
Difficile d’exprimer précisément ce qu’elle me procure par contre, si je la tire de son tombeau, la montre à mes enfants et déclare : « qu’avec ça au fond de la poche, un homme ne peut qu’être heureux » là, je pourrais les inquiéter s’ils n’étaient depuis belle lurette vaccinés contre les lubies paternelles ; vraiment fantastique de pouvoir déclamer : « avec ça au fond de la poche, je suis heureux », l’être vraiment et le meilleur, sans je ne serai pas malheureux ; du reste je n’y attache aucune importance vu qu’elle n’en a aucune et cette réflexion risque de lui arracher des larmes pourtant, il m’arrive de et elle le sait mais comment ? oui et comment se fait-il que je sache qu’elle sache ? elle ne peut visiblement savoir et malgré tout quelque chose en elle sait ; ceci m’intrigue, augmente le facteur étrange ; offre des perspectives inenvisageables auparavant dans ma relation ludique au cosmos..
Je la suppose ancienne, très ancienne et nous partageons la même origine ; le néant nous rapproche. Le temps se réfugie, s’allonge en elle pourtant il ne s’agit pas une montre, je n’en porte jamais et vois mal comment loger dans cet objet un système à mesurer la rotation terrestre quotidienne ; son épaisseur ne le permet pas ; sa minceur la fragilise, pas grave, elle est là.
Un œil de chaque coté ; on peut y voir un œil de chaque côté, pratiquement à la même hauteur et sa forme, incrustée de deux petits cercles symétriques en guise d’yeux, (rien à faire avec le miracle de la vue) rappelle celle d’un petit poisson, un discus ; aveugle, elle ne souffre pas de l’obscurité ; taiseuse, elle ne me dit pas tout ainsi je la soupçonne d’avoir beaucoup voyagé ; ça se voit à l’usure, au lissé de sa surface, au silence grave et sombre et fier qu’elle jette, étole miséricordieuse sur les cours sans miracle du désespoir, ça ce voit quand je la regarde, ça se voit dans son refus de porter jugement, ça se voit dans la sobriété, dans le dépouillement de sa réalité et dans la profusion de ses dons.
Parfois je me dis que c’est ma mort que je trimballe, qu’elle est précieuse, que je ne dois pas la perdre et ça m’amuse de jouer avec ; ça m’amuse de la savoir dans ma poche non pas à ma merci mais plutôt comme une clé dont j’aurais ouvert la porte pour voir si j’y étais et vu que je n’y étais pas, j’en suis revenu et il me resterait le rossignol : la clé de la porte des morts ; je devrais en principe,« cf la symbolique pour les nuls » la glisser dans la poche de gauche et elle y reposait jusqu’à peu ; jusqu’à ce que je pressente, sous le souffle d’une dévastation sans écho, non pas la nécessité mais que je ressente l’idée de la changer de nid et de la passer à droite.
Une larme tombée d’un ciel sans fond ; plus de noir, plus de sombre, plus d’obscur, plus de ténébreux, plus d’anthracite, plus de gris plomb, plus de funèbre, plus d’ébène, plus de nuit, plus de cieux en deuil comment dépeindre cette aumône céleste, cet insondable piqueté d’innombrables espérances, noir d’un noir qui n’existe pas ; larme plongée dans le coeur en fusion de la terre ; perle parfaite, luisante, roulant de l’oeil gauche des ténèbres et bien sûr que je devrais (cf la symbolique sans peine) la placer à gauche mais voilà, je suis un fantaisiste et j’aime bouleverser le mauvais ordre des choses ; renverser les situations sur un canapé, retourner les crêpes sur la tranche, bousculer les nombres premiers qu’ils fassent de la place aux derniers, remonter les rivières en descendant le temps, chambouler les bourses, souffler le chaos dans les turbines bien-pensantes, désarçonner la productivité, virer la poussière neurologique, désarticuler la pensée, secouer les puces du soleil et déclencher des pluies torrentielles, ce genre de petite choses que l’on peut faire de sa cuisine tout en pensant à acheter des ampoules avec les saucisses et les biscuits bleus, ce genre de trucs auxquels on pense ou plutôt qu’elle suggère parmi tant.
A quoi tient de vivre ; la clé de la porte des morts, la larme d’un ciel sans fond, un éclat des tables de la loi, un bout de pierre de dragon, un morceau d’une ayant lapidé Étienne, une brisure du phare d’Alexandrie, de tablette atlante ; quelque chose d’une étoile, d’un astéroïde, une fenêtre sur l’univers, un œil sur l’immensité, une tranche de pierre philosophale ; l’esquille détachée lorsque Moïse frappa le rocher de son bâton et qu’une source en jaillit ; un débris du trône de Satan remonté par le Christ lors de sa visite aux enfers, une minuscule parcelle de la voie lactée, noircie, brûlée dans les entrailles en fusion du noyau planétaire, très peu de la cornée fossilisée d’un cyclope de première génération, une rognure d’ongle luciférienne, un lambeau du futur, ce qui reste du collier que portait Ève au sortir de l’Éden, une écornure du tombeau de la mort, un fragment de la fontaine de jouvence, une lame du roc sur lequel le Christ entreprit de bâtir, une miette d’une des caillasses qu’il n’a pas transformées en pain, ça, tient à tout et à rien de vivre ; une petite pierre plate pour de mystérieuses raisons m’enchante, me procure un indéfinissable bonheur.
A commencer par les jeux absurdes qu’elle induit en raison de son insignifiance ; un caillou lisse et plat comme on en trouve des myriades sur terre, ordinaire, banal à pisser dessus sans le remarquer, supplante à mon regard et ça dure, par quelle grâce je l’ignore, tous les objets en consigne sous le toit familial ; il me plait à penser que s’il ne me restait plus que ce schiste en poche, je serais heureux et j’aime l’idée d’être heureux avec pour seul bien une petite pierre plate, un prêt du ciel qui suffirait à combler, régénérer mes jours et surcroît d’abondance j’aurais écris sous son inspiration.
Nul besoin d’images, de supports, d’objets spécifiques permettant de passer le Styx ; j’emprunte le pont comme beaucoup maintenant ; c’est gratos et ça fonctionne dans les deux sens ; Charron râle ; de toute façon il était débordé, les rives dégueulaient de voyageurs, pire qu’aux époques de grandes vendanges où ça coulait, ça coulait, ça coulait, des flots et des flots ininterrompus de morts mais après la Grosse Affluence il a fallu construire enfin, tout ça c’est de l’histoire ancienne, donc j’emprunte le pont ; je m’y arrête contempler les furies bouillonnantes, les lambeaux de chair liquide, les visages dans les remous et l’horreur m’accompagne jusqu’aux berges du Léthé ; je ne devrais pas m’arrêter, ne pas approcher du parapet ; comme tout le monde ! vite à l’autre bout mais le spectacle désole, glace, capte, fascine, dévore ; rien à voir avec le fleuve de l’oubli que je traverse à gué et à ce propos, je voudrais préciser ; on boit certes de son eau mais au retour ; un petit poste en aval de Pordémonium et jamais je ne manque, dans la lente complainte du fleuve la mémoire des disparus ah mais où ? oui, où ? oh, un jour viendra pour sûr mais pas la première fois.
La première fois, on avance, on suit, on va là où l’on nous dit d’aller, qui on ? ils n’ont pas de nom on dit on pour eux et l’on va ; au second, troisième, quatrième passage, certains paysages, vallons, rivières se laissent reconnaître ; une très grande colline à forte pente qu’il faut gravir nu et là, on se souvient, en haut, juste à la jonction oui, à cet endroit enfin, tout ce foin pour une petite pierre plate de rien du tout au fond de la poche du futal d’un allumé ; c’est bizarre les cailloux, une pierre plate, un galet aurait écrit Francis Ponge.
Le jour se lève, il est cinq heures, Paris s’éveille, le galet dort dans ma poche, un amour dans la chambre d’à côté rêve de résurrection, je vais le rejoindre.
Allurupteur, stopupteur, générupteur, interrupteur allumant, éteignant, selon que le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Les mots, les mots qui les a choisis, au départ ?
L’effleurer à peine, souvent. L’interrupteur est sale, souvent. Se laver les mains, tout le temps.
La baguette magique convoque la fée électricité, elle n’est ni une baguette, ni magique, c’est l’interrupteur.
Il était une fois, un jour, ils éteignirent tous les interrupteurs, tous. Le chaos s’installa en un jour, partout. L’ombre avait gagné et avec elle, les marchands de bougies.
Morceau de plastique, porcelaine, bois précieux, ancien, design, carré, rond, blanc, argenté, noir, modeste ou rutilant. L’interrupteur, petit bout des gouts, reflet d’un monde, dérisoire.
Nul n’est parfait, pas même l‘interrupteur.
Souvenir de mon grand-père faisant la chasse aux interrupteurs allumés. Il avait un rapport de méfiance avec les objets modernes. Il appelait la machine à laver « l’usine » et ne répondait jamais au téléphone. Mais c’est Versailles ici !
Interrupteur : appareil de connexion électrique, permettant d’établir, de supporter et d’interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, ainsi que de supporter, pendant une durée spécifiée, des courants dans des conditions anormales spécifiées (court-circuit). Larousse de la langue française.
Souvenir d’un documentaire ; en Afrique, un groupe de personnes suivaient un cours de « modernité ». Apprendre à ouvrir/fermer une porte, une fenêtre et à allumer/éteindre la lumière. Jour ! Nuit !
Débat moral autour de l’interrupteur. Par quels moyens fabrique-t-on l’électricité ? Curieusement, c’est avec la même technologie que nous accédons au confort ou que nous pouvons anéantir le monde. Deux polarités existent dans tout, partout.
L’interrupteur comme choix d’objet pour une consigne d’un atelier d’écriture, est-ce une bonne idée ?
L’objet interrupteur devient peu à peu obsolète. On peut frapper dans ses mains, crier : « allume-toi ! », utiliser son téléphone ou sa télécommande. Dieu merci, mon grand-père n’est plus de ce monde, il serait devenu fou.
Un interrupteur est-il vivant ? On dit que dans les maisons hantées, les lumières peuvent s’allumer toutes seules.
Parfois j’aimerais avoir un interrupteur, là, derrière l’oreille pour arrêter les pensées.
moleskine
nom féminin
(anglais moleskin, de mole, taupe, et skin, peau)
– Étoffe de coton lustré, que l’on employait autrefois pour faire des doublures de vêtements.
- Toile vernie imitant le maroquin ou le cuir, constituée par une étoffe recouverte d’un enduit et d’un vernis. (Elle est utilisée en gainerie et en reliure.)
Il existait déjà au XIX éme siècle, dit-on dans le dépliant publicitaire faisant office de mode d’emploi, mais la marque semble avoir été crée et déposée en 1997, par un éditeur milanais, sous le nom de Moleskine ®, en référence aux angles arrondis des coins, à l’élastique qui retient les pages et à la pochette interne.
Longueur 21 cm, largeur 13 cm, épaisseur 2 cm.
Pas bien complètement plat à cause des choses qui sont dedans, arrondissant un peu la couverture par un petit renflement. Le signet est un peu effiloché au bout. Le cordon de l’élastique est strié.
Poids 394 g. Ne peut varier qu’avec une humidité prolongée et importante, et par la l’ajout ou l’élimination de petits papiers, tickets, cartes de visite, carnets de timbres.
Noir. C’est noir, recto verso dos. Ivoire pour la tranche. Le signet est marron, les pages de la couleur de la tranche.
Des encres différentes couvrent les pages, souvent de la marque Herbin pour les moins courantes, aux noms tarabiscottés puisqu’il ne s’agit pas de dire simplement rouge, noir ou bleu, mais « Lie de thé » ou « larme de cassis ».
On y trouve également des post-it, jaune ou blanc, rose.
Un ticket gris et neige pour un aller-retour au panoramique des Dômes par le train à crémaillère.
Un autocollant bleu ciel du muCEM, n° 08221.
Une partie de l’emballage noir d’un sandwich « Paul » sur lequel apparaît l’étiquette blanche donnant la date limite d’utilisation 17/12/14 13 :16 17/12/14 17:16 .
Une carte de visite violette et verte d’une auberge où nous ne sommes toujours pas allés.
Deux autocollants récupérés sur une boite de cigares offerte par ma fille de retour de voyage, l’un sans doute du magasin « Couleurs des Iles », noir et or, et l’autre prévenant de la nocivité, en noir sur fond blanc « Fumer tue 100% Tabac Fabrique a CUBA ® Vente en France (D.O.M.) » conçu avec un clavier sans accents.
Un petit carton, rouge et noir, découpé sur un emballage comme pense-bête pour un futur cadeau.
Un morceau de papier cadeau qui emballait un livre offert pour mon anniversaire, imitation du motif des cartons à dessins mais où le rouge remplace le vert, avec ce qui ressemble à des taches d’encre noire, avec collée dessus et rosie par transparence une étiquette blanche de la librairie « Le passeur de l’Isle ».
Un post-it rose avec un mot d’amour.
La carte de visite pourpre du restaurant « Le Bouchon » à Gap.
Un post-it jaune avec un nom et un numéro de téléphone.
Un post-it blanc avec les coordonnées du petit hôtel du Col de la Machine, dans le Vercors.
Un bout de papier blanc sur lequel j’avais noté un menu totalement poisson, pour rire, pour une amie qui déteste ça.
Deux post-it accolées, un jaune et un blanc, avec l’adresse d’un ophtalmologiste.
Pour produire, un bruit, un claquement, un son, il faudrait une chute, un lâcher d’élastique abrupt, un défilement rapide des pages.
Ne sentir que l’odeur d’un faux cuir, l’imaginer puisqu’elle n’existe pas.
N’est pas à goûter, à manger, et passer sa langue sur l’imitation peau est déplaisant à la langue et n’est pas un plaisir au palais.
Ouvert le 22 Juillet 2014 , utilisé pour moitié jusqu’à ce jour, 19 Juillet 2016, alors que le précédent était plein en à peine une année.
Débuté sur les hauts de Clermont-Ferrand, a poursuivi sa fonction au Puy de Dôme, puis à Rennes, St Malo, Ploumanach, Perros-Guirrec, St Bonnay de Tronçais, Gordes, Fontaine de Vaucluse, Lyon, Villeurbanne, Marseille, Impéria, Florence, San Giminiano, Brignais, Forcalquier, Le mans, Lamballe, Val-André, Carpentras, Vedène, Avignon, Aix-en-Provence, Isle sur la Sorgue, Sigoyer, Gap, Genève, Dinard, Ile de Bréhat, Montpellier, Reillane, St Bonnet en Champsaur, Chateauneuf de Gadagne, St Donan, Anduze, Uzes, Cancale, Cluny, Javéa ou Xabia, Cadaques, Lisbonne, Cascais, St jean en Royan, Roussillon, Les Baux de Provence, Le Grau du Roi, Cucuron, St remy de Provence, Porto Vecchio, Lecci, Bonnifacio, Zonza, Arles.
Des gens apparaissent. Des amis, des proches, de la famille, des connaissances, des gens de la vraie vie comme Patricia S., Véronique, Sylvie et Fred, Lucie, une princesse, Kamal, Ma Grande, Lisa, son fils, Nadine, Peggy, Guy, une jeune femme tunisienne, Maman, Papa, Dominique, Marion, la jeune letonne, une mamie, des spectateurs, Arnaud, les enfants, un chef de rang, les filles, le photographe, le cuisinier, Babeth et Jean-Loup, IL, ELLE,ILS, le patron, le personnel, les gens, LUKA, l’artiste, le monsieur, Jean-Claude, Armelle, Suzanne, Sylvia, le serveur indien, Alain, Charles, Domi, Agathe, Arthur, François, Claude, Patricia C., Pascal et Jeanne, l’ophtalmologiste, Henriette, la bourgeoisie friquée, les patrons, Zébulon, des jeunes, des filles, un sommelier.
Un contenant supplémentaire, avec cette pochette tout à la fin qui doit recevoir de petits papiers, des listes, des petites cartes postales, des billets d’exposition, des étiquettes de fromage, des sous-bock qui seront plus tard utilisés pour des mots intimes, un certificat d’authenticité pour une toile, le dépliant publicitaire faisant office de mode d’emploi de l’objet lui-même.
Comme un disque dur d’un coup inutilisable, sa perte serait une peine, une vraie peine, même si ce texte désormais en est une trace indélébile et que ces énumérations, ces recensements constituent une sorte de consolidation de la mémoire, une entrée dans la nostalgie à venir, en ce cas. Alors, j’en achèterai un autre et je continuerai, je recommencerai.

Le soldat des troupes de la mort, ridicule. La mort blanche, mais sans les dents. Sa silhouette écrasée rend tout organique à l’intérieur de la tête à moins de dix ans. Et au-dessus aussi. Le soldat des troupes de la mort tue le ridicule quand les bonnes mains l’empoignent l’enserrent, le maltraitent, le sous-traitent, l’oublient, l’abandonnent, lui offrent la noirceur puis soulèvent le coffre en bois et le ressuscitent à coups d’inventions et de futurs regrets. Le soldat des troupes de la mort fixe quelque chose qui n’est pas permis, ou qui n’est pas perdu. Le monstre qui l’enserre entre le pouce et l’index n’a que faire de son intégrité morale et physique. La première lui est étrangère, la seconde tant son contour s’englue dans sa masse ludique.
Elles n’ont pas de genoux, les jambes du soldat des troupes de la mort. La marche est difficile, surtout en montagne. Pour le soldat des troupes de la mort, il faut renoncer à l’ascension des monts les plus extraordinaires, renoncer à ces vues splendides et telles que ça m’aurait de toute façon rendu un peu jaloux. Alors pour compenser, le soldat des troupes de la mort, parce qu’il est quand même un peu frustré, tue et détruit tout sur son passage. Les pièces volent dans tous les sens, la montagne s’écoule en cubes rouges, en pavés verts et bleus, en colonnes jaunes qui avaient certainement été stalactites ou stalagmites dans une grotte qu’il est trop tard pour explorer.
Quand le soldat des troupes de la mort vaque parmi les siens, il a du mal à se reconnaître, tant il se ressemble. Ils sont tous nés en même temps, le même jour. Bien sûr, il y en a eu plusieurs séries. Dans ce cas, seules de légères traces d’usure sur les traits saillants du costume peuvent permettre de faire la différence. Cela se voit aussi dans l’effacement des expressions du visage. Le soldat des troupes de la mort qui vieillit ne ride pas. Le reste du corps résiste plus longtemps que le visage.
Sous son casque, le soldat des troupes de la mort souffre terriblement. À l’heure de l’élévation des température, de l’affaiblissement considérable des ressources non renouvelables, son casque est une injure à la bienveillance. S’il reste discret, c’est que les odeurs de transpiration et autres fluidités corporelles sont contenues par le casque. Sans lui son crâne rose et lisse dévoile impudiquement le lien physique qui fait qu’il s’y attache amoureusement. Mais sans lui, il n’est pas plus attachant, il reste un clone dans sa grimace figée.
Tout est immense quand on ne s’occupe pas du soldat des troupes de la mort. Sans un petit coup de pouce, il ne voit que les bas morceaux du monde. C’est pourquoi il a besoin de hauteur, il a besoin d’être pris à plaines mains ou même juste entre deux doigts afin de ne pas se croire si misérable.
La nature du soldat des troupes de la mort le trompe sur ce qu’il s’autorise à faire. Le soldat des troupes de la mort se moque bien de la mort, il croit qu’elle n’a aucune prise sur lui. Sa conscience s’éparpille entre des milliers et des milliers de marionnettistes en culottes courtes. Et s’ils grandissaient tous d’un coup ? Mourrait-il immédiatement ou attendrait-il patiemment le signe d’un nouveau démiurge. Résisterait-il à cette nouvelle apparition ? Voudrait-il encore de lui ? Rien n’est moins sûr tant il est vrai que le propre d’un démiurge est d’être caractériel et capricieux.
Une haine inutile afflige le soldat des troupes de la mort. Son amour-propre, son ego, blessés par une de ces humiliations qui vous conduit un soldat des troupes de la mort dans les doutes les plus profonds, le désespoir le plus brûlant. Son regard furieux est un trompe l’œil, une métaphore discrète, un vide entre deux vitres. Il ne devrait pas enlever son casque, le soldat des troupes de la mort, ou alors ne pas en mettre. Serait-il moins furieux, sans ? S’il n’inspire que la pitié, qu’il le garde et qu’il tue, qu’il désintègre les cadavres plastiques de ses congénères au nom de notre bonne vieille Terre.
Il ne transpire pas, le soldat des troupes de la mort, il ne craint pas le soleil, ne craint pas le feu, ne craint pas la mort. Et pour cause. Quand on lui en parle, il reste froid, de marbre, crispé. Puis de fondre sans en dire plus que les bulles liquides qui se répandent autour de lui.
L’obscurité ne fait pas peur au soldat des troupes de la mort. Il est capable des veiller des jours entiers, des nuits entières, sans battre d’un cil, sans qu’un orteil ne s’engourdisse. Il est au-dessus de la volonté, il la survole et la dépasse car finalement, il ne la connaît pas. Ça détermination est son essence, elle ne lui demande aucun effort. Bêtes immondes à poils, à plumes ou à écailles courbent l’échine face à la pugnacité d’un tel adversaire. Heureusement, une telle rencontre ne se déroule jamais, le soldat des troupes de la mort est bien trop humbles.
Le vide à l’intérieur du soldat des troupes de la mort parle de l’empire des instincts primaux, de son débordement sur l’humain. Le vide lui permet de s’accrocher, d’être partout, de ne pas plier sous le poids même de son vaisseau ou de sa maison même, s’il se soucie de délicatesse. Mais au fond du vide, ne reste pas que le désert. Il y fait froid à l’œil nu, mais la chaleur humide qui circule d’aspérité en aspérité trahit sa propension à la vie, celle qui sent mauvais, celle qui fait peur. Où le reflet des entrailles est dans l’intérieur même du corps, dont l’apparence pétrifie dans son élégance la vivacité microbienne du soldat des troupes de la mort.
La fenêtre ouverte s’ennuie. Alors le soldat des troupes de la mort envisage de l’ouvrir pour lui offrir un peu de variété et tant qu’à faire, s’offrir un peu de liberté. Mais la tâche n’est pas aisée. Le soldat des troupes de la mort doit attendre qu’un quidam généreux daigne se présenter, le bousculer, lever son bras de plastique blanc et finalement, ouvrir la fenêtre lui-même. Finalement, la mort dans l’âme, le soldat des troupes de la mort abandonne, la fenêtre devra se débrouiller seule, ce qui arrive tous les jours entre huit heures et neuf heures du matin.
Pour le soldat des troupes de la mort, l’herbe est une forêt, les fourmis des chiens de traîneau, les mouches des charognards marchant dans les pas rouges de la mort.
L’humilité du soldat des troupes de la mort est proverbiale. Son silence aussi. Derrière sa bouche menaçante, ses membres rigides, le noue la contradiction parfaite de la condition du soldat des troupes de la mort : l’énergie de l’immobilité, le mal potentiel, l’autre visage de l’image du bien et du bon, où la malveillance s’incarne dans son impossibilité et que seul le feu peut révéler.
Le soldat des troupes de la mort n’est pas une représentation de l’humain sous le casque. Il est son incarnation. Encore moins un symbole, une image. L’humain égraine l’idée, le soldat des troupes de la mort l’exprime, lui donne forme et corps ; il ne vit jamais plus que dans ce qui n’a pas vécu, bien mieux dans ce qui n’est pas un corps mort. Le casque sur la tête de l’homme le punit pour les crimes qu’il n’a pas commis et qu’il s’apprête très probablement à ne jamais commettre. Sur celle de l’incarnation du soldat des troupes de la mort, elle défit la banalité du clone polychimérique.
Animal jouet sans défenses. Sept centimètres de long, jusqu’à 6 centimètres au garrot. Les pattes sont plus longues que celles qu’on suppose à un cheval. Lon pelage est rayé comme celui de toutes les bêtes qu’on dit dangereuses, les tigres, les guêpes, les abeilles et certains chats. La crinière poursuit la logique des zébrures et s’arrête nette comme une coiffure punk.
Quelle différence entre un pelage tigré et un pelage zébré ?
Il n’a pas de pelage. Cet animal est en plastique. Plastique non lisse pour imiter les poils de l’animal qui saillent un peu.
Animal-objet poétique il trouverait sa place sans écart dans un film en noir et blanc.
Animal-objet poétique il convoque aussi bien l’animal réel que l’inexistant, le jamais vu, l’absent de tous les parcs zoologiques, le zèbre idéal. Peut-être croira-t-on d’après cette reproduction qu’un zèbre qui n’est pas élevé en captivité possède, en vérité, des pattes vraiment longues et un corps aussi fin.
Les pattes des vrais zèbres ne sont pas si longues. Les pattes des vrais zèbres sont courtes et larges, on leur voit à peine les articulations, elles sont sans courbes comme les poteaux des lampadaires. Les troncs des zèbres d’Afrique sont plus larges, quasiment les deux tiers de la hauteur des pattes. La tête est fine mais les yeux sont très grands de sorte que selon l’humeur et le temps qu’il fait on peut le voir triste ou joyeux. Ils sont assez larges pour contenir tout une gamme d’émotions supposées, peut-être même étrangères aux zèbres d’Afrique.
Le zèbre en plastique est au zèbre d’Afrique ce que Barbie est à moi.
Si ce zèbre ne représente pas la Barbie zèbre c’est l’enfant zèbre le disproportionné qui a du mal se tenir droit sur les allumettes qui lui servent de pattes.
Il y a plusieurs sortes de zèbres, tous sont plus petits que les chevaux et que les ânes mais plus grands que les onagres et les hémiones. Le nombre de rayures varie en fonction de l’espèce et dans les espèces, en fonction de la taille du zèbre. Chaque individu porte une robe unique.
A quelle espèce se rattache le zèbre en plastique ? Peut-il seulement appartenir à une espèce vivante et respirante ?
Les équidés comme les bovidés ont un point en commun. Si le moindre vent les frôle, une mouche, un moustique ou une guêpe, une partie de son corps s’émeut et se met à trembler. Cela part d’une patte ou d’un flanc et se propage en vibrations élastiques 20 centimètres à partir de l’épicentre.
Mon zèbre est insensible à ce genre de choses.
Juillet 2012, Bamberg, Allemagne, à l’extérieur d’une résidence étudiante en forme de U à angles droits comme si elle avait été faite en Lego, un zèbre en plastique se tient solidement campé sur ses quatre allumettes au milieu des graviers en trois couleurs qui longent le bâtiment. Depuis il longe mes bibliothèques éphémères.
Les zèbres sont semble-t-il les seuls équidés d’Afrique. Les zèbres sont les seuls animaux zébrés. On n’a inventé ce mot que pour eux et pour tout tissu imité du singulier pelage du zèbre. Le nombre et l’organisation des rayures entre elles varie d’un individu à l’autre. Chaque pelage est singulier.
Les zèbres se font dévorer par les lions, les léopards, les guépards, les hyènes, et même les tigres.
Les zèbres se regroupent à l’ombre des baobabs et attendent que la chaleur passe.
Les zèbres se regroupent à l’abri des baobabs et attendent que l’orage passe.
Le zèbre est écrit noir sur blanc, mais la taille énorme des lettres, la langue même dans laquelle il est écrit nous rend le zèbre (animal ou objet-représentation-de-l’idéal-zèbre) indéchiffrable.
Le pelage du zèbre ne forme nullement la lettre Z. Pas même déformée.
Le zèbre est écrit. Il a sur le ventre des lettres et des chiffres qui nous sont familiers mais qu’on oublie sitôt lus :
« Schleich S®
D-73527 Schw. Gmund
©08 Am Limes 69 »
Sur la patte arrière droite, en relief, très gros :
« CE »
avec ce E qui ressemble à un C avec seulement une barre au milieu pour le transformer.
Sur la patte arrière gauche, à un mot près, le presque habituel :
« made in Germany ».
On oublie ces mots là pour ce qu’ils disent. Ces mots obcurs inscris en relief à même la peau (ou ce que l’enfant imagine être la peau) du zèbre détruisent un part du rêve.
On n’a moins de choses à dire à un zèbre qui a une adresse en Allemagne.
Si on offre un tel zèbre à un enfant qui a une ferme miniature, il le mettra dans sa ferme avec les vaches, les cochons, les chevaux, le chien, le chat, et ses pattes longues et son corps fin qui le font déjà étranger aux zèbres qui vivent bien en vie dans la savane le rendront encore plus étranger au cheval musculeux et à l’âne aux longues oreilles. Sans parler du pelage. Il sera seul et pensera aux baobabs.
Si on offre un tel zèbre à un enfant qui a de quoi reconstituer une savane (c’est-à-dire qu’il a a aussi un lion, une hyène, un léopard, un guépard, un tigre), le zèbre se fera manger car ses pattes d’allumettes l’empêchent de courir.
Elle traînait sur la table ovale qui me sert de bureau, évidemment inutile, l’ampoule que j’ai en main. Je la tiens entre le pouce et le majeur, verticalement ; le culot en métal gris est strié ( ampoule à vis ) et le globe, de taille ordinaire est lisse au contact et totalement transparent. C’est une ampoule halogène.
A l’intérieur se dresse un petit assemblage de rectangles cristallins ,totem lilliputien sous haute protection. L’ampoule n’avait - elle pas autrefois la sainte fonction de renfermer un onguent sacré et royal ?
Pourtant, un filament intérieur en partie détaché trouble ce bel équilibre. La patte légère d’une mouche égarée, emprisonnée ?
C’est que l’ampoule est morte - ça ne tient qu’ à un fil, un cheveu, une vie comme ça. Quel sombre esprit a pu s’immiscer et signer la mort de la fée ?
Voici le soir et ses métamorphoses, l’ampoule est devenue miroir, elle reflète le tissu bleu de ma robe tout en captant la lumière de la lampe de chevet, en minuscule boule de lune. Traversée magique.
Jouer avec l’objet : l’ampoule à présent est à l’horizontale entre mes doigts : mouvement, déplacements troublants. Ce qui apparaît, c’est le manuscrit biffé du texte que je lis et tape à la main.
De là à imaginer une lettre envoyée dans l’océan, pour un autre continent, paisible si possible... Sending out an S O S... Sending....
Et si un navire miniature, une maquette de paquebot s’était retrouvée embouteillée, si l’ampoule berçait un vaisseau spatial ?
Celui-ci nous donnerait à voir comme l’ écrivain dans son Vol de Nuit, les lumières des petites vies sur terre.
Et ce serait le reflet de l’ Humanité même, avec sa misère noire.
Et ce serait la géographie même de notre terre fragilisée, avec ses déserts, ses montagnes, ses zones de vie urbaine et électrique.
Ce serait le firmament tombé à terre, la nuit agenouillée.
Car les étoiles filent et disparaissent des villes lumière...
" Songer à les rallumer", Monsieur Apollinaire...
Cycliquement, il entre dans la liste des indispensables. Clôturant l’année qui s’écoule, ouvrant celle qui s’annonce, le calendrier est repère temporel avec ses encadrés chiffrés mais aussi objet-déco ornant le mur d’une pièce.
Jamais identique, il occupe toujours le même espace : la pièce principal ; là où, parfois, les heures s’imprègnent d’atemporel. Sans préméditation, sa forme carrée s’insère dans un ensemble géométrique, sous le miroir circulaire et à gauche du rectangle électronique, son rival thermostatique.
Au contraire, sa taille, sa couleur, ses illustrations, elles, sont étudiées. On prend le temps qu’il faut pour choisir son calendrier. Les pages doivent se tourner vers le haut, mais l’image doit figurer au premier plan. Esthétique ou pratique ? Là aussi, il faut choisir.
Fantaisie, caprice ridicule. L’almanach du P.T.T épais et cartonné était moins sophistiqué mais il avait l’avantage social. La visite du facteur préludait à l’année qui s’annonçait. Les petites mains parcouraient les carnets d’animaux ou de paysages pour sélectionner le nouveau calendrier pendant qu’on servait le café.
Fenêtres ouvertes vers l’étendue, les photos en couleur invitent aux voyages quand elles n’appellent pas ceux en mémoire. Instants exquis et rebelles filant et défiant la ligne du temps. Désert enneigé en janvier, ensablé en juillet. Le voyage autour du monde se fait en 52 semaines répertoriées sur le côté.
On y voit des fins de semaine orangées et des cellules numérotées qui tiennent lieu de supports pour l’illettré, des sphères et demi sphères qui lui servent de repères. D’ailleurs, avec les sept langues qui traduisent les jours de la semaine, la dimension pédagogique du bloc ne serait pas à négliger.
La main fige ponctuellement les rendez-vous sur la page satinée, là où l’imperceptible passe, invisible. Le jour emprisonné dans sa petite case : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nous fait oublier ce que le marqueur indique fatalement. L’illusion commune de la linéarité temporelle engage les consciences.
Mais le calendrier ne sert pas à penser au temps, il l’organise seulement. On planifie, on projette, on peut faire un saut en arrière, en avant si on le souhaite. On peut, d’un battement de cils, passer d’aujourd’hui à hier, d’hier au mois précédent, voire survoler plusieurs mois d’affilé et cela, grâce au calendrier.
11 : TH, 23 : ORT, 30 : DT. Le calendrier mangeur de lettres est la mini mappemonde des gens bien organisés. Cette manière d’inscrire le rend plus intime, plus personnel et les yeux épieurs ont rarement l’occasion d’accéder au-dessous de cartes.
Il faut toujours prévoir, noter pour ne pas oublier, hiérarchiser, ordonner et le calendrier c’est vrai, est bien pratique. Même s’il nous arrive, parfois, de ne pas honorer l’engagement griffonné parce que nos mémoires sont un peu trop sollicitées.
A bien y regarder, notre joli calendrier nous rappelle surtout combien nous sommes amnésiques. Que reste-t-il en mémoire à la fin d’une journée, d’un mois, d’une année ? Le calendrier imprime…la mémoire supprime.
Certaines mains arrachent avec empressement la page quand le mois s’achève alors que d’autres la tournent plus délicatement. Il faudrait sans doute y voir du sens caché ; le rapport que nous établissons avec le calendrier varie en fonction des personnalités mais aussi en fonction de la charge affective qui nous lie à l’objet.
Il y a néanmoins un aspect rassurant à imaginer le ballet de mains exécutant cette même chorégraphie. Il y a de l’ordre et une soumission commune face à ce qui se dérobe, à ce qui fascine et questionne, mais qui échappe à nos conceptions.
C’est un peu le sceau du temps dans notre espace, du temps qui ne se renouvelle pas, mais qui est seulement. Au contraire, le calendrier se renouvelle sans cesse. Et sa singularité ne réside peut-être ni dans sa fonction ou sa plasticité mais dans ce qu’il a de plus banal au fond : sa durée de vie limitée.

1. Convoitée, ramassée aussitôt, examinée, tournicotée entre deux doigts. Plume, légère, atterrie, tombée des nues. Souffle pour la débarrasser de ses scories et la faire apparaître dans son plus simple appareil, sa perfection.
2. Légère, humble, petite, ébouriffée à la base de son aube, arc sensuel et délicat. Le doigt passé le long de sa tige, résonnance particulière de vagues de toile ferme, précision, tissus imperméable tendu rebondissant.
3. Petite et grise métal argenté de clair à foncé ambré à son extrémité. Composée de trois parties distinctes, simple mais chic. Tige rigide s’élançant d’un trait précis au travers d’une voleté de microsillons sans défaut. Fanons microscopiques si bien rangés que le moindre égarement oblige le doigt ensorcelé à le rectifier. Objet à constamment lisser.
4. Au-delà de cette ferme ligne de conduite et à son sommet, un épis. A l’extrémité de sa base une corne pointue lisse d’un blanc dur plus ou moins transparent, parfait pour un cure ongle momentané, si l’on oublie de se raccorder dans un moment d’égarement, à l’indispensable fonction passée.
5. Légèreté. Tu plies mais ne rompt point. Évanescente. Partout présente et nulle part en mouvement tourbillonnant. Fermeté. Les lignes engagées sont bouclées dans une parfaite simplicité.
6. Plume : production tégumentaire complexe. Phanère de la famille des poils, écailles, ongles, griffes, sabots. Ici, certainement une rémige secondaire composée de ses usuelles barbes et barbules, que je tiens fermement par le calamus devenant le rachis traversant l’aube sans s’arrêter.
7. Ce fil conducteur perçant la peau lisse, tissus tendu de sages stries immobiles, délicatement décoré de fines rayures ombragées, aquarellées. Tube central élancé côté incurvé où pourrait se répandre un restant d’encre oublié.
8. Brouillon de duvet minimaliste, blancs cheveux d’ange d’arbre de noël, marquant un brusque changement de territoire entre la pique dentaire base transparente et le corps ailé. Ou bien nœud délicat entre les deux, pour le finish de cette beauté pavanée. Exhibée.
9. Ombre chinoise le soir venu, lame de rasoir au bout effiloché se découpant sur mon papier. Le monde se désagrège et la plume muette danse en se dédoublant, la scène rituelle du dernier Mohican. Là-bas, des enfants attrapent leurs rêves dans des filets de barbes et d’ongles endimanchés.
10. Plume : Phanère de la famille des poils, écailles, ongles, griffes, sabot. Tu caches ton jeu de rémige secondaire derrière ta ligne impeccable de starlette voilée. Raie au milieu, épine dorsale, dos lisse à caresser de part et d’autre de tes deux hémisphères, poils et fourrures, peau et plumage, atmosphère hybride, vestige trop bien conservé.
11. Isolée arrachée de la voilure originelle, tombée de nulle part, échantillon pris au hasard faussement modeste, exhibé pour seconde vie en objet inanimé. Rideau peau lisse, bouche cousue
sur vols millénaires, migrations obstinées, peuplades musclées d’horizons ailés. De l’ancienne vie le bleu du ciel chute d’Icare à tombeau ouvert, entre mains et crânes de rêves humains envieux non apparentés.
12. Au clair de la lune, à tire d’aile sous la pluie, plume assortie d’un e muet, derrière ta brève syllabe boursouflée lancée à la volée d’un trait éclaté, lèvres bullées motorisées, j’écris ton nom.
13. Lovée à terre, retour aux vers, décors de rêve, griffe de plastique dur transparent, corne muse grattant sous l’ongle ce qu’il me reste de noirceur. Marque page de signal hybride, discrètement fantastique. Objet jouant des tours et détours, se pose, s’oppose. Douceur lisse, imperméable, duvet vaporeux, colonne vertébrale plastique dur terminée en griffe, épi récalcitrant hélant pour être lissé. Humble stature traversée de souvenirs épiques, frissonnante, sage taiseuse immobile, raide, souple, collé monté, les yeux fermés, figée sur son trente et un. Star délicate, ex volante, tirée à quatre épingles, se piquant de parures puissantes.
14. Nippe d’oiseau au cœur volant, fringue perdue, abandonnée, jetée sur rive, délaissée, beauté plastique arrachée à sa destinée, échappée belle, plume esseulée, ramage déserté, image sage de rebelle forcée, striptease aérodynamique jeté en tournoiement lent, accidentel, ombre chinoise le soir venu, réfléchissant le tranchant de son arrête effilée.
Elle n’est pas arctophile. Pourtant, chez elle, nous sommes deux. Celui qu’elle a reçu tardivement et avec qui elle dort. Et moi, qui de là-haut surveille son sommeil.
Elle ne me murmure plus à l’oreille ses petits secrets, ses grands chagrins ; au demeurant, d’oreilles, je n’en ai plus depuis belle lurette.
Quand elle me regarde, elle sait tout de mon membre fantôme, elle sait comment au fil du temps ma patte droite s’est vidée de toute matière.
Du monde je ne vois plus rien ; depuis des lustres, j’ai perdu mes yeux qui ont été remplacés par quelques traits de fil noir. Mais, moi, je la sens quand elle farfouille pour étendre ou repasser le linge, quand elle s’installe près du secrétaire en haut duquel je suis perché sur un tourne-disque orange. Quelquefois je l’entends rire ou pleurer.
De là-haut, je veille sur ses nuits. Elle a connu de longues heures d’insomnie mais depuis quelques temps, ça va mieux ; elle se couche tard, trop tard mais dort comme un bébé.
Elle ne me parle pas plus beaucoup ; d’ailleurs, depuis longtemps, elle dort avec un autre qui est arrivé dans sa vie l’année de ses dix-huit ans. Elle est née un 12 décembre. Moi, je fut le cadeau de sa marraine pour son premier Noël.
Elle ne me prend plus dans ses bras mais elle ne s’est pas lassée de moi. Elle dit parfois qu’elle m’aime autant qu’avant mais que je suis devenu trop fragile, que je ne supporterais pas ses agitations nocturnes. L’autre est plus robuste, c’est tout.
Pour me protéger de la poussière et éviter que mes membres ne se dégarnissent plus, elle m’avait mis une ancienne grenouillère de son neveu. J’ai réussi à lui faire comprendre que ça ne me plaisait pas et que je préfère rester nu.
Le temps a laissé son empreinte sur mon corps. Elle a tenté d’en circonscrire les ravages apparents. L’aiguille et le fil furent ses armes contre le délabrement.
Quand mes yeux en verre sont tombés, elle les remplacés par quelques traits de fil noir grossiers et maladroits. Elle fit de même pour ma bouche et ma truffe lorsqu’elles s’effilochèrent.
Là-haut, sur le secrétaire, assis sur le tourne-disque orange, je suis bien tranquille. Quand des enfants lui rendent visite, ils n’ont pas accès à mon refuge. Si toutefois ils demandent, elle refuse expliquant que les ans m’ont rendu trop fragile. Au fond, elle pense que je ne suis pas un jouet, que je suis le compagnon et le confident de toute une vie.
Mes joues et mon menton sont reprisés pour compenser l’usure du tissu devenu presque transparent. Des sutures primaires ont stoppé l’épanchement de la bourre qui me remplit au niveau des pattes et du cou. D’ailleurs, l’autre, a lui aussi des points de suture au niveau du cou. Ils sont masqués par un bandana rouge.
Il existe des cliniques où l’on répare les ours en peluche mais ni elle ni moi ne voulons que j’y aille. Nous tenons tous les deux à conserver les marques que le temps dépose sur notre corps et notre âme.
Que deviendrai-je quand elle ne sera plus là ? Quelqu’un voudra-t-il encore de moi ?

Sur l’étagère du cosy qui entoure mon lit d’enfant chez ma grand-mère, il y a
une porcelaine.
Posée à plat sur le meuble en chêne, elle fait le dos rond, prêtant le flanc à l’indifférence et à la poussière.
Tenir la porcelaine au creux de la main, la partie bombée bien calée contre la paume, l’approcher de son oreille, très près. Plaquer littéralement l’échancrure dentelée sur le lobe de l’oreille. Écouter la mer. Y croire.
Taches brunes et veloutées au contour indistinct mystérieusement incrustées dans l’épaisseur de l’émail, traces d’un héritage
lourd de secrets.
Les auréoles ne sont pas toutes d’égale teinte. Au plus près du ventre, du brun plus sombre sur fond plus crémeux.
Y a -t-il une logique à découvrir dans le disparate de ces étranges grains de beauté ?
Cet objet me raconte tout bas l’ histoire et la géographie de citadelles marines encore à découvrir, de civilisations aquatiques aimantes et paisibles !
A vrai dire, je ne suis pas si sûre que la porcelaine soit réellement un objet. Ni qu’elle ne le soit pas. Car en vérité, si sa matière naquit du vivant, est-elle inerte à ce jour ?
Vulve Dévorante
dans le Silence de la
Mer
Un animal (diable, quelle sorte d’animal ?) fabrique dans la nuit abyssale la porcelaine tigrée.
L’ oval doux dur mouillé miroitant ruisselant immortel de mon objet féroce se love naturellement dans le creux de ma main surprise par tant de politesse.
Et lorsque la mère tout à coup se met à rugir
rappelant l’interdit mémoriel
l’enfant croit en l’écho de la mer
et se noie tout au fond de la porcelaine devenue dans son rêve géante
Et lorsque le père ne voit rien n’entend rien
l’enfant croit en l’écho de la mer et
s’évade s’évade s’évade
On a retrouvé de merveilleuses porcelaines dans le tombeau d’impératrices antiques.
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne 21 juin 2016 et dernière modification le 4 février 2020
merci aux 8727 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page

