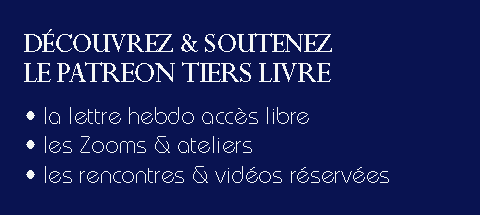en retournant sur elle-même une expression orale prise au quotidien, faire surgir un monde
#4 | Sarraute, ah ne me parlez pas de ça !
La subversion Sarraute, c’est la langue prise à elle-même.
En assignant à son texte, dès Martereau, mais surtout dans la grande suite de livres des années 68 à 80, de n’avoir comme objet et matière que la langue elle-même, en se saisissant de ces fragments devenus rigides de la langue et qui nous parviennent par la conversation, et les retournant sur eux-mêmes pour subvertir de l’intérieur cette rigidité et les réourvrir ainsi au monde, Nathalie Sarraute crée un univers dont la littérature ne disposait pas avant elle. On a encore aujourd’hui à vaincre et expliquer la déstabilisation majeure qu’induit sa lecture : parce que la langue devient sujet, nos habitudes d’identifier la parole à un personnage ne fonctionne plus, notre propre activité de lecteur pour reconnaître qui a proféré ce qui vient d’être dit devient le lieu même par quoi le texte se retourne subversivement sur le monde, via un univers de perceptions auditives, visuelles ou tactiles poussé à son incandescence langagière. Mais quel plaisir aussi de resituer pour un groupe, quel qu’il soit, l’étonnant parcours de vie de Nathalie Sarraute, le rapport à quatre langues dès l’enfance, les performances sportives de la vie étudiante, les combats des années 30 pour se faire reconnaître comme femme au barreau, et comment la fonction même d’avocat crée un autre rapport à la parole, la peine pouvant dépendre de cet engagement oral et comment on l’aura mené à son terme, et puis bien sûr la Résistance, l’écriture : ces livres qu’on utilise en atelier, « Disent les imbéciles… », Vous les entendez, L’Usage de la parole, des livres trop méconnus, d’une verdeur et d’une acidité incroyable, sont écrits par une septuagénaire. Écoutons-la ciseler notre langue, en osant ne parler que de la langue, et laissant notre imagination du monde se reconstituer mais au-delà, et d’après les mots qui nous y lient :
Nathalie Sarraute, L’Usage de la parole, Gallimard, 1980.
L’usage de la parole (Gallimard, 1980) n’est pas un livre isolé dans la tradition française : on met devant soi un de ces fragments ouverts de phrase qui, n’appartenant à personne, se retrouvent dans le discours de tous, et on les fait eux-mêmes médiateurs des discours qu’ils ont organisés, et dont nous ne nous souviendrions pas sans eux. La forme sonore même dont nous savons les investir appelle à convoquer par l’oreille les voix qui les prononçaient, et donc ce qui se disait avec, ce qui se disait à côté, ce qui se disait par eux. Effet immédiat de diffraction, parce que ce qui se disait prend distance avec ce que la parole dit dessous, fait passer dans une profondeur inexprimée, qui contredit ou va au-delà. C’est justement à cause de ce décalage que la parole se saisissait de ces syntagmes, muets par eux-mêmes et qui ne valent que par la voix, que par le blanc ou le brouillage qu’ils imposent au sens qu’ils introduisent ou en apparence soutiennent.
Une suite de syntagmes que Nathalie Sarraute commente donc un par un, avec un effet magistral de fiction par ces ébauches qui naissent soudain à un tour de phrase par une illusion de personnage ou d’ombre, parce que nous, lecteurs, sommes apostrophés et inclus dans le jeu, parce que ce génie de parole suscite autour de leur répétition toute l’idée d’un lieu ou de silhouettes, figures qui viennent tout au bord, nous laissent entrevoir des mondes tout entiers, lourds de tout un roman possible, dans une mécanique quasi infernale d’accent porté sur l’attaque des mots, quelquefois juste par le déport d’un guillemet d’une occurrence à l’autre :
Nathalie Sarraute, L’Usage de la parole, Gallimard, 1980.
Quelque chose lève en deux lignes, en trois, qui est toute la puissance de la fiction plus traditionnelle. Mais, développé en fiction, le travail ici mené juste sur l’emploi anonyme du pronom ne nous piègerait pas si fort. Et parce qu’on est frustrés que cela, pris dans le rythme du livre, soit emporté loin de nous-mêmes, c’est cette instance insatisfaite de la fiction qui demeure, aussi puissante alors à ces fragments de deux lignes que dans ce qui nous reste de livres lus dans l’adolescence, qu’on relit régulièrement, comme Stendhal, juste pour retrouver ce seul mystère de la première lecture. Quelques-unes de ces expressions dont Nathalie Sarraute, née avec le siècle, vient jouer pour ses quatre-vingts ans : Un moment d’absence… je me le demande… rien de précis… Pourquoi pas ?… se paie sa tête… faire semblant… Ah oui vous pouvez le dire… et c’est partout pareil… Mon petit… Eh bien quoi… Ça ne tourne pas rond… Ne me parlez pas de ça…il suffit de quelques mots… Pour de bon… Je ne comprends pas.
La tentative de Nathalie Sarraute dans L’Usage de la parole, c’est un rêve de livre par quoi chacun on passe, un de ces livres qu’on lit en se disant à chaque ligne qu’on voudrait inventer soi-même l’équivalent. Et puis, le livre refermé, bien sûr ce n’est pas la peine de l’écrire, ce livre rêvé, puisque celui-ci existe déjà, qu’on ne saurait que refaire. Mais cette impression d’ouverture, voire d’incomplétude, est contenue dans son principe dialogique : s’il n’y avait pas, au bout de chaque phrase, cette possibilité d’étendre le livre, ou d’en rêver un autre, la petite musique de la phrase ne pourrait pas ainsi résonner après elle. Une petite cristallisation de dix chapitres brefs , là où chacun pourrait suggérer encore trente ou quatre-vingts locutions de cet ordre qui restent à explorer. On peut suggérer de reprendre à son compte la dissymétrie des deux registres du texte : il y a celui ou celle qui prononce la parole toute faite, organisée autour de cette locution qui la brouille, et la distord ou la vide ; et il y a celui ou celle qui analyse et répond. Le texte pourra se présenter d’une seule filée ininterrompue et sans marque de dialogue : on suggèrera plutôt qu’il reste monobloc, et s’ouvre par l’intérieur à l’éclatement des voix, par exemple en marquant juste par des italiques ou un soulignement les expressions toutes faites qui servent de base au dispositif.
Et nous qui étions auprès de lui, nous comme lui désolantes terres stériles, nous, dégageant des vapeurs mortelles.. nous tout couverts de paroles vides, nous comme lui plongés dans la nuit, sans bien comprendre ce qui nous arrive… serait-ce un décollement de la rétine ?… nous, perdant à chaque phrase l’équilibre, comme sur ces escaliers de foire dont les marches mouvantes se scindent et s’écartent… nous gardons obstinément, nous sommes tous ainsi faits, un peu d’espoir…
Et si celui à qui ces paroles sont envoyées allait tout à coup… il suffit de quelques mots… Mais va-t-il avoir le courage de les dire ?… On a envie de le pousser… qu’il le fasse donc, qu’il l’ose…
Nathalie Sarraute, L’Usage de la parole, Gallimard, 1980.
Je ne cesse d’être surpris par le fait que des noms aussi « installés » dans notre histoire littéraire contemporaine puissent être de fait aussi peu lus, faute des clés toutes simples qui nous rendent pourtant ces lectures nécessaires. Tout pèse pour nous éloigner de Sarraute : l’image « nouveau roman », laboratoire ingrat et daté dans le cliché qui s’en fait, loin pourtant de la somptuosité des pages de Claude Simon ou de la précision immensément simple de Beckett. L’effet « tropismes », comme si ce –isme était encore une sorte de manipulation bizarre. L’image même de la vieille dame légendaire. Ne cesse de me surprendre, côté Sarraute, que son texte théorique le plus essentiel, L’Ère du soupçon ait été écrit non pas pour commenter l’œuvre, mais alors même qu’elle débute. Nathalie Sarraute énonce avec clarté ce qui est pour elle le premier des enjeux : en rendant indifférenciés les locuteurs, appeler à l’activité du lecteur, le convoquer lui comme personnage pour que la polyphonie installée par l’écriture trouve son relief. Ce déplacement dans la conception du personnage, du sujet, dans le statut de la voix, nous l’avons en partie désormais intériorisé. Les livres de Nathalie Sarraute sont susceptibles d’immenses plaisirs de lecture : mais à la condition de ce déplacement théorique qui reste encore à l’encontre des usages dominants, des livres consacrés par les prix littéraires ou qui nous encombrent en général. Lorsqu’on arrive en atelier avec les livres de Nathalie Sarraute, il ne s’agit pas seulement de faire écrire des textes : on inocule vraiment un venin. On a plaisir à le faire.
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne 27 décembre 2013 et dernière modification le 10 juillet 2021
merci aux 2088 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page