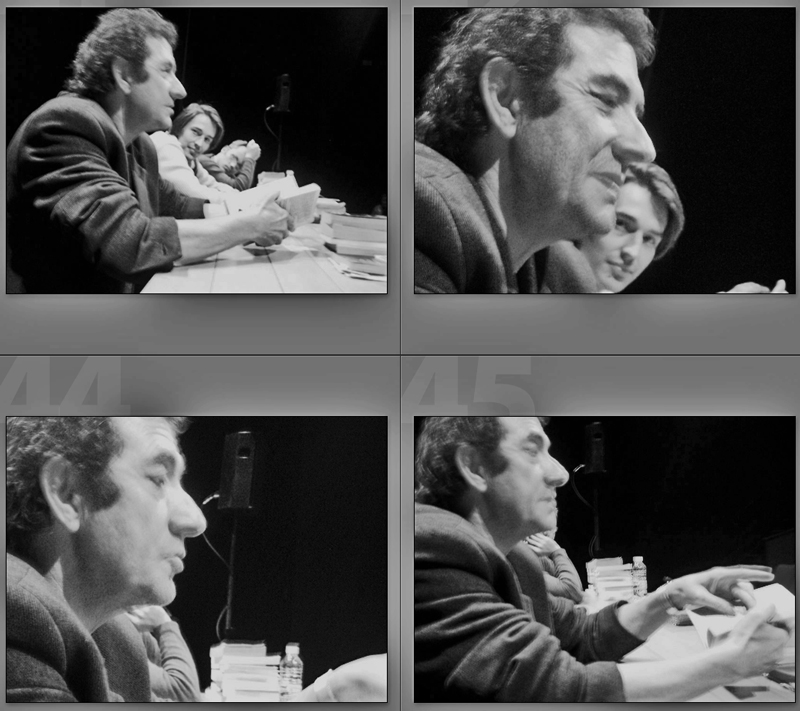
2020.08.12 | Providence Variétés (d’un blog sombré)
Qu’est-ce que le textuel, et en quoi se confondrait-il, ici, avec le livre imprimé, et diffusé dans les circuits industriels et commerciaux auxquels nous, auteurs, l’avons légué par contrat ? Oui, le textuel d’aujourd’hui est sur nos blogs, dans l’éphémère de nos actions réseau, il est dans la parole qu’on tient, préparée (en cours ou sur scène) ou improvisée (mes YouTube). Et si se hisser à la parole était précisément un des enjeux du textuel d’aujourd’hui, et que la magie du web c’était nous en permettre le partage sans avoir à la rabattre sur l’objet imprimé, parce que seule technique disponible ? Et ne sommes-nous pas encore plus auteur à nous saisir de ces outils, hors du vieux monde avec ses rituels et ses fétichismes désormais – de plus – inopérants pour nous faire vivre ?
Je connais pas ce gars-là, on s’est jamais croisé, y a pas longtemps qu’avec Ahmed Slama on est copain sur Facebook, mais j’aime bien cette façon de discuter par web interposé. Je découvre qu’il a un blog, jours banals de belles notations sur la notion de mouvement et de réel, mais 3 billets seulement... alors qu’il me prévient via taguage Facebook d’une « lettre ouverte à François Bon » qu’il signe sur Hypallage, officine peu prolixe de détails sur elle-même et qui semble avoir désespérément besoin de se faire repérer par quelques liens mais pourquoi pas, la liste des destinataires de leurs lettres ouvertes en série désigne surtout les valeurs consensuelles reconnues, ne pas s’étonner qu’ils aient eu si peu de réponse, j’aime pas mais ne me défile pas.
Donc allons-voir cette lettre ouverte à mon humble personne, où se joue quand même une idée bien traditionnelle de l’écrivain. Ou alors une sorte de syndrome de Stockholm généralisé de la religion du livre : on constate que ça ne va plus, et on s’accroche précisément à ce qui sombre (non pas le livre, mais le système qui va autour) plutôt que de rejouer le dire là où ça vit et se bagarre ?
À titre exceptionnel j’ouvre les commentaires, A.S. pourra répondre à mes réponses et vous autres bro’ vous inviter c’est plaisir.
un peu l’angoisse de Beckett refusant les entrevues, répondant systématiquement : – Tout ce que j’avais à dire, je l’ai dit dans mon œuvre » (Samuel Beckett)
lectures où l’on voit comment le corps est engagé, avec tes intonations, ce souffle, ce rythme [...] existe-t-il en toi cette peur que le François Bon, la personne, ne recouvre le François Bon textuel ?
ce troisième François Bon, existe-t-il un risque qu’il n’altère la réception de tes œuvres, déjà parues, ou à venir ?
comment situes-tu aujourd’hui le rapport auteur/lecteur ?
par comparaison à ces auteurs cités, toi, tu as cette présence, massive, en ligne...
ou alors tu considères ce travail en ligne comme une œuvre tout autre ?
Trois ans que je lis du François Bon, que j’ai découvert ta prose et, aussi étrange que cela puisse paraître, ce n’est pas par le web que j’ai rencontré le François Bon textuel (j’invente rien, j’apprends rien à personne, toujours différencier la personne de l’auteur, un des plus grands enseignements que nous ont porté, je cite l’avalanche de noms chronologiquement désordonnée, Proust, Valéry, Mallarmé, Péguy…)
Mais là, désolé, contresens grave : en quoi la figure sur le web, oralité du journal, personnage des vidéos, lecture scénique, et même les séquences VLOG, ne seraient pas des constructions auctoriales comme celles du texte ? en quoi la complexité de la construction de cette présence voix/vidéo/web rapprocherait plus de la « personne », ou alors justement c’est le privilège d’une illusion plus forte grâce à l’emploi d’outils neufs ?
François Bon et question au questionneur : l’enjeu, en fait ce serait ça : comment je fais plutôt pour supprimer les FB précédents de ce qui a commencé désormais par la parole sur web ? et la joie à travailler dans l’éphémère d’un site qui disparaîtra d’un clic ou dans les semaines qui suivront ma fin prématurée.
Évidemment c’est un beau cadeau aussi de lire ça. Mon malaise tient surtout à cette figure de l’écrivain attelé à son oeuvre comme construction de valeur assignée selon critères pérennes. Longtemps je crois qu’on a appris que les oeuvres qui nous concernent ou nous touchent le plus sont des constructions rétrospectives (le mot est de Proust), tirant une partie de leur force précisément de leur arbitraire, de leur composite. Voyez les 26 tomes d’Artaud. Ou l’invention tardive par Alexis Léger de la biographie de Saint-John Perse. Ou l’imbroglio des manuscrits de Proust. Que savons-nous de la socialité de Rimbaud à Londres, et belle la thèse de Thierry Beinstingel incluant la correspondance épicière du Harar comme fait d’oeuvre.
Oui, avec le web, nous prenons un risque. Mais le web n’est jamais en lui-même l’origine de ce risque, il n’en est que le support ou la médiation : ce rapport à la parole et à l’improvisation, peut-être que je l’ai tardivement mis au centre de mon trajet, mais je le dois à Christophe Tarkos, je le dois à ces moments de happening que sont depuis 1993 mes ateliers d’écriture, dans tous les différents contextes où j’ai pu les mener.
Il y a des questions essentielles : comment la logique de la mutation de l’image interfère avec la logique de la mutation de l’écrit. Comment, dans une mutation imprédictible, nous avons à ouvrir l’espace encore trop peu étudié des précédentes transitions dans les quelques principales mutations de l’écrit.
Il y a bien sûr les questions première de survie (matérielle) et de résistance (intellectuelle) dans une société où ce statut de l’écrivain, et le dépôt symbolique à lui afféré dans l’âge encore tout proche des revues (Tel Quel, NRF, Change, Minuit etc) qui a structuré le champ contemporain.
Il y a certainement une instance de plaisir : oui, l’ordinateur connecté est un outil d’écriture en tant que tel, et nos pratiques même du clavier (disparition progressive de l’écran comme place et concept, rédiger directement sur base de données comme là tout de suite sur mon serveur blog, ou le vague brouillon ébauché hier sans fichier traitement de texte sur Ulysses) justifie le laboratoire, l’en avant.
Il y a certainement du conceptuel à réviser : le travail de Lionel Ruffel sur une ré-énonciation du concept de publication c’est le centre du chamboulement mental. Mais revenir à Vilém Flusser pour savoir ce qui change si j’ajoute une photo prise par moi en tête d’un article, ou si j’ouvre la temporalité de cette photo pour en faire une vidéo, ou même ces temps-ci quand je capte mes impros parole en vidéo sphérique, ce n’est pas une rupture du champ de la littérature, c’est la forme précise de l’écosystème d’outils du lire-écrire dans sa configuration d’aujourd’hui.
On se fout total de l’oeuvre : mais on accède à une chance de naissance d’oeuvre. Ce sera rétrospectif, et on ne sait pas sur quel clampin parmi nous ça tombera. Le paradoxe essentiel reste que le livre qui nous apprend au plus haut la pensée de l’écriture en temps mobile, et pour ce qui nous concerne en temps connecté, ce sont les Petits traités de Pascal Quignard.
Récemment, dans un marronnier coutumier au Monde, on me qualifiait d’écrivain très connecté. Aucun d’entre nous n’est plus réellement dans un monde bipolaire à ce point. Les tablettes et téléphones font irruption jusque dans les casseroles quand on cuisine. Bergounioux vient de publier un petit livre de ses photographies numériques. Être connecté n’est plus un état spécifique, nous devons seulement être vigilant à notre attitude critique dans l’espace multiple de la connexion : comment ce qu’on fait dans Facebook n’est pas un agir neutre – mais les grandes manoeuvres du propriétaire espagnol d’Editis, lorsque la Martinière saborde le Seuil en bradant à Editis la pleine distribution de mes livres, ce n’est pas non plus angélique. Être connecté est la définition même de notre table de travail, de notre flux d’information citoyen, de notre agir-monde comme ce l’est aussi de nos usages privés de correspondance, d’annotation et documentation, aussi bien que de la prise de langue grégaire et sauvage, clavier ou caméra, que nous organisons à même la ville, ou dans l’espace clos de notre précaire tour d’ivoire où arrive la fibre.
Ayons juste un peu de crainte pour celles et ceux qui, obnubilés par leur nom imprimé dans un recoin de Fnac, s’imaginent responsables de la survie d’un dépôt symbolique depuis longtemps liquidé, et ne s’ouvrent pas à ce risque : la publication numérique, l’écriture dans sa friction au réel, avec les usages mêmes que lui impose ce réel, qui a toujours eu le choix des armes.
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne et dernière modification le 14 janvier 2017
merci aux 1715 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page

