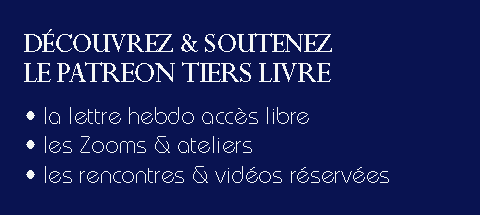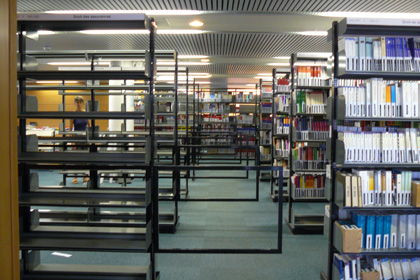
sur quelques pistes ouvertes par Pierre Assouline à propos de Pierre-Marc de Biasi (et hommage à Heritrix)
La mémoire vide des temps informatiques, c’est le titre d’un article important de Pierre Assouline dans le Monde des Livres (sera repris dans son blog lundi en accès libre, je suppose). En voici le passage central :
N’allez pas y voir la réaction affolée d’une corporation menacée de chômage technique : avec les archives encore inexploitées des XIXe et XXe siècles, les généticiens de la littérature ont de quoi s’occuper pendant quelques décennies. Même si les livres sont eux-mêmes rongés par l’acidité et les manuscrits menacés par les encres métalliques.
Lecture évidemment plus que concernée de ce billet de Pierre Assouline, puisque recoupant un certain nombre des thèmes auxquels je suis moi-même attelé dans Après le livre (chantier mis à jour toutes les 2 semaines sur publie.net, version imprimée à paraître au Seuil le 10 septembre) :
– de l’art de ne pas conserver ses ébauches
– nous serions alors chacun l’écrivain d’un seul livre
– l’ordinateur suffit-il à nos secrets
Pierre Assouline reprend donc en détail un certain nombre d’idées émises par Pierre-Marc de Biasi, dont on connaît le travail de généticien sur Flaubert. Malheureusement, le texte de 17 pages évoqué n’est pas disponible en ligne, la première chose pour qu’on prenne ce débat au sérieux – dans l’esprit web et non pas dans le Titanic des pratiques universitaires papier –, ce serait qu’il prenne 3 minutes pour le mettre à notre disposition. Mais l’approche qu’en fait Pierre Assouline ouvre sur un certain nombre de pistes importantes, où ma propre position diffère notablement de celles exprimées par P-M DB.
D’abord, une réticence : on utilise à tort et à travers ces métaphores religieuses – le tocsin c’est pour la guerre ou la mort. Le numérique c’est plutôt une naissance, au pire un prolongement agrandi du très vieux combat de l’homme pour sa curiosité, ce qu’on apprend et ce qu’on transmet.
Tout de suite aussi, l’historicité parfaite aussi de ce qui est décrit : brouillons, plans, épreuves corrigées, carnets, c’est déjà une époque. Ça ne marche pas pour Chateaubriand, ni Saint-Simon, ni Rabelais. Magnifique travail celui de De Biasi, qui coïncide parfaitement avec une configuration précise de la littérature, celle qui va de Balzac à Proust, via Flaubert et Mallarmé.
Manuscrits : la main est est passée à la machine. Mais, à supprimer la trace de la main, supprime-t-on sa propre trace ? Et si on constatait exactement le contraire : même sans pratique numérique personnelle, notre identité numérique ne cesse de se complexifier et s’alourdir. L’enjeu, c’est précisément comment on peut se rendre maître, chacun, de son identité numérique. Et donc, sur ce qui suit, a priori constat clair : dans le cloisonnement du CNRS, si le champ de Pierre-Marc de Biasi ne décèle plus de tracé génétique interprétable c’est qu’il attend dans le hall de la gare alors qu’on a tous pris le train.
Comment le travail génétique d’un auteur, d’un musicien ne serait pas mille fois plus riche quand il s’accompagne justement, en ligne ou dans sa machine personnelle, de tout un ensemble de données, carnets, récits, images, recherches, échanges ? En quoi et comment la génétique d’un texte se limiterait aux états successifs de sa rédaction ?
Encore une métaphore religieuse : on s’est converti au numérique. Non, cher Pierre-Marc de Biasi, si la totalité de l’édition imprimée utilise le numérique, si un livre imprimé est un ensemble précis de fichiers xml, css et onix, il ne s’agit pas d’un changement de religion. Vous diriez ça d’un biologiste ou d’un astrophysicien, ou de la sécurité sociale, converti au numérique ?
La notion de futur, depuis l’Angelus Novus des thèses sur l’histoire de Walter Benjamin, nous ne l’appréhendons qu’à partir des figures d’utopie négative. Le présent est imprédictible : pas seulement la mutation des supports et appareils, mais le contexte économique et politique. Jamais au contraire réel n’aura été aussi documenté que le nôtre. Nous constituons non seulement des bassins entiers de ressources qui sont la mémoire de notre temps, mais aussi les outils qui permettent de l’inventorier, de la requérir. Les travaux d’Olivier Ertzscheid et de Jean-Michel Salaun, parmi bien d’autres – et vrai que j’y passe plus de temps que dans la génétique textuelle –, témoignent de la richesse ici des réflexions. La mémoire dont il s’agit ici, c’est celle de l’espace clos du texte pendant sa gestation : effectivement, cet espace clos n’a plus de raison d’être. Mais c’est bien plus sur cette relation du texte à ce qui l’environne qu’il faut mener le travail. Orphelin, on l’est toujours : des morts de vingt ans massacrés en 14-18 comme de Desnos mort dans un camp, comme des humbles autour de notre enfance – et je ne sais pas si la littérature a jamais poussé ailleurs que dans ce manque, ce non-rattrapable.
Et un généticien comme Pierre-Marc de Biasi est forcément conscient des limites même de sa discipline : dans chaque livre de Henri Michaux se rejoue l’histoire de sa genèse, des accumulations versifiées, aux aphorismes et proverbes, puis aux fictions brèves, avant d’arriver au terme du parcours à la fiction construite. Chaque livre, en rejouant ce schéma (même si c’est dans Face aux verrous qu’il apparaît de la façon la plus lisible, nous force à considérer un seul concept : c’est la genèse du texte qui constitue le tete lui-même. Et lui seul, puisque la pièce blanche où travaillait Michaux ne comportait, en bout de table, qu’un broyeur à papier. On a typiquement, ici, l’évidence d’un auteur requérant, pour le mystère même de son oeuvre, sa disparition en tant que genèse. En quoi cela enlèverait quoi que ce soit à l’importance décisive de Michaux dans notre histoire littéraire, ou la façon dont il nous est à chacun vital, nécessaire ?
Reprenons le chantier : pour un nombre très restreint d’auteurs (ça ne concerne absolument pas Lautréamont, ça concerne très peu Rimbaud, ça va bientôt concerner Julien Gracq, mais certainement pas Christophe Tarkos), l’adéquation entre la forme terminale, le livre imprimé, et le matériau de la gestation, manuscrit, tapuscrit, épreuves, a permis de reconstituer un tracé temporel d’une forme déjà constituée pour son devenir-livre. Par exemple, ce schéma ne s’applique en rien aux manuscrits et journaux de Kafka, qui procédait par séries et récurrences de prises d’écriture sur un même thème.
Où est le travail préparatoire en amont de l’oeuvre littéraire ? Hasard si le moindre logiciel de traitement de texte propose des fonctions de gestion de projet ? La naissance de l’oeuvre littéraire, elle n’est pas dans le fichier texte qui représente ses phases successives de mise au propre. Elle est dans les requêtes de nos recherches web, dans Zotero où nous les archivons, dans le fichier parallèle où nous conservons ce que nous en recopions, dans les forums où nous intervenons sur les questions qui nous préoccupent pour ce projet. Elle est dans les textes, interventions, lectures, qui accompagnent l’écriture, en sont le laboratoire.
Le projet d’un travail littéraire, pour ce qui me concerne, c’est mon site lui-même. J’ai même besoin de cet éphémère, de ce sans trace : écrire en ligne, réfléchir à haute voix par un commentaire sur un site, participer à une écriture collective. Comme dans la musique et le film, l’ancien cloisonnement de métiers, manuscrit -> correction -> composition -> épreuves ->livre a fait place à une répartition différente des rôles.
L’écrivain contemporain n’a presque plus recours au papier : il écrit sur traitement de texte, corrige sur écran, envoie son roman ou son essai à son éditeur en pièce jointe, correspond par courriel ou texto. Et en changeant d’ordinateur, il perd ses données. Un paradoxe que pointe le généticien en chef de l’ITEM : « Nous n’avons jamais été aussi près d’avoir les moyens techniques de tout conserver, et dans le même temps, nous perdons tout en raison de la logique même de mémoire du disque dur : le système de ses anciennes unités de mémoire est écrasé au fur et à mesure de son utilisation et donc de saturation », explique-t-il.
On a certainement attendu que Pierre-Marc de Biasi sonne son tocsin pour commencer à penser à ces choses-là ! Bien sûr, c’est complexe, et cela relève en partie de la responsabilité publique. Mais c’est bourré de contre-sens.
D’abord, ouvrir les yeux. Cette récente publicité de Google en était le meilleur exemple : un quidam pose son ordinateur portable sur un parking, un 35 tonnes qui manoeuvre l’écrase. Nous stockons dans les nuages. Là aussi, quantité de questions lourdes, sur les serveurs (Google qui rachète d’anciennes plate-formes pétrolières pour stockage massif à refroidissement gratuit, nouveaux data-centre de Facebook). Sur tous les Mac, nous disposons de Time Machine : une sauvegarde incrémentielle, automatique, de l’ensemble des données de l’ordinateur. On dispose, avec DropBox, avec MobileMe, de ce même archivage en ligne, sans disposer nous-mêmes du support matériel de la sauvegarde.
Dans les universités, les petites unités pullulent, où ces questions sont évidemment prises en compte pour leur domaine précis de recherche – le centre d’archivage Décalq de René Audet en serait un des plus signifiants exemples.
Mais pour la langue française, on sait qu’un décret autorise la BNF à pratiquer un archivage web qui remplace le dépôt légal de l’imprimé. Une collecte annuelle générale, et des collectes régulières sur un ensemble de sites répartis par discipline. Ces archives, complétées du rachat des années 1996-2002 d’archive.org, la puissance publique s’engage précisément à ce que les outils d’interprétation et déchiffrage les rende pérenne. Je ne dis pas que ce soit simple, je rappelle juste que c’est un des champs de réflexion et qu’un outil majeur – le robot Heritrix – est déjà en place. Seulement, cela replace au premier plan ces frontières entre archives privées et accès public, et le fait que le web en lui-même est devenu cette archive de création : pour nous qui pratiquons la blogosphère, certainement une expérience en soi bien plus riche que tout ce que nous pouvons individuellement stocker.
Il prend du risque, ici, Pierre Assouline. Passons sur le fait de faire croire que les écrivains sont tellement plus manches que les autres, qu’ils ne savent pas sauvegarder le manuscrit en cours. Dans un micro-monde culturel qui pousse les hauts cris dès qu’on murmure que le droit d’auteur peut être soumis à évolution, voilà qu’on nous suggère que notre oeuvre même, globalement, se résout à un dépôt gratuit. Moi je serais prêt à ce qu’une généreuse fac américaine (ce n’est pas que les facs françaises soient si pauvres, c’est plutôt que le web n’y a pas pénétré, du moins chez les profs à un degré de – quoi, 2% ? soyons large dans l’estimation...) me propose de me rémunérer moyennant un accès à ma DropBox ou le mot de passe de mon MobileMe, ou même, chaque 24 décembre, l’envoi d’un disque dur de 500 Go acheté au supermarché du coin, et contenant l’ensemble de mes photos, de mes textes, de mes calepins virtuels, la base de donnée de mon site s’ils veulent – pour mon twitter ou mon facebook, le flux rss est libre. En tout cas, pour l’instant, pas constaté que personne ni aucune institution ne m’ait proposé ce genre de deal.
Bien sûr, moi-même, depuis 1992 passage de l’Atari au Mac j’ai sauvegardé à peu près tous mes fichiers, articles, et j’ai cessé en 2000 de tenir le registre de ma propre bibliographie : mon site, y compris en ce qu’il n’inclut pas, constituant ma bibliographie exclusive et exhaustive. Par contre, j’ai sur le web des espaces privés, qui me servent de stockage et d’expérimentation – là, pas d’accès aux robots d’archivage. Je note aussi que moi-même, contrairement à l’idée de P-M DB, je ne vide pas mon ordinateur de ses archives : j’ai mis longtemps à m’y résoudre, mais depuis 2007 environ j’utilise mon logiciel mail (Entourage, du coup j’y suis enfermé) comme archive de fichiers reçus, correspondances (notamment avec auteurs publie.net ou quelques correspondants suivis) – la base de données de mon logiciel mail devant ainsi une base de ressources incluant pièces jointes, time line d’événements publics, constructions de projets (lorsque je veux savoir ce que je faisais tel jour, ou bien quelle jour, mois, année, je suis allé à Cherbourg ou Toulouse, c’est le calendrier de ma boîte mail qui seul me le permet).
Ainsi, les 2500 et quelques mails échangés ces 3 ans avec l’Immatériel-fr sont comme une micro-histoire de l’édition numérique – je la garde pour moi. Idem pour échanges avec amis auteurs ou quelques blogueurs de référence. Institution ou mécène intéressés à l’archiver ou l’étudier ? Pourquoi pas, mais ce ne sera pas gratuit (allez, on fait le deal : l’intégralité de mes textes, e-mails, photographies de l’année moyennant abonnement résiliable de 2400 euros/an TTC, livraison sur disque dur externe, port compris, et lettre confirmant non exploitation commerciale ni utilisation publique pendant durée de la propriété intellectuelle internationale ?).
Ce logiciel, il existe depuis longtemps : c’est Genèse, développé par l’AFL, on s’en était intensivement servi lors de l’exposition Brouillons d’écrivains à la BNF, en 2000. Mais ce n’est pas grave de refaire l’histoire tous les dix ans.
Pour ma part, j’avais fait l’expérience suivante : prendre 5 pages d’Espèces d’Espaces, et les recopier en notant tout ce qui me passait par la tête, associations, gamberges, réactions. Puis, au bout de ces quelques heures de recopie, j’avais effacées une à une mes interventions, mais par catégories successives. J’obtenais donc exactement le texte de Perec, sauf que les 5 pages en contenaient 40.
Mais quel intérêt ? Il fallait travailler sur une machine spécifique, pas du tout dans le rapport d’intimité que j’ai avec la mienne. Et puis il ne s’agissait que de l’histoire interne d’un fichier : alors que notre utilisation du web, ce qu’on peut nommer écriture numérique, c’est un ensemble bien plus diffus, où figureraient un tel billet, les commentaires qui l’accompagneront, ceux que j’ai pu déposer chez Hubert Guillaud ou d’autres travaillant sur des domaines proches, mes propres ateliers d’écriture à partir d’Espèces d’Espaces, et à la BNF même, pas seulement les manuscrits, mais cette rencontre vidéo avec Paulette Perec, ou les chemins piétons dans la ville de Jacques Roubaud et bien d’autres choses. Si à SciencesPo je parle de Michaux, Artaud ou Cortazar, les ressources film de YouTube, Ina, UbuWeb feront partie de mes prescriptions autant que le livre : ce n’est pas le web qui les apporte, c’est juste que le filtre de l’imprimerie n’est plus nécessaire pour la transmission.
Enfin, courage à l’ITEM, dans 2 ans ce sera vraiment encore plus d’actualité !
Et si c’était cela qui avait effectivement basculé – de même que c’est l’intervention web de Pierre Assouline qui a repris le rôle anciennement dévolu au Feuilleton du Monde des Livres : « l’écrivain » n’est pas une catégorie si facilement identifiable. Née au 17e siècle (Viala), fétichisée au 19e (Chartier), le destin de la maison de Gracq est bien emblématique de cette position fausse. Lui, Louis Poirier dit Julien Gracq, a choisi l’incinération, pas de tombe. Il a légué sa maison à la collectivité (et le bâtiment longtemps louée à la gendarmerie du canton, revenu probablement plus certain que les droits d’auteurs), mais ses légataires l’ont vidée du moindre bout de papier, meuble, fauteuil. Ce dont nous avons à faire mémoire, ce n’est pas de l’oeuvre, c’est du monde. Si cette rencontre de l’oeuvre et du monde fait mémoire, tant mieux. Mais nous vivons depuis si longtemps dans les terribles manques de cette relation. Ce que nous jugeons indispensable de transmettre, peut-être simplement que ce n’est pas ce qui concerne notre regard dans la glace, et nos cartons de vieilles lettres : le goût de lire, le goût de s’aventurer par l’écriture dans le présent, le goût de se mettre en travail, par le regard, par l’écriture – précisément ce qu’on a fait ce semestre, chaque mardi à 10h. Mais justement : oui, peut-être que ce site, en assume les fonctions.
Encore faut-il que les auteurs acceptent de prendre en main leur identité numérique. Problème de formation ? Probablement. Ça s’assume. Pendant que la plupart des Centres régionaux du livre s’épuisent en journées d’études et comités de réflexion lente, celui de la région Centre m’a proposé plusieurs fois des stages de 2 jours où on apprend – auteurs, blogueurs, bibliothécaires, éditeurs, médiateurs – à s’emparer de ces outils et y écrire. Problème de génération ? Voir Michel Chaillou. Risque ? Oui, risque. Que ceux qui surgissent avec blog et écriture, ceux qui de toute façon auraient pris le relais dans l’édition classique il y a 15 ans, se superposent à un monde susceptible de disparaître très vite : justement parce que, écrivain, ce n’est en rien un statut garanti à vie. Quant aux paperoles de Proust, aux rugissements de Flaubert, pas de problème, le web les accueille comme il respire.
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne et dernière modification le 22 avril 2011
merci aux 4868 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page