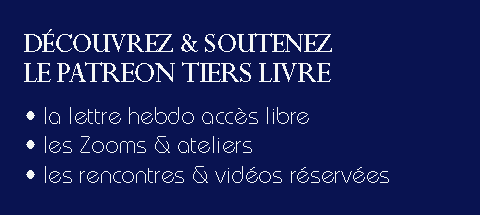via Ginsberg et Steinbeck, Malt Olbren propose un exercice pour que le texte réalisé interagisse sur les éléments qui le composent, et que chacun ait son exacte et nécessaire fonction dans la marche narrative
sommaire général.
Vous commencez à connaître Malt Olbren et comment il s’y prend : jamais tout droit.
Mais aujourd’hui, il s’agit précisément d’un exercice pour aller droit.
L’axiome sera donc : ne pas aller droit, pour aller tout droit.
Développons mathématiquement cette proposition concise mais abstruse.
Il y a plusieurs manières, quand vous êtes en voiture, d’aller tout droit. La première est toute simple : emprunter une route droite. Le problème, c’est qu’en littérature elles sont monotones. Gros livres pour l’été, rayon romance et malheurs d’amour, nous on s’y ennuie terriblement.
Restons donc en voiture, mais empruntons L’automobile verte du cher Ginsberg (NdT : « The Green Automobile », dans les Reality Sandwiches), une page seulement :
roaring across the City & County Building lawn which catches the pure emerald flame
streaming in the wake of our auto.
The time we’ll buy up the city !
I cashed a great check in my skull bank
to found a miraculous college of the body
up to the bus terminal roof
But first we’ll drive the stations of downtown,
poolhall flophouse jazzjoint jail
whorehouse down Folsom
to the darkest alley of Larimer
paying respect to Denver’s father
los on the railroad tracks,
stupor of wine and silence
hallowing the slum of his decades,
salute him and his saintly suitcase
of dark muscatel, drink
and smash the sweet bottles
on Diesels in allegiance.
Then we go driving drunk on boulevards
where armies march and still parade
staggering under the invisible
banner of Reality –
hurling through the street
in the auto of our fate
we share an archangelic cigarette
and tell each others’ fortune
Avec la poésie, me direz-vous, la leçon est plus simple, mais c’est qu’ici on nous fait au plus simplement leçon : la netteté, chers amis, la netteté prime. Et si nous sommes en poésie, accueilli par cher Allen Ginsberg, son vocabulaire est celui du jour banal, et des objets qui nous traînent, pot d’échappement sur une pelouse, le vin et les voies ferrées, un cigarette partagée.
Ce que je prétends, c’est que la netteté ici, parce qu’il y a une voiture et son chemin dans la ville, tient évidemment à la non-répétition des éléments. On dit tout chaque fois de ce qui doit ici être dit. Et, symétriquement, s’en va tout ce qui n’interfèrerait pas avec l’ensemble des éléments, dans une relation chaque fois nécessaire et unique.
Alors comment procéder, de façon fractale et pour notre humble art du roman (mais consolez-vous, aucun poète qui ne rêve d’en disposer s’il le pouvait), pour que la même loi de composition vaille un pour la phrase, deux pour la séquence ou le chapitre, trois pour le livre entier.
Réconfort, c’est notre arme : jamais de livre qui ne soit en entier dans un de ses chapitres ni tout entier dans chacune de ses phrases.
Et bien sûr la rançon inverse : un livre qui ne serait qu’une notice de montage, suite chronologique d’instructions, pourrait-il exister comme livre ? Oui, probablement, si on récite la double construction du Temple dans Exode. Oui, probablement, lorsque Julio Cortàzar, que nous avons bien eu tort de chasser en Europe, écrit ses Instructions pour remonter une montre, ou ses Instructions pour monter un escalier.
Vous saurez toujours où vous trichez : la notion même de littérature est dans cet écart, dans la flamme émeraude, pure emerald flame, et dans l’imprévu qu’est l’adjectif sweet accouplé à bottle, ô dive et douce bouteille de nos hypallages. Mais le lieu même où la phrase n’est que l’expression poétique qui fabrique la distance, le reflet, l’écart, ce miroitement même entre dans la composition et génère la cohésion. Il est pris dans le rythme et ne le dévie pas.
Quelle serait alors la proposition d’écriture ? J’y vois un accomplissement, quelque chose qui en est le résultat, et non la progression : lorsque le texte est fini, qu’il soit en vous-même une carte. Et mieux, dessinez-la. Que chaque phrase, chaque paragraphe ait sa fonction unique dans l’économie du texte. Si c’est une diversion, une ouverture potentielle vers autre chose, ou bien une impasse, un resserrement, ou que cela ne contribue pas à l’économie narrative : danger. Je ne veux pas dire qu’il s’agisse de suite de supprimer. Un Européen ne supprimerait pas, un Américain oui. Soyez parfois mauvais Américain. Il n’y aurait pas Faulkner si nous supprimions de Faulkner ce qui ne contribue pas à la marche imparable du texte. Lui, il l’écrit par la négative, mais c’est cette Amérique négative qui nous prend. Chez Lord Steinbeck, ce sera le contraire :
Les Raisins de la colère, quatrième paragraphe du livre. Exercice à faire sur n’importe quel paragraphe. Ni action ni personnage, on peut se permettre, voir septième paragraphe :
Temps qui passe, couleur et hurlement intérieur des mots associés à ce mouvement du jour sans jour. On a le droit, on écrit en dehors du mouvement du livre, mais ce qu’on dresse est encore le livre, est ce qui constitue l’écriture comme livre.
Vous savez que mon séminaire comporte des séances rédaction et des séances construction. Aujourd’hui nous sommes en construction. Le travail se fera en binôme. Vous confiez votre texte, j’aimerais qu’il s’agisse d’un moment narratif, trois ou cinq pages, jusqu’à douze ou quinze, pensez à la survie de votre compagnon provisoire de galère littéraire. Et c’est l’autre qui va cartographier votre texte.
Indices :
— de quel ordre est le rapport que chaque phrase prise isolément entretient avec la séquence que vous tenez dans les mains ? Narratif, descriptif, digressif, poétique, dialogique, onirique, mental, abstrait, délirant, figuratif, informatif, retour sur soi du narrateur ;
— quel est, pour chaque phrase ou chaque élément de phrase considéré, l’indice (notez sur 10) de satisfaction client (customer care) de cette phrase ou cet élément considéré, par rapport à la fonction ci-dessus évoquée ?
— quel est, pour chaque phrase ou chaque élément de phrase considéré, l’indice (notes sur 10) marquant l’importance de cet élément précis par rapport à l’économie globale du texte que vous avez dans les mains ?
Bien sûr, quiconque ici serait pris à tenir un compte d’apothicaire aves des chiffres perdrait beaucoup de ma propre considération. Mais pensez couleur : mentalement (ou avec vos feutres et crayons) mettez du rouge du jaune du bleu du vert. L’écriture est tellement plus belle, en couleurs.
Maintenant prenez le texte de votre collègue entre vos mains, levez au-dessus de la tête, secouez fort. Il va tomber de la poussière. Il va y avoir des alvéoles, des recoins d’éponge à presser, au jus à vite essorer.
Vous décrit-on les personnages, sous le nuage menaçant ? Non, mais ils ont humecté leur doigt de salive et le tendent vers le ciel. Obéit-on à l’économie réaliste d’une période en grande trouble humain ? Non, mais on vous montre un soleil qui n’est qu’un trait mince dans le gris.
Après, échangez. Vous faites part à votre collègue de l’audit réalisé, et réciproquement. Point par point. Ce qui va, ce qui ne pas, ce qui tombe, et – surtout des surtout –, ce qui désigne et appelle une image non écrite encore, et qui scellera le durcissement du texte.
Vous êtes seul chez vous et sans binôme ? Faites l’exercice avec maître Steinbeck, ouvrez n’importe quel de ses livres pendant vingt minutes, et traitez un chapitre de quatre pages. Et puis revenez à votre texte, écoutez juste ce qu’il a à vous en dire.
Mais attention : « Cours tout droit Billie » c’est un principe qui définit à lui seul notre littérature américaine – jamais d’élément redondant, pris à échelle de la phrase, qui ne soit en rapport énonçable (NdT : cette belle expression de Gilles Deleuze me semble correspondre au plus exact à ce qu’entend ici Malt Olbren par expressed settlement) avec l’économie tout entière du livre. Un élément de récit dont le livre n’ait pas besoin, et le livre tombe tout entier. Mais cette nécessité de chaque élément à l’économie du livre pris globalement n’est pas le préalable à l’écriture, elle ne se définit pas dans le scénario (j’allais dire : et non plus pour nos collègues de l’écriture cinématographique). Elle se définit comme l’action réciproque, rétrospective, de la globalité du texte sur les éléments qui l’ont constitué comme tel.
C’est un travail à rebours, qui exclut, mais aussi qui radicalise, pousse, appelle. La tonalité de ce ciel dans le jour sans jour, septième paragraphe de Grapes of wrath, John Steinbeck l’a-t-il vue en rédigeant son premier chapitre, ou lui a-t-elle été enseignée par le mouvement du livre en se détachant de lui-même, et exigeant alors, rétrospectivement (in retrospect) d’être inscrite là, presque dès le frontispice ? À vous d’y aller voir.
Contradiction permanente : un premier jet ne s’annule pas, et définit l’ambition. Pas de livre sans la manifestation d’emblée de son intuition. Mais c’est le livre ensuite qui agit sur sa forme et l’enfle et en chasse ce qui l’affaiblit. Si aujourd’hui vous travaillerez à deux, pour avoir moins peur, vous aurez toujours à trancher dans ce qui ne se décrète pas : la maladresse même de ce qui s’écrit comme condition pour que le livre enfle et s’avance, et pourtant qu’elle soit niée à son terme.
N’empêche que c’est comme ça qu’un livre va droit : « Cours tout droit Billie ».
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne 7 janvier 2014 et dernière modification le 11 avril 2014
merci aux 1727 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page