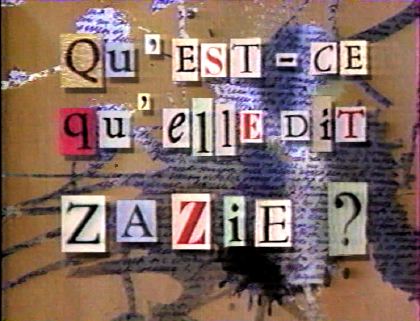
du temps que la télévision devenait création littéraire en direct
Toujours le même émerveillement à écouter les copains. Ces 26’ de 1998... Je transfère cette vidéo sur YouTube, désolé de la mauvaise qualité. J’espère qu’un jour les producteurs (quelle reconnaissance leur avoir...) le feront depuis l’originale...
Note du 30 août 2010
Le lien vers la vidéo était HS depuis fin mai, merci MS me l’avoir signalé. Du coup, en ces temps de rentrée littéraire, et pour saluer le nouveau livre de Jean Échenoz, Des éclairs, on repasse en Une. Ça ne peut pas faire de mal.
A noter que Belin a arrêté la collection signalée ci-dessous, mais – message spécial Dominique Viart – est-ce que justement ce n’est pas le signe qu’il aurait mieux valu de suite faire confiance à Internet ? Vieux débat, tandis que l’université ronronne au lointain...
à propos de cette vidéo, et quelques livres autour
23 avril 2008 : mise en ligne en mai 2007, cette reprise de Qu’est-ce qu’elle dit Zazie ? vient de passer les 3000 visionnages sur Tiers Livre... Trois des protagonistes de l’émission figurent parmi les auteurs choisis dans la collection Ecrivains au présent que publie Dominique Viart chez Bordas, façon de prolonger le lien. Lire pour commencer, dans Etudes françaises Pascal Quignard, le noyau incommunicable par Dominique Rabaté (ci-dessous un hommage personnel de fin 2002 au Dernier Royaume [1] ). Le texte de Rabaté est une dérive, une méditation, où Quignard sert juste de déstabilisateur : reste qu’à chaque fois qu’on croit s’être égaré, on découvre être encore face à un recoin particulier de son travail multiforme, et que c’est précisément de cette subversion-là qu’il est question. Pour l’approche théorique de Dominique Viart, lire sur publie.net : Quel projet pour la littérature contemporaine ?...
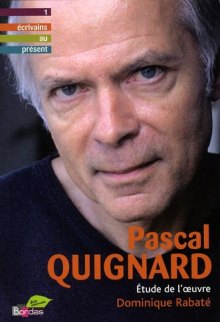
Ou bien, pour l’approche d’Echenoz, mon propre texte Danseurs fragiles de Jean Echenoz, complété par un de mes grands succès depuis que les requêtes Google genre apprendre la lévitation, rêver à la lévitation, pratiquer la lévitation mènent tout droit à De la lévitation, encore à propos de Jean Echenoz, avec preuve photographique.
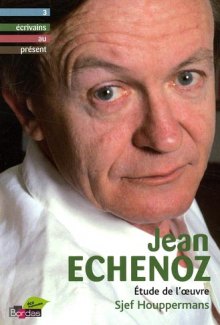
Mais tant que vous y êtes, pour découvrir cette suite de livres qui est bien plus une approche personnelle des essayistes sous apparence de manuel scolaire, lisez Dominique Viart interprétant ma biographie sans oser me demander ce qui est vrai et pas vrai, vous apprendrez plein de choses sur les plate-formes pétrolières... Plus sérieusement, et parce que je ne suis pas évidemment en position de juge, dire que j’ai vraiment apprécié la façon dont Dominique organise le livre, la façon dont il détermine les titres et sous-titres de l’ensemble. Tout d’un coup, ça se met à travailler autrement. Et qu’il se risque aussi à quelques incursions dans mes amitiés privées, mais celles qui comptent dans le tous les jours de ce travail, comme avec Pierre Bergounioux et Antoine Emaz. Qu’il a même mis le bras pour cela dans la pieuvre Internet, puisque telle est désormais mon occupation principale. Viart avait sans doute autant la trouille que moi, ne m’ayant rien demandé tout au long, quand j’ai reçu le livre imprimé...
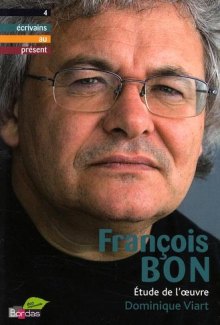
Et n’hésitez pas, chez votre libraire ou dans vos Fnac, à bien mettre ces 4 livres en évidence – puisqu’il y a aussi Annie Ernaux –, sur le dessus des piles ou en avant.
Enfin, et parce qu’il n’y pas de pertinence Internet sans mise à disposition de véritables contenus (axiome dont on discutait hier, Dominique !), pour remercier et appuyer, voici un texte plusieurs fois cité par Dominique Viart dans son étude de l’oeuvre, et que j’intitule paradoxalement, ou pour prolonger l’esprit de contradiction qui préside à nos échanges depuis bientôt 15 ans : Pas besoin de la notion d’oeuvre. Il s’agit de l’entretien le plus complet dont il m’ait été donné de bénéficier, avec Thierry Hesse, et publié par lui-même en mars 2004 dans la revue L’Animal (dans dossier incluant plusieurs hommages amicaux, Goux, Salvayre, Kaplan, Bergounioux... et deux inédits : mes notes sur Balzac et, avc Jérôme Schlomoff, Hoboken plan fixe. Voici ces 40 pages d’entretien, matière brute – avec, à la fin, son hommage à Charlie Watts que j’assume parfaitement aujourd’hui encore !
Qu’est-ce qu’elle dit Zazie : du temps que la télévision supportait la littérature (un peu de)
C’était en 1998. L’émission Qu’est-ce qu’elle dit Zazie ?, créée par Jean-Michel Mariou, avait d’abord été la rubrique littéraire des actualités FR3 Île-de-France. L’émission était devenue nationale, et promenée de ci de là dans les horaires. Mariou non seulement faisait appel aux meilleurs critiques (voir ici Harang et Lebrun), mais nous confiait à nous-mêmes, auteurs, la possibilité de fabriquer des films : ce que j’ai fait avec Stéphane Gatti à partir d’un atelier d’écriture en collège à Bobigny.
Déjà, à l’époque, Mariou considérait son émission comme un îlot, la télévision publique ne cherchant pas à s’embarrasser de création contemporaine. Cet îlot, nous, on estimait en avoir vitalement besoin : non pas pour médiatisation ou service après-vente des livres, mais simplement pour ce dialogue avec l’image. Je me souviens d’avoir laissé un jour Jean-Baptiste Harang entrer chez moi avec sa caméra, et me faire commenter les livres de ma bibliothèque, et pourquoi triés comme ça : c’était en 12 minutes, il a fait ça avec d’autres, et le mien a au moins été diffusé 5 fois, repris sur d’autres chaînes : pourquoi on aime tant Julien Gracq ? Une autre fois, ils m’avaient convoqué au Jardin des Plantes pour que je fasse écho, sans préparation, au livre éponyme de Claude Simon : comment je l’avais lu, qu’est-ce que j’y avais trouvé.
Je ne sais plus comment l’idée leur était venue : le même soir, ils intervieweraient 5 auteurs, donc en simultané, mais chacun en lieu et situation différentes. Chez Jean Echenoz, Jean-Baptiste Harang cuisine une soupe de légumes et ils dînent à 3, Echenoz, Michon et lui, quelques bouteilles au milieu. Bergounioux mis dans un train de nuit, le vieux Corail Orléans-Paris, la ligne qui mène à sa vieille Corrèze, et lui il suffit de le laisser parler seul. Quignard sobre : fond neutre, chaise et parole. Pour moi, dialogue avec Jean-Claude Lebrun dans la librairie Folie d’Encre à Montreuil (l’ancienne).
Les nouveaux malfaiteurs avaient-ils mis en sous-titre : je mets cette archive en ligne, d’une part parce qu’on cause encore des mêmes questions — voir les journées de la Villa Gillet en juin (où aucun de nous 5 n’est invité d’ailleurs, c’est bien, passons le relais). Mais d’autre part pour cette liberté que Jean-Michel Mariou et son complice José Chidlovsky nous permettaient dans un petit coin de lucarne publique, et c’était encore trop semble-t-il. A l’heure des YouTuberies, qu’on ne nous évince pas trop vite du chemin.
Enfin, pour le plaisir que j’ai chaque fois de revoir la bonne trogne de mes amis. Et c’est dans cette émission que JBH avait lâché son « On l’a compris, Michon c’est le patron » devenu vaguement historique entre nous... Mais tout ce qu’il dit, le Pierre, est de majesté (« L’art est rare... »). A part ça, qu’en 10 ans on ne soit pas arrangé ni les uns ni les autres, on fera l’effort de passer.
Ici sur Tiers Livre, à propos de Michon, d’Echenoz (ou ici), de Bergounioux...
Merci à David Farreny pour la transcription DVD (j’ai quelques cassettes comme ça dans un fond d’armoire, mais je sais jamais trop comment faire).
[1]
François Bon | Ce sont des cercles qu’on roule dans la nuit
à propos de Pascal Quignard, texte publié dans Les Inrockuptibles
C’est de la fonction même du livre qu’il est question. De comment cela vous décortique. Des lectures qui vous enclosent, comme, dans un temps qu’on parviendrait à suspendre – et c’est affaire de nuit, d’isolement, de cassure –, on aurait prise sur le mental un instant accessible .
Il s’agit de faire retour. La littérature depuis toujours nourrit dans son ventre ces objets silencieusement aspirants, qui supposent de briser provisoirement d’avec le dehors pour s’y absorber, parce que c’est du temps et du mental qu’il faut traiter. On a tous ici quelques-unes de nos dettes principales. Parfois pour des démarches qui se présentent objectivement comme cet ouvert : la fascination qu’on a à Montaigne, le goût qu’on prend à sa fréquentation, c’est cette paix en travail, le doute élargi aux perceptions, l’interrogation sur soi ouverte. La fascination à Montaigne, c’est cette suite de cercles concentriques, avec ses reprises, compléments, additions, son élargissement sans clôture. On a eu parfois cette même fascination là où on ne l’attendait pas forcément : je pense au Déclin de l’Occident de Spengler, ou bien à la correspondance échangée par Walter Benjamin et Theodor Adorno, qui avaient assez de compte à régler entre eux deux pour ne pas se préoccuper de ce que nous en penserions plus tard. Parmi ces livres du rendez-vous intérieur, les fiches des Carnets de Valéry, que j’ai longtemps lus – je ne saurais pas expliquer pourquoi – uniquement le dimanche matin, si tristes lorsqu’elles sont classées dans l’ordre et par thèmes, si vivantes dans leur accumulation brute, juste ponctuées de tirets.
Les trois livres que Pascal Quignard nous présente comme le début d’une série ouverte s’inscrivent exactement là, et il faut un beau culot. Pas seulement de l’ambition. Mais ce que cela exige de soi-même, s’il ne saurait plus y avoir de retour sans tout perdre.
Non pas qu’on doute a priori : si l’un d’entre nous pouvait avoir cette moelle, cette épaisseur, c’était lui. Une phrase, d’abord. Ce qui ne signifie pas un style ou une marque, mais plutôt le contraire : capacité de la langue au risque, à se risquer hors du sûr et de l’éclat, quitte à casser ou mordre la terre. Qu’on le voie au travail, Quignard, dans ces moments où la langue mord, presque naïve, avec des comptes et des listes. Puis s’agglutinant par tirets, répétant son incantation, tentant l’écart en revenant au sexe, ou bien s’en allant chercher le mot sur lequel on bute dans l’ancien japonais ou l’Inuit (pourquoi autrefois se dit mukashi en ancien japonais, et qu’ancien se dit anga en Inuit), puis soudain l’écluse s’ouvre. Et ce que Quignard ramène alors à la langue a su capter un peu de ces « Abîmes » qui font le titre du troisième volume, le plus puissant et le plus risqué, s’il y a déjà trouvé, plus que dans les deux précédents, son amble, son inertie.
Alors, oui, la récompense c’est que la littérature s’agrandit, non pas comme d’un territoire supplémentaire, mais de son emprise en ce qui depuis toujours est son centre, son énigme, puisque ce mot est un des guides privilégiés sur cette route. Emprise qui touche à notre compréhension du monde, dans l’éclatement neuf du temps à quoi nous contraignent les énonceurs nouveaux de la matière ou des paradoxes de l’univers : « objet fermé sans bord ni frontière », nous dit la physique. « Il faut faire vivre le vivant signifie : Il faut faire mourir les morts. Ce sont des cercles qu’on roule dans la nuit. La mort est finie dans le temps comme la retombée de la ligne verticale du sexe dressé qui lui donne naissance. Le temps est fini et circulaire comme le soleil » écrira Quignard dans le tremblement où il affronte main après main ce qui résiste et outre la langue, en amont de ce qu’elle nomme.
On le savait dans le retrait. On l’imaginait avec ses livres. On le retrouve arpentant des ruines en Afrique, contemplant la mer en tel lieu sauvage du Japon, interrogeant d’anciens rites funéraires comme on exhumerait un crâne. On le croyait relisant ses opuscules latins préférés, on l’aperçoit laissant le livre à terre, dans le crépuscule inchangé d’une maison vers Auxerre avec guêpes et rivière, aux franges de la vieille sorcellerie rurale. On avait l’idée naïve d’une posture d’ermite, mais l’interrogation du cru – sexe, blessure et mort – est le plus redondant de cette reprise sans fin. S’il y a trois livres plutôt qu’un seul, c’est qu’on ne s’affiche pas dans cette volonté d’oeuvre ouverte, questionnement nu du mental, sans savoir si on résistera. Si la paroi (encore un mot à lui, quand on cherche l’énigme) n’est pas là dans l’ombre plus haute que vos doigts. On ne se poste pas sans risque dans cette postérité, où Montaigne, avec ce laisser-aller de génie, titre « Des coches » la dérive qui l’amènera au plus vif du cerveau ouvert.
Eh bien Quignard a tenu, c’est d’évidence. J’ai palpé d’abord ces trois livres avec une résistance intérieure : ce rêve du retrait, de l’examen du tout, l’énigme immédiatement devant soi, c’est une pulsion qu’on porte chacun, sinon qui on est ? Et cela repousse loin en bas toute idée de littérature qui ne serait que divertissement. Le livre qui vous emportera à votre bout. Qui traîne depuis des années son Montaigne écorné sait.
Quignard, pour tenir là, devait trouver ce qui le séparait de ses prédécesseurs, comme Maurice Blanchot se donne cette contrainte de n’aborder énigme, temps et mort qu’à travers les livres qui lui en fournissent déjà image. Quignard a cette révolution toute impalpable d’accepter, dans l’examen rigoureux de temps et de mort qui est le vieux lot repris, la dérive de fiction. Le statut des reprises est inclassable. On est contre la paroi, on s’y agrippe mais on ne trouve pas de passe supplémentaire, alors on invente une histoire. Parce que l’énigme est vraie, l’histoire se présente comme vraie. Nous n’en saurons jamais le statut ultime. Je n’irai pas vérifier si Zenchiku, auteur de nô et beau-fils de Zeami, mort en 1470 a laissé un écrit dont l’incipit est « Quand le cœur des morts nous étrangle ». Mais le cercle de Quignard se tend ici, où la fascination pour la lecture, qui ouvre « Des Ombres errantes », devient indissoluble de cette énigme dont on traite, faite de temps et de mort, et contre laquelle on a seulement notre corps doublement sexué.
On ne met pas sur la place publique une telle démarche sans en avoir franchi soi-même les premières marches intérieures. Trois marches. Où va maintenant Quignard, il a assez de territoire pour tenir. « Des Ombres errantes » en franchit les premières passes, travail sur le chasseur, sur la notion d’image, sur celles de frontières. Il reste le Temps : « Sur le Jadis » en balaye les formes à subvertir. Dans « Abîmes » enfin on se confronte à la peur, à la violence, à la nuit. On peut rejoindre Quignard directement ici, et faire ensuite le chemin à rebours. Qu’il prenne son temps pour le quatrième, on a de quoi réfléchir et rêver. Que notre confiance lui soit favorable, en ce chemin où il va seul, entre chamans et légendes. Qu’il ne se retourne pas.
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne 23 avril 2008 et dernière modification le 1er mai 2015
merci aux 24860 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page

